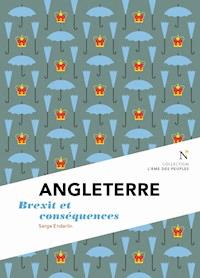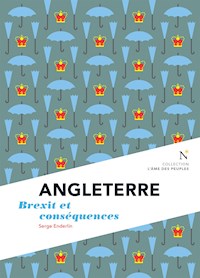
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Pourquoi le Brexit? Que signifie-t-il pour l'avenir de l'Angleterre?
Le Brexit est un divorce qui n’en finira jamais. L’Angleterre sort profondément changée de cette séparation chaotique avec l’Union européenne. Il ne s’agit pas, ici, de revenir sur les tribulations de son Premier ministre Boris Johnson. Il s’agit de s’interroger sur ce qui restera demain de cette nation anglaise, forgée par le long règne d’Elizabeth II. Serge Enderlin a passé des années à raconter l’Angleterre qui, aux côtés de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, forme le Royaume-Uni. Il a appris a en mesurer les excès si flegmatiques et les colères plus indomptables qu’on ne le croit sur le continent. L’Angleterre est persuadée d’avoir un avenir. Elle le proclame. Elle en fait même un argument commercial. Mais redevenue insulaire, la voici seule face à son destin. La force de ce petit livre est d’en tracer avec talent les contours et de tenter de démêler le vrai du faux.
Un grand récit suivi d’entretiens avec Norman Davies et Jon Henley.
Un voyage historique, culturel et linguistique pour comprendre l'Angleterre et ses habitants.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Reporter à la Radio Télévision Suisse, Serge Enderlin a été correspondant du quotidien Le Temps à Londres, de 1998à 2003. Passionné par le destin des îles Britanniques aujourd’hui soumises à rude épreuve, il a voulu comprendre ce que le Brexit dit de l’âme des Anglais.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
L’ÂME DES PEUPLES
Une collection dirigée par Richard Werly
Signés par des journalistes ou écrivains de renom, fins connaisseurs des pays, métropoles et régions sur lesquels ils ont choisi d’écrire, les livres de la collection L’âme des peuples ouvrent grandes les portes de l’histoire, des cultures, des religions et des réalités socio-économiques que les guides touristiques ne font qu’entrouvrir.
Ponctués d’entretiens avec de grands intellectuels rencontrés sur place, ces riches récits de voyage se veulent le compagnon idéal du lecteur désireux de dépasser les clichés et de se faire une idée juste des destinations visitées. Une rencontre littéraire intime, enrichissante et remplie d’informations inédites.
Précédemment basé à Bruxelles, Genève, Tokyo et Bangkok, Richard Werly est le correspondant permanent à Paris et Bruxelles du quotidien suisse Le Temps.
Retrouvez et suivez L’âme des peuples sur
www.editionsnevicata.be
@amedespeuples
À Victor, Octave, Romane
« This royal throne of kings, this sceptred isle, This earth of Majesty, this seat of Mars, This other Eden, demi-paradise ; This fortress built by Nature for herself, Against infection and the hand of war, This happy breed of men, this little world, This precious stone set in the silver sea, Which serves it in the office of a wall, Or as a moat defensive to a house, Against the envy of less happier lands ; This blessed plot, this earth, this realm, this England, This nurse, this teeming womb of royal kings, Fear’d by their breed, and famous by their birth. »
« Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves, that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, This was their finest hour. » Winston Churchill, 18 juin 1940, devant la Chambre des Communes
« Today, therefore, I am writing to give effect to the democratic decision of the people of the United Kingdom. I hereby notify the European Council in accordance with Article 50 (2) of the Treaty on European Union of the United Kingdom’s intention to withdraw from the European Union. » Theresa May, 29 mars 2017, dans une lettre officielle au président du Conseil européen, Donald Tusk
Carte
AVANT-PROPOS Pourquoi l’Angleterre ?
Il est grand temps de s’intéresser aux Anglais. Ne serait-ce que parce qu’ils sont entrés dans une phase d’introspection inédite et profonde, qui ne manque pas de susciter notre étonnement. Quoi, ce pays historique, cette puissance tutélaire, serait, elle aussi, en proie au doute existentiel ? Convenons d’abord d’une convention. Il faut désormais dissocier mentalement l’Angleterre du pays avec lequel on la confond sans cesse, le « Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », plus connu sous le nom de Royaume-Uni. D’un côté, un peuple. De l’autre, une union politique entre quatre nations des Îles Britanniques : Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Mais avec le séisme du Brexit, plébiscité par les Anglais le 23 juin 2016, mais pas par les autres nations britanniques, cette union est en danger. Encore davantage depuis la sortie irrémédiable du pays de l’Union européenne, le 31 janvier 2020 à minuit. Pour la première fois depuis 1707, l’Angleterre redevient malgré elle un sujet. Pas encore un sujet de droit, en tout cas un véritable sujet de discussion.
Sera-t-elle un jour un nouvel État indépendant sur la scène européenne ? À quoi ressemblerait-il ? Peut-on imaginer l’Angleterre sans ses marges celtes, ce « reste » auquel nous l’avons toujours associée ? C’est à cet exercice que je vous convie, pour tenter de comprendre qui sont au fond les Anglais. La question est d’autant plus sensible qu’eux-mêmes ne disposent pas forcément de la réponse ! C’est ce que démontre notre voyage sur des terres attirantes, parfois décaties, parfois vraiment sinistrées, parfois immensément riches. C’est ce qu’illustre notre parcours à travers un territoire de taille modeste, de Londres, au sud, à la région de Newcastle, au nord-est.
Mais quel est le sujet de ce livre ? En préambule, livrons-nous pêle-mêle à la figure de style du name dropping. Les Beatles, Big Ben, Manchester United, la Mini, le fish n’chips, easyJet, Harry Potter, la Worcestershire Sauce, Darwin, la conduite à gauche, Cambridge, le sandwich, David Bowie, le trench-coat, Alfred Hitchcock, le tennis sur gazon. Mais aussi Margaret Thatcher, le full english breakfast, David Beckham, les miles, les yards – et les pieds, et les pouces, et les livres, et les onces… Et le thé au lait. Et le prince Charles, parce qu’il faut bien que quelqu’un pense à lui, le pauvre. Toutes ces icônes universelles sont anglaises, certaines majeures d’autres moins. Elles peuvent faire office de clichés, mais elles fondent la popularité et la réputation de la nation dans le monde entier. Tout un chacun, ou presque, dispose de son Angleterre rêvée ou fantasmée, consommée ou écoutée, traversée, pratiquée, détestée peut-être. Les pays pouvant prétendre à cette faculté sont plutôt rares, mais c’est un fait : l’Angleterre appartient à tout le monde.
Elle séduit par ces doux paysages de collines et de champs bordurés par des futaies, peints par William Turner, ces falaises de craie sur les côtes du Kent ou encore les vallonnements du Lake District dans le sublime comté de Cumbria : classé au patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2017, le « Lakeland » est le seul massif montagneux d’Angleterre digne de ce nom. Son Everest a pour nom Scafell Pike. Il culmine à 958 m et, croyez-le ou non, c’est vertigineux.
Elle plaît aussi par ses paysages urbains authentifiables à la seconde : les briques rouges de la révolution industrielle, les rangées de maisons à l’identique de la période victorienne.
Mieux, depuis que la civilisation anglaise est devenue britannique, depuis que les possessions de l’autre rive de l’Atlantique sont devenues les États-Unis d’Amérique, première puissance mondiale, depuis que la langue anglaise est l’idiome commun, l’Angleterre même affaiblie continue vaille que vaille à conserver sa place de tout premier choix au panthéon des nations. On appelle cela le soft power, concept proposé la première fois par le politologue américain Joseph Nye en 1990. Quel que soit le contexte politique et économique, – et il n’est pas terrible à l’heure d’écrire ce livre – les Anglais continuent à faire envie loin à la ronde. Selon une étude de MasterCard, Londres a accueilli 21 millions de visiteurs en 2019, dernière année statistique « pleine » avant la pandémie de Covid-19. La première place en Europe, juste devant Paris. À leur manière, les migrants afghans ou irakiens qui viennent s’entasser dans l’entonnoir de Calais dans l’attente d’une traversée vers cet eldorado supposé ne dérogent pas à cette représentation : l’Angleterre est le but ultime de leur long périple. Ainsi les Anglais, malgré les revers de fortune des dernières décennies, restent-ils une évidence sur la scène globale, un point d’ancrage, un repère. Et ce n’est pas près de changer.
Je déambulais l’autre jour dans les rues médiévales d’Oxford, où cinq siècles d’excellence universitaire vous contemplent à chaque coin de rue, du Trinity College au All Souls College, sentiment de vertige historique, profondeur de champ d’une civilisation érudite. Assis sur un banc en bois dans la Divinity School (1483), où les étudiants défendaient autrefois leurs thèses, je songeais au rayonnement inouï de cette université, matrice comme sa sœur de Cambridge des élites anglaises puis britanniques depuis des temps immémoriaux. Si je n’avais pas regardé aussi longtemps la sublime voûte gothique, j’aurais compris tout de suite que j’étais le seul Européen dans la salle. À Oxford, pendant les vacances académiques de juillet, on parle chinois, partout. La Chine a beau disposer d’universités largement aussi compétentes que celles d’Angleterre, rien ne remplacera, aux yeux des parents pékinois, le tampon « Oxford » sur le certificat rapporté au pays à grands frais par leur progéniture.
L’Angleterre (130 395 km2) est un petit pays, trois fois la Suisse, quatre fois la Belgique, un cinquième de la France. Même en prenant en compte l’ensemble du Royaume-Uni, cela reste un État de superficie moyenne. En rapport à sa taille, il exerce donc encore une influence démesurée sur le reste du monde, héritage vivace de l’époque où l’Empire donnait le ton. Paradoxe, c’est justement ce pays central, et ses habitants, les Anglais, qui ont pris congé du continent. Puisse mon regard subjectif et toujours intrigué vous aider à comprendre l’Angleterre qui restera de l’autre côté de la Manche, à une encablure du continent.
Brexit et conséquences
L’avion s’est posé sur l’un des sept (sic) aéroports de Londres, à Luton, à 50 km au nord de la capitale, en lisière de la triste ville industrielle du même nom. La voiture de location attend sur le parking. Comme à chaque fois, c’est peut-être la centième, je monte à l’avant à gauche. Une fraction de seconde pour comprendre que ne s’y trouve que le siège du passager. Le volant est de l’autre côté. Ce simple particularisme, prévisible, éculé, vaut piqûre de rappel. Bienvenue en Angleterre, bienvenue ailleurs, au pays de l’étrangeté familière.
Destination la ville de Boston, comté du Lincolnshire, un peu plus au nord sur la carte, au milieu de l’Angleterre, pas très loin de la côte est qui, à cet endroit, fait face aux Pays-Bas. Dès le treizième siècle, Boston était l’une des principales villes marchandes de ce qui était le Royaume d’Angleterre. Elle faisait partie de la ligue hanséatique regroupant les places fortes commerciales autour de la mer du Nord et de la Baltique. Et donna son nom à Boston, Massachusetts, après que, en 1620, des Puritains décidèrent qu’ils ne supportaient plus les discriminations religieuses de l’Église d’Angleterre et quittèrent leur terre natale à bord du Mayflower. Boston, Angleterre, tomba ensuite dans l’oubli total. Jusqu’au 23 juin 2016. Avec 75.6 % des voix en faveur du retrait de l’Union européenne, Boston est alors devenue la capitale britannique du Brexit.
Un honneur qui lui vaut désormais une curiosité internationale que même son extraordinaire cathédrale (dont la tour, dite le Stump, est la plus haute du Royaume-Uni) ne lui avait jamais conférée.
Comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé là à cause des Polonais. À cause des Lituaniens. À cause des Roumains, des Bulgares. « Et de tous les autres. Ils ont envahi notre ville, nous ne sommes plus chez nous » dit Theresa Sutton, une retraitée bien mise croisée justement sur le parvis de St Botolph’s Church. Elle reconnaît que ces immigrés européens ont en quelque sorte été formellement « invités » par le gouvernement quand il a permis, il y a une dizaine d’années, la libre circulation aux ressortissants européens, quand bien même le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace Schengen. « Mais personne ne pensait que les choses tourneraient comme ça, ajoute-t-elle. Nous pensions qu’ils viendraient comme main-d’œuvre temporaire. Mais ils sont restés. C’est une invasion. »
Boston se trouve au centre d’une vaste plaine agricole. On y cultive la pomme de terre, les choux, les poireaux, tout ce qui pousse à cette latitude bien arrosée et venteuse. Or il y a bien longtemps qu’aucun Anglais ne s’est cassé le dos sur ces champs ingrats. Les travailleurs viennent en totalité de l’est du continent, logés dans des préfabriqués à peine salubres en lisière des exploitations. On les croise en ville, où ils font leurs courses dans les échoppes qui sont apparues pour les servir : boulangerie lituanienne, Polish supermarket. La boulangère qui range ses petits gâteaux multicolores derrière une vitrine vient en effet d’une banlieue de Vilnius. Elle en a marre de répondre aux questions des reporters qui se sont succédé ces dernières années pour découvrir la ville la plus europhobe des Îles Britanniques. Tout juste concède-t-elle ceci : « Boston est une ville qui mourait. Depuis que nous sommes ici, elle meurt moins. »