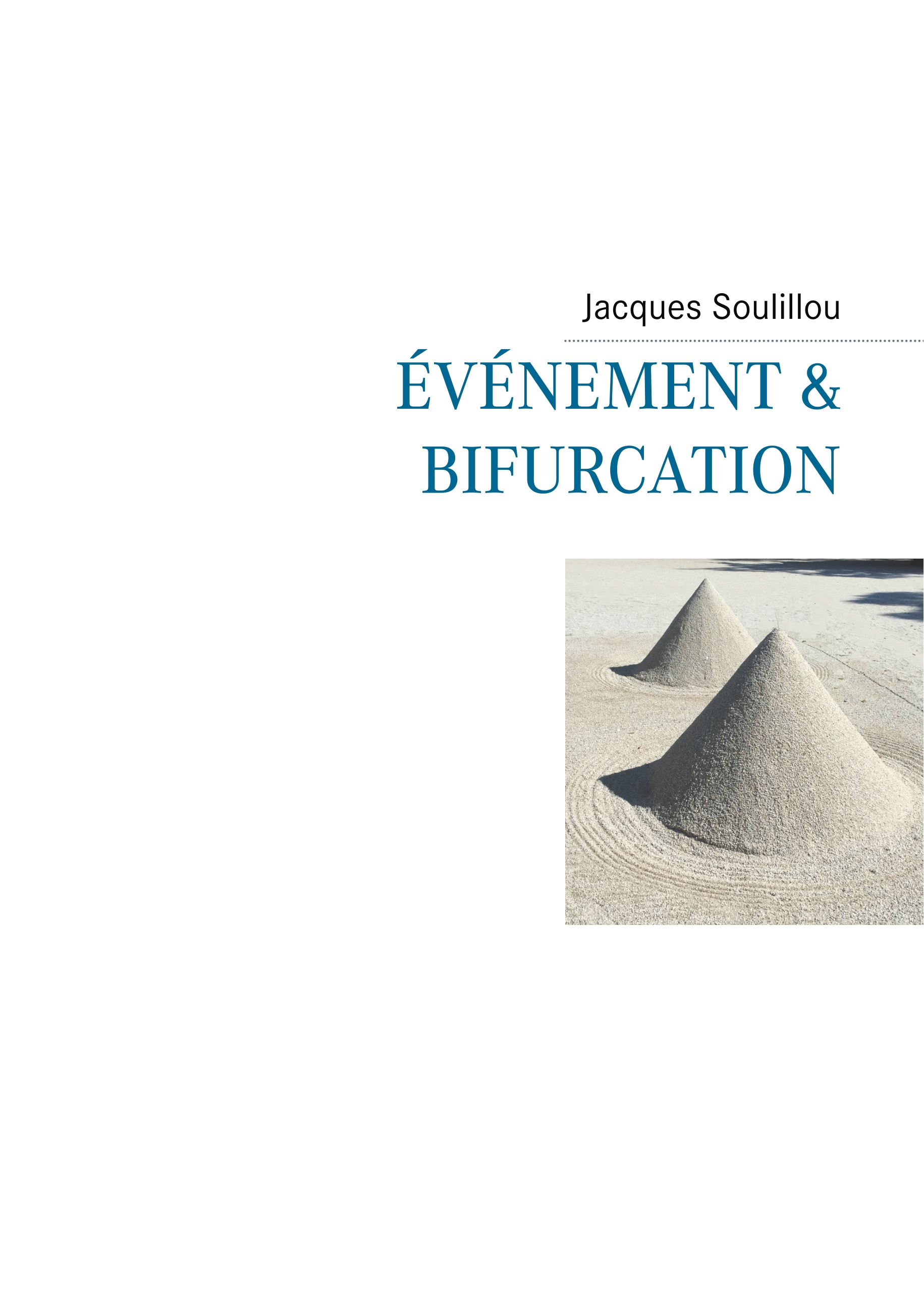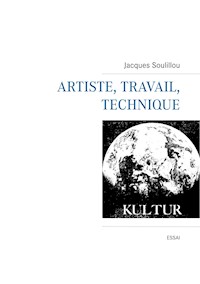
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre a pour objet les pondérations que la triangulation artiste, travail, technique a subies au cours de l'histoire de ce que l'auteur appelle l'aire d'oeuvrement occidentale. A l'époque moderne deux pondérations ont altéré en profondeur le profil de la triangulation artiste, travail, technique : le droit d'auteur d'une part, le ready made duchampien d'autre part, ce dernier permettant pour la première fois de penser l'oeuvrement au-delà du travail de représentation. Dans sa phase actuelle, l'aire d'oeuvrement occidentale est confrontée au double défi de son hégémonie mondiale que lui a conféré le concept d'art contemporain et au défi de nouveaux prétendants au premier rang desquels l'artiste non-humain incarné par la machine intelligente et sa prétention à l'autonomie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR :
Du Décoratif (en collaboration avec Présence Panchounette), 1981, éditions Eric Fabre, Paris.
Le Décoratif, éditions Klincksieck, 1990, coll. d’esthétique, 108 p ; réédition revue et augmentée en 2016.
L’Impunité de l’art, éditions du Seuil ; coll. La couleur des idées, 1995, 350 p. Version électronique en 2019
Contemporary African Art (en collaboration avec André Magnin); éditions Harry N. Abrams, New York / Thames & Hudson, Londres, 1996.
L’Auteur mode d’emploi, L’Harmattan, Paris, 1999, 160 p.
Le Livre de l’ornement et de la guerre, éditions Parenthèses, coll. Eupalinos, Marseille, 2003, 153 p.
Esthétiques du détachement, Sémiose éditions, Paris, 2013, 174 p.
Traductions de l’allemand :
Du style et de l’architecture, écrits 1837-1869 [Gottfried Semper], éditions Parenthèses, coll. Eupalinos, Marseille, 2007.
La Nature des cultures [Die Natur der Kulturen] et MSC [CSM], Heiner Mühlmann ; octobre 2010, éditions Parenthèses, Marseille.
Traduction de l’anglais (américain) :
Le Paradigme du tapis [The Carpet Paradigm], Joseph Masheck, juin 2011, éditions du Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO), Genève.
Table des matières
Avant-propos
P
REMIÈRE PARTIE
1. L’aire d’œuvrement occidentale. Le camp de base
Copier, imiter
Interprétation, écriture
Hiérarchies
Puissance ; fond et forme
Stabilisateurs et polygone de sustentation
Remarque conclusive
2. Kant ; les abeilles ; le génie
Figures du génie
3. Hegel ; communauté désœuvrée et réœuvrement communautaire
Révolution et réœuvrement
Le mythe de l’artiste sans œuvre
4. Désœuvrement originel
Baisse tendancielle du taux d’œuvrement
5. Gardiens et fidèles
6. La possibilité d’une œuvre
Evénements
situation
-dépendants et
individu
-dépendants
Modalités du possible, de l’impossible et du réel
D
EUXIÈME PARTIE
7. Duchamp
Présentation et re-présentation
Pourquoi le ready-made ne peut être une simple idée
8. Infinitisation, excédentisation
De la décroissance du
ready-made
Dada, surréalisme
Benjamin, Baudrillard
9. Machines – vers une nouvelle
poièsis
Démiurge machinique et art non-humain
10. Elargissements, enrichissements
Musée
Prétendants
Précurseurs
11. Irrationnel, rationnel, imaginaire
12. Le créauteur
Des deux régimes du droit d’auteur
À la recherche du passage du Nord-ouest
Mort de l’auteur versus vie de l’artiste
13. Indignations
Canulars et limite du canular
Epilogue
Index des noms propres
Avant-propos
Les réflexions qui suivent partent de l’hypothèse qu’au sein de ce que l’on appelle communément une aire culturelle, vaste ensemble qui comprend aussi bien les manières de table, de s’habiller, de construire, les coutumes funéraires et de mariage, la gestuelle, les langues, l’ornementation, etc., on peut distinguer un espace qui, tout en étant étroitement lié au premier, répond à ses propres règles concernant la production d’œuvres d’art. Nous appellerons aire d’œuvrement d’une culture ou d’une civilisation données ce sous-ensemble. Il faudrait dire production et réception des œuvres en ce sens que toute aire d’œuvrement définit simultanément un espace de désœuvrement qui sans être nécessairement présent à la conscience des acteurs qui agissent en son sein, conditionne néanmoins leur perception de ce qu’est une œuvre et de ce qui n’en est pas - même si extérieurement, en tant que chose fabriquée, elle en présente toutes les caractéristiques.
L’aire d’œuvrement est, si l’on peut dire, une aire d’enfantement des œuvres d’art, leur « paternité » (ou maternité) étant, comme on verra, l’une des questions centrales qui n’a cessé de ressurgir au sein de cette aire de référence que sera pour nous l’aire occidentale, qui se forme en Grèce ancienne pour se prolonger ensuite dans Rome, laquelle en adopte et en traduit dans sa langue les principales notions, non sans leur faire subir certaines torsions que l’on peut encore observer aujourd’hui, comme par exemple dans sa dualité sémantique bien connue et source de tant d’ambiguïtés, celle entre « art » et « technique ».
Comme l’aire culturelle dans laquelle elle est plongée, cette aire d’œuvrement comprend aussi bien des institutions, des infrastructures, des sites naturels - musées, ateliers, appartements de collectionneurs, carrières de marbre, conservatoires, salles de concert, éditeurs, bibliothèques, tribunaux, ministères, etc. -, que des représentations mentales de ce qui fait une œuvre. Même si certaines institutions, le musée notamment, ont joué un rôle important (mais récent) dans la constitution de cette aire occidentale, nous nous intéressons ici en priorité aux représentations mentales et aux œuvres - les premières pouvant être déduites aussi bien d’ouvrages de philosophie, de romans, de poèmes, d’attendus de jugements, de texte de lois, d’articles de presse, etc.
En dépit du caractère naïf consistant à se représenter cette aire d’œuvrement comme un espace clos, elle a pourtant une bordure. Elle n’est donc pas « infinie », même si à l’ère du « tout est possible » et de la liberté de création perçue comme sans limites, nous sommes naturellement portés à nous la représenter de cette manière. Comme toute aire d’œuvrement, l’aire occidentale a non seulement une bordure qui la délimite vis-à-vis des autres (chinoise, indienne, arabe, africaine, etc.), mais ce qui la singularise ça n’est pas tant qu’elle aurait atteint ce stade où il n’y aurait « plus de limites », (car en ce cas il n’y aurait plus d’aire d’œuvrement), mais le fait qu’a émergé en son sein, à titre de bordure absolue de toute aire d’œuvrement humaine, la possibilité d’un art non-humain. Disons tout de suite qu’un tel art, en dépit des prouesses de l’intelligence artificielle et des découvertes étonnantes de l’éthologie animale, n’a encore aucune existence, si ce n’est précisément de donner corps à une ultime bordure de l’aire d’œuvrement occidentale, sachant qu’il n’y a aucune certitude qu’elle puisse être franchie un jour car l’obstacle se situe bien plus haut qu’un simple « changement de paradigme ».
Dans sa première leçon du cours de poétique au Collège de France, Valéry se donnait pour mission « l’exploration du domaine de l’esprit créateur1 ». Vaste programme. À certains égards, et en dépit d’un intitulé de recherche de nature à décourager bien des ardeurs, nous serions prêts à reconnaître un certain parallélisme entre ce projet et celui qui va nous occuper. À cette réserve près que « l’esprit créateur » n’est pas pour nous, comme c’est le cas chez Valéry, une caractéristique qui serait liée d’éternité à la production de ce qu’il appelle les « œuvres de l’esprit », mais un trait qui n’apparaît qu’à une certaine étape de l’histoire de cette aire d’œuvrement occidentale. La thématisation d’un tel « esprit créateur » présuppose en effet que le terme « créateur » ait acquis la plénitude ontologique qu’il aura avec le christianisme, et qu’il ait opéré la jonction avec la notion de liberté au sens d’exception à la causalité physique dans une nature qui a désormais acquis sa pleine autonomie. On serait bien à la peine de trouver quelque chose d’équivalent chez Platon ou Aristote dont les œuvres serviront de camp de base à notre exploration.
Autrement dit, si nous nous reconnaissons dans les objectifs de la « mission d’exploration » de ce « domaine » dont parle Valéry, c’est pour en souligner aussitôt sa nature spatiale, non pas illimitée, voire intemporelle, que reflète cette autre expression d’« univers de l’esprit » qu’il emploie, mais limitée par une ligne qui, dès lors qu’on la franchit, nous fait sortir de l’aire considérée, comme lorsqu’on franchit le périmètre d’un cercle tracé dans le sable.
Reconnaître la nature spatialement limitée d’un domaine (à tout le moins dans le registre humain, et non divin), c’est aussi bien le poser dans son altérité par rapport à d’autres. Cette altérité est fondamentale dans le cas qui nous intéresse à double titre : d’une part elle permet d’identifier ce qui fait la nature même de la bordure de l’aire d’œuvrement occidentale, et elle permet d’autre part de comprendre comment, à un certain moment, ce « domaine de l’esprit créateur » occidental s’est tout à la fois radicalement distingué de ce qu’il avait été jusqu’ici au regard de sa propre tradition, et par là-même de toutes les autres aires d’œuvrement (non-occidentales) obligeant désormais celles-ci à se définir par rapport à elle. Dès lors, elle n’était plus une aire parmi d’autres, mais celle qui allait décider de la trajectoire commune, alors même qu’elle n’avait pas plus de légitimité par rapport à bien d’autres pour le faire.
Le plan en deux parties de ce livre découle de ce constat. La première est dédiée à l’examen des notions fondamentales qui donnent à l’aire d’œuvrement occidentale son profil si particulier, et dont les traits se stabilisent au cours du temps sous forme d’états au croisement de plusieurs champs :
- philosophique, en ce sens que la notion d’œuvre présuppose notamment la thématisation de l’opposition entre « produit » de la nature et produit de la culture, mais aussi, à l’intérieur même de la culture, entre produits qui ont une valeur d’usage et ceux qui n’en ont pas ;
- religieux eu égard à l’idée que l’artiste pourrait tenir son inspiration non de son art mais de puissances non-humaines ;
- social en raison des distinctions qui touchent à la nature du travail selon qu’il est manuel ou non, servile ou non, selon qu’il est mis en œuvre par des hommes ou des femmes ;
- économique du fait que l’œuvre, bien que fabriquée, bien que chose, acquiert une valeur d’échange qui est autre que celle d’un produit ;
- juridique (et moral) avec la notion de permissivité et celle plus moderne de droit d’auteur qui concerne la propriété ;
S’agissant de la philosophie, il faudrait compléter ce tableau, brossé de manière très succincte, par l’esthétique qui n’a fait que très tardivement son apparition, comme du reste le droit d’auteur.
Nous avons dit « se stabilisent » à propos des traits de cette aire d’œuvrement parce que son maintien à l’intérieur d’une certaine bordure repose sur la présence de stabilisateurs dont la mobilisation garantit la capacité à produire des œuvres. Trois d’entre eux retiendront particulièrement notre attention : le démiurge, autrement dit le producteur, alias l’artiste ; le travail ; la technique. Ce sont eux qui ont donné son titre à ce livre. Chacun d’eux dispose d’une marge d’ajustement qui confère à l’ensemble de l’aire une certaine plasticité et capacité d’absorption de changements plus ou moins violents.
On pourrait faire remarquer à juste titre que la triangulation producteur-technique- travail que nous évoquerons dans la première partie, est quasiment universelle et que l’on voit difficilement comment une œuvre et a fortiori une œuvre d’art, pourrait lui échapper, qu’elle soit européenne, asiatique ou africaine. C’est en effet moins la triangulation elle-même qui distingue telle aire d’œuvrement d’autres aires que les pondérations spécifiques qui concernent les démiurges, les techniques ou le travail. Bien que susceptibles d’évoluer dans le temps, ces pondérations, s’agissant de l’aire d’œuvrement occidentale, semblent toujours varier à l’intérieur de bornes qui ont pour noms la nature, le produit, la machine.
Le désœuvrement dont on a dit qu’il est substantiellement lié à l’œuvrement, est un champ qui a ceci de particulier qu’il traverse tous ceux mentionnés auparavant. Ou plutôt il les hante. Ainsi, pendant très longtemps, il allait de soi, sans même qu’on éprouve le besoin de le dire, qu’appartenait à un tel espace « désœuvré » non seulement toute production provenant de la nature - le plus sublime des couchers de soleil n’est pas une œuvre (au sens humain), ni les danses nuptiales des oiseaux préludes aux accouplements -, mais plus encore toute production ne résultant pas d’une technique, et encore moins n’impliquant pas un travail. Entre le Banquet de Platon et le moment où l’on a réalisé qu’il était possible d’intégrer à l’aire d’œuvrement occidentale quelque chose qui courcircuitait totalement le travail dans la production de l’œuvre, il s’écoulera vingt-cinq siècles.
La topologie du désœuvrement est ainsi double : il peut être perçu aussi bien comme ce qui se situe à l’extérieur de la bordure de l’aire d’œuvrement, par exemple sous forme d’un art qu’elle ne reconnaît pas comme tel, comme ce fut le cas pour une large part de l’art africain sub-saharien et océanien jusqu’au début du 20ème siècle, que comme champ intérieur venant doubler chacune de ses manifestations à titre de discriminant entre ce qui est œuvre et ce qui ne l’est pas.
En français, le sens ordinaire de désœuvrement renvoie au fait d’être inactif ou de n’avoir pas d’ouvrage, autrement dit de travail. Et ce dernier mot est particulièrement important dans tout ce qui suit tant la notion d’œuvre est liée précisément à celle de travail (qui ne se confond pas avec la « technique »). Le sens philosophique de désœuvrement est apparu d’abord dans la théorie de la littérature et des réflexions autour de l’écriture. La différence entre le sens ordinaire de désœuvrement et le sens dérivé, c’est que le premier renvoie à un état dans lequel est censé se trouver un sujet, alors que le second renvoie à un acte qui affecte en priorité un objet, à savoir une œuvre. Alors qu’on ne peut pas dire « je désœuvre », le désœuvrement « désœuvre », soit par refus d’accorder le titre d’œuvre, soit en mettant en œuvre des procédures de production qui outrepassent ce que l’on considérait jusqu’ici comme œuvre.
En revanche, il n’existe pas en allemand (ni du reste en anglais), un mot du langage courant qui, comme le français « désœuvrement », serait construit par apposition d’un préfixe marquant la privation et que l’on pourrait ensuite transposer dans le champ de l’esthétique. En ce sens, le concept qui pourrait se rapprocher le plus de ce que nous entendons par désœuvrement, apparait pour la première fois sous la plume d’Adorno, en 1953, sous forme du néologisme Entkunstung. Le mot est formé d’un préfixe marquant l’éloignement, la séparation (ent-) et du nom commun, Kunst qui signifie « art » (et non « œuvre », Werk). Comme l’a fait remarquer Philippe Lacoue-Labarthe, ce néologisme peut être rapproché de ces autres notions formées sur l’apposition du préfixe ent- et qui ont toutes une connotation négative : ent-artete (dégénéré) des nazis, Ent-zauberung (désenchantement) de Max Weber, Ent-göterung (le retrait du divin) de Heidegger, Entmythologiesirung (démythologisation) de Benjamin. « Dans les trois - ou quatre - cas, on voit bien, écrit Lacoue-Labarthe, qu’il s’agit de trouver le concept, ou le mot, d’un monde, le nôtre, désormais privé de teneur sacrée ou religieuse (…) et livré à ce que Nietzsche avait commencé à décrire sous le nom de nihilisme2. »
Cependant, l’Entkunstung est lié chez Adorno à une étape bien particulière de l’aire d’œuvrement occidentale, marquée par l’industrialisation et la marchandisation de la culture. Ce n’est pas une propriété qui caractériserait cette aire tout au long de son histoire. Quant au désœuvrement thématisé par Blanchot, dans le sillage de Mallarmé, il concerne en priorité l’écriture et non l’art en général.
Au regard de notre mission d’exploration, L’Esthétique de Hegel occupe une place toute particulière dans la première partie en ce sens qu’elle a alerté pour la première fois sur la menace du désœuvrement (mot qui n’apparaît pas, ça va sans dire, en tant que tel dans cet ouvrage posthume rédigé à partir de notes de cours) qui, selon elle, pèserait sur l’aire d’œuvrement occidentale contemporaine de l’auteur de cette esthétique, mais aussi sur un désœuvrement qui frappe tout œuvre dès son origine du fait d’une réception inévitablement conditionnée par un certain état de la culture. Cette alerte ne signifiait nullement la « mort » de l’art au sens d’un désœuvrement trivial prophétisant sa disparition, mais au contraire son entrée dans une forme d’inflation chaotique, totalement livrée à elle-même et aux démons de la liberté individuelle, déconnectée de tous les enjeux qui avaient jusqu’ici garanti à l’art son caractère de nécessité et constitué sa « plus haute mission », notamment en rapport avec l’esprit d’un peuple.
La seconde partie de l’ouvrage s’intéresse plus spécifiquement au profil de l’aire d’œuvrement occidentale dans ce qui va constituer sa dynamique de divergence par rapport à sa propre tradition, et par là-même par rapport aux autres aires non-occidentales. L’accélération de cette cinétique de divergence qui, dans sa plus grande extension, va de la seconde moitié du 18ème siècle à la seconde moitié du 20ème, est due certes à des personnalités et mouvements artistiques de la fin du 19ème début du 20ème siècle, mais pas exclusivement. Ces mouvements et personnalités ont contribué à remettre en question de manière radicale certains des présupposés qui conditionnaient ce que l’on se représentait jusqu’alors au titre d’œuvre, que ce soit dans le registre de ce que la tradition tenait comme le plus noble des arts, à savoir la poésie, aussi bien que dans celui des arts visuels qui avaient fini à la Renaissance par la rejoindre parmi les « arts libéraux ». Les personnalités centrales ont pour noms (entre autres), Flaubert, Mallarmé, Fernando Pessoa, Marcel Duchamp, André Breton. Chacune d’elle a contribué d’une manière précise au réaménagement des limites internes qui traversent l’aire d’œuvrement, contribuant de la sorte à projeter en avant sa bordure au point de donner le sentiment illusoire qu’elle n’en avait plus.
Mais cette dynamique de divergence trouve aussi son explication dans des phénomènes qui ne peuvent plus être rapportés seulement à telle ou telle personnalité car ils relèvent de dynamiques collectives. Le premier est la naissance du droit d’auteur qui a eu pour effet de faire du créateur une entité hybride : à la fois artiste libre et auteur pouvant désormais prétendre avoir des droits sur une portion de création appelée œuvre, encapsulée dans des limites sur lesquelles, sauf exception, il est possible de s’accorder. Au moment où, avec le concept de génie, émergeait le concept d’originalité pris dans son acception moderne d’opérateur de rupture par rapport à la tradition, le droit d’auteur allait paradoxalement prendre à contre-pied cette Originalität dont il est question au § 46 de la Critique du jugement de Kant, la rabattant sur la notion d’origine au sens généalogique. Cette originalité était désormais clairement centrée sur l’artiste et non l’art - et ceci en contradiction non seulement avec une tradition occidentale qui remonte bien au-delà de Platon, mais avec celle de très nombreuses autres cultures.
Le second phénomène apparu avec force au début du 20ème siècle, est celui de l’élargissement de l’aire occidentale à ce que j’appellerai des « prétendants démiurges » jusqu’ici considérés comme illégitimes, implicitement ou explicitement : la Femme, le Fou, l’Idiot, le Nègre3 - pour ne citer que les principaux. Deux prétendants restent cependant irrémédiablement exclus jusqu’ici de ce périmètre. Tous deux non-humains : l’animal et la machine.
Ce qu’il y a de singulier dans la trajectoire de l’aire d’œuvrement occidentale, c’est qu’en dépit des tempêtes qui se sont abattues sur elle à partir de la seconde moitié du 19ème siècle, conduisant de nombreux observateurs à prophétiser ni plus ni moins sa fin, elle témoignait au même moment d’une formidable résilience que l’on peut reconnaître à la reconduction à travers le temps de questions déjà ouvertes depuis bien longtemps et restées sans réponse : celle de l’origine de l’œuvre, celle de l’unité de l’aire au regard des différentes techniques et poétiques dont elle est le siège, celle encore de l’étendue de son domaine de définition eu égard, d’une part à la nature, et d’autre part aux autres choses produites au sein de la culture - questions toujours aussi actuelles qui pourraient presque laisser croire qu’elles ont été imaginées la veille.
S’il fallait résumer d’un mot cette résilience, alors il ne fait aucun doute que celui de poièsis - que l’on se contentera de traduire à ce stade par « poétique » - s’imposerait à tout autre comme ce point d’ancrage de l’aire d’œuvrement occidentale jusqu’à aujourd’hui, même si de très fortes pressions s’exercent désormais à son endroit, notamment dans la confrontation grandissante avec la possibilité d’un art non-humain.
Le critère de sélection des questions que nous avons choisies de traiter repose donc en partie sur cette capacité à être restées ouvertes jusqu’à nous, dans l’horizon de la poièsis. Ainsi, à aucun moment, nous n’aborderons cette question qui a été au cœur de l’aire d’œuvrement occidentale pendant plus de deux mille cinq cents ans, à savoir celle de la beauté. Dans le courant du 19ème siècle, notamment chez Baudelaire, voire même plus tôt si l’on considère le Neveu de Rameau4, puis en s’accélérant au tournant du 20ème siècle, apparaissent les premiers signes que cette question dont on pourrait remplir la Bibliothèque nationale des volumes qui lui ont été consacrés, semble perdre toute sa pertinence.
C’est comme si, au même titre que la querelle du dessin et du coloris, ou des Anciens et des Modernes, qui n’intéressent plus que les historiens, la question du beau avait été impuissante à franchir la barrière de potentiel apparue dans le sillage des révolutions formelles qui se succèdent à partir de la seconde moitié du 19ème siècle. Ça n’est pas que le beau ne soit pas un concept qui ne présente plus d’intérêt ; bien au contraire. Que ce soit avec l’anthropologie, la sociologie ou les neurosciences, ce concept conserve toujours une formidable actualité, quant à savoir par exemple s’il existe des invariants anthropologiques de ce que nous sommes portés à considérer comme beau, ou quant à savoir si cette sensibilité au beau est une prérogative exclusivement humaine, ou bien, comme le pensait déjà Darwin, si c’est un comportement dont on peut attester la présence aussi chez certains animaux.
Toutes ces questions sont d’une importance cruciale et sont en train d’être renouvelées avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans la recherche en sciences humaines. Cependant elles n’intéressent plus l’aire d’œuvrement occidentale dès lors que la notion de la production d’œuvres n’est plus conditionnée par celle de beauté mais par celle de nouveauté. Dans un texte publié en 1919, Malévitch écrit : « Notre tâche est d’avancer toujours vers la nouveauté5. » Et ceci ne surprend plus personne.
Bien que notre approche ne soit pas comparative (ni d’ailleurs historique au sens strict pour la raison que l’on vient d’exposer à propos de la question de la beauté), et ceci en grande partie pour des raisons pratiques - une vie entière ne suffirait pas à comparer l’aire d’œuvrement occidentale à ces autres aires, chinoises et indiennes, pour ne citer que celles-là qui dominent encore largement toute une partie de l’Asie - un certain horizon comparatif restera inévitablement présent tout au long de nos réflexions. La remarque suivante de Simon Leys (alias Pierre Ryckmans), selon laquelle « l’esthétique chinoise qui, dans le domaine des théories littéraires, calligraphiques, picturales et musicales, a accumulé une littérature remarquablement vaste et riche (…) s’est élaborée sans faire aucune référence au concept de « beauté6 » nous montre au passage l’extrême difficulté d’une telle approche comparative qui, dans le cas d’espèce, pourrait conduire à dire que la Chine serait parvenue à un « résultat » qu’il aura fallu plus de deux mille ans à l’Occident pour commencer de l’évoquer - ce qui serait bien évidemment une comparaison caricaturale en ce sens que l’absence de « référence à la beauté » dans l’esthétique de l’aire d’œuvrement chinoise d’une part, dans l’aire occidentale d’autre part, dans sa phase la plus moderne, n’ont rigoureusement rien en commun.
Il n’est pas possible cependant d’étudier l’aire d’œuvrement occidentale en vase clos dès lors qu’ayant pris la mesure de la signification du phénomène de divergence qui l’a affectée au 20ème siècle, accélérant son devenir monde, et dont Gauguin fut sans doute le premier argonaute, on voit que le processus d’élargissement et d’enrichissement qui lui était propre a fini par affecter la trajectoire des aires d’œuvrement non-occidentales, conduisant celles-ci à adopter un certain nombre de traits qui leur étaient jusqu’ici étrangers.
Si, dans un premier temps, cet élargissement a pris la forme d’un accueil d’œuvres en provenance d’aires d’œuvrement non-européennes, œuvres qui contribuèrent parfois à légitimer des révolutions en cours dans son propre espace ; dans un second temps, après 1945, il a pris une forme hégémonique en imposant le concept d’« art contemporain » comme la seule forme légitime d’art authentiquement présent et vivant, étant entendu que « contemporain » n’avait plus désormais le sens trivial de « vivant à la même époque ».
Il est en effet clair qu’aujourd’hui, même s’ils revendiquent des liens étroits avec leur propre culture en prétendant y puiser leur inspiration, des artistes contemporains chinois, indiens, africains, océaniens, a fortiori s’ils vivent en Europe ou en Amérique du Nord, sont partie intégrante de l’aire d’œuvrement occidentale. Il leur est impossible de revenir sur l’aire d’œuvrement de leur propre culture qui, par comparaison, fait figure de citadelle cernée de toutes parts par une forme de désœuvrement à leurs yeux archaïque, inséparable de la définition d’une aire dont on ne voit que trop bien la bordure qui se dresse comme un rempart destiné à protéger les « valeurs » ancestrales propres à telle ou telle culture7.
1 Voir Œuvres complètes, T1, éd. de la Pléiade, p. 1056.
2 P. Lacoue-Labarthe, « Remarque sur Adorno et le jazz, (D’un désart obscur) » in Rue Descartes, n° 10, juin 1994, Albin Michel, pp. 131-141. Jouant sur le mot «désert», Lacoue-Labarthe a proposé de traduire Entkunstung par « désartification » plutôt que par « désesthétisation », comme l’a proposé Marc Jimenez dans sa traduction de la Théorie esthétique d’Adorno. Nous reviendrons plus avant sur ce qui pourrait justifier le cas échéant une telle traduction.
3 J’expliquerai plus avant en m’appuyant sur Aimé Césaire, pourquoi je garde dans ce contexte ce terme et non celui de noir.
4 « S’il importe d’être sublime en quelque genre, c’est surtout dans le mal. »
5 « Du musée » in Malévitch, écrits, présentés par Andréi B. Nakov, trad. Andrée Robel-Chicurel, éd. Champ Libre, 1975, p. 233.
6 Simon Leys, Le studio de l’inutilité, Flammarion, 2012, p.121. Leys ajoute que « le terme meixue, « étude du beau », est un vocable moderne spécialement fabriqué pour traduire la notion occidentale d’esthétique. » On a envie de dire que cette traduction arrive trop tard...
7 Pensons à cet égard à l’importance de la valeur d’harmonie dans l’aire d’œuvrement chinoise, qui ne peut aujourd’hui qu’exciter l’artiste contemporain chinois à en dénoncer le caractère purement idéologique.
Première partie
1. L’aire d’œuvrement occidentale. Le camp de base
Le fait d’avoir indiqué que les œuvres de Platon et Aristote serviraient de point de départ à notre voyage d’exploration ne doit pas être interprété comme si l’on considérait que l’aire d’œuvrement occidentale commençait avec ces deux auteurs. Il suffit de lire le premier vers de L’Iliade - « Chante, déesse, la colère d’Achille fils de Pélée… » pour voir dans ce simple appel à la divinité, et non au poète, que cette aire projette ses racines dans le passé bien au-delà de ces deux auteurs. Cependant, Platon et Aristote en mettent au jour explicitement les fondations conceptuelles, et ce faisant ils ouvrent une tradition de questions dont certaines sont parvenues jusqu’à nous, soit intactes, soit travesties. Parmi ces questions, certaines semblent appartenir à un fonds commun - celle par exemple de l’origine de l’œuvre indiquée en creux par ce vers de L’Iliade -, d’autres semblent au contraire prendre leur source dans des problématiques personnelles à l’un et l’autre de ces penseurs, comme la notion d’idée ou de puissance. Autrement dit, tantôt philosophes et artistes (au sens général de démiurge) jouent le rôle de passeurs d’une tradition beaucoup plus ancienne qu’eux, tantôt le rôle de contributeurs net à une tradition qu’ils tendent à enrichir.
Comme nous l’avons dit, ce qui nous intéresse dans cette exploration, c’est la continuité de ces questions non résolues et les transformations qu’elles ont subies jusqu’à l’ère d’internet et de la montée en puissance de l’intelligence artificielle qui contribue à crédibiliser l’émergence d’un art non-humain.
Au fonds commun qui va des Grecs jusqu’à nous, passant notamment par Rome, appartiennent un certain nombre de notions que nous rappellerons brièvement. À commencer bien sûr par le mot « art » qui, tel qu’il nous a été légué par le latin ars, signifie « savoir », (de même que Kunst en allemand). Savoir indispensable pour produire une chose - sans être pour autant une science (épistémè). Une certaine forme de circularité en découle : il faut déjà avoir de l’art pour pouvoir en produire sous forme d’œuvre. Mais l’art lui-même ne s’acquiert pas comme un produit, il est ce qui sert à produire. Produire « en général », se dit facere d’où vient notre verbe faire8. On verra pourquoi je dis « en général ». Le mot latin ars transpose le mot grec technè (τέχνη), qui a donné « technique », et qui peut être traduit aussi bien par « art » que « savoir », « savoir-faire » ou « connaissance » en français. Il n’y a pas le mot « technique » dans un dictionnaire latin, mais il y a le mot artificiosus qui signifie… « obtenu par l’art ». Le latin nous a donc légué l’art avec la technique, étant entendu que ces mots sont à la fois inséparables et qu’ils doivent impérativement être séparés si on veut pouvoir penser ce qu’est l’art.
Si en effet le mot œuvre (work, Werke, obra, etc.) renvoie à tout ce qui est produit moyennant la mobilisation simultanée d’un démiurge humain, d’une technique spécifique et d’un travail, sur quoi repose la différence entre œuvre de l’art et œuvre d’art ? Le paysan qui contemple sa récolte peut parler à son propos d’œuvre résultant de son travail et de l’art au sens de la technique, de même le menuisier à propos d’un meuble qu’il vient d’achever. Tout du long de la tradition occidentale, l’œuvre d’art a revendiqué une utilité non bornée par les performances de tel ou tel outil et les exigences de tel ou tel besoin. Cette autre utilité paraît du même coup se tenir dans un entre deux où d’un côté elle est menacée par l’utilité purement instrumentale de la chose produite pour répondre à un besoin précis, de l’autre par l’inutilité de la chose détachée de toute préoccupation mondaine. Cet entre-deux se veut, comme on verra, « pur » de toute dimension utilitaire, tout en revendiquant une utilité supérieure qui n’est pas sans connotation aristocratique.
Les Grecs avaient deux mots bien distincts pour « création » et « savoir » : poièsis (ποἰησις) d’une part, technè (τέχνη) d’autre part9. Le premier est lié au verbe poieîn (ποιεῖν) qui veut dire (ici à l’infinitif) produire une chose, une paire de chaussures ou un tableau, un bateau ou le Parthénon. Mais « création » est un mot qui en fait outrepasse la portée de ce que peut produire la poièsis, car celle-ci ne peut créer que par la médiation de la technique. Le dieu auquel fait allusion le livre X de La République n’a pas besoin de technique pour créer, (ni d’ailleurs le dieu de la Bible). Platon lui donne le nom de phutourgos (597d), qui est littéralement celui qui fait croître, aussi bien des choses, comme des lits, ou des plantes, des animaux, des étoiles.
Pour « faire des affaires », « faire de la politique » ou « faire la guerre », les Grecs emploient un autre mot : prattô, ou prassô (πράττω, je fais), d’où dérive praxis et notre terme de « pratique », au sens d’action. Une œuvre d’art n’est ainsi pas un produit de la praxis, bien qu’elle suppose une forme d’action. En revanche, organiser une campagne d’opinion pour interdire l’exposition de telle œuvre d’art relève de la praxis. La poièsis produit un objet séparé de moi, objectif, un poièma, une œuvre, alors que je ne fais qu’un avec la praxis comme action. La conséquence la plus évidente, mais fondamentale, qu’implique cette séparation, c’est que cette chose produite échappe à un contrôle direct par son producteur - a fortiori s’il décide de l’échanger. L’opposition de ces deux notions de poièsis et de praxis ne veut pas dire que la seconde serait étrangère à ce que nous appelons l’art en général. Cependant, la condition pour que cette dimension « pratique » de l’art apparaisse au grand jour, c’est que l’artiste soit en pleine possession de sa capacité de créer, sans nécessairement d’ailleurs se livrer au travail de produire une œuvre sous forme de chose séparée. Le thème si populaire à partir du 20ème siècle de l’art rejoignant la vie relève en ce sens de la praxis.
Il y a d’emblée une dimension ontologique dans la poièsis qu’il n’y a pas dans la praxis. C’est ce que montre un court passage du Banquet de Platon où Diotime, l’interlocutrice de Socrate, lui explique qu’il y a deux manières de considérer l’amour, l’une où on le comprend comme un tout, l’autre où on le considère sous une forme particulière. Et alors que Socrate lui demande s’il existe d’autres exemples d’une telle division, elle répond : oui, la poièsis. Au sens général elle est « acheminement du non-être à l’être » (ek tou mè ontos eis to on). Ce « non-être » n’est cependant pas le néant absolu, sinon la technè ne pourrait pas s’appliquer. Il faut comprendre ce passage comme la production de quelque chose qui n’existait pas auparavant - par exemple ce morceau de pierre taillé en forme de torse d’Hercule -, mais qui ne part pas de rien. Celui qui ne part pas de rien et qui applique sa technique à quelque chose, Platon l’appelle un « démiurge » - terme général que nous utiliserons tout au long de ce livre et qui peut désigner aussi bien un poète ou un peintre, un artiste ou un artisan, de statut libre ou non libre, car on sait que seule la politique est interdite aux esclaves - et ce « vide » juridique sera d’une grande importance dans l’évolution des contours de l’aire d’œuvrement au cours des siècles.
Et donc, il en découle tout naturellement que « relèvent de la poièsis tous les ouvrages (ergasiai) qui ont pour cause les différentes technai », et que les « démiurges » sont tous des poètes (poiètai), (205c). Or cette belle unité de façade ne va pas résister à un examen plus attentif de la manière dont la poièsis se déploie à travers ces différentes techniques qui sont autant de poétiques régionales. En effet, alors qu’on aurait pu croire la digression ouverte par Diotime achevée et Socrate convaincu par cet éclaircissement, voici que soudain elle ouvre une nouvelle porte en faisant remarquer que « de la totalité de la création (poièsis), on a détaché une partie, celle qui concerne la musique et la métrique, et c’est la dénomination du tout qui sert à la désigner. » Cette séparation, absolument essentielle à la définition de l’aire, en fragilise en même temps son unité au point qu’elle ne la recouvrera sans doute plus jamais.
Diotime nous dit donc qu’on utilise le même mot pour parler de la production en général (poièsis) et de ces productions particulières que sont la musique et la poésie, qui sont les deux seuls techniques (le latin, et tout l’Occident à sa suite, va dire « arts ») qui méritent vraiment le nom de « poésies », et le nom de « poètes » ceux qui en sont les démiurges.
D’où cette première ébauche de l’aire :
Diagramme 1.1
Remarque : S’agissant du partage entre deux types de poètes, deux formes de démiurges, on peut remarquer qu’elle enveloppe de manière embryonnaire une division présente dans un très grand nombre de sociétés, européennes et non-européennes, entre productions culturelles hautes et basses. Dans la Grèce antique, l’opposition de la tragédie et de la comédie atteste de cette polarisation, ainsi que le statut spécial accordée à la poésie vis-à-vis des autres arts, position hégémonique qui ne commencera à perdre vraiment de son éclat que dans la seconde moitié du 20ème siècle en Occident - et que l’on retrouve en haut de la hiérarchie des arts aussi dans l’aire d’œuvrement sous influence chinoise, avec un lien très fort à l’écriture.
L’opposition entre haute et basse culture, arts nobles et arts populaires, est vraisemblablement ce que l’aire d’œuvrement occidentale a en partage avec les autres, indienne, chinoise, égyptienne notamment. Son émergence présuppose la formation d’une caste non astreinte au travail de production, entretenue grâce à un surplus de denrées agricoles et de produits relevant de l’élevage, et en capacité d’agréger autour d’elle toute une culture de la distinction ostentatoire, reposant à la fois sur la possession de biens rares et le privilège de rituels, notamment funéraires, marqués par le faste, ainsi qu’une culture de la transcendance se manifestant à la fois dans le registre religieux et politique. On a longtemps cru que l’émergence de cette distinction était liée à l’apparition de l’agriculture et de l’élevage au néolithique. Les travaux d’Alain Testart, entre autres, ont montré qu’il convenait de relativiser cette coupure en ce sens que certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs attestaient de stratégies de stockage et de comportements sédentarisés, à partir desquels s’étaient constituées des hiérarchies sociales et culturelles10. La spectaculaire découverte du site de Göbekli Tepe, en 1995 en Turquie, daté de 11 000 ans avant notre ère, avec ses mégalithes de plusieurs mètres en partie ornés de hauts reliefs, montraient qu’une société de chasseurs-cueilleurs était en mesure d’édifier des structures architecturales complexes présupposant spécialisation, sédentarisation et hiérarchisation11.
Copier, imiter
En tant qu’elle ne peut actualiser la puissance qu’elle recèle que par la médiation de la technique, au-dessus de la poièsis se tient le dieu, phutourgos ou ergastèr, l’artisan divin, qui crée aussi bien des choses naturelles que réelles. C’est, comme on sait, l’originalité du platonisme de dire que ces œuvres de l’artisan suprême sont plus réelles que celles de l’artisan humain. Non seulement authentiquement réelles mais uniques. Car si cet artisan divin faisait, par exemple, deux formes naturelles de lit, il en apparaîtrait aussitôt une troisième, puis une quatrième, etc. L’artisan humain qui a « les yeux fixés sur l’idée » de lit (République, 596b) ne fera jamais une chose réelle au sens plein, et la variété des formes mêmes que le lit produit par la technique est susceptible de prendre découle de cette impuissance. Si on supposait le démiurge humain capable de créer le lit à l’image du lit réel, au point d’en faire une copie parfaite, alors il faudrait supposer qu’il produit toujours la même forme - ce qui n’est pas le cas. Platon insiste sur la nécessité que la copie ne soit pas parfaitement identique au modèle, au point que celui-ci apparaîtrait comme double ouvrant de facto un cycle fatal d’illimitation. Cette possibilité de copie parfaite est encore moins accessible au peintre dont Platon ne nous dit pas qu’il copie l’idée mais qu’il imite ce que produit l’artisan humain12. Dans un premier temps, selon la lecture classique, on dit que le peintre, l’imitateur, se retrouve relégué à la dernière place dans l’ordre des réalités, comme si le lit peint était deux fois moins réel que le lit réel « incarné » par l’idée. Aussi bien, l’aptitude à imiter que sa technique confère au peintre recèle une puissance qui semble faire de lui l’égal d’un dieu. En effet, si l’artisan divin a non seulement « le talent de faire tous les meubles, [mais] encore toutes les plantes et [s’il] façonne tous les êtres vivants et lui-même, [il fait aussi] la terre, le ciel, les dieux, tout ce qui existe dans le ciel et tout ce qui existe sous la terre chez Hadès13 », cette puissance de création a un talon d’Achille que révèle une remarque de Socrate : « Ne vois-tu pas que toi-même tu pourrais créer tout cela d’une certaine façon » (596d). Et la première technique que donne Socrate à son interlocuteur, un peu surpris par autant de facilité, est celle qui consiste à « prendre un miroir et à le présenter de tous côtés ; en moins de rien tu feras le soleil et les astres du ciel, etc. » Mais la seconde c’est celle que met en œuvre le peintre lorsqu’il représente ce qui l’entoure. Une forme d’excédentisation de l’art, dénoncée par Platon, est déjà ici à l’œuvre que nous retrouverons dans d’autres conditions bien plus tard. Une forme de suspicion aussi. Suspicion non pas vers « l’art en général », qui n’existe pas encore, mais envers l’image comme puissance du double, puissance du simulacre, que Baudrillard reprendra à son compte dans un toute autre contexte lorsqu’il verra dans l’image photographique et la vidéo (a fortiori numérisées), l’incarnation d’une forme « d’extermination du réel par son double14 » selon une formule qui ne fait pas dans le détail.
Notons au passage que la suspicion que Platon nourrit envers l’image n’est pas de même nature que celle que l’on trouve dans le judaïsme dont l’aire d’œuvrement est contiguë à celle de la Grèce antique et qui va en partie fusionner avec elle lors de l’avènement du christianisme et avec le travail des Pères de l’église. Si dans l’un et l’autre cas, tenter de mimer la complétude au moyen de cette apparence qu’est l’image fabriquée revient bien à se poser en égal du dieu15, elle ne revêt pas la forme d’un défi ou d’un blasphème à l’égard de ce dieu, ou plus exactement, de Dieu s’agissant du judaïsme. Le scandale que revêt chez Platon cette forme de production fondée sur la mimésis est plus un scandale ontologique que de nature religieuse. Nous y reviendrons.
Alors que chez Aristote la mimésis est le support d’une pondération inclusive du triangle démiurge-travail-technique en ce sens que sa Poétique intègre tous les genres poétiques, tout en les hiérarchisant plus ou moins explicitement16, elle est au contraire chez Platon exclusive ; elle radicalise la première séparation « molle » entre poètes au sens strict et autres démiurges. Il est faux de prétendre, comme on le lit parfois, que Platon exclut les poètes de sa cité idéale. Il en exclut la grande majorité sur la base d’une critique de l’imitation non régulée, excessive, mais il sait bien qu’aucune société ne peut exclure la totalité de ses démiurges car elles en ont besoin. On dira qu’il garde les plus dociles, ceux qui sont prêts à se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Certes, mais ceux-là aussi font partie des démiurges et ne sont pas nécessairement toujours les plus mauvais si on se place du côté de l’art…au sens de la technique. Et en cela la théorie de l’imitation développée par Aristote dans le second livre de sa Poétique et celle développée par Platon dans les livres II et III de la République, balisent deux formes de pondération de l’aire d’œuvrement occidentale jusqu’à nous : l’une qui met l’accent sur la hiérarchie des genres, avec d’un côté un pôle noble ou sublime (épopée, tragédie), de l’autre un pôle profane et vulgaire (comédie), dont l’opposition entre grand art ou art savant et arts populaires est l’expression euphémisée contemporaine ; une autre forme qui met l’accent sur l’utilité de la poièsis à des fins explicitement politiques - la théorie nazie de l’art dégénéré mais aussi la théorie du réalisme socialiste constituant les formes les plus exacerbées de cette politisation explicite de l’esthétique. La différence, et elle n’est pas petite, entre l’exclusion des poètes et démiurges « non conformes » dans les contextes du nazisme et du stalinisme d’un côté, de la cité idéale platonicienne de l’autre, c’est que, dans la seconde, on y met les formes : « Si un homme habile à prendre toutes les formes et à tout imiter se présentait dans notre Etat pour se produire en public et jouer ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, ravissant ; mais nous lui dirions qu’il n’y a pas d’homme comme lui dans notre Etat et qu’il ne peut y en avoir, et nous l’enverrions dans un autre Etat, après avoir répandu des parfums sur sa tête et l’avoir couronné de bandelettes 17. » C’est que Platon a conscience qu’il s’attaque ici à des géants, Homère, Hésiode, entre autres ; piliers incontestés d’une culture où se reconnaissent tous les Grecs et qui font d’eux au sein de l’aire d’œuvrement occidentale le prototype même de la communauté non-désœuvrée comme on verra aux chapitres 3 et 4.
Non seulement Platon appelle à exclure de sa cité les démiurges qui font un usage immodéré de l’imitation, et ceci concerne tous les arts car il s’agit de créer l’environnement le plus favorable à l’éducation des gardiens18, mais il engage pour la première fois une forme de désœuvrement qui va bien au-delà de la censure et qui consiste à substituer à l’écriture poétique une forme de récit « plus simple » et dépouillé (diègèsis). En 393e Socrate se livre ainsi devant son interlocuteur à un exercice de « dépoétisation » d’un passage de l’Iliade réduit à un tel « récit simple, sans imitation (aneu mimèseôs). » On est presque tenté de dire « sans ornement ». À la hiérarchie verticale des genres, Platon en substitue une nouvelle, horizontale, bornée à une extrémité par le récit en prose « où il y aura peu d’imitation pour beaucoup de récit », sur le modèle de la réécriture du passage de l’Iliade, et bornée à l’autre extrémité par le discours qui n’est « qu’imitation de voix et de gestes » et où on peut à peine distinguer « quelque portion de récit ».
La traduction habituelle de mimésis par imitation tend à l’assimiler à la copie, ce qu’elle n’est pas. Mais cette traduction a surtout le défaut de masquer la différence entre présentation et représentation, car la mimésis représente au moyen d’une technique dite « poétique », certaines actions nobles ou ignobles, graves ou légères19. Copier est une activité servile et c’est une activité visant à produire quelque chose qui peut être présentée pour un certain usage. Le lit de l’artisan n’est en aucune manière ni imité ni représenté. En tant que son activité relève de la poièsis il met bien en jeu aussi une technique mais ça n’est pas au sens strict une technique poétique. La poétique (ou poïétique qui conviendrait mieux ici) est une certaine modulation de la poièsis qui esquisse, sans la nommer comme telle, une différence entre une poièsis productive et une poièsis représentative. La différence entre Aristote et Platon est que le second interprète cette différence sur une base ontologique : la poièsis productive a plus de réalité que la poièsis représentative mimétique. Il y a bien toujours une part de production dans la poièsis représentative, mais cette production qui fait appel à des matériaux aussi variés que le bois, la toile, les pigments, les pinceaux, etc. ne vise qu’à produire un support pour une représentation. C’est vrai aussi des matériaux et outils de l’artisan mais ceux-ci ont pour finalité la présentation. C’est, comme on verra, dans cette différence entre une poièsis présentative qui produit en « copiant » et une poétiquereprésentative qui produit en « imitant », que pourra éclore au début du 20ème siècle avec le ready-made la tentative de faire voler en éclat cette séparation faisant en sorte que le lit représenté soit aussi bien présenté.
L’imitation ou la représentation ne constituent pas en elles-mêmes une quelconque « spécificité » de l’aire d’œuvrement occidentale, mais bien la thématisation d’une poièsis présentative et d’une poétique représentative, à la fois si proches puisque reposant sur la triangulation démiurge-travail-technique, et si éloignées puisque l’une ne peut atteindre que la présentation et l’autre la représentation.
Interprétation, écriture
Mais sur quoi repose la distinction entre les deux sortes de « poésie » et les deux espèces de « producteurs » qui apparaissent dans notre diagramme 1.1 ? La raison de ce partage est que la poésie, au sens strict, est une poièsis qui s’emploie à faire advenir quelque chose dans ces matériaux tels que le langage et le son, qui paraissent immatériels et liés au temps. Cette « immatérialité » garantit de fait une affinité ontologique avec l’esprit. Dans son Esthétique, Hegel donne encore une définition de la poésie conforme à cette tradition, tout en accentuant plus encore sa dimension spirituelle : « La poésie est l’art universel de l’esprit devenu libre en soi-même, esprit dont la réalisation n’est pas liée à un matériau extérieur sensible, et qui ne s’épanche que dans l’espace et le temps intérieurs des représentations et des sentiments20. » Hegel (comme Platon du reste) fait comme s’il ignorait que la poésie pouvait être écrite, ou il fait comme si cette possibilité existait certes comme une réalité triviale mais ne méritait pas qu’on s’y attarde21.
La poièsis au sens strict ne semble pas produire un objet séparé du poète ou du musicien. Elle n’est pas strictement ob-jective, même si le poème est bien quelque chose qui peut se transmettre et être accaparé par d’autres à la manière d’un bien, car je peux l’écrire, c’est à dire l’enregistrer. La partition écrite ou le livre de poèmes sont bien des objets au même titre qu’un tableau. Mais, aux yeux de Platon et de ses contemporains, et même bien avant, le poème n’est véritablement poème que lorsqu’il est dit, de même que la musique n’est véritablement musique que lorsqu’elle est jouée22.
Que le poème n’existe que dans la temporalité de son énonciation, c’est aussi ce que dira Valéry deux mille cinq cents ans plus tard dans sa poétique. « Tout ce que j’ai dit jusqu’ici se resserre en ces quelques mots : l’œuvre de l’esprit n’existe qu’en acte. (…) Un poème sur le papier n’est rien qu’une écriture soumise à tout ce qu’on peut faire d’une écriture. Mais, parmi toutes ses possibilités, il en est une, et une seule, qui place enfin ce texte dans les conditions où il prendra force et forme d’action. Un poème est un discours qui exige et entraîne une liaison continuée entre la voix qui est et la voix qui vient et qui doit venir. (…) Ôtez la voix et tout devient arbitraire. (…) C’est l’exécution du poème qui est le poème23. »
Platon n’aurait sans doute pas démenti ce passage qui semble directement inspiré de son Phèdre où l’on sait que l’écriture est dénoncée pour son rôle corrupteur de la mémoire, et parce que le poème écrit présente le grave défaut de ne pouvoir être interrogé, comme on peut interroger le poète vivant sur ce qu’il a voulu dire - mais là, sans doute, Valéry, « disciple » de Mallarmé, répondrait que le poète n’a pas nécessairement « voulu » dire quelque chose selon la manière naïve dont on se représente ce vouloir dire.
Cependant, Valéry ne recrée-t-il pas trop hâtivement cette unité de la poièsis que Diotime avait défaite ? Comment prétendre en effet qu’une peinture ou une sculpture pourraient être des « œuvres de l’esprit » qui n’existeraient que dans l’acte de les produire, au même titre que des poèmes n’existeraient que dans le moment où une voix les incarne ? Car peinture et sculpture ont bien une existence après l’acte qui leur a donné naissance. Ce qui est vrai en revanche, c’est qu’une fois produites, les œuvres qui relèvent de ces poièsis particulières que sont la peinture ou la sculpture, échappent à leurs producteurs. Elles attestent bien de la présence d’une forme d’interprète, mais celui-ci n’agit pour ainsi dire qu’une seule fois dans un matériau donné24. Elles n’ont plus besoin de lui au même titre que le poème a encore besoin du poète ou de l’interprète pour être dit, ou la musique du musicien pour être jouée.
Le poème ne disparaît pas après avoir été dit. Il est sauvegardé dans la mémoire vivante de l’interprète. Il peut se passer de l’écriture nous dit implicitement Platon, et c’est bien comme ça que l’on présente les rhapsodes qui étaient ces interprètes capables de mémoriser l’entièreté de L’Iliade qui pourra être encore interprétée mille ans après son apparition même si le monde qui l’a vue naître ne nous est plus accessible.
Une certaine forme d’écriture produit donc du désœuvrement dans les deux moitiés qui constituent la poièsis : s’agissant de la musique et de la poésie parce que l’écriture ne peut pas restituer ce qui se produit dans l’acte même d’interprétation qui a toujours des conditions de lieux et de temps particulières. En cela la poésie ne peut être assimilée à la littérature, qui ne figure pas en tant que telle dans la liste des technai et qui en tout cas ne s’interprète pas au sens d’un poème qui est dit, ou d’une tragédie qui est jouée. Et en ce sens la littérature semble plus proche de poétiques comme la peinture ou la sculpture en ce qu’elle produit une chose, un livre. Il faudra attendre Mallarmé pour que, par la médiation de l’écriture précisément, la poésie et le livre tendent à ne faire qu’un. Mais nous n’en sommes pas encore là.
S’agissant des autres « arts », l’écriture comme désœuvrement n’est pas aussi explicite, car on n’écrit pas une peinture ou une sculpture - à la rigueur une gravure se rapproche de cette technè qu’est l’écriture. Ce qu’ont en partage l’écriture et ces arts qui ne font pas appel à l’interprétation, et dont les produits sont pour ainsi dire achevés après l’acte d’œuvrement, c’est précisément cette permanence, cette stabilité de la trace, du marquage d’un matériau au moyen d’un calame ou d’un poinçon.
On a pas toujours bien prêté attention au fait que la fameuse comparaison d’Horace dans son Ars poetica (technè poiétikè !) entre poésie et peinture (ut pictura poesis, erit quae…, v. 360), que les peintres de la Renaissance réinterpréteront à leur avantage en la renversant - ut pœsis pictura…-, n’est possible que si justement on rapporte ces deux poétiques à leur dimension d’écriture. Dans son texte (v. 360-365), Horace justifie cette comparaison, sans trop s’y étendre, en disant que, dans un poème, on peut considérer les choses à distance variable, de près ou de loin, comme on peut le faire sans difficulté en présence d’une peinture. Or cette variation de perspective, facile avec la peinture et la sculpture, est beaucoup plus difficile avec la poésie (et a fortiori avec la musique) si celle-ci n’est pas stabilisée sous forme de texte que l’on peut embrasser d’un seul coup du regard à la manière d’un tableau. Le poème qui est dit passe sans que l’on puisse prendre vis-à-vis de lui du recul ou se pencher sur un détail, car il faut suivre la progression poétique en tant qu’il est « liaison continuée entre la voix qui est et la voix qui vient et qui doit venir » (Valéry).
Lorsque Lessing va dire dans son analyse du Laocoon qu’il faut en finir avec cette comparaison entre peinture et poésie, avant d’y déceler comme on le fait d’habitude l’annonce d’une bifurcation radicale vers la modernité et sa libération des arts à proportion de leur spécificité technique, il faut d’abord y voir une invitation à revenir aux fondamentaux de l’aire d’œuvrement occidentale où poésie et peinture sont séparées par une barrière d’espèce. Si elles sont séparées par une telle barrière, c’est que la première est diachronique et la seconde synchronique. Mais à quelle condition la première est-elle diachronique ? À la condition bien sûr de ne considérer la poésie qu’en tant que poésie « en acte », autrement dit produite par une voix dont Valéry nous dit que ça n’est pas n’importe laquelle : « cette voix doit être telle qu’elle s’impose et qu’elle excite l’état affectif dont le texte soit l’unique expression verbale. » Le poème écrit relève lui en revanche de la synchronicité et son écriture, droite ou penchée, importe peu - pour l’instant.
Qu’avaient fait les peintres de la Renaissance en réinterprétant le ut pictoria poesis d’Horace à leur avantage ? Ils avaient fait subir à l’aire d’œuvrement telle que nous avons commencé d’en ébaucher grossièrement les contours, un réaménagement consistant à faire passer la peinture du côté de la poièsis au sens strict, laissant de l’autre côté de la barrière les « autres arts », qui n’auront de cesse de vouloir accomplir ce saut à leur tour.
D’où ce nouveau diagramme :
Diagramme 1.2
Est-ce que Lessing casse cette logique d’exclusion et remet tout à plat ? Non bien sûr ; et ceci nous amène à dire qu’un des traits fondamentaux de l’aire d’œuvrement occidentale est que si la partie gauche du diagramme 1.2 ne cessera de s’enrichir au cours du temps de nouveaux membres (la peinture, la sculpture, la photographie, la bande dessinée, etc.), la partie droite ne se videra jamais totalement, comme on peut le voir avec le statut qui est celui des arts appliqués - et donc des artisans, de ceux qui se distingueraient des autres par le côté « essentiellement » manuel de leur travail.
Remarquons au passage que si poièsis désigne aussi bien la production en général, le passage du non-être à l’être, que le résultat sous forme d’une œuvre spécifique, on ne voit jamais la création « en général » mais toujours une forme particulière de poétique. La poièsis « en général » voudrait dire en quelque sorte que la technè a disparu et qu’il ne reste qu’une poièsis pure, voire ultra-pure. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la remarque de J.-L. Nancy consistant à dire que « dès qu’il a lieu, l’« art » s’évanouit ; il est un art, celui-ci est une œuvre26». Et il ajoute : « la technicité elle-même, c’est aussi bien le « désœuvrement » de l’œuvre, ce qui la met hors de soi, à toucher l’infini. Le désœuvrement technique ne cesse pas de forcer les beaux-arts, de les déloger sans cesse du repos esthétisant27. » Si l’on revient aux deux diagrammes précédents, on voit qu’aussitôt après l’avoir posée, il faudrait barrer poièsis qui se tient en position de genre, car on ne connaît jamais la poièsis que sous une forme spécifique - qui ne peut jamais être purement « immatérielle ». Même déclamé, le poème l’est en un certain lieu et un certain temps par un certain interprète doté de telle voix, avec une prosodie plus ou moins parfaite. C’est un événement strictement local, ce qu’il n’est plus lorsque qu’il est enregistré sous forme imprimé.
Le trait sur poièsis renvoie à un désœuvrement qui est à proprement parler ontologique : il n’y a pas d’être-œuvre de la poièsis indépendamment de telle ou telle de ses manifestations, indépendamment de son accouplement à une technique d’où résulte l’œuvrement, indépendamment d’une écriture28.
Cependant, que la poièsis ne soit pas réductible à la technique, qu’elle puisse lui échapper, qu’elle soit libre par essence, c’est bien ce dont nous sommes intimement convaincus. Toute création que l’on ne peut semble-t-il libérer de cette pesante tutelle nous apparaît être déjà entrée dans le défilé mortel du désœuvrement en vertu duquel ce qui relève purement de la technè n’est pas de l’art. Jamais jusqu’à aujourd’hui l’aire d’œuvrement occidentale n’est parvenue à s’affranchir de ce dilemme auquel la thématisation de la possibilité d’un art non-humain donne encore plus de relief. Mais quel est cet espace que semble accaparer ainsi la technique au détriment de la poièsis au sens de création « pure » ? Nous lui donnons habituellement le nom de liberté. Et la « preuve » c’est que nous ne parlons pas d’« œuvre » à propos de l’animal dont nous sommes prêts à reconnaître qu’il peut faire des choses merveilleuses mais dont nous concevons qu’il ne « crée » qu’en obéissant à son instinct, de même que nous concevons que le robot ne « crée » que par abus de langage puisqu’il ne fait que suivre les instructions d’un programme et qu’il n’est qu’un outil. Pourquoi l’animal ou le robot ne créent pas d’œuvres ? Parce que justement on ne peut y lire la liberté que l’on attache implicitement à la poièsis. Pourtant, Platon ne fait aucune allusion à la liberté dans le passage cité du Banquet. La liberté est implicite dans cette aire d’œuvrement mais elle n’est pas thématisée comme attribut du démiurge humain, du poète. Sa thématisation explicite et indispensable interviendra beaucoup plus tard. Chez Platon, cette liberté implicite est plutôt liée à la technique qui est appliquée différemment selon les démiurges, le peintre, mais aussi le poète, incarnant des producteurs disposant d’une liberté quasi infinie de créer des apparences de choses réelles.
Hiérarchies
Explorons plus avant les gradins de quelques-unes des hiérarchies que nous avons croisées ici et là en nous demandant s’il n’y aurait pas une autre raison pour laquelle Platon instaure un tel partage entre poètes au sens strict (et donc poèmes au sens authentique) et « autres démiurges » ? Outre l’interprétation, y aurait-il quelque chose qui appartient spécifiquement à la poièsis des poètes et des musiciens qui justifierait cette séparation ? Le court passage du Banquet ne dit rien là-dessus. Il faut pour cela se transposer dans un autre dialogue intitulé Ion, qui est le nom d’un rhapsode, autrement dit de quelqu’un qui récite, interprète, des œuvres de poètes – par exemple Homère.
Comme dans la plupart des dialogues de Platon, il s’agit pour Socrate de déstabiliser son interlocuteur en le mettant face à ses contradictions. Le levier de sa dialectique c’est justement l’interprétation d’Homère dont Ion se prétend le maître inégalé (le trait commun de tous les adversaires de Socrate est, comme on sait, d’être soit naïfs soit présomptueux). Au cours de leurs échanges, Socrate démontre à son interlocuteur qu’il n’est qu’un interprète au service d’un dieu et que le poète qui crée le poème « original » (notion totalement anachronique ça va sans dire), forme avec le rhapsode et l’auditeur, une chaîne aimantée (536a) le long de laquelle se transmet l’attraction du dieu - sorte d’énergie (dunamis) que Socrate va qualifier de divine (theia). L’équilibre que nous avons souligné précédemment entre « création » (poièsis) et technique (technè) semble ici rompu au profit de la première. Si tu parles si bien d’Homère dit Socrate à Ion, ça n’est pas du fait de ta technique comme tu le crois (533d), mais en raison d’une force de nature divine. Et ça n’est pas non plus grâce à leur technique que tous les bons poètes épiques déclament tous ces beaux poèmes mais parce qu’ils sont inspirés et possédés (