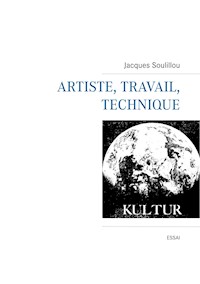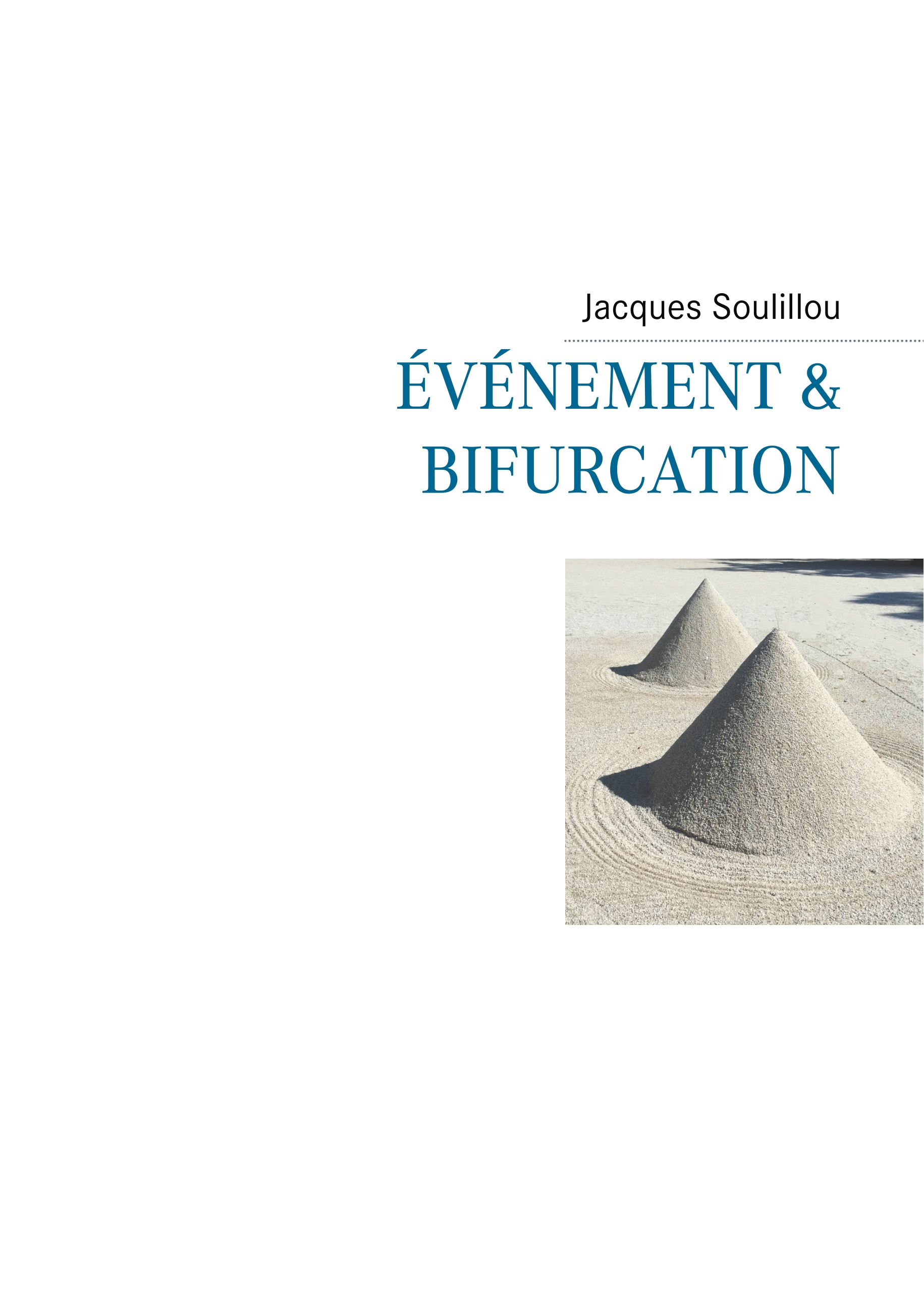
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre revisite la question centrale de l'événement par la médiation de la bifurcation et du un - comme dans la question qu'est-ce que un événement ? La bifurcation détient la clef pour consacrer l'événement comme un car elle seule peut servir d'étalon pour mesurer la distance qu'il reste à accomplir pour l'atteindre. Aussi bien, l'événement qui parviendrait au un marquerait la fin de l'histoire. Il serait devenu le dernier événement. Ce qui est peut-être son rêve le plus secret.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR :
Guido Biasi, 1970-1978, tabula, insula, camera, Shakespeare & company ; collection Théories et pratiques artistiques Paris, 1979, 125 p.
Le Décoratif, éditions Klincksieck, Paris, 1990 ; collection d’Esthétique, 108 p ; réédition revue et augmentée en 2016.
Rives coloniales, architectures de St Louis du Sénégal à Douala, (directeur de publication), éditions Parenthèses et ORSTOM, 1993, 316 p, illustrations et plans.
L’Impunité de l’art, éditions du Seuil, Paris ; collection La couleur des idées, 1995, 350 p. Publié avec le soutien du Centre national du livre. Version électronique en 2019
Contemporary African Art (en collaboration avec André Magnin); éditions Harry N. Abrams, New York / Thames & Hudson, Londres, 1996, 192 p., illustrations.
L’Auteur mode d’emploi, L’Harmattan, Paris, 1999, 160 p.
Le Livre de l’ornement et de la guerre, éditions Parenthèses, collection Eupalinos, Marseille, 2003, 153 p.
Esthétiques du détachement, Sémiose éditions, Paris, 2013. Illustrations de Erwann Terrier, 174 p.
artiste, travail, technique, Books on demand, Norderstedt, Allemagne, août 2019, 316 p. Version électronique et papier.
Traductions de l’allemand :
Du style et de l’architecture, écrits 1837-1869 [Gottfried Semper], éditions Parenthèses, collection Eupalinos, Marseille, 2007. Publié avec le soutien du Centre national du livre.
La Nature des cultures [Die Natur der Kulturen] et MSC [CSM] de Heiner Mühlmann ; octobre 2010, éditions Parenthèses, Marseille.
La forme sans ornement [Die Form ohne Ornament] de Dr. Wolfgang Pfleiderer in Esthétiques du détachement, Sémiose éditions, Paris, 2013.
Traduction de l’anglais (américain) :
Le Paradigme du tapis [The Carpet Paradigm] de Joseph Masheck, juin 2011, éditions du Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO), Genève.
Table des matières
I L
A SITUATION
:
RIEN ET QUELQUE CHOSE
II L
OCALITÉ STRICTE ET TRANS
-
LOCALITÉ
III B
URIDAN
IV S
TABILISATEURS DE TRAJECTOIRE
V M
ÉTAPHYSIQUES CORPUSCUAIRES
VI I
NTERPRÉTATIONS CORPUSCULAIRES ET ONDULATOIRES
VII I
NTERFÉRENCES CONSTRUCTIVES ET DESTRUCTRIVES
VIII É
VÉNEMENTS
-
AUSSI
-
BIFURCATION
IX B
IFURCATIONS
«
LÀ
-
DEVANT
»
ET BIFURCATIONS IN
-
APERÇUES
X M
UTATIONS ET BIFURCATIONS
XI S
ITES ET QUASI
-
SITES
XII P
OINTS ET POINTS
XIII C
OUPURES RATIONNELLES ET IRRATIONNELLES
XIV P
HILOSOPHIE ET MATHÉMATIQUE
XV P
UISSANCES DE L
'
ÉVÉNEMENT
XVI P
OSSIBLES ET IMPOSSIBLE
XVII É
VÉNEMENT ET VÉRITÉ
XVIII I
NDIVIDU GÉNÉRIQUE ET INDIVIDU SPÉCIFIQUE
XIX F
IDÉLITÉS
XX N
OMMER L
'
ÉVÉNEMENT
XXI D
IRE L
'
ÉVÉNEMENT
XXII A
RRIVÉE
-
SELON L
'
ESPACE
XXIII A
RRIVÉE
-
SELON LE TEMPS
XXIV E
NTREMETTEURS ET PRÉCURSEURS
XXV A
TTENTE ET ANTICIPATION
XXVI I
NDIVIDU
-
OBJET ET INDIVIDU
-
PERSONNE
(É
LOGE DE L
'
ÉRRANCE
)
XXVII É
VÉNEMENTISATION DE LA NATURE
XXVIII E
SQUISSE D
'
UNE TYPOLOGIE
(P
UISSANCES ÉVENEMENTIELLES DE PREMIER ET SECOND ORDRE
)
XXIX Q
U
'
EST CE QUE
UN ÉVÉNEMENT
?
XXX B
IFURCATIONS DESTINALES ET INTERDITES
Index des noms propres de personnes
I LA SITUATION : RIEN ET QUELQUE CHOSE
Every Something is an Echo of Nothing
John Cage
S’il fallait attribuer une mention à la question philosophique qui incarne le mieux aux yeux du grand public le caractère vain et fumeux des interrogations que la philosophie se pose à propos du monde, nul doute que le « pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » l’emporterait haut la main. Cette question apparaît au détour du § 7 des Principes de la nature et de la grâce. Fondés en raison (1714) de Leibniz. Et c’est bien sûr ce semblant de sous-titre – « Fondés en raison » - qui est important car la question porte sur ce qui fait que, là où il n’y avait rien, il y a maintenant quelque chose. Et ceci quelle que soit la situation.
Or la réponse à cette question en apparence déroutante est singulièrement triviale : s’il y a quelque chose là où auparavant il n’y avait rien c’est qu’entre ce rien et ce quelque chose il s’est passé quelque chose. Et ceci n’est pas moins certain que le Cogito. Juste avant de formuler sa question, Leibniz nous avait du reste déjà donné la réponse : « … que rien ne se fait sans raison suffisante ; c’est-à-dire que rien n’arrive… ». Autrement dit seule la présence avérée d’un événement justifie d’avancer une raison suffisante à quelque chose qui arrive, mais qui n’arrive jamais seul - toujours accompagné ou précédé par l’événement, qui est un autre quelque chose.
Le quelque chose se trouve de fait aussitôt dédoublé en un quelque chose-résultat – le changement observé (E1) - et en quelque chose-cause de ce résultat (E2). Ce qui est observé en premier c’est le quelque chose-résultat (E1). Par exemple, ouvrant les volets le matin j’observe que la terrasse est mouillée (E1), d’où j’en déduis qu’il a plu pendant la nuit (E2) ; l’ordre d’apparition est l’inverse de l’enchaînement causal. Mais il n’y a aucune raison pour que le processus du dédoublement s’arrête en (E2) car il y a forcément quelque chose qui fait que quelque chose… et ainsi de suite. Une première flèche de temps apparaît qui remonte en direction du passé ← (E3) ← (E2)← (E1) et qui tout en remontant engendre un réseau quasi infini de bifurcations.
Or la question qui se pose dans le sillage de ce premier résultat c’est : dans quelle mesure cette diffraction du quelque chose affecte-t-elle le « rien » ? A priori la réponse paraît être non : quelque chose ne peut pas résulter de rien ; et pourtant nous avons reconnu comme trivial le fait qu’il fallait admettre que quelque chose se soit produit pour que là où il n’y avait rien on constate qu’il y a désormais quelque chose. Et c’est là toute la question : il ne suffit pas de stipuler la présence nécessaire du quelque chose-événement pour passer du rien au quelque chose, il faut aussi montrer quel lien existe entre l’événement et le rien. S’il n’y en a pas, si le rien est strictement rien, alors il est difficile d’imaginer de pouvoir aller plus loin.
Remarquons au passage que si l’on avait pu observer directement la pluie tomber, alors le dédoublement entre (E1) et (E2) n’aurait pas lieu d’être ; ils n’auraient fait qu’un. Il peut donc se faire que dans certains cas, l’événement nous apparaisse comme un et que dans d’autres nous le dédoublions entre un résultat et une cause. Mais dans tous les cas « événement » voudra dire changement d’état entre un avant (0) et un après (1) qui suscite l’émergence de la flèche du temps du passé (là où il n’y avait rien) au présent (là où il y a quelque chose). Ce quelque chose qui apparaît est par définition « nouveau » puisqu’avant il n’y avait « rien ».
En dépit des premières informations importantes que nous procure l’examen rapide de la question du passage du « rien » au « quelque chose », il y a cependant une chose très importante que nous ignorons à propos de cette bascule, à savoir l’intervalle de temps pris par le passage qui semble se faire de façon instantané1. Dans mon exemple très simple cet intervalle peut être ramené à une nuit. Mais il va de soi que dans d’autres situations cet intervalle peut être beaucoup plus court (quelques minutes) ou beaucoup plus long (un siècle). Autrement dit, nous avons bien cette flèche du temps, qui est comme un vecteur indiquant la direction de la bascule du 0 vers le 1, mais nous ignorons tout de sa grandeur. Supposons qu’elle excède la durée d’une génération, cela voudra dire que cette bascule ne pourra pas être observée directement pendant la génération qui correspond à l’intervalle de temps mais à la génération suivante. Or on verra que cette considération de l’intervalle est très importante lorsqu’on aborde la relation de l’événement à la bifurcation. Intuitivement nous avons tendance à ramener l’intervalle de temps de la bascule événementielle à des durées à « taille humaine », de quelques journées (les Trois glorieuses) à quelques années (la Première guerre mondiale). La question va se poser de savoir si au-delà d’un certain intervalle, la nature même de l’événement change et pourquoi.
*
La principale difficulté à laquelle nous confronte l’agencement décrit précédemment c’est bien sûr la présence du « rien » en position d’origine, car on répugne instinctivement à admettre que du rien puisse résulter quelque chose, comme s’il en était la cause. « Rien, c’est rien » ou alors c’est « quelque chose ». Or tout l’enjeu c’est justement que le rien puisse aussi être quelque chose, et inversement le quelque chose rien.
Si le signal rétroactif (E2) ← (E1) que l’événement constaté sous forme de résultat envoie en direction du passé interroge la cause du quelque chose (1) apparu dans la situation là où il n’y avait rien (0), cette cause ne peut être l’événement lui-même qui serait alors cause de soi, ce que le principe de raison exclut. Par exemple la pluie n’est pas cause d’elle-même mais de l’humidité constatée sur la terrasse.
Ce signal nous dit que cette cause doit se situer avant, dans la situation qui apparaît alors comme son site. Contrairement à notre première estimation, comme lorsqu’on regarde un paysage de loin où rien ne semble bouger, il nous apprend que la situation n’était pas rien, mais bien un espace où il se passe « des choses » même si elles ne se signalent pas immédiatement à mon attention.
C’est la situation qui fait le lien entre le rien et le quelque chose au sens où le rien tient lieu de point de référence quant à l’état d’une situation. Il n’est pas le néant qui, lui, n’est pas une « situation » car on peut imaginer que n’importe quoi en sorte, de même qu’en logique classique on peut déduire tout et son contraire de ex falso quodlibet. Le rien est nécessairement toujours quelque chose, le quelque chose des conditions initiales de la situation, avant l’événement – conditions dont il est impossible d’avoir une connaissance globale précise, ça va sans dire.
L’erreur que l’on commet à propos du « rien » consiste à monter aussitôt aux extrêmes. Et la métaphysique est, depuis Parménide, une telle montée aux extrêmes (l’Être, l’Idée, Dieu, le Premier moteur, etc.). Leibniz lui-même, dans le texte cité, tout de suite après le paragraphe où apparait sa fameuse question, nous invite à une telle remontée lorsqu’il invoque Dieu comme « raison suffisante de l’univers », « dernière raison » au-delà de laquelle on ne peut plus aller. Mais la « dernière raison » échappe au principe de raison ; en dépit des apparences elle ne peut pas être « raisonnable ». Et l’on sait par ailleurs que même si Leibniz pose Dieu comme condition initiale en « dernière raison », même cette puissance absolue a ses contraintes : parmi l’infinité des possibles et de leurs conditions initiales il faudra faire un choix. Mais il y a pas en revanche, pour un monde ou univers donné, une infinité de conditions initiales. Nous reviendrons là-dessus à propos de l’examen du possible. Confronté à cette infinité des possibles la méthode la plus rationnelle consiste à choisir soit le meilleur - soit le pire2.
Pour illustrer ce lien fondamental entre le « rien » de la situation et le « quelque », je prendrai trois exemples, l’un trivial, deux autres extraits de deux célèbres textes philosophiques relevant de domaines très différents. Le premier est un exemple tiré d’une scène de la vie quotidienne, que nous avons tous vécue, où nous demandons à une personne qui écoute les nouvelles du jour à la radio ou à la télévision, s’il y a « quelque chose », et qui répond : « rien ». C’est peut-être ce que Louis XVI s’est entendu dire le 14 juillet 1789 par un de ses conseillers avant de consigner cette réponse d’anthologie dans son journal. Ce rien veut simplement dire que l’état de la situation tel qu’on le connaissait la veille, est resté inchangé. Il a pu se passer beaucoup de choses en fait (des morts et des naissances, des émeutes, des crimes, des grèves, etc.). Mais tout ceci n’est « rien » pour celui qui attend une nouvelle sur l’état de la situation qui lui montrerait que quelque chose de nouveau s’est produit.
Le premier des deux autres exemples provient du livre II du De natura rerum de Lucrèce qui expose la théorie matérialiste de l’apparition du monde, sans faire appel à aucune puissance divine. Or cette théorie ne part pas de rien même si elle a l’ambition de nous expliquer l’origine de toute chose. Elle part d’une situation qui est déjà quelque chose de considérable, à savoir une pluie d’atomes tombant verticalement dans le vide sans collision. C’est ça le « rien » de la condition initiale qui va permettre de dire si quelque chose s’est produit. Le génie de Démocrite c’est d’avoir trouvé par une expérience de pensée, une condition initiale qui, sans être une entité immatérielle, permet cependant de tout faire, non seulement un monde mais des mondes.
On ne sait ni combien d’atomes il y a, ni pendant combien de temps cette pluie a duré, ni même ce qui l’a provoquée. Mais ce n’est pas ça qui intéresse Lucrèce. Ce qui l’intéresse, c’est de nous faire comprendre que si on se donne cette hypothèse de départ et qu’on imagine qu’un atome ait dévié un tant soit peu de sa course, alors, là où il n’y avait rien (à savoir une pluie d’atomes tombant dans le vide), apparaît soudain la possibilité d’un monde par l’entremise de cet événement qu’est le clinamen. Le clinamen est quelque chose, la pluie verticale des atomes dans le vide n’est rien.
Mon dernier exemple est tiré du Léviathan de Hobbes et concerne sa fameuse guerre de tous contre tous : « Par cela il est manifeste que pendant ce temps où les humains vivent sans qu’une puissance commune ne leur impose à tous un respect mêlé d’effroi, leur condition est ce qu’on appelle la guerre ; et celle-ci est telle qu’elle est une guerre de chacun contre chacun3. » Dans cet état de nature beaucoup d’événements violents se produisent mais tout ceci n’est rien dans la mesure où c’est toujours la même chose.
Dans les deux derniers cas il faut la présence d’observateurs extérieurs (Lucrèce et Hobbes) qui attestent ou bien que la situation reste inchangée (les atomes continuent de tomber à la verticale dans le vide et les hommes continuent leur guerre de tous contre tous), ou bien que quelque chose s’est produit qui a mis fin à la trajectoire inertielle du rien.
Le rien est en effet un quelque chose doté d’une inertie à laquelle ne peut mettre fin qu’une force extérieure. Par défaut, toute situation possède une trajectoire inertielle. Il est intéressant à ce égard de rapprocher la question de Leibniz du principe d’inertie qui forme la première des trois lois de Newton, l’un des marqueurs fondamentaux de la nouvelle physique par rapport à la physique aristotélicienne : « Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque chose n’agisse sur lui et ne le contraigne à changer d’état. » « Repos » et « mouvement rectiligne uniforme » représentent ici la situation. Cette situation peut rester « en l’état » un temps indéfini nous dit cette première loi (dont Galilée et Descartes avaient séparément jeté les bases), si quelque chose ne se produit pas qui vient en modifier l’état.
Les deux co-découvreurs du calcul infinitésimal énonçaient ainsi chacun à leur manière le premier théorème concernant l’événement : un événement est la perturbation de la trajectoire d’une situation qui serait restée « en l’état » – un jour, une année, une éternité - aussi longtemps que cette perturbation ne se serait pas produite.
Or pour pouvoir évaluer le changement provoquée par la perturbation, il faut un référentiel qui joue un rôle fondamental dans cet autre principe que l’on doit à Galilée, le principe de relativité, repris par Newton et généralisé par Einstein. Ce principe dit en effet que les lois physiques restent inchangées par rapport à des référentiels qui peuvent par ailleurs être différents selon que tel observateur se déplace par rapport à tel autre. Ainsi la balle que le voyageur debout dans un train en déplacement à vitesse constante laisse tomber tombe verticalement et non de manière oblique. La même chose peut être observée dans cet autre référentiel qu’est le quai de gare « en repos » par rapport au train (bien qu’en mouvement par rapport au soleil). C’est par rapport au référentiel « au repos » de la situation que l’on peut dire s’il y a eu événement. Et c’est vrai aussi des situations sociales. Qu’il se produise en permanence une multitude d’événements dans la situation prise comme référentiel « au repos » est une évidence. Mais cette multitude ne fait pas événement au sens où par rapport au référentiel de la situation telle qu’on l’observe au temps t, la trajectoire inertielle paraît inchangée. Si le changement de trajectoire peut être imputé à un événement celui-ci est nécessairement autre que tous les événements que l’on pouvait observer dans la situation avant qu’il se produise en ce sens qu’il s’accompagne d’une bifurcation de situation. Celle-ci abandonne la trajectoire inertielle pour en adopter une nouvelle. La bifurcation nous fait passer de la multitude événementielle qui compte « pour rien » à la situation nouvelle où l’on reconnaît la présence de ˂ un événement4 ˃.
Dans son pamphlet de janvier 1789 écrit à la veille de la réunion des Etats généraux, l’abbé Sieyès posait trois questions célèbres qui méritent d’être rappelées car elles contiennent tous les termes qui nous intéressent :
« 1. Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Tout.
2. Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien.
3. Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. »
Le Tiers-Etat n’est donc rien aussi longtemps que la trajectoire de référence du régime politique de la France en janvier 1789 se confond avec sa trajectoire inertielle où l’on peut être « tout » mais n’avoir aucune incidence sur cette trajectoire. Sans qu’on puisse dire que Sieyès « prédit » la révolution à venir, il donne néanmoins la puissance qu’aurait un événement où ce qui n’est « rien », tout en représentant une force qui est « tout », aspirerait à devenir « quelque chose ». La réponse la plus évidente est : un tremblement de terre de grande magnitude.
*
Que le rien soit déjà quelque chose signifie ainsi qu’il est tout sauf vide, au sens si l’on veut d’un ensemble vide (Ø). En particulier il n’est pas vide de ces événements que l’on considère comme appartenant à l’ordre normal de la situation (par exemple les morts et les naissances). Ce rien est configuré de telle manière qu’il pourra donner lieu à un certain type d’événement. À chaque type d’événement correspond ainsi non pas le rien en général (qui reviendrait à en faire le néant) mais un rien spécifique. Par exemple le rien de l’atomisme ancien. Ou bien le rien de la philosophie politique de Hobbes. Qu’il n’y ait jamais eu rien de tel qu’une pluie d’atomes tombant verticalement dans le vide ou une guerre de tous contre tous, est très probable. Mais là n’est pas la question. La question est d’imaginer un agencement dont la trajectoire inertielle devra être perturbée par une force extérieure pour pouvoir passer dans autre chose.
Ce qu’apporte de nouveau ˂ un événement ˃ par rapport à une situation de référence est si énigmatique que certains philosophes – par exemple Heidegger dans sa méditation sur l’origine de l’œuvre d’art, mais nous verrons qu’il n’est pas le seul et que les auteurs peuvent rivaliser de formules toujours plus radicales – n’ont pas hésité à braver l’interdit de Leibniz à propos du principe de raison et suggéré que le principe de causalité lui-même était inapte à rendre compte de l’apparition de ce nouveau. C’est un pari risqué qui trouve cependant sa justification dans le constat que si quelque chose prétend être radicalement nouveau, ce ne peut être qu’au sens d’un quelque chose qui déjoue toute prévision à partir de la situation-ante dont il serait la suite « naturelle » ou « logique » ; le caractère nouveau de ce qui se produit sera d’autant plus fort que l’on est incapable de trouver le passage qui va du quelque chose au rien au point de remettre en question le principe de raison. Or on est sûr que ce passage existe puisque justement il y a quelque chose et non pas rien. On peut même tenter de se représenter son site dans la situation, mais c’est comme si entre les deux il y avait un vide énigmatique.
Toute la difficulté résulte du fait que l’événement censé apporter « quelque chose » de nouveau à la situation ne lui appartient pas puisqu’elle est le « rien ». Comme on l’a dit, ceci n’est pas contradictoire avec le fait qu’il peut se passer beaucoup de choses dans la situation mais pas « la chose » dont tel observateur dira qu’elle est nouvelle. Et l’on doit bien remarquer au passage que cette évaluation du quelque-chose-plutôt-que-rien pourra varier en fonction des observateurs. Ceci peut paraître anecdotique et trivial mais revêt une grande importance dès lors qu’il s’agit de statuer si le quelque chose est bien ˂ un événement ˃- ce qui suppose une forme de consensus. Car, et c’est l’envers de la médaille, il faut bien que l’événement soit d’une manière ou d’une autre aussi inclus dans la situation au titre de ses causes car il ne procède pas « de rien » au sens du néant, et il n’est pas non plus « cause de soi » comme le Dieu de l’Ethique de Spinoza.
Deleuze résume bien cette quadrature du cercle de l’advenue de l’événementiel lorsqu’il dit à propos des « choses » qu’elles « surgissent dans un ensemble qui ne les comportait pas encore, et doivent mettre en avant les caractères communs qu’elles conservent avec l’ensemble, pour ne pas être rejetées5. »
C’est cette double caractéristique de l’événement qui d’un côté n’appartient pas à la situation, car en ce cas il ne serait « rien » au sens où le ou les observateurs considèreraient qu’il n’est que « un » événement de plus parmi bien d’autres auxquels on ne prête pas attention, et qui de l’autre est nécessairement inclus dans la situation lorsqu’on essaie rétrospectivement d’en établir les causes (principe de raison), qui constitue toute la difficulté de statuer sur le « un » de ce qu’est un événement ?
Il n’y a pas non plus d’unité entre le rien et le quelque chose dans un troisième terme comme le fait Hegel à propos du devenir comme unité de l’être et du néant. Le quelque chose comme rien, ou inversement le rien comme quelque chose, n’est qu’un étalon de mesure pour décider s’il y a eu événement.
*
Venons-en maintenant à la bifurcation. À la différence de l’événement, la notion de bifurcation présente un profil beaucoup plus marqué par les mathématiques et il existe d’ailleurs une théorie mathématique de la bifurcation dont l’émergence date de la seconde moitié du XIXe siècle7 ; les « (mal nommées) « théorie du chaos » et « théorie des catastrophes » en sont des rejetons célèbres. Mais laissons cela pour l’instant de côté et partons d’une expérience que chacun a pu faire soit réellement à l’occasion d’un événement, soit seulement en pensée à la lecture du compte rendu d’un événement. Cette expérience conduit à voir aussitôt que derrière la notion d’événement comme passage du rien au quelque chose, se cache une bifurcation au sens où, chaque fois que se produit un événement, se pose rétrospectivement la question de savoir s’il aurait pu emprunter un autre chemin aboutissant à un autre quelque chose. On ne remet pas ici en question la pertinence du principe de raison, mais la prétention du passage à être unique au même titre que l’événement. Autrement dit, dans le sillage de l’événement, apparaît une (au minimum) bifurcation virtuelle ou « après-coup » conduisant à quelque chose d‘autre qui aurait pu aussi bien se produire à la place de ce que l’on a vécu. Cette bifurcation virtuelle ouvre un espace d’autres possibles et constitue par là même une forme d’interprétation minimale de l’événement qui est certes ce qui s’est produit, mais qui aurait pu se produire différemment, voire pas du tout (zéro événement fait aussi partie des possibles).
Les neurosciences nous ont appris depuis longtemps que la modélisation mentale d’une telle bifurcation virtuelle est une donnée anthropologique fondamentale. Elle consiste à remonter le chemin pour tâcher d’identifier le point où s’est produit la bifurcation qui a conduit au quelque chose advenu et fait surgir du même coup un ou des quelques choses non advenus plus favorables ou plus défavorables. Nous verrons plus avant qu’une telle modélisation avec un chemin et un point de bifurcation relève d’une interprétation que nous nommerons « corpusculaire ».
Cette bifurcation virtuelle ou « après-coup » du quelque chose non advenu ne doit pas être confondue avec ce que nous appellerons bifurcation « là-devant » que l’homme et certains animaux sont capables de thématiser sous forme de carte mentale du ou des chemins conduisant à un certain but8.
Cette capacité à se représenter, dans le sillage de l’événement advenu, une ou plusieurs bifurcations virtuelles associées confère à l’espèce qui en est dotée un avantage sélectif puisqu’elle pourra ajuster son comportement si la situation la confronte à un événement du même type, par exemple la rencontre avec un grand prédateur. La bifurcation virtuelle permet par ailleurs d’appréhender que ce qui advient n’est pas inéluctable et que d’autres possibles non advenus sont concevables dont les formes les plus élaborées ont pris le nom d’uchronie et d’analyse contrefactuelle.
La forme spontanée d’expression de cette bifurcation virtuelle associée peut être représentée par les exclamations du type « on a eu de la chance », « on l’a échappé belle », « ça aurait pu être pire », etc. L’une de ses formes culturelles les plus ancienne est le mythe du Paradis perdu - avec le paradis dans la situation du rien. Il ne se passe rien dans le paradis. Et c’est bien ça le problème comme on le verra à propos du rapport entre récit et événement. Par définition on ne peut se représenter que rétrospectivement le Paradis perdu qui est la bifurcation virtuelle implicitement associée à tout événement advenu qui conduit à regretter la situation-ante. Car le vrai bonheur est l’absence d’événement comme l’avaient si bien compris les Anciens, en particulier épicuriens et stoïciens.
Ce qui précède peut être résumé sous forme du diagramme élémentaire suivant :
Diagramme 1
Comme on le remarquera, nous avons dans ce diagramme inversé la succession E1 → E2, E1 n’est plus en position de résultat constaté mais d’événement qui a produit ce résultat. La flèche à contre-sens correspond à ce que nous avons appelé le signal rétroactif conduisant à la représentation d’une régression sans fin des causes.
Cette bifurcation virtuelle n’est pas non plus une bifurcation de situation dont on a laissé entendre le rôle important qu’elle allait jouer dans la suite de cette enquête. Cependant, à ce stade, l’événement (E1) incarne bien une bifurcation de situation dès que l’événement se produit puisqu’il rompt avec le rien de la situation-ante et lui impose de facto une autre trajectoire. Il est alors quelque chose (E2) et non plus rien. La bifurcation virtuelle ne se produit pas strictement en même temps que l’événement (E1), mais avec un décalage. Il faut préalablement avoir appréhendé l’existence de l’événement comme « quelque chose » (E2) pour que cette bifurcation apparaisse. Le temps écoulé entre E1 et E2 peut être très court mais il n’est jamais nul.
On verra cependant qu’une telle représentation de la bifurcation virtuelle associée repose sur une conception de la localité événementielle particulière qui n’est pas représentative de toutes les formes de localités événementielles.
L’originalité du système de Leibniz tient au fait de concilier la nécessité absolue que le passage du rien au quelque chose soit unique – Adam pécheur par exemple -, tout en ménageant un espace à la bifurcation virtuelle – Adam non-pécheur comme possible non advenu-, en se fondant sur cette idée que s’il y a bien passage unique, il résulte d’un choix opéré parmi une infinité de possibilités parmi lesquelles une seule pouvait être retenue. En grec ancien le mot tuchè (τύχη) désigne au sens premier le sort, dans le sens du bonheur ou du malheur, ce qui arrive par hasard en un certain lieu et un certain temps, comme Œdipe qui tue Laïos à la bifurcation des chemins qui conduisent à Delphes et Daulia (Y). Mais la tuchè peut aussi désigner le sort présent, autrement dit la situation. Et parfois même la nécessité. Et ce sont bien ces deux sens que l’on retrouve dans le couple événement/bifurcation virtuelle : la nécessité du passage par l’événement pour aller de rien à quelque chose et la nécessité de pouvoir se représenter une bifurcation virtuelle orientée soit vers quelque chose de mieux ou de pire non advenu.
1 Nous verrons au chapitre XII (« Point et points ») qu’une telle bascule « instantanée » de 0 à 1 peut être représentée par une fonction dite en « marche d’escalier » ou fonction de Heaviside du nom de son inventeur.
2Candide de Voltaire marche en équilibre sur la ligne immatérielle qui sépare ces deux mondes.
3 Hobbes, Léviathan, chap. 13 De la condition du genre humain à l’état de nature, trad. Gérard Mairet.
4 Cette notation sera explicitée plus en détail ultérieurement. Elle peut être interprétée à ce stade par la périphrase « ce qui est véritablement un événement ».
5L’image-mouvement T1, p. 11, éditions de Minuit, 1985. Italiques de moi. C’est peu ou prou, en beaucoup moins technique, ce que Badiou va faire dire au forcing du mathématicien Paul J. Cohen comme on verra au chapitre XVII « Evénement et vérité ».
6 Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, La doctrine de l’être, § 87 et 88, trad. Maurice de Gandillac, éd. Gallimard, 1970.
7 Dans son ouvrage intitulé Energie et stabilité, éléments de philosophie naturelle et d’histoire des sciences (2006), le mathématicien Claude P. Bruter note que c’est « dans un article paru en 1855 Sur l’équilibre d’une masse fluide animée d’un mouvement de rotation, que le terme « bifurcation » apparaît pour la première fois sous la plume de Poincaré » (p. 107 de la version électronique de l’ouvrage de C.P.Bruter).
8 Voir à ce sujet l’article de Andrew T.D. Bennet et al. à propos des cognitive maps chez les animaux : « Do Animals have Cognitive Maps ? » in The Journal of Experimental Biology 199, 219-224 (1996). Accessible en ligne. Les animaux ne semblent pas jusqu’ici en revanche capable de représentation de la bifurcation virtuelle associée à tout événement advenu.
II LOCALITÉ STRICTE ET TRANS-LOCALITÉ
Tenter de répondre à la question qu’est-ce que un événement ? est l’unique enjeu de ce livre. Ce n’est cependant qu’à la fin de notre parcours, au chapitre XXIX, que nous proposerons une réponse dont la formulation est liée à la thématisation du lien entre événement et bifurcation, et au statut du un.
L’explicitation des modalités de ce lien passe par l’examen de la question fondamentale de la localité que nous abordons dans ce chapitre et qui nous accompagnera tout au long de ce livre.
La notion de localité conditionne toute notre perception de l’événement que nous associons mentalement à un point qui a des coordonnées d’espace et de temps. Cette localité événementielle nous apparait triviale au même titre que nous apparaissait trivial le fait qu’il faille supposer que quelque chose s’était produit pour rendre compte de l’apparition du nouveau. Notre hypothèse de départ est que ce caractère trivial de la localité événementielle cache en fait une réalité plus complexe qui résulte du fait qu’elle n’est pas une mais qu’elle se redivise toujours en une localité au sens strict et une autre forme de localité que nous appellerons trans-locale pour des raisons que l’on verra après. L’événement est toujours soit l’un, soit l’autre. Eu égard à la localité l’événement « en soi » n’existe pas et l’image de la division du « un » en deux branches est inappropriée. Un événement pourra s’approcher très près de la limite qui sépare les événements strictement locaux des événements trans-locaux (nous en donnerons quelques exemples), mais jamais il ne pourra franchir cette « barrière d’espèce ». Même s’il devient « global ».
Le paradoxe est que l’événement dont on vient de dire qu’il ne peut jamais être « un », au sens d’une unité originelle qui se diviserait ensuite en une descendance stricte et une descendance trans-locale, aspire cependant toujours à être « un ». Il n’y a rien de pire pour un événement que de ne pas être < un événement >, autrement dit de n’être simplement quelque chose qui arrive et qu’on oublie aussitôt. Cette « aspiration » il l’a doit à la bifurcation. Il ne s’agit pas de la bifurcation entre la localité stricte et la trans-localité. La bifurcation ne peut se faire qu’à partir d’une trajectoire de référence qui est le rien, autrement dit l’inertie de la situation qui se prolonge inchangée à travers le temps jusqu’à ce que quelque chose arrive.
*
La distinction entre événements strictement locaux et trans-locaux montre qu’il convient de se méfier du caractère évident du caractère local de l’événement. Cette distinction a tellement d’implications que nous n’allons dans ce chapitre qu’en poser les bases. Nous verrons ultérieurement comment elle se décline selon que l’on considère le site événementiel, l’arrivée de l’événement dans un lieu, ou bien sa nomination, ou bien son anticipation, etc. Nous verrons aussi que l’association d’une bifurcation à tout événement, que l’on peut rapprocher, toutes choses égales par ailleurs, de celle établie par Louis de Broglie entre une particule et une onde, doit faire l’objet d’une modulation selon la nature de la localité.
Nous définissons un événement strictement local comme un événement dont les acteurs et les témoins reconnaissent la nature événementielle dans le moment où se produit l’événement. C’est le cas de la prise de la Bastille, de l’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, ou, dans un registre plus pacifique, du vote abolissant l’esclavage ou la peine de mort, ou donnant le droit de vote aux femmes, etc. Cet événement pourra être rapporté à d’autres, il pourra être déformé, etc., mais il n’empêche que pour un certain nombre de témoins, il a eu lieu et il est apparu aussitôt dans sa dimension événementielle. Il est strictement local car précisément des témoins peuvent prétendre avoir assisté à son arrivée un certain jour en un certain lieu. À cet événement est donc associé ce qu’en psychologie cognitive on appelle la mémoire épisodique qui désigne le processus par lequel on se souvient des événements vécus avec leur contexte (date, lieu, état émotionnel), et que l’on oppose ordinairement à la mémoire sémantique qui s’attache aux faits et aux concepts. Le fait de ne pas connaître avec précision la date ou le lieu d’un événement strictement local n’hypothèque cependant pas la localité stricte. Par exemple, même si on ne connaît pas avec précision ni le lieu ni la date de la naissance du Christ, même en se contentant de « né quelque part en Palestine durant l’occupation romaine », cela ne prive pas cet événement de son caractère strictement local, (le christianisme lui-même n’est pas en revanche un événement strictement local).
« Strictement local » ne veut pas dire non plus que l’événement devrait se dérouler nécessairement sur le modèle « ponctuel » de l’attentat de Sarajevo ou du lâcher de la première bombe atomique sur Hiroshima. La saint Barthélémy ou la Nuit de cristal mais aussi la Première et la Seconde guerre mondiales sont des événements strictement locaux qui ont eu pour scène plusieurs lieux dans Paris pour le premier, plusieurs villes d’Allemagne pour le second, plusieurs dizaines de pays pour les deux guerres mondiales. Une composante caractéristique de la localité stricte est celle de l’élément « déclencheur » ou « marquant » qui, selon les situations, pourra prendre la forme d’un ordre ou d’un cri invitant à engager le combat, d’un décret ou d’une annonce comme celle appelant en août 1914 à la mobilisation générale. On ne peut pas attribuer à de tels éléments d’être la cause de l’événement lui-même mais ils contribuent à l’enraciner dans la localité au sens strict.
La différence entre ce que nous appelons strictement local et trans-local ne repose pas en priorité sur la durée et l’étendue spatiale des événements. « Strictement » ne se comprend que dans son opposition à « trans-local » qui ne pourra être totalement explicité que sur le cours de plusieurs chapitres.
Le corollaire phénoménologique de la participation événementielle à l’événement strictement local, c’est qu’il est possible de convaincre, notamment par l’image, un ou des sujets qu’ils sont en présence d’un vrai événement alors même qu’il ne s’agit que d’un produit de synthèse. On verra comment les technologies modernes de l’image couplée à l’intelligence artificielle sont en train de rendre crédible chaque jour un peu plus la notion de faux événement strictement local, qui va bien au-delà de la simple distorsion des faits et des fameuses « fake news ». Le film culte Matrix est l’apothéose du faux Evénement.
La Révolution française (ou russe ou chinoise), la Renaissance ou la révolution industrielle sont bien des événements « locaux » mais leur localité n’est plus stricte ; elle est trans-locale, qui ne renvoie pas simplement au fait que ces événements se déroulent dans plusieurs lieux sur une « même » période de temps. Si on parle de leur site, alors il faut dire qu’il enveloppe plusieurs lieux, avec différentes circonstances, où, à chaque fois, on peut identifier des événements strictement locaux - Convocation des Etats généraux, prise de la Bastille, exécution du roi, bataille de Valmy, insurrection vendéenne, etc. s’agissant de la Révolution française qui, avec les autres exemples cités de révolutions de nature politique, économique et sociale, sont des événements trans-locaux qui semblent se situer très près de la ligne de démarcation d’avec les événements strictement locaux, sans jamais la franchir, nous verrons pourquoi. Leur site est pour ainsi dire « infini » en ce sens que, par exemple, les historiens ne sont d’accord ni sur la date à laquelle commence la Révolution ni sur la date à laquelle elle s’achève. Ils sont d’accord en revanche pour considérer que la prise de la Bastille a eu lieu à Paris le 14 juillet 1789 du calendrier grégorien (toute date supposant de s’entendre sur le référentiel calendaire).
Au plan phénoménologique, la différence entre l’un et l’autre type d’événement, c’est que, comme on a dit, on peut toujours prétendre avoir assisté à un événement strictement local, si bien sûr on est un contemporain de la période où il s’est déroulé, alors que ça n’est pas vrai de l’événement trans-local. On pourra avoir vécu pendant toute la Révolution française (ou la révolution industrielle, autre grand événement trans-local), sans pour autant pouvoir affirmer avoir assisté à la révolution. Pour pouvoir « assister » à la révolution il faudrait la réduire à ce qu’elle prétend justement ne pas être, à savoir un événement strictement local.
On voit aussitôt que si on s’en tient à la notion générale d’événement sans faire la distinction entre localité stricte et localité trans-locale, l’idée qu’on pourrait ne pas assister à la Révolution, alors même qu’on en est contemporain, paraît absurde. On lui opposera aussitôt le fait qu’une multitude de témoins ont bien assisté à « cet événement » et que des bibliothèques entières, françaises et étrangères, sont remplies de témoignages ou d’ouvrages d’historiens le concernant. C’est pourtant un fait que personne n’a assisté à la Révolution française, comme on dit que quelqu’un a assisté à l’exécution du roi Louis XVI. De la même manière, personne n’a assisté à la naissance de la révolution industrielle que tout le monde a constaté ensuite comme étant là.
La différence entre événements strictement locaux et trans-locaux ne coïncide pas avec une différence d’intensité ou de durée entre « grands » et « petits » événements. C’est bien plutôt une différence de puissance, terme de référence essentiel que nous expliciterons le moment venu et qui a un rapport avec le fait de pouvoir dénombrer un ensemble d’événements sur une période donnée, par exemple les Trois glorieuses en juillet 1830, ou bien de août 1914 à novembre 1918, entre une déclaration et un armistice. Un événement trans-local est en revanche indénombrable. Le christianisme, le capitalisme, le réchauffement climatique, pour ne citer que quelques événements trans-locaux, sont indénombrables.
*
On pourrait très bien imaginer une histoire où l’on déciderait de ne conserver que les événements strictement locaux sous prétexte que la présence de témoins visuels garantie leur certitude. Dans ce cas, la Révolution française, par exemple, n’apparaîtrait plus comme un événement puisque, comme on a dit, on a des témoins de tel et tel événement strictement local, mais pas de cette chose qu’on appelle « Révolution française » car il faudrait pour cela la réduire à la dimension d’un événement strictement local.
Pour autant on ne pourrait pas dire que la Révolution n’existe pas, qu’elle est une pure invention, une abstraction, car, au cours des différents événements strictement locaux qu’on lui attribue, des témoins, soit à travers ce qu’ils disent (« vive la Révolution ! » ou « à bas la Révolution ! »), ou à travers ce qu’ils écrivent (« la Révolution a fait que… »), un historien ne pourrait pas douter que quelque chose qui s’appelle « la Révolution », même si elle n’est pas un événement strictement local, a bel et bien existé. Cet historien serait un peu comme ces mathématiciens du début du XXe siècle que l’on a baptisés « intuitionnistes » qui, en réaction aux paradoxes sur l’infini, considéraient que « les objets mathématiques sont par leur vraie nature dépendants de la pensée humaine. Leur existence est garantie seulement pour autant qu’ils peuvent être déterminés pas la pensée9. »
Une des conséquences les plus troublantes de cette mathématique constructiviste ou intuitionniste est l’exclusion du tiers-exclu (A ou non-A). On appelle en mathématique une démonstration « constructive » une démonstration qui ne repose pas sur le tiers-exclu et qui corrobore l’existence d’un objet en le montrant, cet objet faisant office de « témoin »10. Le témoin d’existence de la prise de la Bastille n’a pas besoin de se référer au tiers exclu puisqu’il était là au moment où l’événement s’est produit. Mais le « témoin » de la Révolution française ne peut pas dire qu’il était là au sens de la localité stricte. Si vous étiez à Toulouse ou Bordeaux lorsque la prise de la Bastille a eu lieu vous ne pouvez pas croire à cet événement sur la base de votre participation mais de ce que des témoins en rapportent oralement ou par écrit. C’est alors que vous en déduisez que cet événement appartient à un ensemble plus vaste que l’on a fini par appeler Révolution.
Même en supposant que, par miracle, les événements qui font partie de la Révolution se succèdent dans le temps et l’espace de telle façon qu’un même témoin puisse assister à chacun d’entre eux et proclamer fièrement à la fin de son périple qu’il a bien assisté à toute la Révolution, et qu’il peut donc en parler comme un témoin vivant, nous ne serions pas au bout de nos peines. Encore faudrait-il s’entendre sur le premier événement (et aussi en principe sur le dernier si on veut être rigoureux) qui inaugure cette série. Mais qui peut prétendre sérieusement savoir quand a commencé la Révolution française ? La plus mauvaise réponse étant bien sûr le 14 juillet 1789.
Un historien « intuitionniste » serait donc un historien qui n’accepterait de considérer comme certains que les événements strictement locaux, sans pour autant pouvoir rejeter comme imaginaires l’événement trans-local auxquels des « témoins » se référèrent en invoquant par exemple « l’esprit de la révolution », ou « le spectre de la révolution » en telle ou telle occasion. Mais alors il serait vite confronté à une autre difficulté qui est que, s’il n’a aucune peine à qualifier la coupure que marque tel événement strictement local en disant par exemple qu’il y a un avant et un après du serment du Jeu de Paume qui a eu lieu le 20 juin 1789 à Versailles, ou qu’il y a un avant et un après du premier transport (commercial) en train tiré par une machine à vapeur entre deux villes d’Angleterre en 1812, comment en revanche qualifier les coupures auxquelles tels témoins se réfèrent en parlant de la « Révolution française » ou de la « révolution industrielle », qui pour eux marquent clairement un avant et un après dans l’histoire politique ou économique et sociale de ces situations ? Où faire passer la ligne de cette coupure ?
*
L’événement strictement local est beaucoup plus facile à modéliser que le trans-local. On peut s’appuyer pour cela sur la cinématique du point qui est un chapitre important de la physique depuis que Galilée s’est intéressé à la chute des corps. Cette cinématique s’intéresse au trajet d’un point le long d’une courbe ; il peut monter descendre, ralentir accélérer, etc. Le calcul différentiel permet de préciser la nature de chacune des inflexions, dy/dx donnant le taux de changement en chaque point de la courbe. Dans notre cas, nous allons considérer que ce point est doté d’une certaine autonomie et nous allons dire qu’il est un sujet automobile. Ce sujet automobile (qui peut être vivant ou mécanique, humain ou non-humain) a deux caractéristiques essentielles : il se meut de lui-même et il peut bifurquer spontanément à tout moment. Spontanément veut dire que si vous l’observez s’avancer le long du chemin, vous ne pouvez pas prédire quand et où il va bifurquer. Incidente : vous ne pouvez pas être sûr que le sujet automobile le sache aussi. Il est pour vous comme une boîte noire. La seule chose que vous puissiez constater, c’est qu’il peut bifurquer sans prévenir et sans reproduire un motif périodique (tous les quarts d’heure à droite et toutes les demi-heures à gauche par exemple). On voit qu’ici tout changement de trajectoire du sujet automobile constitue un événement qui est aussitôt une bifurcation ; autrement dit il prend une nouvelle direction qui s’écarte de ce qui faisait office jusqu’ici de trajectoire de référence.
On ne retrouve pas une telle coïncidence dans les événements trans-locaux. Ce qui caractérise au contraire ces événements au plan phénoménologique c’est une inquiétude permanente concernant le statut de la bifurcation. Cette inquiétude repose sur cette singularité capitale de la bifurcation qu’est le point de non-retour : est-ce que la dynamique de l’événement a franchi une étape qui rendrait tout retour en arrière impossible ou non ? Nous connaissons bien cette situation aujourd’hui avec la question du changement climatique qui est l’événement trans-local par excellence de notre temps (sans toutefois être le seul !). Mais la question se posait aussi pendant la Révolution française, avec bien sûr une appréciation très différente selon que l’on était pour ou contre elle. Pour les Ultras, comme on disait à l’époque, il était hors de question qu’un tel franchissement du point de non-retour ait pu déjà avoir lieu, et finalement l’épisode de la Restauration ne leur a pas donné totalement tort - mais ne leur a pas donné non plus totalement raison…
Il peut y avoir un devenir global aussi bien d’un événement strictement local que d’un événement trans-local. L’invention de l’imprimerie est un événement strictement local (centré sur l’atelier de Gutenberg) devenu global. La révolution industrielle, le réchauffement climatique sont des événements trans-locaux devenu globaux.
Pour qu’un événement puisse être considéré comme authentiquement « global » dès son origine, il faudrait qu’en différents points du globe, se produise un même phénomène11. La vie apparue sur Terre il y a 3.5 milliards d’années correspondrait assez bien à ce scénario, peut-être aussi l’agriculture, à condition qu’on ne réfère pas son origine à une région du globe en particulier (par exemple le Moyen-Orient), car dès qu’il y a origine, il y a localité stricte ou trans-locale. Le changement climatique n’est de ce point de vue qu’en apparence « global ». Le global, sans origine assignable à une région en particulier, pose donc un défi au local, qu’il soit « strict » ou « trans-local ». C’est une autre forme de localité qui se confond immédiatement avec l’ensemble de la Terre ou à tout le moins avec plusieurs lieux dispersés sur plusieurs continents ou fonds marins.
Notons en passant qu’en disant que l’apparition de la vie est un événement global on anticipe sur la réponse à la question de savoir s’il y a des événements naturels – ce qui comme on le verra, ne va pas de soi.
9 A. Heyting, The Intuitionist Foundations of Mathematics, cité par Michel Combes, dans Fondements des Mathématiques, éd. PUF, 1971, p. 45. L’intuitionnisme s’oppose au réalisme qui considère, à l’instar de Platon, que les objets mathématiques ont une existence indépendamment de nous.
10 Je m’appuie ici sur l’ouvrage de Gilles Doweck, Les métamorphoses du calcul, Une étonnante histoire de mathématiques, éd. du Pommier, 2018, notamment le chapitre VII intitulé « La constructivité ».
11Badiou note à ce propos que « L’idée d’un bouleversement dont l’origine serait un état de la totalité est imaginaire. », Être et événement, éd. du Seuil, 1988, p. 197.
III BURIDAN
Avant de revenir sur ce qui constitue la différence irréductible entre localité au sens strict et trans-localité, je voudrais m’arrêter sur ce sujet automobile qui va nous conduire à définir plus précisément ce que l’on peut entendre pas interprétation « corpusculaire » de l’événement et de manière plus générale par « métaphysique corpusculaire ».
Si l’on se représente le sujet automobile dont nous venons de parler progressant le long d’un chemin, on peut imaginer une foule d’incidents se produisant durant son trajet. L’un d’eux nous intéresse plus particulièrement parce qu’il implique une bifurcation qui a notamment été étudiée par Leibniz12. Cette bifurcation nous l’appellerons bifurcation Buridan en hommage à un autre philosophe et son âne. Elle est différente de la bifurcation virtuelle vue précédemment. Elle est virtuelle mais pour ainsi dire « là-devant » alors que l’autre renvoyait au passé. L’histoire de cet âne (ou ânesse chez certains auteurs) est bien connue. Mis en présence de deux seaux contenant de la nourriture et ne sachant lequel choisir l’âne finit par mourir de faim. Moins qu’un paradoxe voyons plutôt là une expérience de pensée ; il n’y a jamais eu âne aussi âne. Transposons maintenant cette âne sur notre chemin et imaginons qu’il soit subitement confronté à une bifurcation entre un chemin A et un autre B. Et qu’il s’arrête pendant un temps indéfini ne sachant lequel choisir. Appelons E cet arrêt.
Rien de plus simple. Mais pourquoi Leibniz s’intéresse-t-il tant à une situation aussi triviale et pour tout dire un peu bête ? La raison pourrait en être qu’elle met en jeu toute sa philosophie.
C’est que sa résolution n’est pas aussi simple qu’il y paraît et qu’elle implique un véritable forçage pour rompre ce sortilège que la scholastique appelait « indifférence d’équilibre » : « Il ne faut pas s’imaginer que notre liberté, écrit ainsi Leibniz, consiste dans une indétermination ou dans une indifférence d’équilibre ; comme s’il fallait être incliné également du côté du oui et du non, et du côté des différents partis lorsqu’il y en a plusieurs à prendre. Cet équilibre en tout sens est impossible ; car si nous étions également portés vers les parties A, B, et C, nous ne pourrions pas être également portés vers A et non A13. »
En présence de cette singularité où le sujet automobile est confronté à une bifurcation « là-devant » où rien ne semble pouvoir l’inciter à prendre la voie A plutôt que B toute dynamique s’arrête ; il n’y a plus de mouvement vers l’avant. Aussi bien, cette figure de la bifurcation indécidable possède une dimension événementielle en raison de son caractère strictement local et totalement imprévu. En théorie, l’âne dispose de « toute la liberté » de choisir entre A et B, mais il est impuissant à franchir ce seuil parce que les deux branches se neutralisent mutuellement14.
Leibniz, qui fait preuve d’une certaine impatience face à cette objection de l’équilibre, consacre plusieurs développements dans ses Essais de théodicée à la réfuter. Car autant il entend en nier la possibilité, autant il tient à sauver la liberté et à ne pas la sacrifier à ce qu’il appelle la « nécessité absolue ou métaphysique » qu’incarne à ses yeux Spinoza (qui est encore moins patient que Leibniz vis-à-vis de ce paradoxe) : « On fera voir aussi, écrit-il dans la préface des Essais…, qu’il y a une indifférence dans la liberté, parce qu’il n’y a point de nécessité absolue pour l’un ou l’autre parti ; mais qu’il n’y a pourtant jamais une indifférence de parfait équilibre. » Chassée par la porte, l’indifférence revient donc par la fenêtre pour sauver la liberté. Celle-ci doit se tenir à égale distance d’un côté du parfait équilibre qui, dans son scénario le plus extrême, débouche sur la mort, de l’autre de la nécessité absolue qui revient à supprimer la liberté au sens de capacité de spontanéité de l’individu. Comme aime à le dire Leibniz : la liberté incline mais n’oblige pas, inclinaison qui, remarquons-le au passage, penche dangereusement vers le clinamen15 qu’il rejette avec force chaque fois qu’il le peut.
Leibniz produit essentiellement deux arguments pour montrer que l’équilibre qui mettrait fin à la dynamique de la bifurcation, est impossible – et qu’il n’y a donc pas événement, autrement dit quelque chose plutôt que rien. Le premier repose sur l’idée, partagée par toute la métaphysique, d’une liaison entre elles de toutes les actions qui constituent un sujet, ou plus exactement une « créature », (ce qui n’est pas tout à fait pareil), liaison en vertu de laquelle l’action B découle de l’action A, et ainsi de suite dans une régression sans fin. Or, si cette solution redonne à la bifurcation sa dynamique en ce sens qu’il n’est plus désormais possible d’imaginer que la créature puisse s’arrêter subitement au beau milieu de son cheminement, elle semble la priver de choix, comme si elle était en pilotage automatique (souvenons-nous de l’image de « l’automate spirituel » employé par Leibniz à propos de l’âme), traversant de manière fluide les bifurcations successives auxquelles elle est confrontée au cours de son existence puisque son parcours est prédéterminé par Dieu dans l’entendement duquel « toutes ces liaisons des actions de la créature et de toutes les créatures étaient représentées16. »
Le second argument est beaucoup plus novateur en ce sens qu’il stipule que l’univers ne peut être symétrique, qu’il y a toujours une légère déviation, aussi petite qu’on voudra l’imaginer, mais pas nulle, à droite ou à gauche. Et c’est là où l’âne de Buridan entre de nouveau en scène : la raison pour laquelle, même s’il n’est pas libre au sens où l’homme l’est, l’âne finira par rompre l’équilibre c’est que « l’univers ne saurait être mi-parti par un plan tiré par le milieu de l’âne, coupé verticalement suivant sa longueur, en sorte que tout soit égal et semblable de part et d’autre ; (…) car ni les parties de l’univers, ni les viscères de l’animal ne sont semblables, ni également situées de deux côtés de ce plan vertical. Il y aura donc toujours bien des choses dans l’âne et hors de l’âne, quoiqu’elles ne nous paraissent pas, qui le détermineront à aller d’un côté plutôt que de l’autre » (§ 48). Je souligne le quoiqu’elles ne nous paraissent pas, autrement dit « quoique nous ne les percevions pas », car, on peut bien sûr imaginer que la rupture de symétrie ou d’invariance, indispensable pour échapper à la sidération en présence d’une bifurcation, a été voulue par Dieu dès l’origine du monde, mais on peut aussi bien, en se passant de Dieu, imaginer que cette rupture de symétrie résulte de fluctuation aléatoires amplifiées jusqu’à produire cet effet.
La théorie des indiscernables et des quantités infinitésimales, qui contribuent sans que nous nous en rendions compte à faire que nous inclinons plutôt d’un côté que de l’autre, joue ici un rôle essentiel. Leibniz n’optera toutefois pas pour ce scénario purement matérialiste qui fait l’économie de Dieu car, pour lui, si tout l’univers « incline » dès son origine d’un côté plutôt que de l’autre, il faut bien, si on respecte le principe de raison, rendre compte de cette « cause ou raison inclinante », et pour cela Dieu est l’argument qui met un terme à la régression sans fin des causes. Un des points faibles de la théorie démocritienne aux yeux de Leibniz c’est qu’on ne sait pas pourquoi à un certain moment et dans un certain lieu le clinamen se produit spontanément.
Dans sa correspondance avec Samuel Clarke (lequel était conseillé sotto voce par Newton, excusez du peu), Leibniz met en avant un argument qui fait appel à Dieu. Il dit en substance que si on affirme qu’un espace absolu existe, (comme le prétend Newton), alors il faut supposer que tous les points de l’espace sont identiques et que Dieu, au moment où il a créé le monde, n’aurait donc eu aucune raison de choisir tel point plutôt que tel autre. Le même argument vaut pour le temps : s’il y a un temps absolu et que tous les instants qui le composent sont identiques entre eux, là non plus Dieu n’a aucune raison de choisir tel moment plutôt que tel autre pour créer le monde. Imaginer que Dieu aurait pu agir dans une situation où toutes les options qui se présentaient à lui étaient identiques, reviendrait donc à le mettre dans la situation inconfortable de l’âne. J’ajoute que Leibniz exclut que Dieu confronté à cette apparente égalité des points de temps et d’espace, décide de choisir en s’appuyant sur le hasard qui serait un aveu d’impuissance.
À travers l’évocation de cette singularité qu’est le point situé avant que la bifurcation s’actualise, Leibniz fait cette découverte essentielle qu’un univers parfaitement symétrique est un univers mort. Il raisonne pour ainsi dire par l’absurde : si l’univers existe, et il existe puisque j’en suis témoin, alors il n’est pas en équilibre ou symétrique, sinon il serait mort et moi avec, ce qui contredit l’hypothèse. Dieu lui a donc imprimé une infime bifurcation par rapport à une trajectoire d’équilibre parfaite qui est le rien - équivalent idéaliste de la chute des atomes dans vide. Et il n’a pu le faire que parce que la fabrique du temps et de l’espace n’est pas la même en tous ses points. L’asymétrie est une condition initiale. Démontrer que l’indifférence d’équilibre, autrement dit la symétrie parfaite, est impossible emporte donc un enjeu qui va bien au-delà de la question de la liberté. Avant même toute bifurcation effective, la bifurcation est présupposée ici à titre de transcendantal