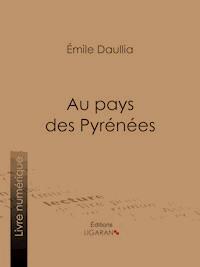
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Parmi les contrées de la France les plus parcourues, la région des Pyrénées est sans contredit l'une des plus universellement admirées. Ces Filles du feu, comme on les appelées, ont tour à tour excité la verve des littérateurs et les accents lyriques des poètes, qui les ont décrites et chantées sur tous les tons."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Perdu à travers l’espace, absorbé dans la contemplation de la nature, l’œil de l’observateur se délecte, en voyage, à découvrir des spectacles, dont jamais il ne se lasse.
Comme en un vaste kaléidoscope, les villes et les campagnes, les fleuves et les rivières, les lacs et les forêts, les vallons et les plaines, surgissent successivement ; et ceux-ci, frappant l’imagination du voyageur, viennent se refléter dans son esprit. Les montagnes surtout, avec leurs aspects variés et pittoresques, ont le don, en vraies sirènes qu’elles sont, d’attirer et de fasciner le regard. Aussi le touriste va-t-il volontiers de l’une à l’autre, impatient de s’en approcher, curieux de les découvrir, empressé à faire leur connaissance, et d’avance assuré de prendre quelque plaisir à cette fréquentation.
C’est qu’en vérité, à la recherche des horizons nouveaux, à cette aspiration de l’infini, s’attache un charme enivrant, qui vous entraîne dans le champ des découvertes et vous ravit tout à la fois. À marcher ainsi à l’aventure, on va de surprise en surprise, on voudrait avoir des ailes… et toujours lancé plus avant, se laisser emporter dans le domaine du rêve et de la fantaisie ! D’où, cette soif impérieuse de locomotion, qui sévit de nos jours, s’exerçant à tout âge et en toutes saisons, et qui fait que tout le monde veut être dans le mouvement. D’où aussi, l’attrait particulier qui découle des relations de voyage, ayant de plus en plus conquis la faveur du public.
S’agit-il de contrées inconnues ? On a hâte d’aller au-devant d’elles, et, par une description anticipée, d’en avoir quelque aperçu, de même que si l’on a déjà visité la région décrite, on est bien aise de comparer son propre jugement avec les impressions d’autrui. De toute façon l’élan est donné, on s’agite et l’on part.
On est parti ! Quel bonheur ! Quel plaisir de voyager… Sans même quitter le coin de son feu, de faire du chemin, et de se laisser doucement aller, d’étape en étape, là où vous entraîne la folle du logis ! Et puis, au retour, comme on est heureux d’évoquer ses souvenirs, de pouvoir se rappeler ce qu’on a vu, senti, admiré, et d’en faire part aux autres ! Car un homme d’esprit l’a dit :
« Après le plaisir de préparer un voyage et de le faire, le plus grand est de le raconter, au risque de ne pas faire partager son plaisir par celui qui vous écoute ou qui vous lit. »
Remarque des plus judicieuses. Raconter son voyage, n’est-ce pas en effet le faire une deuxième fois, en nouvelle compagnie et avec d’autant plus d’entrain, que l’entourage nous paraît plus sympathique ? C’est ainsi que le narrateur éprouvera un réel intérêt à s’identifier en quelque sorte avec son auditoire, en cherchant à l’associer dans son récit, à ses joies, comme à ses déconvenues, à lui faire partager sa propre émotion, à éveiller enfin dans son esprit des impressions analogues à celles que lui-même aura ressenties.
Après la relation d’un voyage dans les Alpes, celle d’un voyage aux Pyrénées se déduit tout naturellement. Et, par le temps qui court, des Alpes aux Pyrénées, il n’y a qu’un pas, pour ainsi dire. Le franchir, n’est qu’un jeu, en somme. Dans tous les cas, rien de plus aisé que de l’essayer.
Si, pénétré de cette idée, ami lecteur, qui déjà avez bien voulu me suivre dans mes pérégrinations autour du Mont-Blanc, vous consentez une fois de plus à vous attacher à mes pas, laissez-moi vous guider, vers ces contrées bénies du soleil, qu’on rencontre au Pays des Pyrénées.
En marchant ensemble, à petites journées, nous ferons durer le plaisir, sans risquer de nous fatiguer. Du moins, c’est là mon rêve ! Et que ce soit aussi mon excuse, si malgré tout nous n’y avons pas réussi.
ÉMILE DAULLIA.
En chemin de fer, de Lyon à Arles. – Nuit blanche. – Arles et ses monuments. – La place de la République. – L’Hôtel de ville et l’Obélisque. – L’Église et le Cloître de Saint-Trophime. – Ruines du Théâtre antique. – Les Arènes et les Corridas a muerte. – Les Aliscamps. – L’Arlésienne. – (Rien de Bizet, ni de Daudet.)
Parmi les contrées de la France les plus parcourues, la région des Pyrénées est sans contredit l’une des plus belles et des plus universellement admirées. Ces Filles du feu, comme on les a appelées, ont tour à tour excité la verve des littérateurs et les accents lyriques des poètes, qui les ont décrites et chantées sur tous les tons.
Aussi le monde des voyageurs, des savants et des artistes, séduit par la célébrité de leur réputation, s’est-il porté en foule vers elles, déterminant le grand courant de tourisme, de jour en jour plus développé.
Pas plus qu’un autre, je n’avais échappé à cette sorte d’attrait irrésistible, qui s’empare des esprits aventureux, épris des merveilleux spectacles de la nature. Après avoir été à même de contempler de près la grandiose ampleur des Alpes et leur majestueuse sévérité, j’avais le plus vif désir de m’initier à la grâce souveraine des Pyrénées, et de rendre aux contrées bénies du soleil le tribut d’admiration qui leur est dû. Depuis longtemps déjà je l’avais caressé, ce projet de voyage, m’en promettant d’avance monts et merveilles. Mais jusqu’alors je n’avais pu y donner suite, tant il est vrai qu’entre la coupe et les lèvres il y a loin, souvent ! Il vint un jour cependant où, mes vœux étant exaucés, il me fut enfin loisible de mettre à exécution l’itinéraire que je m’étais plu à préparer. Sans perdre une minute, je m’empressai de boucler ma valise, de faire mes derniers préparatifs, et d’arrondir l’intérieur de mon porte-monnaie. Une circonstance fortuite me tenait cependant encore en suspens, l’état de ma santé, qui n’était pas aussi bon que je l’eusse désiré. Toutefois, je ne m’y arrêtai pas, tant j’avais hâte de profiter d’une occasion, impatiemment attendue, et qu’en laissant échapper, je craignais de ne pouvoir de sitôt retrouver. J’espérais du reste que le changement d’air et les distractions, inhérentes au voyage, auraient par leur heureuse influence facilement raison de mon indisposition. Tout bien considéré, étant résolu à me mettre en route, je fixai le jour du départ.
On était au milieu du mois de juillet, six heures sonnaient ce matin-là à l’horloge de la ville. Un commissionnaire était venu, quelques minutes auparavant, prendre mes bagages et les transporter à la gare, distante à cinq minutes de mon habitation. Je sortis à pied, après avoir fait mes adieux à mon entourage, et de peur de manquer le train je dus me hâter.
Levé depuis longtemps, le soleil, vif et clair, dardait ses rayons obliques sur la campagne environnante, qu’une pluie abondante avait rafraîchie pendant la nuit. Cependant, malgré l’heure matinale, le temps me parut un peu lourd. Çà et là, de gros nuages marbraient l’azur du ciel, faisant présager de nouvelles averses pour la journée.
À l’heure réglementaire le train vint en gare et s’y arrêta. Je montai dans un compartiment qui était vide, puis me laissai entraîner à toute vapeur dans la direction de Lyon. À la station de Perrache, je descendis, ayant quelques emplettes à faire en ville. Je m’empressai d’abord, au sortir de la gare, de déposer à la consigne mes nombreux colis à la main ; puis, délivré de ces impedimenta, je m’occupai de mes commissions. M’étant chargé au départ d’un appareil photographique, dont je comptais largement me servir pendant le voyage, je dus me rendre chez un fournisseur, pour lui faire une commande de plaques, et le prier de me les expédier à Bagnères-de-Luchon. J’allai ensuite déjeuner, et, à l’issue du repas, un orage ayant soudain éclaté, je fus obligé de prendre une voiture pour me ramener à la gare.
Au moment de retirer mes bagages de la consigne, je commençai par éprouver une vive contrariété. On avait omis d’enregistrer mon appareil photographique sur le bulletin qui m’avait été remis. Or, m’étant aperçu de ce lapsus, je crus devoir le faire remarquer à l’employé, qui me répondit qu’en aucun cas la Compagnie du P.-L.-M. ne saurait être responsable de l’absence du colis. Si cet appareil n’avait pas été mentionné sur le bulletin, ajouta-t-il avec aplomb, c’était qu’on ne l’avait pas présenté au dépôt ! Nullement convaincu, je protestai de mon mieux pour la forme, mais au fond, j’étais très inquiet, finissant par croire que j’avais pu laisser par mégarde mon sac dans le wagon précédemment occupé. Plein d’anxiété, j’attendis donc, quelques minutes durant, l’arrivée du monte-charge, et j’eus un véritable soulagement en voyant enfin réapparaître le précieux auxiliaire, qui fort heureusement n’avait pas été égaré. Ce fut avec la plus grande satisfaction que j’en repris possession ; puis, ayant réuni tous mes colis à la main, je montai dans le train se dirigeant sur Arles. Cette fois encore, le compartiment dans lequel j’étais entré se trouvait inoccupé ! Je ne le regrettai pas d’ailleurs, me disant qu’à défaut de compagnons de voyage, je ne manquerais pas de sujets d’observation au dehors, en étudiant le parcours tout à loisir.
En attendant, je m’installai commodément dans un coin, et m’épongeai le front, couvert de sueur, en subissant la pénible influence du temps orageux qu’il faisait. Une chaleur, moite, accablante, s’était emparée de moi, provoquant dans tout mon être une véritable prostration. Et peu à peu, je me laissai malgré moi envahir par une certaine mélancolie, dont souvent on a peine à se défendre en partant. Il est vrai que, si parfois les nuées grises engendrent des idées grises, il suffit d’un rayon de soleil pour tout dissiper. Pour le moment, celui-ci étant éclipsé, l’orage sévissait dans toute son intensité, répandant sur le vitrage du hall des torrents d’eau, au milieu des éclairs et du fracas de la foudre. Mais l’heure du départ étant arrivée, au signal donné, le train s’ébranla, et lentement les voitures glissèrent sur les rails. Le sort en était jeté, j’étais bien désormais en route pour le Midi ! N’ayant au demeurant rien de mieux à faire, je m’appliquai dès lors à tout observer des particularités du trajet ; et en voici la relation fidèle d’après mes souvenirs.
Au sortir de la gare de Lyon-Perrache, nous traversons le Rhône, dont en été le cours précipité est grossi et troublé par la fonte des neiges. Après un faubourg, nous longeons des terrains vagues jusqu’à la station de Chasse, où le train effectue son premier arrêt. Jusque-là, rien de remarquable. Après Vienne, nous côtoyons la rive gauche du Rhône, dans une riche vallée superbement verdoyante. Aux environs d’Ampuis, tout le long de la rive, ce sont des vergers splendides, étalant au grand jour leurs magnificences. Le regard enchanté se promène dans une véritable dépendance de la Terre de Chanaan ! Il admire des arbres dorés, tout jaunes d’abricots, ou violets de prunes, dont les branches, surchargées de fruits, s’inclinent délicieusement jusqu’au sol, attendant leur délivrance ! À cette vue, les accents lyriques reprennent chez moi le dessus, chassant au loin l’escouade des papillons noirs, emportée sur les ailes des zéphyrs ! Car la sérénité est revenue dans le ciel. L’orage s’est calmé, et de nouveau le soleil a lui, irradiant de gais rayons à travers l’empyrée !
Lancée à toute vapeur, notre locomotive dévore l’espace ; mais avant Tain, voilà que, ralentissant soudain sa marche, elle ne s’avance plus qu’avec une extrême lenteur. Qu’y a-t-il ? On se le demande. Tout le monde de se précipiter aux portières ; moi de même, et que vois-je ?
Nous sommes à l’entrée d’un tunnel, dont l’orifice béant apparaît lumineux. Il semble qu’il en jaillisse des flammes, et, comme dans un cercle du Dante, nous nous engouffrons dans ce nouvel Enfer ! Au fur et à mesure que s’avance, à pas comptés, la longue théorie des wagons, nous nous rapprochons du centre du foyer, et bientôt même nous le traversons ! Qu’on se rassure. Le passage n’est effrayant qu’en apparence, et nullement dangereux. Le souterrain a été simplement éclairé par des torches, que nous apercevons, tout allumées, gisant sur le ballast, au milieu de manœuvres, dont en passant nous venons d’interrompre le difficile travail de réfection de la voie.
À Tain-Tournon, les coteaux rocheux se redressent de chaque côté de la vallée. Les fameux vignobles de l’Hermitage, reconstitués et restaurés, s’échelonnent en terrasses verdoyantes, attirant le regard par leurs affiches-réclames peintes en blanc. Oh ! cette publicité, éhontée ! Qui nous délivrera de cette lèpre envahissante ? Aujourd’hui, avec les nécessités du commerce et de l’industrie, le progrès nouveau-jeu a tué la poésie des champs. Quelle misère ! De nos jours, les voies ferrées, les routes, les terres, les arbres, les rochers eux-mêmes, sont flanqués de poteaux, sillonnés de réseaux de fils de fer et de cuivre, barrés de placards, d’écriteaux, d’affiches, qui, impudemment étalés au nez des passants, hurlent avec leur entourage, masquant la vue, détruisant l’harmonie de la nature. Impossible désormais de faire deux pas dans la campagne, sans rencontrer ces horreurs et en être obsédé ! Veut-on prendre un croquis, photographier un site ? On ne voit plus qu’elles au premier plan ! Ah ! c’est cela qui donne une riche idée des merveilles de la civilisation !
Un peu avant d’atteindre Valence, un pont de pierre se présente, et nous traversons l’Isère, aux eaux courantes et grises, descendues des glaciers de la Maurienne et de la Tarentaise. Dans le fond se dressent, au levant, les crêtes dentelées d’une chaîne de montagnes ; c’est le massif de Pont-en-Royan. En face de Valence, sur la rive droite du Rhône, apparaît, mélancolique, un roc à pic, surmonté d’une ruine à jour, qu’on appelle le Château de Crussol. Toute cette côte se montre nue et stérile ; mais en bas, dans la plaine, l’œil admire de belles moissons dorées, et le contraste est frappant. Rien cependant dans la végétation n’annonce encore de changement de climat ; à peine l’azur du ciel est-il plus coloré. À voir toutefois la blanche poussière des routes, on a comme le pressentiment de l’approche de la Provence.
Après avoir dépassé Livron, nous abordons un nouveau pont de pierre, jeté sur le lit d’une nouvelle rivière, la Drôme, qui en cette saison coule presque à sec. Plus loin, se montre un village, pittoresquement bâti en amphithéâtre, sur un monticule gris, tandis que dans les champs les mûriers alternent avec les céréales. À Montélimar, cinq minutes d’arrêt. Il fait de plus en plus chaud, et l’aspect de la campagne se modifie d’une façon plus caractéristique. Le soleil resplendit radieusement dans un ciel aux teintes fortement azurées. Les terres apparaissent sèches et grillées, les routes semblent enfarinées ! Beaucoup de mûriers, quelques haies d’ifs et de cyprès, rompant la monotonie de la plaine, mais pas encore d’oliviers. Bientôt se montre la silhouette fuyante d’un vieux castel, à tours carrées et crénelées ; puis c’est le lit d’un torrent qui disparaît sous une folle végétation, sans la moindre trace d’eau, malgré l’inévitable pont de pierre. Enfin, dans une brume lointaine surgissent à l’horizon d’élégantes cimes, dorées par les rayons du soleil couchant.
Entre les stations de Châteauneuf et Donzère, la voie s’ouvre un passage à travers un défilé de crêtes blanches, verticales et menaçantes, sortes de dolomites en miniature. Toute la région est accidentée, dénudée, à la fois sauvage et pittoresque. L’œil admire au passage des bourgs, aux enceintes crénelées, des pans de murs garnis de lierres, des tours en ruines sur des collines rocheuses, et des brebis vagabondes folâtrant çà et là pour l’agrément du paysage.
À Pierrelatte, j’entends pour la première fois le cri strident des cigales, bruit monotone et mélancolique. Sur une éminence se détache en belle vue le village de Saint-Paul-Trois-Châteaux que surmonte la pointe effilée d’un clocher. On dirait de loin quelque gigantesque château fort du Moyen Âge. À Bollène-la-Croisière, à Mondragon, de belles ruines apparaissent en haut d’escarpements. Puis se présente une nouvelle région alpestre, avec roches surplombantes, broussailles maigres et pins rabougris, auxquels succèdent en pleins champs les oliviers et les figuiers. C’est le Midi qui commence.
Orange. Doux nom à prononcer, mais de la station vue insignifiante. Je ne puis découvrir, ni le Théâtre Antique, ni l’Arc de Triomphe. Au loin, s’étend la plaine, infinie, laissant errer le regard et se perdre, jusqu’à une cime, pelée et pointue, celle du mont Ventoux, à qui son observatoire a créé une notoriété. À Bédarrides, je jouis d’une belle échappée de vue sur les montagnes, de la surprise d’une vieille église, et de l’agrément d’une petite rivière, l’Ouvèze, où il y a de l’eau qui chante. De toutes parts, dans la campagne, des quinconces d’oliviers s’alignent avec symétrie, étalant la nappe de leur feuillage grêle, à la teinte vert-de-grisée, que soutiennent des branches aux inflexions tourmentées.
Aux environs de Sorgues, c’est une oasis de verdure, qui repose la vue. Les avenues de peupliers, de platanes, ainsi que les bordures de cyprès se succèdent autour des habitations. Et bientôt après le train fait son entrée dans la gare d’Avignon, où il s’arrête, et où descendent de nombreux voyageurs. La chaleur ici est accablante, et sous l’immense hall vitré, où nous stationnons, il n’y a pas le moindre souffle d’air. C’est une véritable fournaise que l’on respire et qui ne laisse pas de m’incommoder. Non sans appréhension, je me demande ce que je vais devenir, à Arles, à Cette, à Toulouse, dans les Pyrénées, si la température est toujours aussi élevée. Au sortir de la gare, j’ai une superbe vision de la belle cité, enguirlandée de sa ceinture de remparts, et dominée par l’imposante masse du Palais des Papes, que vient auréoler l’incandescence du soleil couchant. Mais le train file, et à peine entrevue, la vision disparaît.
En passant à Tarascon, immortalisé par Daudet, la silhouette de l’ancien château du roi René, d’allure féodale, et la flèche élancée d’un clocher frappent ma vue. Une demi-heure plus tard, après la traversée de l’interminable plaine de la Camargue, que des troupeaux errants sillonnent çà et là, nous arrivons enfin à la station d’Arles, terme de ma première étape.
Je m’empresse d’y descendre, car c’est à Arles que j’ai résolu de passer la nuit, et de consacrer à sa visite une partie de la journée du lendemain. J’aurais pu sans doute aller coucher le soir même à Cette, et en repartir plus tôt pour arriver aux Pyrénées, but principal du voyage. Mais alors il m’aurait fallu brûler ces villes du Midi, si intéressantes par elles-mêmes, et qui m’étaient inconnues. Je n’y songeai pas un seul instant. Et puis, n’en déplaise aux impatients, qu’on veuille bien ne pas l’oublier, je ne marche qu’à petites journées, afin de mieux voir et de moins me fatiguer.
L’ancienne capitale du Royaume de Provence, la Rome des Gaules, renferme des antiquités et des monuments qui ont fait et font encore de nos jours la joie des archéologues et des artistes. On a pu dire sous ce rapport qu’Arles est à la France ce que Pompéi est à l’Italie ; avec cette différence toutefois, que, si la proie du Vésuve n’est plus aujourd’hui qu’une vaste nécropole, la vieille cité gauloise est encore vivante.
Au sortir de la gare, pour entrer en ville, nous suivons un chemin poudreux, dans une avenue qui traverse un jardin public ; nous franchissons un ancien pont-levis, au-dessus de fossés pleins d’eau, entre deux tours dont l’arcade a été démolie, et par un dédale de rues, tortueuses, noirâtres, atrocement pavées en cailloux pointus, nous pénétrons au cœur de la cité. Après mille tours et détours et des cahots sans nombre, l’omnibus dans lequel je suis monté s’engage dans une petite place, ombragée de platanes, puis s’arrête à la porte d’un hôtel.
Nous sommes sur la place du Forum, et nous avons devant nous l’Hôtel du Nord, qui est adossé au Capitole romain, sur l’emplacement de l’ancien palais des Thermes, dont deux colonnes subsistent, encastrées dans sa façade. À mon arrivée, un hôte obligeant, plein de prévenance, me fit un accueil empressé, et après m’avoir donné une chambre, m’invita à passer à la salle à manger. Malheureusement l’heure était indue, depuis longtemps la table d’hôte était finie, et je ne trouvai à me mettre sous la dent qu’un méchant souper froid, peu fait pour me réconforter. Peut-être aussi, convient-il d’ajouter, la fatigue du voyage et la chaleur combinées m’avaient-elles coupé l’appétit ? Toujours est-il que, n’ayant pu faire honneur aux mets, je cherchai à me rattraper au dessert, en faisant main basse sur une affriolante assiette de figues fraîches (j’avoue que j’ai un faible pour les figues fraîches). Je fis donc assez imprudemment une petite débauche de ces fruits savoureux et rafraîchissants, mais laxatifs. J’allai ensuite me promener sur la place, dans l’espoir de respirer le frais sous les arbres du Forum. Mais là, ayant constaté avec regret qu’il n’y avait pas le moindre zéphyr, me sentant du reste rompu de fatigue, je me décidai à rentrer au logis, afin de m’y reposer. De cette nuit j’ai gardé un assez piètre souvenir, qu’on en juge !
La chambre, qui m’avait été assignée, était située au deuxième étage ; elle était spacieuse et prenait jour sur la place, avec deux fenêtres de façade. M’étant déshabillé, je m’empressai de me coucher ; puis une fois la lumière éteinte, j’attendis qu’un bienfaisant sommeil, réparateur des fatigues de la journée, vint s’emparer de moi. Mais ce fut en vain. Une irritante mélopée se mit à bruire à mes oreilles, c’était la ritournelle connue de la valse des moustiques qui entrent en danse, et bientôt ces odieux moucherons s’acharnèrent sur ma peau, offerte à leurs appétits sanguinaires ! Aiguillonné, je m’agitai, et dès lors je fus au supplice. Du reste, la scène était éclairée a giorno ! Une lune, éclatante et indiscrète, était venue jusque dans ma chambre tracer, à travers les rideaux des fenêtres, des arabesques bizarres sur les murs ! Je voyais cela d’un œil ; car de l’autre, je m’obstinais à vouloir dormir…
Vers quatre heures, au tout petit jour était-ce la lune ou le jour, je ne savais trop, mais quoi qu’il en fût, le palefrenier de l’hôtel commença son service journalier. Très distinctement, j’entendis le piaffement des chevaux, qui s’ébrouaient et exécutaient un pas redoublé sur le pavé retentissant de la chaussée ! À cinq heures, même concert, à six, la séance continua, sans autres variations que des bruits d’allées et venues, des clameurs, mêlées à des bêlements d’agneaux ! Ah ! La jolie musique, et quelle charmante pastorale !
Je me levai, agacé, après cette nuit trop blanche, pendant laquelle Morphée m’avait tenu rigueur. Mais voilà que tout d’un coup je songeai qu’ayant laissé à la consigne ma malle, celle-ci renfermait le pied de mon appareil, sans lequel je ne pouvais photographier quoi que ce soit ! Je n’avais d’autre ressource que d’aller bien vite le chercher à la gare, et justement l’omnibus qui stationnait en bas allait partir. Je m’habillai au galop et descendis les escaliers quatre à quatre pour m’élancer dans la voiture. Mais, arrivé à la station, nouvelle déception ! Cette fois, c’étaient mes clefs oubliées à l’hôtel ! Bon Dieu ! me dis-je, où donc ai-je la tête, ce matin ? De plus en plus agacé, je me hâtai d’expédier un commissionnaire, place du Forum, avec ordre de bouleverser ma chambre et de me rapporter mes clefs. Et pendant ce temps-là, j’en étais tristement réduit à me ronger les pouces.
Ayant ainsi perdu un temps précieux, par suite de ces bévues, je pus enfin commencer mes courses photographiques. Mon premier soin fut de chercher un cicerone pour me guider à travers le dédale des rues, et porter mon sac, lourd et encombrant. Puis, ce factotum découvert, je m’attachai à ses pas, m’en rapportant à lui.
Avant tout, quelques mots d’explication.
Qu’on ne s’attende pas à trouver ici la monographie de la ville d’Arles. Je n’ai nullement la prétention de l’écrire, pas plus du reste que celle de toutes les villes que j’ai traversées. Ces descriptions se trouvent détaillées dans tous les guides spéciaux, auxquels je prie le lecteur de vouloir bien se reporter. Narrer simplement ce que j’ai vu, ce qui m’a frappé, relater mes impressions, souvent trop hâtives, mais sincères et fidèlement observées, tel est mon objectif ; de même qu’intéresser, telle est ma seule ambition.
Parti sur les traces de mon conducteur, espèce de lazarone, d’aspect famélique, qui d’un pas nonchalant s’en va, rasant les murs à l’ombre, je débouche sur une place carrée de belle apparence. C’est la place de la République, bordée d’un côté par le monument de l’Hôtel de ville, et de l’autre par l’Église de Saint-Trophime. En son milieu, au-dessus d’un bassin circulaire, se dresse inopinément un Obélisque, à la taille élancée. J’ignore s’il vient de Louqsor, comme son frère de la place de la Concorde, mais je constate qu’il recèle dans ses flancs une source, qui découle parcimonieusement de gueules à têtes de lions, ornant le soubassement. Ce sont également des lions qui, accroupis au quatre angles de la pyramide, semblent supporter sans trop de peine, sur leur échine, le poids du monument et vouloir défier l’action du temps.
Le Campanile de l’Hôtel de ville s’élève en face de l’Obélisque. Il est caractérisé par une élégante tour carrée, que surmonte une tour ronde, ajourée par huit baies, ouvertes en plein cintre, et que vient terminer une coupole, flanquée à son faîte d’un porte-étendard de crâne allure.
À côté, noyé dans l’ombre matinale, s’efface mystérieusement le porche de l’église de Saint-Trophime, vraie merveille d’architecture, à colonnettes et bas-reliefs finement ciselés. Pour le moment, cette place, qui ne manque pas de distinction, est encombrée d’agneaux bêlants et me paraît livrée aux Philistins ! C’est aujourd’hui samedi, jour de marché à Arles, qu’on ne l’oublie pas.
Nous étant difficilement frayé un passage à travers cette foule bruyante, nous réussissons à gagner une ruelle donnant accès dans l’intérieur du Cloître de Saint-Trophime. Dès l’entrée, on sent qu’on pénètre dans un lieu plein de recueillement, et l’on subit l’influence de ce milieu austère. Un silence de tombe et une fraîcheur délicieuse y règnent.
Encastré entre de véritables murs de forteresse, apparaît le préau, d’aspect monastique, et dont le pourtour est à quatre galeries, ornées de piliers à doubles colonnettes, délicatement ouvragées en pierre et marbre. Les voûtes affectent, les unes, le style roman, et les autres, le style gothique, avec arcades en plein cintre et arcades en ogive. Au centre de la cour carrée, une herbe, grise et poussiéreuse, s’obstine à vouloir pousser, semant, au milieu de cette solitude, un peu de gaieté. Très intéressant au point de vue archéologique et sculptural, cet intérieur rappelle celui du cloître de l’ancienne Abbaye de Charlieu. Une façade date du XIe siècle, m’explique avec vénération le gardien, tandis que les autres sont du XVe et du XVIe siècles. En vrai cicerone, ce préposé du lieu, tout à la fois charmé de recevoir une visite et désireux de débiter son boniment, s’apprête à me faire l’historique du monument. Le voilà donc, pour me donner un échantillon de son érudition, entreprenant en conscience la description de tous les bas-reliefs, malheureusement aux trois quarts mutilés. Moi, je ne l’écoute que d’une oreille distraite. Car, pour le moment, ce qui me préoccupe, ce que je recherche, ce n’est pas précisément un cours d’archéologie, mais plutôt une place favorable pour dresser mon appareil et prendre une photographie. La chose n’est pas aisée, faute du recul nécessaire ; car je voudrais pouvoir embrasser dans le même champ, l’intérieur du cloître et le clocher massif qui domine les galeries. J’y parviens non sans peine, et, séduit par l’aspect décoratif que présente une voûte aux arceaux gothiques, dont les nervures sont harmonieusement enchevêtrées et les piliers, éclairés par reflets, offrent des détails intéressants, j’en fais l’objet d’un second cliché. Enfin, pour animer la scène, j’ai invité le gardien et le guide à servir de comparses, assis aux pieds de l’autel de la vierge. La pose terminée, je les remerciai, pliai bagage, et sortis, emportant du Cloître de Saint-Trophime de précieux souvenirs.
Nous nous rendîmes ensuite au Théâtre Romain, ou du moins à l’emplacement de ce qui fut jadis cela. Il n’en reste debout, au milieu d’un chaos de pierres ruinées, que deux colonnes, avec leurs chapiteaux sculptés, et deux socles à côté. On peut voir encore et reconnaître, par endroits, les gradins de pierre en hémicycle, ainsi que divers dégagements aux proportions gigantesques. Mais que tout cet ensemble me parut donc délabré et misérablement effondré ! Tandis que j’errais à travers ces décombres, le concierge, chargé de piloter et d’instruire les rares visiteurs, m’avait aperçu. Étant venu à ma rencontre, il me fit aussitôt remarquer combien avait dû être magnifique cet antique monument, orné jadis de ses cinquante colonnes, semblables aux deux spécimens qui seuls ont résisté aux injures du temps. Je le crus sur parole.
À côté de ce Théâtre, dont la construction date du temps des Romains, et parmi les décombres duquel fut découverte en 1651 la fameuse Vénus d’Arles, transférée au Louvre, se trouve une haute tour carrée, également en ruines, et qui, elle, date du Moyen Âge. En présence de ces vestiges du passé, appartenant à des époques si différentes, et subsistant côte à côte, que de réflexions viennent à l’esprit ! Et si elles pouvaient parler, ces pierres, que de choses ne se diraient-elles pas ! que d’évènements n’évoqueraient-elles pas, depuis longtemps tombés dans le domaine de l’oubli ! Encore aujourd’hui, bien que muettes, elles ont leur éloquence, en frappant l’imagination du passant et en l’obligeant à se reporter à plusieurs siècles en arrière.
C’est ainsi que, pour avoir leur image et mieux la graver dans mon esprit, j’en prends la photographie.
À cette intention, je m’installe sur un des gradins supérieurs du Théâtre, en plein soleil, et, par une chaleur tropicale, je braque mon appareil sur les rares débris, au-dessus desquels se détachent harmonieusement les fines silhouettes du clocher de Saint-Trophime et du beffroi de l’Hôtel de ville. Juste à point nommé, vient à passer, en soutane noire, chapeau rond et longue barbe blanche, un père Chartreux, que je prie de vouloir bien s’arrêter quelques secondes. Il daigne se prêter à ma fantaisie, et me laisser à l’improviste un vivant souvenir de sa personne, que sans doute je ne reverrai plus. Un sourire, un salut, et c’est tout ! Il passe, il a passé, et moi-même j’ai hâte de fuir ce Sahara, où littéralement l’on grille. Il règne en cet endroit, à cette heure, de 50 à 60° de chaleur, et je fonds en eau par tous les pores de ma peau !
Après le Théâtre, c’est le tour des Arènes.
L’Amphithéâtre, comme on l’appelle, date également du temps des Romains ; mais, construit plus solidement, il est mieux conservé.
Tel qu’il se présente, cet édifice, à trois étages d’arcades en plein cintre superposées, dresse encore fièrement sa façade orbiculaire, surmontée aux quatre points cardinaux de tours carrées. L’ensemble est imposant, d’une courbe gracieuse, qui, par ses perspectives fuyantes, atténue la masse colossale du monument. Mais la vue de l’extérieur offre avec celle de l’intérieur un singulier contraste. Au dehors, tout est noir, sombre, menaçant ; au dedans, tout se montre d’une blancheur éblouissante ! C’est que, tombant de vétusté, l’édifice ayant nécessité de notables réparations, a produit cet assemblage disparate de matériaux neufs mêlés aux anciens. Et voilà que ces arcades, ces galeries, ces gradins, ces tours, en pierre de taille rapportée, jurent maintenant par leur teinte trop crue et leur grain trop fin, avec les tons bronzés des murs antiques. Rien de laid, à mon sens, comme ces ruines à demi restaurées. Elles me font l’effet de ces vieilles coquettes, qui, pour se rajeunir, croient faire merveille en faisant peau neuve, et qui, ne paraissant, ni vieilles, ni jeunes, ne font illusion à personne, pas mêmes à elles ! Est-ce pourtant à dire que l’Amphithéâtre d’Arles constitue de nos jours un véritable anachronisme ? Non, pas précisément. Car là, comme à Nîmes et dans plusieurs autres villes du Midi, les arènes ne sont pas de simples motifs de curiosité archéologique. Elles servent encore à des représentations populaires, elles servent surtout aux courses de taureaux, qui s’y donnent certains dimanches et jours de fêtes. S’il ne s’agissait encore que de simples courses à la Provençale, il n’y aurait rien à dire ; mais les corridas à muerte elles-mêmes y font fureur, à tel point qu’elles s’exercent, coram populo, per fas et ne fas, au nez de l’autorité, impuissante à les empêcher. Tant et si bien, que l’on se demande si, sous ce ciel embrasé de la Provence, les Méridionaux ne voient pas rouge, à force de se repaître de la vue du sang ! Oui, il en est, et combien, qui trouvent cela tout naturel ! Ah ! quelle honte ! Dire que nous sommes à l’aurore du XXe siècle, et que nous émettons la prétention d’être à la tête des nations civilisées ! En réalité, nul animal n’est plus féroce que l’homme. La bête, saigne, égorge, tue, par nécessité, pour vivre ; l’homme, lui, le fait souvent pour rien, pour s’amuser ! Et voilà le triomphe de l’intelligence sur l’instinct, ce qui distingue l’humanité de l’animalité !
Telles sont les réflexions qui ne manquent jamais de me venir à l’esprit, chaque fois que je suis en présence de ces abominables arènes, où trop souvent le sang coule à flots, où des chevaux pantelants exhalent leur dernière plainte avec leur dernier soupir, où le spectacle odieux de la souffrance s’allie avec celui de la mort !…
À Arles, sans doute pour que la fête soit plus complète, on la donne de nuit, et c’est ainsi que l’Amphithéâtre est disposé pour être éclairé au gaz ! Les spectateurs, de cette façon, sont alors sûrs de ne pas attraper de coups… de soleil. Oui, mais moi, j’en ai malheureusement gobé un, en circulant sur ces gradins surchauffés, et en y stationnant trop longtemps avec mon appareil.
Chancelant et le corps en ébullition, je quitte ces lieux maudits, suivi de mon guide, aux allures de plus en plus languissantes. Le hasard de la marche nous ramène en face de l’Hôtel de ville, sur cette place de la République, que les agneaux bêlants ont enfin désertée. J’en profite aussitôt pour dresser ma chambre noire, vis-à-vis de la fontaine de l’Obélisque, et le porche de Saint-Trophime, aux trois quarts dans l’ombre. Et alors, je suis assailli par une nuée de gamins, qui viennent effrontément se camper devant mon objectif, auquel ils font des pieds de nez ! je les envoie s’asseoir sur le rebord du bassin, en leur promettant, s’ils sont sages, une épreuve aux prunes prochaines, et crac ! je presse la poire ! L’instantané est pris, les gamins, eux, sont surpris, et me demandent si c’est réussi ! Assurément, leur dis-je, et je me sauve !
Il est midi, la chaleur est atroce ; je prends congé du factotum, qui n’est pas fâché de délivrer ses épaules de mon sac, puis je reviens place du Forum. D’ailleurs, je n’ai pas une minute à perdre, ayant décidé d’aller coucher à Cette le soir même ; c’est même tout au plus si j’aurai le temps de déjeuner, régler l’addition et gagner la station.
Arrivé en nage à l’hôtel, je m’empresse donc de passer à la salle à manger, ayant plus soif que faim. Mais je suis en si mauvaise disposition, que le déjeuner, qui m’est offert, me paraît non moins médiocre que le souper de la veille. Je trouve ces mets du Midi étranges, et par trop épicés. Mon gosier altéré ne peut s’y faire, et je me sens dévoré par une soif inextinguible. Dégoûté de tout, je suis heureux de retrouver au dessert mon fruit favori, les figues fraîches ! Par exemple, je les trouve délicieuses, elles ; aussi je m’en régale.
Après avoir réuni mes colis, fait mes adieux au maître de céans, je monte dans l’omnibus, où une seule place est vacante. Toutes les autres sont occupées par des indigènes et des Artésiennes, les unes jeunes, les autres vieilles, qui étalent au grand jour leur piquant minois.
Combien de fois n’a-t-il pas été décrit ce type fameux, semi-grec et semi-sarrasin, qui a inspiré tant de poètes, de littérateurs et de musiciens ?
Grande ou petite, mince ou forte, l’Arlésienne se distingue par un teint mat et des traits fins, assez réguliers, qu’animent des yeux noirs, veloutés, pleins de feu, ou bleus, fendus en amandes et frangés de longs cils. Le nez, légèrement aquilin, est mince et pointu ; la bouche, petite, aux lèvres purpurines, sourit volontiers, parfois malicieusement. La chevelure d’ébène, à elle seule, mériterait une mention, par la façon vraiment distinguée avec laquelle elle est portée. Les oreilles, aux lobes délicats, à la conque dégagée, accompagnent en le complétant l’ovale d’une figure, quelquefois trop émaciée. La coiffure, composée de deux bandeaux redressés sur le front et séparés par la raie du milieu, se termine par un chignon en pointe, tordu au sommet de la tête. Ce chignon est lui-même inséré dans une étoffe légère, gaze, tulle ou mousseline, autour de laquelle est fixé un ruban de velours, le plus souvent noir. Le cou est fin, la nuque frisottante, et la gorge légèrement à découvert.
La tenue ordinaire se compose, outre ce genre de coiffure, d’un corsage, dit en chapelle, sorte de veste tenant à la taille, et se continue par un jupon noir, quelquefois aussi de couleur. Sur les épaules se place un fichu blanc, croisé par-devant et tombant en pointe au bas du dos. Enfin, un court tablier complète ce costume, qui a quelque chose de coquet et de monacal tout à la fois. Ajoutez à cela que l’Arlésienne a naturellement la démarche fière, et qu’avec ses mains finement gantées, ses bijoux et son ombrelle, elle se présente avec un port de reine. D’allure aussi distinguée, comment ne pas être remarquée ? Et de fait, elle l’est, et y réussit sans peine. Mais, chose regrettable, le type pur se fait rare, même à Arles, où il ne court guère les rues ; et quant au costume, lui-même tend à disparaître ! Ainsi s’en vont peu à peu nos vieilles traditions gauloises !
À Gênes, à Bologne, à Milan, il y a le Campo Santo, que ne manque pas de visiter tout étranger nouvellement débarqué. À Arles, on vous vante les Aliscamps, comme un lieu de délices ! Ce n’est, hélas ! qu’une belle avenue, bordée de peupliers et de sarcophages, plus ou moins antiques. Il y a des gens qui se promènent volontiers dans les cimetières et vont y chercher des distractions. Celles qu’on y trouve, me paraissant plutôt manquer de gaieté, j’ai quitté Arles sans voir les Aliscamps (en latin Elysei campi), c’est une lacune à combler.
Arrivée à Cette. – La ville, ses ponts métalliques et ses deux ports. – Visite au phare, beau panorama. – De Cette à Narbonne. – Promenade nocturne. – L’Hôtel de ville, ancien Palais archiépiscopal. – Le Musée lapidaire du Lamourguier. – Le pont couvert sur la Robine. – La Cathédrale de Saint-Just. – Petites misères du photographe.
D’Arles à Cette, le chemin de fer traverse la plaine de la Camargue, berceau des taureaux à demi-sauvages, qui font le jeu des courses provençales.
Ce parcours m’a paru plat, monotone, peu intéressant. Des terres maigres s’étendent à perte de vue, d’abord grises, et ensuite rouges. Puis viennent des prairies, des marécages, auxquels succèdent bientôt les vignes ; et celles-ci, très luxuriantes, abondent aux environs de Lunel, Frontignan, Montpellier et Cette. Avant que d’atteindre cette dernière ville, on longe des marais salants, dont les bords pleins d’efflorescences et d’amoncellements de sel, qui sèche au soleil, simulent des effets de neige. Enfin, on ne tarde pas à apercevoir la mer, dont la belle teinte azurée attire les regards et s’associe agréablement à la verdure des champs.
Arrivé en gare, le train stoppa, et je descendis de wagon. Quelques instants après l’omnibus me déposait au seuil du Grand Hôtel, où j’espérais trouver une table plus à mon goût qu’à Arles. Mais la chaleur était si forte que j’en étais accablé, et que j’éprouvai avant tout l’impérieux besoin de me rafraîchir. Mon premier soin fut donc d’accourir à la plage et de me plonger dans l’onde amère. De fait, j’ai pu le constater, cette amertume n’est pas un vain mot, ayant bien involontairement bu un coup à la grande tasse ! Rafraîchi par le bain, mais non désaltéré, je partis ensuite en reconnaissance, en marchant au hasard, devant moi.
La ville de Cette est toute moderne, aussi, à part son église, dédiée à Saint Louis, n’offre-t-elle guère à la vue de monument remarquable. Le canal du Midi la traverse, entre des quais, reliés entre eux par des ponts, et ceux-ci, très étroits, sont métalliques et en dos d’âne. Bâtie au pied d’une colline, le mont Saint-Clair, Cette s’étale en éventail sur un large promontoire, que dessert une route en corniche, d’où l’on jouit de beaux points de vue. C’est une cité très commerçante, qui prend chaque jour plus d’extension. Par son heureuse position, entre l’étang de Thau et la mer, son canal et ses importantes lignes de chemins de fer, elle se trouve en relation directe avec le monde entier. Mais ses rues, très inégalement pavées, sont assez mal entretenues.
Au moment où je les parcourus, une foule d’artisans et d’ouvriers y circulaient, affairés et bruyants, comme des abeilles dans une ruche. Tous les débits de boissons, les zincs, les assommoirs, les cafés, les caboulots, les bars, étaient pris d’assaut. C’était l’heure de l’absinthe, et je vis des consommateurs, encombrant les trottoirs, savourer, avec des mines congestionnées ou pâlottes, la liqueur verte, aux reflets d’opale, dont l’âcre parfum se répandait partout au dehors. À la vue de ce spectacle il m’arriva de perdre une de mes illusions, ayant cru jusqu’à ce jour à la sobriété des gens du Midi. En réalité, il faut pas mal en rabattre. Il est vrai qu’il fait si chaud, en été, dans ces régions, qu’il n’est pas étonnant qu’on éprouve le besoin de se désaltérer. On y pousse la sollicitude jusqu’à préserver les animaux des atteintes du soleil. C’est ainsi qu’à Cette les chevaux circulent, la tête ornée d’un chapeau de paille, au travers duquel passent leurs oreilles droites. À Dijon, à Nice, à Marseille, et sans doute ailleurs, ce sont au contraire les oreilles de ces nobles animaux que l’on protège en les recouvrant d’un capuchon. Quoi qu’il en soit, rien de drôle comme l’allure de ces pauvres bêtes, trottant, attifées de cette coiffure quelque peu grotesque.
Après une nuit de repos, je repris le lendemain de bonne heure mes pérégrinations à travers la ville, n’ayant que peu de temps à y consacrer. Et pour commencer, ayant endossé le fardeau photographique, je me dirigeai du côté de la mer, à peine entrevue la veille.
Avec ses ponts mobiles, ses nombreux canaux, aboutissant à ses deux ports, le Vieux et le Neuf, ses maisons propres, régulièrement bâties à deux étages, son boulevard Victor-Hugo, spacieux et ombragé, Cette rappelle certaines villes des Flandres ou des Pays-Bas, Gand notamment, sauf les monuments qui font ici défaut.
L’église Saint-Louis présente, il est vrai, un caractère architectural non dénué d’élégance ; et, en cherchant, on trouverait sans doute quelque casino, genre Kursaal, à l’usage des baigneurs et des étrangers, mais ces établissements trop modernes sont quelconques.
Pour le voyageur, le côté vraiment intéressant d’une cité maritime, c’est son port de mer. Car c’est là surtout que se révèle l’activité commerciale de ses habitants. En outre, chaque arrivée et chaque départ des navires et embarcations diverses donnent lieu à des scènes animées, qui sont autant de sujets d’observation.
Le Vieux port de Cette est spécialement affecté aux barques de pêche, qui y sont très nombreuses ; tandis que le port Neuf est réservé aux voiliers et bateaux marchands. L’un et l’autre sont protégés par des jetées maçonnées solidement et s’avançant en demi-cercle dans la mer.
À l’extrémité du môle se trouve le Phare, qui s’enlève d’une blancheur éblouissante dans le bleu du ciel. Après en avoir pris la photographie, je voulus le visiter ; et pour y arriver, une petite ascension fut nécessaire. Je comptai successivement 139 marches, dont 100 en pierre taillée, et les autres, en métal, et en colimaçon. Au dernier étage se trouve la cabine du gardien, réduit cylindrique de 2 à 3 mètres, éclairé par deux minuscules ouvertures, et succinctement meublé d’un lit, d’une armoire et d’une petite table. Quelle triste et monotone existence doit y mener la vigie qui, constamment en vedette, et condamnée à la solitude, voit s’écouler ses jours entre le ciel et l’onde, uniquement occupée à entretenir ses feux, comme une prêtresse de Vesta ! Au-dessus de l’étroit logement d’anachorète, court une galerie circulaire, garnie d’une balustrade de pierre à jour. On jouit de là d’une vue délicieuse sur la ville tout entière, ses canaux, ses ports, ses ponts, la colline à laquelle elle est adossée et l’immensité de la mer. Les petits points blancs, que l’on aperçoit à la côte, au bout de l’horizon, ce sont les maisons de Palavas, dont la plage est très fréquentée. Quant au clocher, rouge et carré, que l’on devine à côté, c’est celui de Frontignan, ainsi que me l’expliqua le gardien, qui me servait de cicerone. Le phare se termine par une coupole vitrée, où s’allument les feux que projettent de puissants réflecteurs. Invité à pénétrer à l’intérieur, afin d’admirer le mécanisme de l’appareil et les perfectionnements de l’installation, je dus y renoncer, n’ayant pu résister à la chaleur suffocante qui régnait dans cette étuve. Et, chose bizarre, je faillis y prendre le mal de mer !
Il faisait ce jour-là une assez forte brise, qui, ébranlant la tour jusque dans ses fondements, la rendait toute frémissante du haut en bas. J’en ressentais assez les oscillations pour que celles-ci me parussent désagréables et peu rassurantes, malgré la solidité éprouvée de la construction. Ayant hâte de m’y soustraire, afin d’aller respirer plus librement au grand air, je fis mes adieux au gardien, qui ne voyait pas tous les jours des visiteurs, puis je quittai le phare et la jetée pour rentrer en ville.
Passant à proximité de l’établissement de bains, j’y entrai pour me baigner avant le déjeuner, et bien qu’il ventât ferme, je trouvai l’eau délicieuse. En revenant, je traversai les quais, partout encombrés de futailles gigantesques, qui peuvent donner une idée de l’important commerce de liquides se faisant dans cette ville.
Après un substantiel déjeuner, aiguisé par l’air vif du matin, je consacrai une partie de l’après-midi à compléter ma collection de clichés, et ne voulant pas prolonger plus longtemps mon séjour à Cette, je partis pour Narbonne, où j’arrivai à huit heures du soir.
Le trajet en chemin de fer ne m’offrit rien de particulièrement intéressant. De Cette à Agde, on côtoie quelques instants la mer, puis les champs, les terres, les vignes se succèdent sans discontinuité jusqu’à Béziers, et de là à Narbonne. Avant que d’y arriver, j’avais aperçu, au passage du train, l’église forteresse de Saint-Nazaire, pittoresquement édifiée sur une colline, au bas de laquelle coule la petite rivière de l’Orb. Et cette vue m’avait semblé jolie, mais combien l’impression fut rapide !
J’arrivai à la nuit tombante à Narbonne et descendis à l’Hôtel de la Dorade, ayant eu beaucoup de peine à me débarrasser d’une nuée de portefaix, qui, sous prétexte de porter mes bagages, vinrent m’assaillir dans la cour de la gare. Après souper, je voulus, suivant mon habitude, faire une reconnaissance en ville, et en conséquence j’allai me promener au hasard de la découverte.
En sortant de l’hôtel, situé près d’un canal et en face d’un moulin, je longeai un boulevard, bordé de platanes gigantesques, et bientôt je débouchai sur une place rectangulaire. Devant moi se détachait, bien haut dans les airs, la sombre façade d’un monument massif, flanqué d’immenses tours carrées, ornées de poivrières et de mâchicoulis, que l’obscurité de la nuit me permettait à peine de distinguer. Remettant au lendemain l’examen de cet édifice, qui n’était rien moins que l’ancien Palais des Archevêquesde Narbonne, et qui sert actuellement d’Hôtel de ville et de Musée, je poursuivis ma promenade. Peu après j’arrivai dans une belle avenue, encore plantée de magnifiques platanes (on paraît avoir une prédilection marquée pour ces arbres, dans la plupart des villes du Midi). Là, de nombreux promeneurs, des familles entières, circulaient de tous côtés, encombrant la chaussée, se répandant sous les ombrages, riant, chantant, fêtant enfin allègrement cette soirée du dimanche.
Continuant à marcher à l’aventure, allant droit devant moi, j’aboutis à un pont de pierre, que je franchis, et voilà que sans m’en douter je tombe au milieu d’une fête foraine ! Baraques, balançoires, chevaux de bois, tirs à la cible, jeux de massacres, panoramas, parades, ménagerie, bals, théâtre, rien n’y manque, à commencer par la foule compacte et grouillante, comme toujours en pareille circonstance. C’est une cohue, un tohu-bohu indescriptibles, un assaut de cacophonies, à écorcher les oreilles les moins délicates. Ne désirant en aucune façon me mêler à ce tourbillon populaire, j’ai hâte de fuir ces lieux bruyants, où non seulement les nombreux badauds se ruent avec frénésie, mais sans doute aussi les pickpockets. Seulement, dans l’ignorance absolue où je suis du plan de la ville, je ne sais trop où aller. Une avenue, noire et déserte, semble s’ouvrir devant moi et m’inviter à la suivre, pour échapper au bruit et à l’agitation. Je m’y engage à l’aveuglette, mais bientôt je suis arrêté par la vue d’une construction élevée, aux lignes bizarres, qui dresse sa sombre silhouette à droite de la chaussée.
De misérables bicoques, comme des champignons de mauvais aloi, s’accrochent aux contreforts des soubassements, contrastant par leur laide modernité avec la vétusté de l’édifice. Qu’est ceci, une église en ruines, une prison ou un donjon ? Impossible de le préciser à cette heure. Tout ce que je puis observer, ce sont des ouvertures ogivales et de plein cintre, des meurtrières et des mâchicoulis. Quoi qu’il en soit, cela me paraît mériter un examen plus approfondi, et je me promets de revenir le visiter au grand jour. J’aurais bien voulu poursuivre plus loin mes investigations, mais en cet endroit le boulevard, décrivant un arc de cercle, avait l’air de se perdre dans des quartiers excentriques. Pour ne pas m’égarer, il me parut prudent de revenir sur mes pas.
De nouveau me voici au milieu de la foule, plus délirante, plus échevelée que jamais, et j’ai quelque peine à m’y soustraire. Je me hâte de retraverser le pont et de regagner le long du canal l’avenue ombragée par laquelle je suis arrivé. Puis, fatigué, dévoré d’une soif ardente, je m’échoue finalement à la terrasse d’un café, bondé de consommateurs. Là, pendant que je me repose et me désaltère, j’en profite pour me livrer à quelques observations autour de moi. Et d’abord, il me semble que, si la clientèle de l’établissement est nombreuse, en revanche elle n’a pas l’air très distinguée. On sent que c’est le populaire qui y domine.
Des artisans, des boutiquiers, des commis de magasins, des ouvriers, avec femmes et enfants, il y a de tout là-dedans, excepté des fashionables. Mais qu’importe ! Au milieu de consommations variées, la bière circule en abondance, et les piles des soucoupes des bocks s’accumulent sur les tables. Sans doute les citadins ont dû profiter du dimanche et de la radieuse journée pour aller s’ébattre à la campagne, peut-être même jusqu’à la mer qui n’est pas loin de la ville. Et en effet, à 21 kilomètres de Narbonne, se trouve la plage de La Nouvelle, très fréquentée dans la belle saison.
Tout en observant les types divers, assis aux tables qui avoisinent la mienne, je vois un flot de passants faire sans cesse irruption, par l’étroite rue qui donne sur la promenade. Et je me demande d’où vient tout ce monde et où il va. Il y a, en cet endroit, un mouvement de circulation vraiment extraordinaire, à chaque instant créé par un tramway, qui passe et repasse, déversant à chaque arrêt des familles entières. Chacun reprend le chemin du logis, la soirée finie ; et comme il commence à se faire tard, j’en fais de même. Rentré dans ma chambre, je vais pour me coucher, mais je remarque alors que mon lit est agrémenté de quelque chose d’insolite, tout au moins pour moi, encore novice aux usages du Midi. C’est une moustiquaire, qui semble indiquer la présence éventuelle de ces insectes irritants qu’engendrent les pays chauds !
La perspective d’entamer une nouvelle nuit blanche se présente à mon esprit et n’a rien de réjouissant. Tout rêveur, je me déshabille. Et pour pénétrer dans mon lit, qu’une gaze ténue enveloppe hermétiquement, je suis obligé de m’y insinuer en rampant, comme une couleuvre ! Mais, à peine suis-je couché que j’étouffe ! J’éprouve une pénible sensation d’oppression, de manque d’air, causée par cette sorte d’engin qui m’enserre de toutes parts et dont je n’ai pas l’habitude. Je voudrais m’en délivrer, quitte à me laisser dévorer, mais comment faire ? C’est une vraie tunique de Nessus, cette moustiquaire de malheur, dont je ne réussis pas à me dépêtrer. De guerre lasse, j’y renonce, et invinciblement mes yeux se ferment…
Un radieux soleil filtre à travers les rideaux de ma fenêtre, quand, au matin, ayant ouvert les yeux, je parviens à me réveiller. En me rappelant les péripéties de la nuit précédente, je m’applaudis d’y avoir échappé. Cette fois, du moins, j’ai pu dormir, sans piqûres et sans musique ! J’ai même fait la grasse matinée, et j’en suis honteux, car on ne voyage pas pour se reposer. D’un bond j’envoie promener le velum protecteur, je saute à bas du lit et m’habille rapidement. Je n’ai pas une minute à perdre, si je veux visiter la ville, avant le départ du train pour Toulouse, où j’ai projeté d’arriver ce même jour.
Muni de mon appareil photographique, je me dirige vers la place de l’Hôtel-de-Ville, entrevue la veille, pendant ma promenade nocturne.
Tant par ses dimensions imposantes que par ses lignes architecturales, l’Hôtel-de-Ville de Narbonne est un monument à grand caractère, qui frappe le regard et commande l’admiration. Il date des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe siècles, ayant été construit à diverses époques et restauré de nos jours, par l’habile architecte Viollet-le-Duc. C’était jadis l’ancien Palais des Archevêques, sorte de forteresse, flanquée de trois grandes tours carrées et crénelées. Au centre de la façade, mal à l’aise sur une place trop étroite, et à côté de la tour dite Saint-Martial, se trouve à proprement parler l’Hôtel-de-Ville, renfermant, en outre, la bibliothèque, le musée lapidaire, celui de peinture, d’antiquités et de céramique. Je ne doute pas que la visite en détail de toutes ces curiosités n’offre un réel intérêt ; mais, n’en ayant pas le loisir, je me vois obligé d’y renoncer. Forcé de me borner à la vue extérieure du monument, je traverse la place, à cette heure encombrée d’échoppes, d’étalages en plein vent, de fruits, de légumes, de fleurs, d’étoffes, de faïences, de porcelaines et de chalands plus ou moins affairés. Car c’est là, paraît-il, que se tient le marché.
Tout en cherchant à me faufiler au milieu de cette cohue, je songe combien il va être difficile de placer mon appareil à l’endroit convenable pour photographier l’édifice. Et d’abord pour embrasser les flèches et les pignons de la façade dentelée, où me mettre ? En face, il n’y faut pas songer, il n’y a pas assez de recul. Je pourrais, il est vrai, aller dans une ruelle perpendiculaire, que j’aperçois débouchant sur la place, mais elle est si étroite que je n’aurais là qu’une tranche de la façade. Cela ne fait pas mon affaire. Un peu plus loin je découvre une rue transversale, qui me permettra d’être à bonne distance et de prendre de biais le monument. Malheureusement je ne l’aurai pas en entier, à cause d’un mur en saillie. Ma foi, tant pis ! On fait ce qu’on peut !
M’étant donc installé sur le trottoir de ladite rue, je dispose l’appareil à cette fin d’opérer. Tout d’abord, la chose n’est pas aisée, car la mise au point est des plus laborieuses. Ce sont, à chaque instant, des charrettes, des attelages, qui vont et viennent, des gens qui passent, des marchands qui discutent, des badauds qui causent, des gamins qui s’amusent à fourrer le nez devant mon objectif. Évidemment je révolutionne le quartier. De peur d’être prises, les femmes se sauvent, en riant comme des folles, les chiens intrigués rôdent autour du support de l’appareil, et, en signe de mépris, lèveraient la jambe pour l’arroser, si je ne mettais le holà ! Pour comble de misères, j’ai le regret de constater que non seulement je n’embrasse pas toute la façade du monument, mais que je n’ai pas même la partie supérieure de l’édifice. Encore trop près, je ne puis avoir qu’une vue partielle, forcément très incomplète. Qu’à cela ne tienne. Faute du haut, je me contenterai du bas, puisqu’il n’y a pas moyen de faire autrement. Pendant mes préparatifs, un indigène est là à mes côtés, suivant avec intérêt mes moindres mouvements et paraissant attendre le moment propice pour se faire prendre. Il est escorté de deux chiens d’arrêt, qui gambadent autour de lui. Pour m’en débarrasser, je lui demande s’il lui serait agréable de poser avec ses toutous. Comme il en grillait d’envie, je le prie, sur sa réponse affirmative, d’aller plus loin sur la place. Il y court, en sifflant sa meute, tandis que moi, guettant l’instant favorable, je déclenche l’obturateur, et c’est fait : bonne ou mauvaise, la vue est prise !
Mais je n’étais qu’à moitié satisfait, ayant quelque peine à quitter ces lieux, sans en emporter un souvenir plus fidèle. Ce que voyant, l’indigène me fit observer que du haut du café situé sur la place en face même de l’Hôtel-de-Ville, on découvrait l’ensemble du monument, et m’engagea à y aller.





























