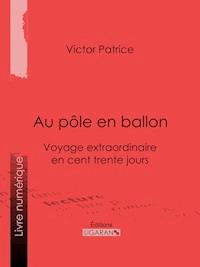
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le 20 avril 1875, un certain nombre de gros bourgeois se trouvaient réunis dans une salle de l'auberge des Trois-Tulipes, à la Haye. Cette salle, spacieuse et bien éclairée, était ornée de quelques tableaux de maîtres flamands, et tenue avec cette propreté méticuleuse que l'on chercherait vainement ailleurs qu'en Hollande."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le 20 avril 1875, un certain nombre de gros bourgeois de la ville se trouvaient réunis dans une salle de l’auberge des Trois-Tulipes, à la Haye. Cette salle, spacieuse et bien éclairée, était ornée de quelques tableaux de maîtres flamands, et tenue avec cette propreté méticuleuse que l’on chercherait vainement ailleurs qu’en Hollande. Elle était affectée spécialement aux membres d’un cercle où l’on causait et riait chaque soir, en jouant aux cartes ou aux dominos, en lisant les journaux et en buvant de la bière ou du genièvre.
Ces réunions étaient toujours très paisibles, et, le soir dont nous parlons, les habitués, groupés autour des tables, se livraient sans bruit à leurs distractions ordinaires, quand le docteur Cornélis, le président et l’un des membres les plus influents du cercle, interrompit la lecture du Journal de la Haye, que l’on venait d’apporter, et dit tout haut, comme s’il ne pouvait contenir l’expression des sentiments qu’il éprouvait :
– Grande nouvelle, messieurs ! Puisque, après tant d’expéditions maritimes de toutes les nations civilisées, on n’a pu atteindre le pôle nord par la navigation, il est bien naturel que l’on cherche à obtenir ce magnifique résultat par des moyens nouveaux. Aussi notre journal annonce-t-il aujourd’hui que le Ruyter, cet immense ballon de notre riche et savant compatriote, M. Frédéric Van Egberg, est complètement terminé. On va procéder au gonflement, et dans quelques jours le propriétaire, accompagné de plusieurs personnes, espère partir, si le vent est favorable, pour tenter la conquête du pôle nord !
Quoique le docteur Cornélis n’eût paru s’adresser qu’aux intimes assis à la même table que lui, aucun des assistants n’avait perdu un mot de ce qu’il venait de dire, et un silence profond s’était établi dans la salle. Les buveurs avaient déposé vivement leurs chopes, les joueurs avaient interrompu leur partie, les négociants avaient cessé d’étudier la cote de la bourse, et tous s’étaient tournés vers le président d’un air stupéfait.
– Ah çà, le journal ne se moque-t-il pas de nous ? demanda un gros bonhomme à figure bourgeonnée qui était un riche marchand de salaisons ; ce ballon, dont on fait tant de bruit et que je suis allé voir chez M. Van Egberg avec les bonnes gens de la ville, aurait-il la prétention d’être autre chose qu’un de ces joujoux d’aérostats qu’on lance en l’air les jours de kermesse ? Il est plus gros, c’est vrai, car on assure qu’il faudra sept mille mètres cubes de gaz pour le gonfler… Mais pourra-t-on jamais voyager dans ces choses-là avec la certitude d’arriver à un but déterminé ?
– Et puis, s’écria un grand vieux, sec et jaune, qui avait été capitaine de navire baleinier, ils parlent d’arriver au pôle, comme je parlerais d’avaler un verre de genièvre… Mais je sais ce que c’est, moi, que ces régions polaires !… J’y ai navigué, dans mon temps, et j’ai noué connaissance avec leurs brumes, leurs tempêtes, leurs ice-bergs de cent pieds de haut, leur froid de 50 degrés qui congèle le mercure, et surtout avec leur « banquise », cette zone de glaces compactes qui a peut-être deux cents lieues de large… S’ils se hasardent de ce côté-là, croyez ce que je vous dis, ils n’en reviendront pas !… Mais, voyons ! ajouta-t-il avec un accent d’ironie, ce M. Frédéric Van Egberg, qui est si malin, aurait-il donc trouvé le moyen, que tout le monde cherche depuis longtemps, de diriger les ballons ? Ce serait une fière découverte, je vous le garantis !
– Aussi, n’est-ce pas celle-là qu’il a faite, dit le président Cornélis ; mais il a trouvé le moyen de mouvoir son aérostat de haut en bas, sans perdre un atome de gaz, et cela aussi souvent qu’il lui plaît. De plus, comme, dans les hautes régions de l’atmosphère, on serait exposé à rencontrer des couches d’air où manquent les éléments nécessaires à la vie, il a donné le plan d’une nacelle que l’on peut fermer hermétiquement et dans laquelle on respirera avec facilité, sans craindre les mortelles atteintes de l’air extérieur. Enfin, cette nacelle, qui est, dit-on, un prodige de construction et d’ingéniosité, voguera au besoin sur l’eau comme une barque ordinaire.
Ces explications attirèrent au président une avalanche de questions, qui partaient de tous les points de la salle.
– Eh ! messieurs, répliqua Cornélis avec impatience, je ne peux vous répondre, car je ne sais de cette découverte que ce qu’en rapporte le journal. D’ailleurs, Van Egberg garde le secret de l’appareil dont il est l’inventeur pour élever ou abaisser l’aérostat à son gré ; on assure seulement que les expériences, opérées en présence de plusieurs personnes, ont toujours complètement réussi.
– N’importe ! dit le marchand de salaisons, ce n’est pas moi qui voudrais me risquer dans sa… machine !
– Ni moi ! s’écria l’ancien baleinier ; j’en ai pourtant vu de dures aux régions polaires et ailleurs !… Mais qui donc sera assez abandonné de Dieu et des hommes pour l’accompagner dans son ascension ?
– Il a déjà deux compagnons, répondit Cornélis ; d’abord son plus intime ami, M. Paul Teerveld, professeur à l’université de Leyde, un homme dans la force de l’âge, aussi robuste et intrépide qu’il est savant ; puis un jeune domestique, Philippin, brave garçon qui lui est attaché jusqu’à la mort. Il est question, paraît-il, d’accepter un autre associé, car, pendant le voyage audacieux qui se prépare, il se présentera sans doute des circonstances telles que la présence de quatre hommes solides et déterminés sera nécessaire ; mais on ignore qui sera ce quatrième élu.
– Et moi, j’affirme qu’on ne le trouvera pas, s’écria le baleinier, excepté peut-être quelque pauvre diable de désespéré cherchant la mort.
– Oui, oui, dirent plusieurs des assistants, on ne trouvera personne.
– Qu’en savez-vous, messieurs ? s’écria tout à coup une voix fraîche et sonore du côté de la porte.
Au même instant, un jeune homme d’environ vingt-deux ans, convenablement vêtu, d’une taille au-dessous de la moyenne, entra dans la salle. Son visage, au teint rosé, au nez aquilin, aux lèvres fines, presque imberbe, était animé par de grands yeux noirs, pleins d’intelligence et de feu. On reconnut M. Maurice Suidorff, un des membres les plus jeunes du cercle des Trois-Tulipes, bien qu’il y vînt rarement depuis quelques semaines.
Maurice Suidorff était le beau-frère de Paul Teerveld, qui, veuf depuis plusieurs années et n’ayant point d’enfants, avait pu sans scrupule s’associer à la périlleuse entreprise de son ami Frédéric Van Egberg. Maurice, quoiqu’il n’eût pas encore choisi de carrière spéciale, passait pour un des hommes les plus instruits de la Haye. On assurait surtout que sa mémoire était prodigieuse, et qu’il lui suffisait d’avoir lu un livre une seule fois pour pouvoir en réciter plusieurs pages consécutives sans la moindre faute. Peut-être y avait-il de l’exagération dans ces affirmations ; mais Maurice avait réellement un savoir extraordinaire, et, quelque carrière libérale qu’il voulût embrasser, il était certain de la parcourir d’une manière brillante.
À la vue du jeune homme, dont on avait éprouvé l’humeur vive et la repartie prompte, tout le monde s’était tu. Le docteur Cornélis essaya de mettre fin à l’embarras de plusieurs membres du cercle.
– Vous arrivez à propos, monsieur Suidorff, dit-il à Maurice ; nous parlions justement de la grande entreprise de M. Van Egberg, entreprise à laquelle votre digne beau-frère s’est associé avec tant d’ardeur. Vous êtes en mesure mieux que personne de nous apprendre quelles chances de succès elle peut avoir.
– C’est le plus grand, le plus beau, le plus noble projet qui soit jamais sorti d’une cervelle humaine, messieurs ! s’écria Maurice, dont les yeux rayonnaient d’enthousiasme, et Van Egberg deviendra une des gloires de notre pays… Son ballon est un chef-d’œuvre de solidité, de prévoyance et de précision. Je n’ai pas tout vu ; et, en particulier, l’appareil dont Van Egberg doit se servir pour dilater et contracter indéfiniment le gaz, sans déperdition aucune, n’est pas entièrement connu même de mon cher beau-frère Paul ; mais ce que je sais déjà me donne la certitude que ce voyage du Ruyter immortalisera le nom de tous ceux qui y auront pris part.
– Ainsi, monsieur Suidorff, demanda le baleinier en se tordant la bouche d’un air narquois, vous êtes convaincu que le ballon de vos amis ira comme ça, tout de go, se poser sur le pôle nord, comme une mouette fatiguée sur un rocher ?
– Pourquoi pas ? s’écria Maurice avec beaucoup de feu ; il suffirait d’un bon vent du sud qui soufflât pendant quelques jours consécutifs, pour que l’un des plus grands problèmes de la science géographique fût enfin résolu.
– Eh donc ! monsieur Suidorff, demanda à son tour le marchand de salaisons d’un ton patelin qui voulait être malicieux, qu’est-ce que ça pourra bien rapporter à ceux qui, au risque de mille morts, seront parvenus au pôle ?
– De la gloire d’abord ! répliqua le jeune enthousiaste sans remarquer l’intention railleuse du négociant ; et puis, quelle joie, quel orgueil d’atteindre le premier ce point central, cet axe de la terre, vers lequel tendent toutes les nobles aspirations, que tant de navigateurs, depuis les temps historiques, cherchent à toucher, pour lequel ont péri tant de vaillants marins, tant de navires appartenant à toutes les nations du globe !… Que découvrira-t-on à cette extrémité du monde ? Qu’y a-t-il derrière cette formidable banquise, cette immense barrière de glace qui, jusqu’ici, a opposé un obstacle infranchissable aux plus audacieux, aux plus obstinés voyageurs ? Les uns affirment que ces glaces éternelles se continuent jusqu’au pôle. Les autres supposent qu’il existe derrière la banquise une mer libre et clémente, peut-être un continent où règne un climat particulier et où l’on pourrait trouver des animaux inconnus de nous… Quoiqu’il en soit de ces suppositions, croyez-vous, messieurs, qu’il n’y aurait pas une suprême et magnifique jouissance à voir enfin ce que nul être humain n’a vu, à poser le pied où jamais créature humaine n’a posé le sien, à saisir le dernier mot de cette énigme que les plus fières intelligences ont cherchée pendant si longtemps ? Et si, pour arriver à ce splendide résultat, il faut risquer sa vie, qui ne risquerait la sienne sans hésitation, pourvu que l’entreprise eût la moindre chance de réussite ? Or, celle de Van Egberg réussira… elle réussira, j’en suis sûr !
L’enthousiasme n’est pas commun dans le royaume néerlandais, et, en particulier, les membres un peu positifs du cercle des Trois-Tulipes ne semblaient pas susceptibles de subir de fougueux entraînements. Cependant la chaleur communicative de Maurice Suidorff, sa foi profonde dans le succès, la noblesse des sentiments qu’il venait d’exprimer, avaient produit une certaine impression sur tous les assistants. On ne riait plus, et l’on se regardait les uns les autres, comme si l’ardente conviction de ce jeune homme, si posé et si instruit, eût ébranlé les doutes des auditeurs.
Après un moment de silence, le docteur Cornélis reprit :
– Eh bien ! monsieur Suidorff, puisque vous avez tant de confiance dans le résultat de ce voyage, pourquoi ne demandez-vous pas à votre beau-frère de l’accompagner ?
– Ah ! docteur, s’écria Maurice, ce serait là le plus cher de mes vœux ! Van Egberg, qui a foi dans son œuvre, m’accepterait peut-être pour associé ; mais mon beau-frère Paul s’oppose obstinément à ce que je parte avec lui. Il veut bien exposer sa vie, il n’entend pas que j’expose la mienne. Il prétend que, s’il m’arrivait malheur, ma mère resterait sans consolation. À la vérité, ma mère, à qui j’ai touché quelques mots de mes désirs, a jeté les hauts cris et m’a prié de ne plus lui parler de ce projet… Cependant, je ne veux pas désespérer encore ; je ferai de nouvelles tentatives, et peut-être… Dans quelques jours, lorsque l’on commencera le gonflement de l’aérostat, Paul m’a promis de m’amener déjeuner chez M. Van Egberg ; il faut que ce jour-là je sois parvenu à les décider tous… même ma bonne vieille mère, ce qui sera le plus difficile.
Les assistants interrogèrent Maurice sur certaines particularités de la construction du Ruyter sur les précautions que devaient prendre les voyageurs, et Maurice leur répondit avec autant de netteté que de complaisance. Cependant, il était nerveux, agité ; il semblait dévoré par une fièvre intérieure, et peut-être n’avait-il obéi qu’à une distraction en entrant ce soir-là au cercle des Trois-Tulipes, où, comme nous l’avons dit, il venait rarement. Bientôt, n’y tenant plus, il prit un peu brusquement congé et se retira.
Après son départ, la conversation continua parmi les membres du cercle, au sujet du ballon de Van Egberg et du téméraire projet des futurs aéronautes.
– Voyez-vous, messieurs, disait l’ancien capitaine baleinier d’un ton d’oracle, on aura beau se démener comme un cachalot harponné, on ne me persuadera jamais que ces messieurs feront de la bonne besogne. Leur ballon n’atteindra jamais le pôle, et s’ils essayent de l’atteindre, la frêle mécanique sera emportée comme un fétu par les effroyables bourrasques qui règnent dans ces vilains parages. Quant à eux, s’ils n’ont pas le cou cassé, s’ils ne sont pas noyés, ils périront de froid ou de faim, à moins qu’ils ne soient éventrés par les morses ou dévorés par les ours blancs… Souvenez-vous de ce que je vous dis, car je ne parle que de ce que je connais.
– Et puis, encore une fois, ça ne leur rapportera rien du tout, dit le marchand avec non moins de gravité. On prétend que M. Van Egberg a dépensé d’énormes sommes pour son ballon, et maintenant il va exposer sa vie, ainsi que celle de plusieurs autres… À supposer qu’ils réussissent, quels profits tireront-ils de l’affaire, je vous le demande ?
Le docteur Cornélis était pensif.
– Messieurs, reprit-il, quand nous voyons des hommes de la valeur de M. Van Egberg, de M. Paul Teerveld et même de M. Maurice, le brave et avisé jeune homme qui était là tout à l’heure, se passionner pour une entreprise de ce genre au point d’y exposer leur fortune et leur vie, nous devons supposer qu’après en avoir étudié soigneusement les incertitudes et les périls, ils croient avoir les moyens de les surmonter… Attendons donc l’évènement, et, quoi qu’il arrive, reconnaissons que leur pensée est belle, noble et grande, qu’elle mérite la sympathie de tous les gens d’intelligence et de cœur.
Cette opinion de Cornélis, pour qui tous les membres du cercle avaient autant de respect que d’affection, mit fin aux conversations sur Van Egberg et son aérostat. Bientôt il n’y eut plus dans la salle que des gens qui jouaient et buvaient ; et des flocons de fumée, s’échappant de leurs grosses pipes hollandaises, se condensaient autour des becs de gaz en nuages compacts, qui pouvaient donner une idée des brumes polaires.
Frédéric Van Egberg, le promoteur du grand voyage aérien dont il venait d’être question au cercle des Trois-Tulipes, avait alors trente-cinq ans environ. Il était le fils unique d’un négociant, qui lui avait laissé en mourant une immense fortune. Frédéric n’avait pas voulu se marier, afin de se consacrer complètement à l’étude des sciences et en particulier de la chimie, pour laquelle il avait un goût passionné. Pendant dix années de sa vie, il s’était tenu en dehors du monde, faisant de précieuses découvertes scientifiques et écrivant des ouvrages, qui excitaient l’admiration des savants de tous pays.
Parmi ces découvertes, la plus importante sans contredit était celle qui allait donner un essor tout nouveau aux études aérostatiques. Van Egberg avait trouvé, par suite de certaines combinaisons chimiques, deux substances ayant les propriétés, l’une d’augmenter la densité du gaz hydrogène, l’autre d’annuler l’effet de la première, c’est-à-dire de remettre le gaz dans son état normal. Quelles étaient ces substances ? Tout le monde en ignorait exactement la composition, même son ami Paul Teerveld ; néanmoins, tous les deux avaient songé à utiliser l’invention nouvelle dans un voyage aérostatique au pôle nord.
Nulle considération de famille ne pouvait les empêcher l’un et l’autre, nous le répétons, de se dévouer corps et âme à cette œuvre périlleuse. Paul, comme nous l’avons dit, était veuf, sans enfants ; Van Egberg, célibataire, avait toute liberté pour disposer de lui-même et de sa grande fortune. Aussi, depuis quelques mois, s’occupaient-ils uniquement des moyens de réaliser leur grandiose projet. Paul avait donné sa démission de professeur à l’université de Leyde, et l’on prétendait qu’il s’enfermait souvent avec son ami dans un atelier spécial, pour exécuter l’appareil mystérieux dont dépendait le succès de l’entreprise.
Frédéric Van Egberg habitait, à une lieue environ de la ville, une de ces belles maisons de campagne qui existent en grand nombre sur la route de la Haye à Leyde. Les pignons de la sienne étaient d’une blancheur de neige, et, avec sa toiture en tuiles rouges, ses hautes fenêtres cintrées et son perron de six marches, elle se distinguait au milieu de toutes les autres. Elle avait pour dépendances de vastes jardins, où l’on cultivait toutes sortes de fleurs et de légumes susceptibles de croître sous le ciel humide et généralement froid des Pays-Bas. Derrière les jardins, s’étendait une sorte de parc, d’un demi-hectare environ, où Frédéric avait fait installer les ateliers nécessaires à la construction de son aérostat.
Ils consistaient en cinq ou six corps de bâtiment en bois ; près de la haie du jardin, un vaste hangar avait servi à abriter la nacelle, le filet et les cordages, accessoires indispensables de la navigation aérienne. Au centre du chantier, entre deux poutres plantées en terre et hautes comme les mâts d’un navire, apparaissait le ballon dont on parlait tant.
Jusqu’ici, Van Egberg et son fidèle associé Teerveld s’étaient peu souciés d’admettre les oisifs et les curieux inintelligents à visiter les travaux. Les questions saugrenues, les importunités les agaçaient, et l’entrée des ateliers n’avait été permise qu’à un très petit nombre de personnes. Mais, dans la matinée du jour où Maurice Suidorff devait venir déjeuner à la villa, les curieux n’avaient plus besoin de pénétrer dans l’enceinte du parc pour avoir satisfaction, car le Ruyter, que l’on était en train de gonfler depuis la veille, se montrait dans toute sa magnificence par-dessus les clôtures du parc.
Ce ballon, d’une solidité à toute épreuve, était recouvert d’un vernis imperméable, inventé par Van Egberg. Son diamètre horizontal avait vingt-deux mètres ; il était peint, dans le sens de la longueur, de bandes jaunes et noires alternativement. De plus, une zone tricolore l’entourait sur une largeur de trois mètres, rouge en haut, blanc au milieu et bleu en bas ; c’étaient les couleurs nationales de la Hollande. Comme on avait beau temps, un soleil clair faisait ressortir encore ces couleurs éclatantes, et l’énorme sphère, qui ne cessait de grossir, pouvait déjà être aperçue de la ville.
Aussi une foule de gens étaient-ils accourus de la Haye pour jouir de cet imposant spectacle, et se pressaient autour des clôtures, assez basses du reste, qui défendaient l’approche des ateliers. Beaucoup de négociants avaient déserté la bourse et leurs comptoirs afin de se rendre à la villa, et l’on eût pu, parmi les curieux, reconnaître plusieurs membres du cercle des Trois-Tulipes. Certains spectateurs, s’étant procuré des renseignements auprès des nombreux ouvriers de Van Egberg, donnaient des détails sur les opérations du gonflement qui avaient lieu à cette heure. Dans le but d’obtenir les 7 500 mètres cubes de gaz hydrogène nécessaires pour remplir l’aérostat, il avait fallu 36 232 kilogrammes de fer, 185 175 litres d’eau, 21 150 litres d’acide sulfurique. Ces chiffres n’avaient rien d’incroyable, quand, par les portes ouvertes des ateliers, on entrevoyait les gigantesques appareils autour desquels s’agitaient les ouvriers. Trois batteries, de vingt-cinq tonneaux chacune, fournissaient le gaz, qui, après avoir traversé une cuve d’eau pour s’épurer, s’engouffrait dans trois gros tuyaux en caoutchouc conduisant dans le ballon. Or, depuis la veille, le gaz ne cessait d’arriver à grands flots, et le monstrueux aérostat semblait insatiable.
Au milieu des travailleurs et des machines, allaient et venaient deux hommes actifs, donnant des ordres, surveillant tout et parant sur-le-champ aux difficultés qui se présentaient ; c’étaient Frédéric Van Egberg et son lieutenant Paul Teerveld.
Frédéric, de taille moyenne, avait un maintien modeste, réservé, et l’expression de ses traits annonçait une bienveillance extrême. Quant à Paul, beaucoup plus grand que son ami, il jouissait d’une constitution très vigoureuse. Son abondante chevelure bouclée, sa barbe qu’il portait entière s’harmonisaient parfaitement avec ce corps d’athlète. Cependant, sa physionomie annonçait aussi un caractère loyal et franc, ce qui n’empêchait pas l’un et l’autre de montrer, dans l’occasion, autant de décision que d’énergie.
Les manœuvres pour le gonflement de l’aérostat tiraient à leur fin. Van Egberg, après avoir adressé les recommandations dernières au chef des ateliers, s’approcha de Paul, qui venait aussi de reconnaître l’inutilité de sa présence pour ce qui restait à faire.
– Ma foi ! mon cher Paul, lui dit-il, si ton beau-frère Maurice, qui doit déjeuner ce matin à la maison, était arrivé, je crois que le mieux, pour le moment, serait d’aller nous mettre à table.
– Oh ! il viendra sûrement, répliqua le professeur ; il a un trop grand désir… Je soupçonne qu’il s’occupe encore de certaines négociations, qui pourraient ne pas tourner comme il l’entend ; mais il ne tardera pas… Et, tiens ! quand je disais !
En même temps, il étendit le bras vers la porte du jardin, où venait d’apparaître Maurice Suidorff.
L’abord fut cordial de part et d’autre. Maurice était tout en nage et semblait avoir fait à pied le trajet de la ville. En revanche, sa mine était radieuse, et sa figure rosée exprimait la joie la plus vive.
– Si nous allions voir le Ruyter ? dit-il enfin.
– Pas pour le quart d’heure, mon cher Suidorff, répliqua Frédéric en riant ; ne le voyez-vous pas bien d’ici ? Chaque chose a son temps, et… nous mourons de faim.
– C’est bon ! répliqua gaiement Maurice ; aussi bien, j’espère pouvoir bientôt l’admirer à mon gré.
Et il se frottait les mains.
On se dirigea vers la maison, où un excellent déjeuner fut servi par Philippin, qui, avec Gertrude, la vieille cuisinière et le jardinier, formaient toute la maison de Frédéric Van Egberg.
Pendant le repas, Maurice Suidorff montra la même gaieté exubérante. On parlait du ballon, cela va sans dire, et du voyage vers les régions inconnues du globe. Le jeune homme avait toujours un vif enthousiasme et prouvait, par ses citations, qu’il était parfaitement au courant des difficultés scientifiques et géographiques à surmonter. Son beau-frère le regardait parfois avec étonnement, comme s’il ne pouvait comprendre cette attitude résolue ; il en eut bientôt l’explication.
À la fin du déjeuner, au moment où l’on venait d’allumer des cigares, Maurice dit tout à coup :
– N’est-il pas vrai, monsieur Van Egberg, que vous avez besoin encore d’un associé, qui soit dévoué à votre œuvre et à votre personne ?
– Oui, répliqua Frédéric ; toutes mes installations, tous mes approvisionnements sont faits en vue de ce quatrième associé ; mais le choix est si difficile que j’hésite.
– Eh bien ! poursuivit Maurice avec émotion, voudriez-vous combler mes vœux en m’accordant la faveur de m’accepter pour ce quatrième compagnon de voyage ?
– Comment, Maurice, encore ? dit Paul avec humeur ; tu sais bien…
– Patience, mon cher Paul ! s’écria Suidorff ; laisse-moi d’abord présenter ma requête à M. Van Egberg ; après quoi nous causerons ensemble.
Paul se tut et se remit à fumer précipitamment son cigare.
– Monsieur Van Egberg, reprit Maurice d’une voix vibrante, vous me connaissez depuis mon enfance et vous savez ce que je suis. Jeune et robuste, je me sens prêt à sacrifier mon bien-être, mon existence au besoin, pour le succès de votre entreprise, et j’aurai pour vous, que j’aime et que j’honore, le même dévouement que pour mon cher Paul. Quant aux services que je pourrai rendre pendant les pérégrinations lointaines du Ruyter, ils sont de diverses natures. On a peut-être trop vanté ma mémoire ; mais, telle qu’elle est, je pense qu’elle aura souvent l’occasion de vous être utile. L’espace restreint dont on dispose dans la nacelle du ballon ne permet pas d’emporter beaucoup de livres ; je serai pour vous comme un livre toujours ouvert, que vous pourrez feuilleter à votre gré. Récemment encore, j’ai fait des études en vue du voyage projeté, et j’ose affirmer que toutes les questions sur l’histoire, la géographie, les sciences physiques et naturelles, que l’on voudra bien m’adresser, ne resteront pas sans réponse. De plus, je rédigerai les notes, les observations de voyage, une sorte de « journal du bord », où je consignerai les découvertes, les rectifications, les réflexions qui mériteront d’être mentionnées. Enfin, si vous ne me repoussez pas, je serai tout à vous, tête, bras et cœur… Maintenant, décidez.
Frédéric parut embarrassé et regarda Paul, qui fronçait le sourcil.
– Mon cher Maurice, répondit-il en prenant la main de l’enthousiaste jeune homme, je vous connais depuis longtemps en effet, et il n’est personne au monde que je choisirais plus volontiers pour compagnon de voyage. J’ai la certitude que, par votre grand savoir, votre activité, votre fermeté, vous seriez un des membres les plus précieux de notre association… Mais permettez-moi de vous rappeler qu’il vous est interdit de disposer de vous-même dans une affaire aussi grave ; des affections saintes, des devoirs sacrés vous retiennent ici, et votre frère vous dira…
– Je lui dirai, répliqua Paul brusquement, en détournant la tête, qu’il a tort de revenir sur ce pénible sujet ; il ne peut oublier que des obstacles insurmontables empêchent d’accepter sa proposition.
– Et parmi ces obstacles, demanda Maurice avec douceur, y aurait-il cette pensée, mon cher Paul, que je ne saurais être d’aucune utilité dans cette belle entreprise ?
– Ce n’est pas cela ; je suis au contraire convaincu, comme Van Egberg, que nul ne pourrait nous rendre de plus grands services ; tu as les qualités brillantes et solides qui font réussir, et, d’autre part, l’amitié fraternelle qui nous lie… Voyons ! Maurice, oublies-tu que ta bonne et digne mère, dont, depuis la mort de ma pauvre femme, tu es la joie, l’orgueil et l’unique espérance, se jetterait dans un brasier ardent plutôt que de te laisser partir ?
– Ainsi donc, reprit Maurice, qui semblait se contenir avec peine, si ma mère consentait à ce départ, tu n’y ferais, pour ton compte, aucune opposition ?
– Sans doute ; mais madame Suidorff ne consentira jamais…
– C’est ce qui te trompe, Paul, s’écria Maurice avec explosion ; j’ai tant prié, tant supplié, j’ai employé tant d’influences puissantes, mis en jeu tant de ressorts, que ma généreuse et tendre mère a fini par céder ; c’est avec son assentiment formel que je viens vous conjurer de me donner une place parmi vous.
– Si cela était, dit Van Egberg qui se tourna encore vers Teerveld, il n’y aurait plus d’objection…
Paul, en entendant l’affirmation si précise de son beau-frère, avait fait un geste d’étonnement et de défiance.
– Je ne peux croire cela, s’écria-t-il ; et à moins que madame Suidorff ne déclare nettement en ma présence…
– Elle te le déclarera, s’écria Maurice, et en attendant, tu ajouteras bien foi à sa signature… Voici le consentement que je suis parvenu à lui arracher tout à l’heure, afin de ne laisser aucun doute dans ton esprit et dans celui de M. Van Egberg.
Il tira de sa poche un papier tout froissé, tout griffonné, et sur lequel on eût pu découvrir des traces de larmes. Ce papier contenait seulement ces mots :
« Je ne m’oppose plus à ce que mon fils bien-aimé Maurice accompagne M. Van Egberg et mon cher gendre Paul Teerveld, dans leur voyage en ballon. Ver SUIDORFF. »
Paul, après avoir lu, tortillait tristement le papier entre ses doigts.
– Quelles séductions, dit-il, quels sortilèges, Maurice, as-tu employés pour décider ta mère ?…
– Oh ! la tâche a été difficile ! répliqua Maurice d’une voix altérée ; mais j’ai une telle confiance dans la sagesse, la prudence, la science supérieure de M. Van Egberg et dans les tiennes, que je suis parvenu à la lui faire partager. J’ai persuadé à cette bonne et simple femme qu’il n’y a pas plus de risques à partir sur le Ruyter pour aller au pôle nord, qu’à monter en wagon pour aller de la Haye à Amsterdam… Ne la détrompe pas, Paul, je t’en conjure ! Ne la fais pas revenir sur sa décision !
– Je ne l’essayerai pas, Maurice, et cependant…
– Eh bien ! reprit Van Egberg, puisque madame Suidorff est consentante, puisque Maurice éprouve un si ardent désir de tenter la fortune avec nous…
– Soit donc ! répliqua Paul en poussant un profond soupir.
Maurice bondit de joie.
– Merci, monsieur Van Egberg, s’écria-t-il transporté ; merci aussi, mon excellent Paul… Enfin ! me voilà des vôtres, et vous ne vous repentirez pas de m’avoir associé à votre œuvre… Nous reviendrons, allez ! Nous reviendrons tous, heureux et fiers d’avoir accompli, chacun dans la mesure de ses forces, une des plus belles conquêtes de la science géographique.
Il se jeta dans les bras de son beau-frère et le serra convulsivement sur sa poitrine ; puis il embrassa Van Egberg à son tour avec effusion. Tous étaient très émus et avaient les yeux pleins de larmes.
Maurice le premier surmonta son attendrissement.
– Maintenant, reprit-il avec résolution, tout est convenu… Allons voir le Ruyter.
– En effet, dit Van Egberg, le gonflement doit être terminé à cette heure, et il y a sans doute de la besogne pour nous là-bas.
Les trois amis se hâtèrent de quitter la maison et se dirigèrent vers l’enceinte de l’aérostat, suivis de Philippin, qui, lui aussi, avait hâte d’admirer la machine aérienne à laquelle son existence allait être confiée, ainsi que celle de ses maîtres.
Comme l’avait annoncé Frédéric, le gonflement était terminé, et la majestueuse sphère se balançait mollement dans les airs. Il n’y avait pas à craindre pourtant qu’elle s’échappât, car elle était maintenue par cent cinquante sacs pleins de sable, dont chacun pesait quatre-vingts kilogrammes. Ces sacs étaient disposés en cercle autour du Ruyter, et chacun d’eux s’amarrait au filet par une corde solide. Les brillantes couleurs dont le ballon était peint prenaient au soleil un éclat incomparable.
Ainsi que l’avait prévu Van Egberg, sa présence et celle de Paul au milieu des ouvriers devenaient nécessaires en ce moment. Il s’agissait d’attacher au-dessous du filet le lourd cercle de fer destiné à soutenir la nacelle. Ce cercle était ovale et avait huit mètres dans son plus grand diamètre. Les deux amis s’avancèrent pour surveiller l’opération nouvelle, et Maurice resta avec Philippin hors du centre d’action, en attendant le retour de son frère et de Frédéric.
Philippin était un grand garçon, de vingt-huit à trente ans, qui connaissait à peine sa famille, car, depuis qu’il avait l’âge de raison, il était au service de Van Egberg. Quoique long et mince, il ne manquait pas de vigueur, et ses traits placides, ses yeux habituellement un peu effarés, laissaient deviner une naïveté extrême. Il était en contemplation devant l’aérostat, la main posée au-dessus de ses yeux pour se garantir du soleil, et il dit à Maurice d’un ton de ravissement :
– Hein ! monsieur Suidorff, est-il assez beau, notre Ruyter ? ça ne donne-t-il pas envie de partir avec lui pour aller au fin fond du ciel et de la terre ?
– Aussi ai-je cette envie-là, mon bon Philippin, répliqua Maurice avec gaieté ; et elle sera bientôt satisfaite, puisqu’il vient d’être entendu que je pars avec vous.
– Pas possible !
Nous devons dire que ce mot « pas possible ! » était toujours le premier qui échappait à Philippin quand une chose l’étonnait.
– Cela est pourtant… Ne savais-tu pas que M. Van Egberg avait l’intention de s’adjoindre un quatrième compagnon de voyage ?
– Sans doute, sans doute ; mais… c’est singulier !
Ce « c’est singulier » était encore une expression favorite de Philippin, lorsqu’il commençait à comprendre.
Cependant, il ajouta presque aussitôt :
– Et que dira votre maman, monsieur Suidorff ?
Le souvenir de sa mère appela un nuage sur le front de Maurice.
– Tout est arrangé avec elle, répliqua-t-il précipitamment ; elle permet que j’accompagne mon beau-frère Paul… Mais, toi-même, ajouta-t-il, afin peut-être d’éviter une nouvelle question sur un sujet douloureux, comment t’es-tu décidé à suivre ton maître dans ce voyage, qui peut-être aura ses périls ?
– Que voulez-vous, monsieur ! répliqua Philippin avec bonhomie ; je n’ai pas de parents, ou du moins je ne les connais guère, et M. Van Egberg est toute ma famille… Aussi je l’aime, je l’aime, que je ne saurais dire combien… Ma foi ! il irait au diable que je ne voudrais pas le quitter, d’autant moins, qu’en quelque endroit qu’il aille, il aura certainement besoin de mes services.
– Tu es un brave garçon… Je t’admire de suivre ton maître par pure amitié, toi qui ne t’inquiètes pas, sans doute, des problèmes scientifiques que nous essayerons de résoudre.
– Eh ! monsieur Maurice, reprit Philippin en se redressant d’un petit air grave, il y a peut-être bien aussi un brin de curiosité dans mon affaire ; on n’est pas fâché tout de même de voir de belles choses, et certainement elles ne manqueront pas… Il y a d’abord les montagnes de glace qui sont, dit-on, plus hautes que tous les clochers de la Haye les uns sur les autres ; puis les ours blancs, avec lesquels je compte faire d’excellents biftecks, d’après la recette d’un de mes amis, ancien chef de cuisine d’un prince russe… Ensuite, il faut l’avouer, je serais bien content de voir ce « cercle polaire » dont ces messieurs parlent souvent devant moi, et qui doit avoir de furieuses dimensions, si, comme on le prétend, il fait tout le tour du globe… Et puis, je voudrais bien aussi voir le pôle, cet « axe de la terre » autour duquel on assure que tourne notre monde, comme une roue tourne autour d’un essieu, et qui doit être également de belle taille…
– Pardieu ! je le crois bien ! interrompit Maurice en riant aux éclats ; l’essieu d’une roue qui aurait neuf mille lieues de tour !
Ce rire du jeune savant interloqua Philippin.
– Bon ! reprit-il d’un air confus, voilà que vous vous moquez de moi, comme ces messieurs quand je me risque à toucher un mot de ces merveilles… On dirait qu’ils veulent les garder pour eux seuls, et ils ne m’expliquent rien.
– Allons ! allons ! mon ami Philippin, console-toi. Je t’expliquerai tout cela quand nous serons au pôle… si nous y arrivons.
En ce moment, Van Egberg, laissant à Teerveld le soin de surveiller les manœuvres, s’approcha d’eux.
– Mon cher Maurice, dit-il amicalement, ne voulez-vous pas venir visiter la nacelle avant qu’on l’attache au ballon ? C’est, je crois, la partie la plus intéressante et la plus curieuse du Ruyter.
– Me voici, répliqua Maurice.
Et il suivit Van Egberg, pendant que Philippin retournait la maison, tout heureux de songer aux explications lumineuses qu’il tirerait plus tard du complaisant Suidorff.
La nacelle, comme nous l’avons dit, était un chef-d’œuvre de solidité et d’élégance. Elle avait la forme d’un wagon de chemin de fer ; longue de sept mètres, elle avait deux mètres cinquante de hauteur et autant de largeur. Sa base arrondie était garnie, à la partie inférieure, de quatre tampons très élastiques pour amortir les chocs. Divisée en trois compartiments, dont chacun avait deux fenêtres, elle se terminait par deux balcons extérieurs avec balustrades à hauteur d’appui. Une porte se trouvait à chacune des extrémités, et ses parois, en fine tôle bronzée, étaient munies intérieurement d’un capitonnage de dix centimètres d’épaisseur.
On pénétra dans le premier compartiment, et Maurice remarqua deux banquettes en tôle, disposées à droite et à gauche.
Il demanda à quoi elles devaient servir.
– Ces banquettes, répondit Frédéric, se prolongent dans toute la longueur de la nacelle, et ne sont autres que deux réservoirs ; l’une contiendra de l’eau pour notre alimentation ; l’autre, du gaz hydrogène pour notre chauffage et notre cuisine. Dans la seconde, dont la capacité est de près de deux mètres cubes, je compte emmagasiner, à une haute pression, le gaz nécessaire pour la durée de notre voyage.
Dans le compartiment du milieu, deux ouvertures, pratiquées à la partie supérieure de la nacelle, attirèrent encore l’attention de Maurice.
– Et ces trous, demanda-t-il, à quel usage serviront-ils ?
– C’est par là que passeront les conduits de l’appareil destiné à manœuvrer l’aérostat.
Maurice grillait d’envie de faire des questions sur cet important sujet, mais il se tut par discrétion ; Van Egberg devina sa pensée.
– Mon cher Maurice, reprit-il en souriant, maintenant que vous êtes des nôtres, je vous apprendrai ce que sait déjà votre frère de ma découverte. Vous êtes trop versé dans les sciences physiques et chimiques, comme dans toutes les autres, pour ne pas me comprendre avec une extrême facilité. Vous n’ignorez pas, ainsi qu’on l’enseigne, que la force ascensionnelle du gaz hydrogène est de 1 210 grammes par mètre cube ; eh bien, une substance que j’ai découverte, décomposée par l’électricité, a la propriété de diminuer de trois dixièmes la force ascensionnelle de l’hydrogène, c’est-à-dire de la réduire à 847 grammes par mètre. J’ai découvert ensuite une autre substance qui, après avoir été également décomposée, détruit l’effet de la première et rend au gaz sa force d’ascension intégrale. Vous voyez le résultat que j’obtiens à l’aide de ces deux agents : l’un me permet de monter, l’autre de descendre. Avec le poids considérable que l’aérostat va emporter, mon appareil me permettra d’atteindre une hauteur maximum de cinq mille mètres, et de redescendre sans qu’un atome de gaz ait été perdu. Aussi le Ruyter n’a-t-il pas de soupape, comme en ont les ballons ordinaires.
– C’est merveilleux ! dit Maurice ; néanmoins, je ne peux m’expliquer…
– Une expérience bien simple vous donnera idée de l’effet que produit mon appareil. Prenons un volume d’air, faisons-le chauffer, puis laissons-le refroidir. Que s’est-il passé ? L’air s’est dilaté par la chaleur et s’est contracté de nouveau par le froid, mais il n’a subi aucune altération. Il en est de même de l’hydrogène qui, dans le cas dont nous parlons, a subi dilatation et contraction.
– Fort bien ; mais, comme toute matière décomposée laisse un résidu quelconque, que reste-t-il de vos substances quand elles ont été employées ?
– Un liquide noirâtre et huileux ; elles sont injectées dans le gaz sous forme de vapeurs et se condensent sur les parois du ballon ; je recueille le liquide par un conduit, ménagé à la partie inférieure.
– Tout cela est merveilleux, répéta Maurice ; et combien je suis impatient de voir en œuvre ces étonnantes combinaisons !
– Votre frère et moi, nous nous sommes livrés déjà à de nombreuses expériences, et elles ont réussi… Mais demain, nous tenterons une expérience décisive, en ballon captif, et il vous sera facile de vous assurer que tout a été prévu et calculé en vue du succès.
Frédéric montra encore à son nouvel associé le précieux appareil, qui ne devait être mis en place qu’au dernier moment. Il était contenu dans une caisse en tôle, d’un mètre de longueur environ ; mais la caisse était hermétiquement close, et l’on ne pouvait juger du mécanisme délicat qu’elle recélait. Sur la partie supérieure, on voyait seulement deux leviers, terminés chacun par une poignée en porcelaine, deux douilles en cuivre taraudées extérieurement, et enfin, au centre, un cercle horizontal gradué, sur lequel une aiguille, qui avait son pivot dans la caisse même, devait probablement servir à indiquer les diverses hauteurs de l’aérostat.
Nous n’entrerons pas dans le détail des opérations exécutées ce jour-là pour mettre le ballon en état de partir ; il suffira de savoir que, le soir, lorsque Paul Teerveld et Maurice retournèrent à la Haye, la nacelle, malgré son poids énorme, avait été amenée et fixée par huit solides chaînes de fer au cercle du Ruyter.
Il ne restait plus qu’à charger, après les avoir pesés, tous les objets qu’il y avait à emporter, puis à faire l’expérience de l’ascension captive ; ce devait être l’œuvre du lendemain et des jours suivants.
Le lendemain, en effet, dès les premières heures de la matinée, les deux beaux-frères accoururent à la villa. On eût pu remarquer que Maurice Suidorff était triste et avait les yeux rouges de larmes, comme s’il eût récemment supporté quelque nouvel assaut de la tendresse maternelle. Cependant, Paul ne lui adressa aucune question, et le nuage de chagrin qui couvrait le front de Maurice se dissipa, dès que le vaillant jeune homme eut commencé à s’occuper de la tâche qui lui était assignée dans les travaux communs.
Ils trouvèrent Frédéric Van Egberg déjà en besogne, au milieu de ses ouvriers.
Le poids total de la cargaison du Ruyter était de neuf mille kilogrammes, y compris celui des quatre voyageurs. On avait calculé exactement, outre le poids de l’hydrogène lui-même, celui du ballon, du cercle et du filet, de la nacelle, des appareils et instruments, des cordages, des ancres et des outils. De plus, il fallait des approvisionnements de nourriture pour quatre personnes pendant plusieurs mois ; car les pays inhospitaliers que l’on espérait atteindre n’offriraient aucune ressource aux voyageurs. On emportait donc de l’eau douce, du biscuit, de la viande sèche ou pemmican, des boîtes de conserve, du vin et des liqueurs ; puis des meubles et de la literie, du linge et des vêtements, des armes et des munitions, des livres, du tabac, etc.
Tout cela, grâce à Frédéric, était déjà arrimé en partie dans la nacelle. La viande, les conserves, le biscuit et le vin étaient enfermés dans de petites caisses parfaitement étanches. L’eau potable devait remplir l’un des réservoirs qui servaient de banquettes.
Outre l’appareil contenu dans la caisse de tôle, les instruments étaient : un sextant, un graphomètre, deux baromètres, dont un à siphon ; des longues-vues, trois thermomètres, dont un à maxima et un à minima ; deux boussoles, deux chronomètres, un microscope, un podomètre, un appareil photographique, et enfin une caisse contenant divers ingrédients, dont Frédéric et Paul connaissaient seuls la nature.
Les armes se composaient de trois excellents fusils se chargeant par la culasse, de trois fusils ordinaires, d’autant de revolvers et de quatre couteaux de chasse. Le mobilier consistait en deux petites tables, quelques sièges légers, des couvertures et matelas, ainsi qu’un attirail complet de cuisine.
On n’avait pas oublié l’outillage qui pouvait, dans certains cas, devenir indispensable : pelle, pioche, marteau, maillets, ciseaux. Quatre petites ancres, à branches droites, étaient destinées à être enfouies dans le sol et à servir de point d’attache, dans le cas où les arbres manqueraient.
Les cordages, cette partie si importante de l’approvisionnement pour la conduite et la sûreté de l’aérostat, comprenaient : d’abord, une corde en filin de mille mètres de long, et ne pesant que cinquante-cinq kilogrammes ; on devait l’employer à captiver le ballon et aussi, le cas échéant, à opérer des sondages en mer ; puis une autre corde de cent mètres, du poids de trente-cinq kilogrammes ; elle était destinée, suivant l’invention de Green, à arrêter l’aérostat à la descente par son traînage, sur le sol ; elle pourrait également indiquer la direction suivie sur mer, quand les points de repère feraient défaut. Le reste des cordes, de différentes longueurs, devait permettre d’attacher le ballon au sol en cas de grand vent.
Tout avait été calculé avec tant de justesse, que quelques heures suffirent pour mettre en ordre cette volumineuse cargaison dans la nacelle du Ruyter, et, à l’heure fixée pour l’ascension captive, l’expérience put avoir lieu sans difficulté.
La nouvelle de cette solennelle expérience s’était répandue à la Haye et avait été annoncée par les journaux ; aussi une foule immense se pressait-elle autour de l’enceinte du ballon.
Cette fois, Van Egberg, sans admettre tout ce monde qui eût pu gêner les manœuvres, avait invité quelques-uns des personnages les plus distingués de la ville à venir voir l’épreuve décisive. Des savants, des journalistes, des marins, quelques-unes des autorités locales, pénétrèrent dans l’enceinte, où ils furent accueillis avec urbanité par Frédéric et par ses amis.
Le temps continuait d’être beau, l’air paraissait très calme. Les quatre voyageurs ayant pris place dans la nacelle, Frédéric Van Egberg manœuvra le mécanisme, de manière à donner au gaz le minimum de force ascensionnelle. L’équilibre du ballon dans l’air ambiant étant établi, on détacha les cent cinquante cordes des sacs de sable, et l’on fixa à un coin de la nacelle la corde de mille mètres, afin de pouvoir ramener le Ruyter dans l’enceinte si le vent se faisait sentir dans les couches d’air qu’on allait atteindre.
Lorsque tout fut prêt, Frédéric appuya sur l’un des leviers de l’appareil jusqu’à ce que l’aiguille du cercle gradué marquât dix ; c’était le chiffre qui permettait au ballon d’atteindre la hauteur de mille mètres. Après quelques minutes d’attente, on vit l’énorme aérostat osciller lentement ; puis les cordes du cercle se tendirent, et la nacelle, irrésistiblement attirée, quitta le sol. On lâcha du câble, et le Ruyter, tout pavoisé de drapeaux aux couleurs hollandaises, commença de s’élever majestueusement dans les airs.
De bruyantes acclamations, des applaudissements partirent de toutes parts et se prolongèrent au loin dans la campagne.
Frédéric et ses compagnons, debout à l’un des balcons de la nacelle, saluèrent la foule ; mais bientôt leur attention fut absorbée par le spectacle grandiose qui s’offrait à leurs regards. Un horizon immense semblait encore s’agrandir autour d’eux à mesure qu’ils s’élevaient.
Cette ascension se prolongea verticalement jusqu’à six cents mètres ; passé cette hauteur, un vent léger poussa sensiblement le ballon vers l’ouest. Son mouvement ascendant diminua peu à peu, à mesure qu’il se rapprochait du point voulu. Enfin, vingt minutes après qu’il eut quitté terre, il atteignit la hauteur de mille mètres. La corde, qui le maintenait, faisait à cette heure un angle d’environ vingt-cinq degrés avec la verticale.
L’expérience avait donc tout le succès désirable ; néanmoins, au bout d’un moment, Van Egberg, désirant prouver à ses compagnons et aux spectateurs de la plaine qu’il possédait réellement le moyen de mouvoir l’aérostat de haut en bas, résolut de descendre jusqu’à cinq cents mètres et de remonter ensuite. Il disposa donc l’appareil dans ce but, et l’aérostat ne tarda pas à descendre. Il s’arrêta et sembla planer à l’altitude de cinq cents mètres, comme il fut facile de le constater par le changement de niveau de la colonne barométrique. Le résultat étant bien établi, on remonta de nouveau, et ce fut seulement après avoir démontré que l’effet répondait avec exactitude à la théorie que Frédéric se décida à redescendre définitivement.
Cette descente s’opéra avec lenteur. Au bout d’une demi-heure, la base de la nacelle frappa le sol ; mais, au lieu de s’y asseoir fermement du premier coup, elle rebondit jusqu’à environ vingt mètres de haut. C’était là un effet inévitable ; aussi, pour parer à ce désagréable contrecoup, Frédéric, comme on sait, avait-il fait fixer sous la nacelle quatre tampons très élastiques. Un deuxième bond eut lieu, puis un troisième, puis un quatrième ; après le cinquième, la nacelle demeura immobile.
La réussite dépassait toutes les espérances, et un tonnerre d’applaudissements s’éleva encore du sein de la foule ; les bravos, les hourras n’avaient pas de fin.
À peine Van Egberg et ses compagnons eurent-ils mis pied à terre, qu’ils furent entourés par toutes les personnes de distinction invitées à cette espèce de fête. On leur serrait les mains, on les accablait de félicitations enthousiastes.
Frédéric et Paul, que cet heureux résultat ne semblait nullement étonner, répondaient à ces démonstrations avec politesse, mais avec le calme le plus complet. Maurice Suidorff, au contraire, laissait éclater sa joie. Quant à Philippin, qui, pendant l’ascension, n’avait pas prononcé un mot et s’était tenu convulsivement cramponné à la balustrade du balcon, il avait été pris, en touchant la terre, d’une loquacité nerveuse.
– Allez, ce n’est pas difficile de voyager en ballon ! disait-il à quelques ouvriers qui l’entouraient ; moi, sans avoir appris, je me suis tout de suite trouvé au courant de la chose. On croirait qu’on ne bouge pas ; c’est la terre, les maisons, les arbres, qui ont l’air de danser la sarabande. On peut là-dedans boire, manger, dormir à son aise, faire les ouvrages les plus délicats, enfiler des aiguilles ou piquer de lard un râble de lièvre… Ah ! je suis fièrement content que mon maître ait consenti à m’amener ! Sans compter que je vais voir des choses diablement curieuses… Et le cercle polaire, et l’axe de la terre, et puis les ours blancs, les baleines… Par exemple, je ne vous dirai pas si les baleines, c’est bon à manger ; ça doit être joliment dur, ce me semble !
Et le brave garçon riait d’un rire convulsif.
D’autre part, Maurice Suidorff, entouré de quelques amis de sa famille, qui exprimaient leur admiration pour cette mémorable expérience, leur disait avec émotion :
– Répétez tout cela à ma pauvre mère, messieurs ; elle se lamente de nous voir partir, Paul et moi… moi surtout… dans le ballon de Van Egberg. Assurez-la que, dans cette merveilleuse machine, nous courrons moins de dangers que dans les wagons de certains chemins de fer américains ou sur les paquebots de certaines compagnies maritimes. Ses supplications me brisent le cœur ; et si, maintenant que je connais toutes les beautés et toutes les grandeurs de l’entreprise où je m’engage, ma mère venait à me retirer la permission qu’elle m’a donnée, j’en mourrais de douleur et de honte.
Tout le monde retourna à la ville, et les trois amis passèrent le reste de la journée à perfectionner l’arrimage et les installations dans l’intérieur de la nacelle.
On était alors à la fin d’avril, et Frédéric avait fixé la date du départ entre le 10 et le 15 mai, ne jugeant pas prudent de s’aventurer plus tôt dans les parages du nord, où le long et terrible hiver polaire pouvait encore exercer ses fureurs.
Du reste, dès le lendemain du jour de l’expérience, le temps changea, et il s’éleva un vent tout à fait contraire à la direction que l’on voulait suivre. Ce vent devint même si fort, qu’il fallut prendre des précautions pour la sûreté de l’aérostat et le fixer au sol par de nouveaux et solides cordages. De plus, on dut veiller chaque nuit par crainte de quelque accident imprévu.
Plusieurs jours se passèrent. Chaque matin, Paul et Maurice arrivaient de la Haye, et l’on se préparait à tout évènement. Maurice paraissait toujours triste et inquiet ; quoiqu’il ne négligeât aucun des devoirs de sa tâche, il y avait quelque chose de fiévreux dans ses actions et dans ses paroles.
Le 4 mai, au matin, les deux beaux-frères vinrent à la villa, selon leur coutume. Ils trouvèrent Frédéric très occupé auprès du ballon.
– Mes amis, leur dit-il, le vent a tourné cette nuit, et il serait assez favorable à notre départ. D’après l’anémomètre, l’air se déplace avec une vitesse de onze mètres à la seconde, dans la direction sud 31° ouest… Maurice, vous qui avez le département des cartes, voyez donc où cette bonne brise-là pourrait nous conduire.
Maurice traça à la hâte, sur une carte d’Europe, une ligne qui faisait un angle de trente et un degrés avec le méridien. Il constata que cette ligne abordait la presqu’île Scandinave, à une vingtaine de milles de Christiansand, et qu’après la traversée de la Laponie, elle touchait l’océan Glacial au cap Tana, situé à quarante-cinq milles à l’est du cap Nord.
Il conclut que ce vent devait porter en plein sur le continent.
– Cette route nous conviendrait bien, répliqua Van Egberg, quoiqu’il soit très probable qu’un nouveau changement de vent surviendra, pendant ce trajet d’environ douze cents milles géographiques. Eh bien, messieurs, je me demande si, toute réflexion faite, nous ne devrions pas profiter de ce vent favorable et partir aujourd’hui… à l’instant même. Quant à moi, mes affaires sont complètement réglées ; mon testament est déposé chez mon notaire de la Haye. J’ai récompensé largement mes ouvriers, donné mes instructions aux serviteurs qui doivent garder ma maison pendant mon absence… Rien personnellement ne m’empêche de me mettre en route… Et vous, mes bons amis, qu’en pensez-vous ?
– Mes préparatifs à moi, répliqua Paul, sont terminés aussi depuis longtemps, et ce que je dois emporter avec moi se trouve ici déjà ; mais peut-être Maurice…
– Partons ! il faut partir sans retard ! s’écria Maurice impétueusement ; comme ça, je n’embrasserai pas ma pauvre mère ; mais, elle et moi, nous ne ferions que nous attendrir inutilement, et peut-être au dernier moment le courage lui manquerait-il… Je vais écrire pour lui dire adieu, et j’enverrai la lettre par un ouvrier.
– Je crois que tu as raison, Maurice, dit Paul en soupirant ; ni elle, ni toi, peut-être, vous n’auriez le courage à l’heure de la séparation… Présente-lui donc mes adieux en même temps que les tiens.
Suidorff, tout frémissant d’émotion, se rendit dans le cabinet de Van Egberg pour écrire sa lettre, et Frédéric alla prévenir Philippin qu’il eût à faire ses préparatifs pour un départ immédiat.
– Mes préparatifs ! répliqua Philippin, mais ils sont terminés depuis longtemps !… Tenez, voilà.
Il prit sur un meuble un mouchoir noué par les quatre coins et qui semblait contenir de menus objets de toilette. Dans la corne du mouchoir était passé un bâton, qui avait dû être coupé à quelque arbre du jardin. Le tout ressemblait au bagage d’un compagnon du devoir, partant pour une tournée.
Néanmoins, à cet égard, Philippin eut des doutes.
– Maître, demanda-t-il avec embarras, ce bâton me sera-t-il vraiment nécessaire pour aller au pôle nord ?
Il ne reçut pas de réponse ; Van Egberg était déjà retourné auprès du ballon.





























