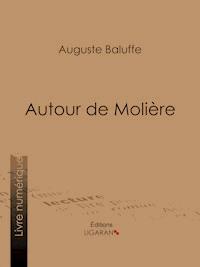
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ne croyez pas en être quittes pour si peu avec les érudits soupçonneux, à propos de l'inventaire en question ! Jean Poquelin a besoin d'être présenté sous un aspect nouveau. Connaissez à fond cette âme sordide et cupide ! Voyez-le dans son rôle de «prêteur à la petite semaine». Cette étude de mœurs a son agrément; et puis, vous saurez par là comment l'Harpagon de l'Avare n'est, après tout, que Jean Poquelin mis à la scène par son fils."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Tout ce qui est imprimé est inédit ! » Ce paradoxe de Théophile Gautier devient souvent une vérité, pour l’histoire de Molière en général et pour l’histoire du père de Molière en particulier. Les publications de documents authentiques sur Jean Poquelin ont beau se répéter : elles sont et demeurent comme nulles et non avenues. La légende a pris pied dans sa biographie ; elle en dispose à son gré, malgré tout. Pour la légende, possession vaut titre. Les décrets de son bon plaisir ont force de loi. Mais (tant il est vrai qu’il ne faut jamais désespérer) si la légende est souveraine maîtresse, elle n’est pas immuable : elle consent à changer quelquefois. C’est ainsi qu’au bout d’un siècle, la tradition qui faisait du père de Molière un « fripier » de la pire espèce, a bien voulu reconnaître qu’il était d’un peu moins basse condition, Jean Poquelin a obtenu de l’avancement à l’ancienneté.
Aujourd’hui, il est classé professionnellement à mi-chemin du métier à l’art. On le considère comme un tapissier distingué, presque comme « un bourgeois », ce qui est déjà quelque chose. Par malheur, non seulement on lui signifie qu’à présent il n’a pas à prétendre à mieux et qu’on a fait assez et plus qu’assez pour lui, mais on lui fait en outre payer, et payer cher, les frais de son élévation professionnelle. C’est aux dépens de sa moralité qu’on le déplace et décrasse. Il était infime : le voilà presque infâme. La légende, en se modifiant, est en train de décréter que Jean Poquelin fut un avare abominable, un prêteur sur gages, un usurier à la petite semaine, exerçant sa cupidité sordide même à l’encontre de ses enfants, exploitant les uns, spoliant les autres, bref le type même qui aurait servi de modèle à Molière pour son personnage d’Harpagon !
Eh bien, avec tout le respect dû aux légendes, et quoique je n’ignore pas les ménagements qu’exigent certaines manières de voir et surtout de savoir, et quoique je sache combien il est imprudent de déranger les habitudes prises par nombre d’esprits qui n’aiment pas à changer d’opinion, – j’ose dire et je veux prouver que le père de Molière fut un brave et digne honnête homme, commerçant adroit, mais droit, père de famille irréprochable, – un homme probe et, de toute façon, « propre ». Se pourrait-il, même aux yeux de quelques érudits, qui semblent écrire l’histoire de Molière d’un commun accord et par consentement mutuel, que les vérités historiques contenues dans cette étude fussent du nombre des vérités qui fâchent ? Je mets quelque fierté de conscience à croire qu’on ne m’en voudra pas de faire ici le portrait d’un père de Molière digne de son fils !
Jean Poquelin, né en 1595, était le premier de neuf enfants, quatre fils et cinq filles, dont la plupart n’ont pas laissé jusqu’ici plus de trace dans l’existence de Molière que les Poquelin des autres branches. Comme lui, son père se prénommait Jean, ce prénom faisant en quelque sorte partie de leur raison de commerce. En un temps où la profession de tapissier était considérée et considérable, puisqu’on jugeait ce corps d’état comme aussi riche à lui seul que les cinq autres classes des marchands de Paris, le vieux Poquelin, père de Jean et aïeul de Molière, n’était pas des moins achalandés. Son mariage avec Agnès Mazuel témoigne assez qu’il n’avait pas l’exclusive ambition de l’argent. Agnès Mazuel était la fille d’un artiste alors célèbre, Guillaume Mazuel, violon du Roi, et renommé comme un des trois maîtres du violon en France : ses deux émules étaient Farinel et Brulard. C’était toute une famille de musiciens que celle des Mazuel, et l’infusion d’un tel sang dans les veines d’un Poquelin aide à expliquer Molière. La fantaisie, la poésie entrèrent assurément de compte à demi dans la maison du tapissier. Physiologiquement, il est déjà difficile que Jean Poquelin ne soit pas assez fils de sa mère pour tenir d’Agnès Mazuel. Son mariage, à lui aussi, semble inspiré par des convenances plutôt de cœur que d’intérêt. Du moins, la distinction personnelle de sa femme lui fait honneur.
C’est le 25 avril 1621 que furent célébrées les fiançailles de Jean Poquelin, tapissier, et de Marie Cressé. La bénédiction nuptiale eut lieu deux jours après. Le contrat est du 22 février précédent. Chacun des époux apporte en dot une valeur de 2 200 livres, soit 11 à 12 000 francs de nos jours. Ce n’est d’ailleurs qu’en avancement d’hoirie. Sur la part de Jean Poquelin est stipulée l’origine de « 200 livres provenant du gain fait par ledit futur ». Ce détail a son parfum de probité laborieuse. Les 2 000 livres, sans compter le « gain », sont représentées par « la marchandise et meubles » en magasin. La future a « 1 800 livres en deniers comptants », « le surplus en meubles, habits et linge ». Il n’est pas déclaré de bijoux. Or, lorsque, dans dix ans, Marie Cressé viendra à mourir, elle ne laissera pas moins de « 1 148 livres (6 000 francs actuels) de bagues et joyaux » à son avoir et pour son usage personnel : ce qui ne fait pas supposer un grand fonds d’avarice et de ladrerie chez Jean Poquelin. Mais nous aurons bien d’autres motifs de comparaison à son avantage. Le moins qu’on en puisse conclure, c’est que Jean Poquelin était plein d’affectueuses attentions pour sa jeune femme.
Marie Cressé méritait de lui être chère. L’inventaire dressé après son décès, en nous faisant pénétrer dans son intérieur, a donné d’elle l’opinion d’une personne d’élite par le cœur et par l’esprit. Ni sa nature ni son éducation n’étaient vulgaires. Elle était fille de riches bourgeois. Tapissiers comme les Poquelin, les Cressé étaient alliés aux Nivelle, imprimeurs en renom de Troyes ; et Mgr Pierre Nivelle, évêque de Luçon et grand amateur de livres rares, était leur proche parent. Il faut mettre au nombre de leurs cousins ce chirurgien du nom de Cressé, dont certaine mésaventure galante défraya plus tard la chronique au jour le jour de Gui Patin, qui va jusqu’à annoncer, dans une de ses lettres, que Molière « en doit faire une comédie ». Bref, Marie Cressé était de bonne maison. Le lent travail de sélection est sensible en cette bourgeoisie cossue, représentée dans les carrières libérales et, toujours, foncièrement vivante et gaie, et gauloise.
J’en ai dit assez pour marquer le parfait assortiment de cette union de Jean Poquelin avec Marie Cressé. – Je n’ajouterai plus que deux mots à propos du contrat de mariage. Ni frères ni sœurs de Jean Poquelin ne sont mentionnés dans l’acte : on ne signale qu’un « oncle » et deux « beaux-frères » présents ; mais il faut croire que les absences des frères et sœurs ne tirent pas ici à conséquence aux yeux des érudits, si préoccupés d’autre part de ne pas voir donner signe de vie à tous les Poquelin, à chaque affaire de famille. Du moins, cette fois, « l’oncle » mentionné appartient à l’histoire anecdotique de Molière. Le « Daniel Crespy, marchand plumassier, bourgeois de Paris, oncle maternel », est, dit-on, celui-là même qui fit cadeau au poète d’une montre, possédée aujourd’hui par M. Coquelin aîné, et qui porte en lettres gravées dans l’intérieur du boîtier cette dédicace d’un souvenir : « Crespy à J.-B. Molière. »
Du mariage de Jean Poquelin et de Marie Cressé naquirent : Jean (Jean-Baptiste Molière), vers et avant le 15 janvier 1622 ; Louis, baptisé le 6 juin 1623 ; Jean, baptisé le 1er octobre 1624 ; Marie, baptisée le 10 août 1625 ; Nicolas, baptisé le 13 juillet 1627 ; Marie, baptisée le 13 juin 1628. On a remarqué que Louis eut pour marraine la « femme de noble homme Jehan Ledoux, président à Joigny », et que Marie eut pour marraine à son tour la femme du chirurgien Lirot, valet de chambre du Roi. Appelée à tenir un enfant sur les fonts de baptême, Marie Cressé eut pour compère (15 septembre 1631) maître Antoine Forget, commissaire de l’artillerie, parent du « Forget de Molière », auteur de Polyxène.
Ainsi l’art par les Mazuel, les lettres par les Forget, fraternisaient et sympathisaient au foyer domestique de Molière enfant. Une charge à la cour allait lui ouvrir la porte de la cour même et lui en permettre l’accès tout jeune.
En 1631, Nicolas Poquelin, tapissier-valet de chambre du Roi, céda son office à son frère Jean Poquelin. Les gages n’étaient que de « 300 livres », mais on exerçait une sorte de fonction, et de précieux privilèges professionnels et judiciaires y étaient attachés. Les tapissiers-valets de chambre, au nombre de huit, exerçant de quartier, deux par deux, aidaient à faire le lit du Roi ; le garde-meuble royal leur était confié ; enfin, ils faisaient les meubles de Sa Majesté. Or, on sait, par les musées, ce qu’étaient les meubles de la cour sous Louis XIV : c’étaient des œuvres d’art que les amateurs recherchent et admirent aujourd’hui. De vulgaires marchands d’objets d’ameublement, même de mobilier de luxe, eussent été incapables et réputés indignes d’un tel emploi. L’office privilégié impliquait la maîtrise ès meubles et tentures. L’importance de la charge cédée par Nicolas Poquelin à son frère ressort d’elle-même.
Dès avant cette acquisition d’office, la maison de Jean Poquelin jouissait de la faveur d’une clientèle riche et brillante. De beaux et grands noms, parmi les plus illustres de l’armorial de France, s’inscrivaient sur ses livres de comptes. La mode ne les attirait pas ailleurs ; la confiance et l’estime les retenaient là. Jean Poquelin était apprécié et haut coté dans le monde élégant et le grand monde. M. de La Rochefoucauld d’Estissac, M. le duc de La Rochefoucauld, père de l’auteur des Maximes, M. de La Mothe, le marquis de Fourille, M. de Langeais, M. de Marsillac, M. du Tellay, M. René de La Suze, M. de Chastillon, M. de Billy, une foule de grands seigneurs ont Jean Poquelin pour tapissier et fournisseur ordinaire, et souvent pour des sommes rondes. Le seul M. de La Rochefoucauld d’Estissac, en deux fois, restera débiteur de la succession de Marie Cressé pour un total de 1 423 livres. Donc, même avant et bien avant de devenir tapissier titulaire de la cour, Jean Poquelin est en pleine réussite, en plein succès de ses affaires. C’est à l’apogée de sa florissante situation, au milieu de l’épanouissement complet de sa fortune commerciale, qu’il perdit sa femme, le 15 mai 1632, moins d’un an après avoir reçu les « lettres de provision » de son nouvel office.
Marie Cressé mourait âgée de trente et un ans. Outre celui qui devait être Molière, elle laissait deux fils et une fille. Ces quatre enfants, dont un mourut jeune, eurent pour tuteur Jean Poquelin leur père, et pour subrogé tuteur leur grand-père maternel Cressé, tapissier. La nomination de cette tutelle est datée du 30 décembre 1632. Ce n’est donc que sept mois après le décès de Marie Cressé qu’il fut pourvu à cette nécessité légale. Elle impliquait un inventaire des biens communs. On y procéda du 19 au 31 janvier suivant. Cet acte existe ; il est du plus haut intérêt documentaire et historique, – et loin de constituer une sorte d’accusation contre la probité de Jean Poquelin, comme on a cru pouvoir le dire et le répéter, il est véritablement un admirable certificat de sa droiture et comme une page de morale en action par les chiffres. L’ordre ponctuel, consciencieux, absolu, du commerçant qui considère l’exactitude comme sa première vertu, éclate là à chaque article. Mais pourquoi cette mise en suspicion posthume, après deux siècles, de l’inattaquable et parfaite honnêteté de cet homme ? Rendons-lui la justice d’avouer, d’abord, qu’on avait confiance dans sa stricte intégrité, puisque l’inventaire se fait huit mois après qu’il a pu librement disposer des ressources de la succession. Il avait le temps de frauder s’il en eût été capable. Non. Les choses se passent en famille, entre honnêtes gens ; et il y préside, lui, en bon père de famille qui se respecte trop pour qu’on ne le respecte pas. Tout se fait au grand jour.
L’expert-priseur qui assiste les deux notaires n’est autre que François Rozon, le beau-frère même de Jean Poquelin : il avait épousé sa sœur Agnès. Dans la bouche de ce sergent à verge, la mise en demeure de ne rien cacher ni dérober « sur les peines de droit » n’est pas une injurieuse menace, mais une pure et simple formalité. On aurait pu aller jusqu’à exiger le serment de Jean Poquelin et de sa servante, comme on le voit dans l’inventaire de Joseph Béjart, où sa mère, Marie Hervé, sa propre héritière, est obligée de jurer qu’elle n’a « rien détourné ». Or, cette recommandation de pure forme, d’avoir à déclarer sincèrement et complètement « tous les biens » se trouvant dans la maison de la défunte et de son survivant mari, c’est là la seule insinuation de doute possible sur la rectitude de conduite de Jean Poquelin, – et cette insinuation, la loi l’ordonnait. Elle était inévitable. On s’est ingénié quand même à découvrir un motif de suspicion. Et on l’a trouvé là où personne au monde n’eût songé à l’aller quérir ! Mais laissons parler plutôt, et avant tout, l’éloquence même des chiffres de cet inventaire, et l’éloquence aussi de sa sincérité loyale.
Les époux Poquelin-Cressé étaient entrés en ménage avec un capital commercial de 4 400 livres. Tout compte fait, leur avoir s’élève à présent à la somme de 11 425 livres. Marchandises, meubles, bijoux : 6 625 livres. Deniers comptants : 2 000 livres. Valeurs en papier : 2 800 livres.
Eh bien ! il est dès à présent impossible de nier que Jean Poquelin dut administrer la fortune de ses enfants et prendre leurs intérêts en excellent père de famille. Les trois enfants survivants toucheront, au jour de leur établissement, chacun plus de cinq mille livres, et cela quand le père a droit à un prélèvement de moitié sur ces 11 425 livres !
Même en impliquant la valeur tacite de la charge dans les parts dotales des trois enfants de Jean Poquelin et de Marie Cressé, la réserve personnelle du père, prélevée, ne laisserait pas « cinq mille livres » par tête sur la succession maternelle. Rien donc, rien ne saurait faire admettre que Jean Poquelin ait eu même l’idée de frustrer ses enfants. Au contraire, loin de retenir de leur avoir, il y met du sien.
Et qu’on me pardonne de commenter les chiffres sans insister sur les descriptions qui ont été faites de l’intérieur de cette maison, d’après l’inventaire publié par Eudore Soulié ! On a, je crois, tiré de cette pièce historique son plein effet, et au-delà. Meubles, tentures, bijoux, tout est de prix, tout est de choix ; le goût de la femme s’y révèle avec toute l’élégance de distinction parisienne qu’on peut souhaiter chez « des bourgeois » de l’époque. Même en faisant la part aux préférences professionnelles dans cet ameublement luxueux, vous ne trouvez pas mieux ni si bien, par exemple, chez le lettré et riche, et célèbre médecin Gui Patin. La femme de Gui Patin n’a pas autant de bijoux, assurément, que Marie Cressé ! La comparaison tourne à l’honneur des parents de Molière, à ce point de vue. Sans en faire bon marché, je passe outre, pour relever un détail significatif et topique : dans cette maison du tapissier, – tapissier de la cour, – chez cet industriel émérite, mais qu’on croirait un peu « enfoncé dans la matière », selon un mot de son fils, chez ce bourgeois, tandis que la femme, la mère de famille, n’est pas assez coquette, malgré tous ses bijoux, pour oublier de faire lire la Bible à ses enfants, le père leur commente Plutarque. Car il figure un beau Plutarque à l’inventaire ; et cela en dit plus qu’une magnifique armoire ou une riche tenture sur cette vie domestique !
Mais revenons à l’inventaire. On appréciera, au risque de subir quelques détails minutieux, comment des biographes s’y sont pris pour déshonorer Jean Poquelin.
On prétend que l’inventaire ne s’est pas fait régulièrement, correctement. Comment s’est-il donc fait ? D’après l’ordre indiqué d’avance dans le constat de la première vacation, dès le 19 janvier : recensement des « meubles et marchandises, ustensiles d’hôtel, or et argent monnoyé, ou non monnoyé, lettres, titres, papiers et enseignements ». On a dressé scrupuleusement la liste de tous les objets qu’on a trouvés. Cet examen dure deux jours. Le 21 janvier, une vacation est effectuée à « Saint-Ouen », où le père de Marie Cressé possède une maison de campagne, dont « une chambre » est laissée à la disposition de Jean Poquelin et de sa famille. Là, reprise de l’inventaire ; dénombrement de tous les meubles meublants et effets divers. Et cette vacation est close par l’article suivant, écrit, paraît-il, d’une « encre différente » et signé du nom de J. Poquelin : « En pistoles, écus et douzains, deux mille livres. » Le lendemain, suite, à Paris et jusqu’à la fin du mois, de la vérification et de l’énumération des « titres et papiers ». Le dernier jour de l’inventaire qui est aussi « le dernier jour de janvier », tout se termine à l’amiable, sans ombre ni trace d’incident imaginable ou possible, sur la déclaration de J. Poquelin disant à la bonne franquette qu’il n’a désiré « faire mémoire au présent inventaire de quelques menues dettes qui lui sont dues, etc., montant à la somme de mille livres tournois, d’autant qu’il a retenues icelles pour taxer pareille somme de mille livres qu’il doit pour marchandises qu’il a eues, pendant le vivant de ladite feue de Cressé, sa femme, de divers marchands, desquelles dettes il promet décharger et acquitter sa succession envers sesdits enfants ; la présente déclaration être du consentement et avis dudit Cressé son beau-père ». Tout finit là et ainsi. L’accord est complet et parfait. Le beau-père, qui estime son gendre, s’en rapporte à sa parole et n’exige pas la justification de ces mille livres de dettes, quoique mille livres soient à considérer sur un bilan total de onze mille. Mais ils se connaissent. Encore une fois, tout est dit. L’acte est là pour en faire foi.
Il vous semble absolument irréprochable de fait et de forme ? Détrompez-vous. Il s’y décèle une infamie. Ce prétendu honnête homme de Poquelin n’est qu’un abominable fourbe qui a tramé la plus noire des machinations pour duper et frustrer ses enfants. C’est à M. Édouard Fournier que revient l’honneur d’avoir démasqué l’astucieuse duplicité de ce méchant et barbare père. Enfin, tout se découvre ! Il s’était passé ceci, sans que nous nous en doutions. La vacation à Saint-Ouen s’était terminée ; on était revenu à Paris, et Jean Poquelin n’avait pas déclaré « d’argent comptant » ; – il se serait même défendu d’en avoir. Mais « notaire et parents refusant de le croire, menacé d’une poursuite “en recélé” qui lui aurait fait perdre toute la somme, IL AURAIT RAMENÉ SON MONDE À SAINT-OUEN et produit les 2 000 livres, cachées au fond du coffre à linge ».
Quand je vous disais que vous ne vous doutiez de rien ! Mais on ne déjoue pas la perspicacité des érudits ! La « différence de l’encre » a trahi les ténébreux complots du traître Poquelin. Rien ne s’oppose du reste, puisqu’on y est, à ce que le retour à « Saint-Ouen » ait eu lieu dans la nuit : la situation y gagne en pathétique : c’est même forcé, la vacation du jour s’étant opérée dans l’« après-midi », et la vacation du lendemain ayant eu lieu à Paris à l’heure ordinaire des séances précédentes. Se peut-il, d’ailleurs, rien de plus habilement combiné que ce détournement d’argent par un négociant qui a ses comptes en règle, si bien en règle que, trente ans après, on retrouvera chez lui, en bon ordre, toutes ses écritures tenues imperturbablement depuis sa première facture jusqu’à la dernière ? Et Jean Poquelin cache l’argent ainsi fraudé, où ? Il le cache dans une chambre… « à la campagne » ! Chez son beau-père ! Maintenant, si vous voulez savoir l’indice révélateur de toute cette machiavélique intrigue, apprenez que c’est l’interversion de l’ordre des articles dans l’inventaire. Oui. « Le bordereau des espèces » aurait « dû venir aussitôt après la vaisselle précieuse et les bijoux ». L’usage l’exigeait, à ce qu’il paraît. Il est vrai, on néglige de spécifier si c’est l’usage des érudits ou celui des notaires.
Car l’usage des notaires, précisément, n’est pas ici en défaut. Les « deniers comptants » sont, dans l’inventaire après décès de Marie Cressé, absolument en même lieu et place que dans l’inventaire après décès de Madeleine Béjart, pour en citer un qui ne nous écarte pas de Molière, et pour ne citer que celui-là entre cent et mille autres – Et c’est ainsi qu’on écrit l’histoire de Jean Poquelin.
Ne croyez pas en être quittes pour si peu avec les érudits soupçonneux, à propos de l’inventaire en question ! Jean Poquelin a besoin d’être présenté sous un aspect nouveau. Connaissez à fond cette âme sordide et cupide ! Voyez-le dans son rôle de « prêteur à la petite semaine ». Cette étude de mœurs a son agrément ; et puis, vous saurez par là comment l’Harpagon de l’Avare n’est, après tout, que Jean Poquelin mis à la scène par son fils, sans lui manquer de respect encore !
Donc, Jean Poquelin était un usurier. Cela ressort des papiers et titres de l’inventaire. La preuve qu’il prêtait à la petite semaine, c’est d’abord que sur le total des créances énumérées « la moitié seulement représente des opérations normales, c’est-à-dire des ventes de meubles ». Le reste ne fait aucune mention de marchandises et contient seulement cette vague formule, anormale en l’espèce, puisque l’obligataire est commerçant : « Pour les causes y portées. » « On a donc lieu de croire qu’il s’agit là de prêts, voire de prêts à la petite semaine ; car on y trouve de bien petites sommes dues par de petites gens. » Ainsi, c’est bien entendu. Un client dont la facture en débet se serait réglée par un billet ou une obligation à échéance, « pour les causes y portées », – causes que personne n’a vues ni connues à l’original et qu’on déclare tout de même suspectes, – un tel client rentre de plano dans la catégorie des gens pressurés par l’usure ! Et, parce que dans le mouvement d’affaires de Jean Poquelin, quelques débiteurs plus modestes que la Rochefoucauld, par exemple un « tailleur d’habits » ou « un vigneron » même, restaient devoir au tapissier, comme celui-ci « 24 livres 6 sous », comme celui-là « 26 livres », il est impossible d’admettre une source avouable à cette dette ? Ces allégations si graves n’ont pas même l’excuse d’une vague apparence de raison. Le tailleur d’habits et le vigneron ont contracté « devant notaire », comme c’était la règle, leurs obligations « pour les causes et à payer au terme y porté ». Avez-vous idée de pareils prêteurs à la petite semaine par acte notarié et à échéance stipulée par contrat ? Je vous fais grâce des savants commentaires que ce thème d’un Poquelin père usurier offre l’occasion de développer dans un parallèle fantaisiste avec Harpagon !
Toute l’existence du père de Molière a été tournée selon la logique de cette erreur capitale. Par suite, nous voyons un Jean Poquelin se remarier un peu à la manière des coureurs de dot, puis, en toute occurrence, s’efforcer de gruger et frustrer ses enfants, puis spéculer à leurs dépens sur leurs besoins d’argent, sur leurs installations, sur leurs sentiments même, puis, de chute en chute, s’affaisser et s’abaisser dans l’obscure malpropreté de ses trafics ignobles, au point de perdre toute dignité extérieure et personnelle dans son avilissement final ! La dégradation commencerait à s’accuser même à partir de son second mariage, – et cela aboutirait à une vieillesse répugnante. Pour mesurer cet effondrement, savez-vous quel terme de comparaison est mis en avant ? L’inventaire de 1632 que nous venons d’étudier. On en rapproche l’inventaire fait à la mort de Jean Poquelin, – et l’on triomphe là-dessus.
Le procédé est pour le moins étrange ; car quiconque sait lire et a lu ce document doit véritablement éprouver un sérieux embarras à l’invoquer pour la conclusion qu’on en tire. Mais il y a des grâces d’état avec les documents ; et ce qu’on avait fait pour l’inventaire de 1632, on le refait pour l’inventaire de 1669. C’est en 1669 que le père de Molière mourut. « Triste mort après une triste vieillesse ! » s’écrie un de ses biographes… « Ce n’était chez lui qu’incurie et abandon !… Plus de luxe dans les vêtements, le linge et les ustensiles de ménage… » Comme argenterie, « six fourchettes, six cuillers et une tasse »… Enfin, « vingt-cinq tableaux représentant des sujets de sainteté, sauf quatre qui figurent une Vénus, des têtes de femme et une dame ». La valeur de tout cela n’atteint pas « 2 000 livres… » Tout cela « excite la commisération dédaigneuse du sergent à verge chargé de l’estimation », dit un autre moliériste.
Raisonnons. Si Jean Poquelin avait gardé en sa possession les bijoux, tentures et meubles revenant aux légitimes héritiers de sa femme, Marie Cressé, il n’y aurait pas assez de mots sévères pour le qualifier. Restitution intégrale leur en a été faite ; doit-on l’incriminer de ne les avoir plus ? Veuf depuis longtemps pour la seconde fois, solitaire et vieux, peut-il être de son goût et de son âge d’avoir un somptueux mobilier ? Non. Eh bien, cependant, il se doit à lui-même, il doit à son rang, il doit à ses enfants de garder un honnête décorum et de soigner sa tenue. Il n’y manque pas. Il s’en départ si peu, que la comparaison des deux inventaires va devenir édifiante autrement qu’on ne s’y attendait. Les 2 000 livres auxquelles se monte la prisée de ses meubles, hardes et objets divers, en 1669, et qui le font prendre en pitié, dépassent positivement la valeur de ce qui lui appartenait individuellement dans l’inventaire de 1632. Inutile d’épiloguer à côté. Plus de vêtements de luxe ? dites-vous. En 1632, la prisée des habits à l’usage de J. Poquelin est de « 47 livres 10 sous ». En 1669, cette même prisée est de « 71 livres » ! Tel est le luxe de ces vêtements, que Molière, vivant sur le pied de 30 000 livres de rente, Molière plein de gloire, fêté à la cour, fêté à la ville, Molière a une garde-robe bourgeoise moins riche et une toilette moins soignée. La prisée des habits de Molière est de « 65 livres », et son plus bel habit de sortie n’est coté que « 25 livres » : son père en a un de « 30 » ! – En 1632, on citait avec estime les cinq tableaux de l’appartement de la rue des Vieilles-Étuves. Ces cinq toiles, « plus la glace de Venise », étaient évaluées ensemble « 27 livres ». En 1669, Jean Poquelin possède « 25 tableaux », d’une valeur totale de « 195 livres ». On vante les splendeurs de la demeure de Molière. Ses ennemis font bruyamment d’envieuses allusions à ses meubles, à ses tentures, à ses « tableaux ». Combien Molière en a-t-il, de ces fameux tableaux, témoignage d’un luxe insolent ? Il en a « 18 ». Et ils valent ? J’en ai fait l’addition : « 88 livres », ni plus ni moins. La valeur moyenne de ces tableaux-là est d’un peu plus de « 4 livres et demie » pièce ; la valeur moyenne de ceux de Poquelin père est de « 7 livres 5 sols ». – Parlez-vous avec commisération des « six fourchettes et six cuillers » ? C’est vrai, en 1632, on en avait davantage. Cependant, Molière marié, ayant une femme coquette, qui aime le luxe, Molière donnant des dîners, enfin, menant bon train de maison, Molière, à son décès, ne laissera que « 18 cuillers et 18 fourchettes ». Et, pour ne pas trop humilier le vieux Poquelin, par des confrontations extérieures, peut-être n’est-il pas hors de propos de se souvenir que Madeleine Béjart, morte avec la réputation d’être plus qu’à son aise, n’avait pour toute argenterie que « quatre fourchettes » quand le vieux Poquelin en a « six » !
La vaine fantasmagorie des rhétoriques nuageuses passe un mauvais quart d’heure, parfois, au contact des froides réalités mathématiques. Ma foi ! le plaisir d’être tranchant en l’honneur d’un honnête homme n’est pas à dédaigner. Je n’en abuserai pourtant pas. Mais comment s’interdire une dernière de ces vérités éclatantes ? Jean Poquelin, dont on s’obstine à montrer la situation extrêmement embarrassée à la fin, laisse « 870 livres en argent comptant », selon un des écrivains dont je relève les erreurs incessantes. Il laisse, selon moi, « 914 livres ». Et comme il n’est plus marchand, s’il laisse après tout « 870 livres » seulement, on conviendra que c’est déjà un joli denier : cela représente près de 5 000 francs d’aujourd’hui. De fort riches bourgeois ne gardent pas toujours pareilles sommes chez eux, pour leurs besoins courants. C’est donc, à tout le moins, le symptôme évident d’une gêne… absente. Or, de l’aveu de l’écrivain en cause, les créances de l’inventaire de 1669 « font un total d’environ 8 000 livres ». On observe aussi que Jean Poquelin a, de plus, une maison achetée « 8 500 livres » ; mais comme elle est hypothéquée de 10 000 livres, on en profite pour assombrir encore le tableau noir. Comptons : 2 000 livres d’argent, 8 000 livres de créances, 8 500 livres de la maison : total, 18 500 livres. Faut-il en déduire le montant de l’hypothèque ? Non. Les 10 000 livres empruntées, aux termes mêmes du contrat, sont applicables à un accroissement de valeur de l’immeuble. Par-devant le notaire, Jean Poquelin s’est engagé à livrer les « quittances des ouvriers », en justification des dépenses. Donc, l’application des 10 000 livres à la maison s’opère aux fins déterminées d’une plus-value obligatoire. Cette même maison se louait naguère « 600 livres ». Réédifiée, elle ne peut qu’offrir un placement excellent. En tant qu’opération financière, l’emprunt ne serait donc pas une dette contractée, mais un moyen d’accroître les revenus déjà assurés. En tout état de cause, et fallût-il oublier encore que c’est Molière qui, sous le prête-nom de Rohault, fait les fonds de cette hypothèque ; – à tout prendre, dis-je, même tout réduit au pis-aller, même en passant aux profits et pertes cette somme de 10 000 livres, et en oubliant qu’il manque des créances au dossier, Jean Poquelin est-il à plaindre ? est-il réellement en déchéance ? Non. Toutes déductions faites, il lui reste un avoir de 9 400 livres. Or, en 1632, l’inventaire « tel quel » des biens communs se chiffrait par 11 425 livres pour deux ayants droit. Jean Poquelin était donc, à sa mort, en admettant tous les déchets les plus invraisemblables, plus riche encore d’un tiers qu’au décès de sa femme. Il est, relativement à l’inventaire de 1632 « tel quel », il est riche et il a pourvu à l’éducation et à l’établissement de tous ses enfants, vis-à-vis de qui il ne s’est conduit ni en égoïste ni en grincheux avare.
Enfin, où trouvez-vous qu’il était, à ses derniers jours, morose et chagrin ? Sa toilette est des plus soignées : le cas était rare alors chez les vieillards, et il est d’autant plus à signaler ici que l’on a argué du contraste en sens contraire ! Au surplus, que, sur ce dernier détail, ou même sur l’appréciation générale de la dernière partie de la vie de Jean Poquelin, l’erreur que je combats se puisse autoriser de M. Eudore Soulié, je ne le conteste pas, et cela prouve que M. Eudore Soulié n’était pas infaillible. Les Documents qu’il a découverts et publiés parlent plus haut que lui-même. Je ne connais et ne reconnais qu’eux dans ce débat. Ils se prononcent pour l’abrogation des fables mises en cours sur le compte de Jean Poquelin !
Il importe de reprendre, où nous l’avons interrompue, cette esquisse rapide d’une notice sur le père de Molière. On comprend qu’il ne s’agit pas ici de l’histoire d’un tapissier quelconque, ni de la biographie d’un père de famille banal. Molière était le fils de Jean Poquelin, et l’étroitesse tyrannique des préjugés bourgeois et professionnels, l’insuffisance d’esprit, de cœur, d’élévation intellectuelle et morale chez cet homme pouvaient exercer une si désastreuse influence sur les destinées du poète et de l’artiste placé sous sa double autorité de père et de tuteur, c’est-à-dire livré à ses volontés corps et biens, – elle pouvait être si funeste, cette influence, qu’il est bien naturel de s’informer exactement de ce que fut l’action du père sur son fils. S’exerça-t-elle avec le despotisme de l’ignorance ou avec la sagesse raisonnée d’une paternité clairvoyante ? Un mot résumera d’avance ma pensée et mes conclusions immédiates : Jean Poquelin fit son devoir envers Molière.
Il faut réserver pour d’autres le rôle traditionnel de père baroque et rébarbatif. Instruit, bien élevé, il ne se prête pas au moule où ces types sont coulés d’ordinaire. Cet homme pratique, – il est Poquelin de sang et de sens, – n’est pas sensé sans être aussi, à l’occasion, sensible. Une apparence de fermeté, il est vrai, colore ses actes de plus de raison visible que de vive tendresse : ce caractère a néanmoins des dessous franchement bons et humains. Il aime les siens. Qu’un désaccord d’intérêt survienne entre son frère Nicolas et lui, vous serez tout étonné de retrouver, jusque dans l’acte notarié qui scelle leur réconciliation, l’affectueux écho de leurs vœux communs : « d’entretenir l’amitié fraternelle ». Il y a la note d’émotion discrète dans cette existence qu’on a dépeinte sous des traits secs et durs. On peut montrer, je suppose, les bons côtés de cette nature, sans paraître vouloir canoniser le père de Molière dès l’instant qu’on tâche de le faire mieux connaître. Ceux qui ont exclusivement attribué à Marie Cressé la direction si digne et si correcte de sa maison, durant la vie de sa première femme, doivent convenir que le sentiment, le goût, l’intelligence de cette correction et dignité domestiques, de cette tenue personnelle, il ne les devait qu’à lui-même. La mort de Marie Cressé avait été un malheur pour Jean Poquelin ; elle n’avait pas pu être le signal d’une démoralisation.
Ses qualités étaient en lui et bien à lui. Il les garda jusqu’à la fin, inégalement, mais constamment. Il resta lui-même.
Au bout d’un an de veuvage, chargé de quatre enfants dont l’aîné avait dix ans à la mort de sa mère, chargé de soins domestiques et commerciaux, Jean Poquelin se remaria. Le 30 mai 1633, il épousait Catherine Fleurette, « fille d’honorable homme Eustache Fleurette, marchand de fer ». On a vu là une affaire d’argent. Il n’en est rien.
Le 30 septembre de la même année, Jean Poquelin achetait une maison située sous les piliers des Halles, avec la dot de sa nouvelle femme, et, plus tard, en échange de cette maison, il fournit, d’accord avec la famille Fleurette, et par acte du 15 janvier 1655, « la somme de cinq mille livres en deniers comptants », nécessaire à sa fille Catherine Poquelin-Fleurette, pour entrer comme religieuse au couvent de la Visitation Sainte-Marie de Montargis, où elle avait été élevée de bonne heure, et où l’avait précédée une tante de Marie Cressé. Une autre fille, morte en bas âge, était née de cette seconde union de Jean Poquelin. Les liens avec sa nouvelle famille furent, à leur commune louange, toujours étroits, et d’autant plus que l’alliance de Martin Poquelin, son plus jeune frère, les avait encore resserrés, en 1635, par son mariage avec Marguerite Fleurette, sœur de Catherine. Toujours étroite fut cette liaison, même après la mort de Catherine Fleurette, survenue le 12 novembre 1636. Pas plus au moral qu’au physique, on ne connaît le signalement de cette jeune femme, qui n’a laissé pour tout souvenir que son nom dans l’histoire de la famille de Molière.
Peu de jours après cette mort, Jean Poquelin procède à une sage mesure : afin d’assurer l’avenir de son fils aîné, il lui fait accorder, dans les formes légales, la survivance de sa charge. La sollicitude paternelle ne se dément jamais. Que n’a-t-on dit pour la nier, cependant ! Par ladrerie, stupide calcul, défiance inepte de tout savoir, Jean Poquelin ne l’aurait pas envoyé, ce fils, aux écoles jusqu’à l’âge de quinze ans ! Il est vrai qu’alors, il se serait rattrapé de ces retards. Alors, soudain, sans cause apparente, une réaction brusque se serait produite. C’est sous le coup de cette détente subite et inexplicable que le père Poquelin aurait résolument mis l’enfant au collège, puis lui aurait assuré les leçons de philosophie de Gassendi, en compagnie d’un groupe de fils de famille, puis l’aurait poussé aux cours de droit jusqu’à lui faire obtenir son diplôme d’avocat. Doit-on en conscience rendre Jean Poquelin responsable de ces incertitudes et de ces inconséquences ? Les récits des biographes se contredisent trop souvent pour qu’il faille incriminer sans ombre de preuves la conduite de Jean Poquelin : il est douteux que la responsabilité d’un manque formel de logique lui incombe, à lui, plutôt qu’aux anecdotiers. Cette péripétie biographique n’est, j’en suis convaincu, pour ne pas dire certain, qu’un de ces nombreux incidents dont on a coutume de dramatiser la vie de Molière.
Jean Poquelin n’avait pas besoin d’apprendre dans Plutarque qu’il sied d’instruire les enfants.
Il le savait par expérience. On l’eût méprisé dans toute sa parenté, il se fût méprisé lui-même d’oublier à cet égard ce qu’il devait, ne fût-ce qu’à sa position de commerçant notable et honorable, syndic de sa corporation déjà, et appelé à tenir le haut du pavé parmi les premiers et les plus riches tapissiers de Paris, à la ville et à la cour. La considération dont jouissait Jean Poquelin est à elle seule un argument sans réplique contre cette niaise invention d’un Molière enfant condamné par un calcul stupide à l’ignorance perpétuelle. Les résultats répondent pour la générosité du principe. Molière sortit des collèges et des facultés instruit autant et plus qu’un fils de bonne bourgeoisie pouvait l’être au dix-septième siècle. Et quand, chez Molière, l’instinctif entraînement de la vocation dramatique parla plus haut que les espoirs secrets et longtemps caressés de son père ; quand une autre carrière que celle du commerce ou du barreau s’ouvrit avec la fatalité d’une exigence comminatoire du sort qui s’impose et veut être obéi, – Jean Poquelin, préparé d’ailleurs au consentement par d’honorables exemples fournis à foison dans les rangs mêmes de la noblesse, Jean Poquelin, aussi empêché de défendre sans scrupule que de permettre sans regret, laissa faire, sans abdiquer le droit de conseiller et de payer en conseillant.
Le 6 janvier 1643, le jour où Molière, après des essais inutiles à raconter ici, eut besoin de fonds pour la fondation ou plutôt la reconstitution à Paris de l’Illustre-Théâtre, – la bourse paternelle s’ouvrit à son appel sans difficulté : Molière toucha « six cent trente livres… tant de ce qui lui pouvait appartenir de la succession de sa mère qu’en avancement d’hoirie future de sondit père ». Ces derniers mots coupent court aux hypothèses sur les termes dans lesquels le père et le fils se trouvaient dès l’entrée de Molière au théâtre. La « malédiction paternelle » se traduisant par un avancement d’hoirie, ce serait là un mode de reniement inédit.
En homme aussi prudent comme père que comme industriel, Jean Poquelin se fit délivrer par son fils aîné, tapissier démissionnaire, une renonciation éventuelle et facultative de la survivance de la charge de tapissier-valet de chambre du Roi, dont le second fils, Jean, mieux disposé à rester dans la partie, devait être appelé à bénéficier. Dès lors, dans la chronique domestique de la maison Poquelin, telle que les papiers du père, précieuses archives, nous permettent de la reconstituer avec des intermittences inévitables, dès lors, Molière ne fait guère parler de lui, sur les livres du marchand, que par ses emprunts à la caisse paternelle.
Nous avons là, du moins, une curieuse chronologie de ses besoins d’argent et de ses dettes. Le 24 décembre 1646, Jean Poquelin s’engage à payer pour Molière, à Léonard Aubry, la somme de « 320 livres ». Cette obligation fut soldée le 1er juin 1649, à la demande et sur « une lettre missive dudit sieur Molière ». Le 4 août suivant, payement par Jean Poquelin d’une somme de « 125 livres » à « la femme Pommier », encore « à la prière » de Molière. Ce compte courant était arrêté et approuvé par Molière, de passage à Paris, le 14 avril 1651. Ici, l’infaillible rectitude du commerçant, incapable de faire tort d’un sou à ses enfants, même au profit de l’un deux, s’accuse imperturbablement ; et vous voilà enclins à croire que, chez Jean Poquelin, le cœur du père est étouffé sans pitié par l’impassible rigidité du teneur de livres, de l’agent d’affaires. Ne préjugeons rien ; surtout n’oublions pas que le crédit ouvert par le comptable est accordé, sans terme, sur sa propre succession paternelle, – si Molière ne désire pas s’acquitter avant cette échéance. Cela donne même une certaine grandeur à cette comptabilité, au premier abord si prosaïque et mesquine.
Dès maintenant, comment s’expliquer cette différence d’attitude chez le père Poquelin, s’il est vrai que l’histoire de ses rapports d’intérêt avec Molière soit conforme en réalité à ce qu’elle paraît être d’après la comptabilité domestique ? Comment concilier la continuité d’affection et de concours durant les excursions en province et l’abandon où se trouva Molière, pendant la période critique de ses épreuves et de ses déveines théâtrales de 1643 à 1646 ? Comment expliquer la prison pour dettes ?
On verra que Molière, en 1668, n’osera pas se mettre en face de son père pour lui prêter 10 000 livres. Pas davantage, encore moins dans les moments difficiles de 1643 à 1646, il ne devait oser recourir à son crédit, – non par crainte d’un inexorable refus, car il n’avait pas motif de douter de l’affection paternelle, mais parce qu’il croyait de son devoir de fils de ne pas revenir à la charge, par un appel de fonds qu’il jugeait sans doute abusif. Les 630 livres, reçues le 6 janvier 1643, n’excédaient-elles pas déjà le solde de l’héritage de sa mère, et n’avait-il pas touché un « avancement d’hoirie sur sondit père » ? Molière avait cet amour-propre de fils qui s’est placé, vis-à-vis de sa famille, dans la situation d’un jeune homme sûr de son avenir, et à qui il en coûte d’avouer trop tôt son erreur, sa défaite. L’attachement de son père ne lui rendait-il pas cette confession d’autant plus douloureuse ? Il ne se résigna vraiment à demander son appui qu’à la veille de son départ pour la province et quand, ses embarras liquidés, il n’avait plus besoin que d’une caution de forme pendant son absence, vis-à-vis d’un créancier, Léonard Aubry, peu pressant d’ailleurs. Un peu naïvement peut-être, mais très noblement, Molière s’était cru en délicatesse de bourse, sinon de cœur, avec son père, et, à aucun prix, il ne voulait le prendre pour confident, pour témoin indulgent, mais attristé, de ses déboires et de ses désastres.





























