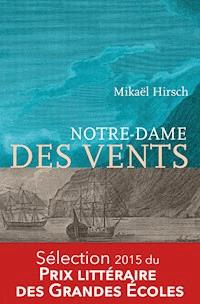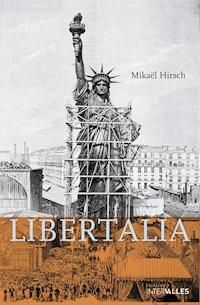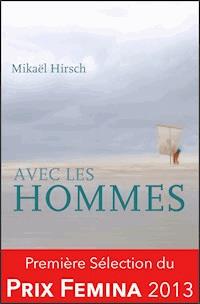
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les destinées se lient quand les langues se délient
A Brest, deux anciens amis se retrouvent après vingt années de séparation. Le premier, en devenant écrivain, semble avoir réussi sa vie; le second, en dépit de débuts prometteurs, n’est jamais devenu ce qu’on attendait de lui. Et si l’amertume rattrape souvent les grandes espérances, l’idée même de réussite peut parfois s’avérer illusoire.
De Tel-Aviv à la presqu’île de Crozon, de la cour de Normale Sup’ aux monts d’Arrée, ces deux destins parallèles nous racontent la soif d’exotisme, la passion qui dévore et la littérature qui consume.
Variation jubilatoire sur le thème du voyage en Orient, réflexion sur la honte et la cruauté, Avec les hommes est aussi et surtout un magistral roman d’amour.
EXTRAIT
La toute première chose dont il voulut se délester fut l’amour malheureux, comme autrefois les dockers, sur les quais de Recouvrance, vidaient le ventre des navires avant d’engrosser les filles. Je l’écoutais distraitement, refusant tout à fait de transvaser sa peine, habitué que j’étais au harcèlement des souvenirs. Avec l’écriture, j’étais devenu la proie des mythomanes et des assoiffés. Partout m’attendaient inévitablement les aphasiques et les frustrés, les notaires poètes et les dentistes cocus cherchant un réceptacle pour leur litanie. La France entière semblait habitée par des hordes d’écrivains déçus, jaloux, envieux, toute une nation de conteurs tristes au répertoire invariable. Il leur manquait uniquement le temps libre pour s’adonner enfin à la littérature, pour produire le grand oeuvre mûri depuis toujours.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Un roman profond et féroce."
(François Perrin, TGV Magazine)
- "Un livre fort, amer et passionné."
(Dominique Le Bian-Rivier, Le Télégramme)
- "On lit
Avec les hommes d’une traite."
(Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement.net)- "Les choses simples de la vie, Mikaël Hirsch les décrit directement, avec justesse et sans fioritures...
Avec les hommes est un joli texte, à déguster en l’honneur de la langue française et des femmes de cœur."
(Yaël Hirsch, Toute la culture.com)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Mikaël Hirsch est un écrivain français, né à Paris en 1973. Il a déjà publié plusieurs romans et notamment
OMICRoN (Ramsay, 2007),
Le Réprouvé (L’Éditeur, 2010), qui fut particulièrement remarqué par la critique, sélectionné pour le prix Femina puis repris en poche (J’ai lu) et
Les Successions (l’Éditeur, 2011). Il est aussi actuellement libraire à Paris. Il est également le co-auteur (avec Émile Brami) d’une pièce de théâtre intitulée
Faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère, composée à partir de textes de Marcel Proust et Louis Ferdinand Céline et mise en scène par Ivan Morane pour le festival d’Avignon en 2012.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Je ne parle pas de la mauvaise honte au sortir du collège »
De l’amour, Stendhal.
« Tout menace de ruine un jeune homme »
Aden Arabie, Paul Nizan.
À Antoine et Marie.
La toute première chose dont il voulut se délester fut l’amour malheureux, comme autrefois les dockers, sur les quais de Recouvrance, vidaient le ventre des navires avant d’engrosser les filles. Je l’écoutais distraitement, refusant tout à fait de transvaser sa peine, habitué que j’étais au harcèlement des souvenirs. Avec l’écriture, j’étais devenu la proie des mythomanes et des assoiffés. Partout m’attendaient inévitablement les aphasiques et les frustrés, les notaires poètes et les dentistes cocus cherchant un réceptacle pour leur litanie. La France entière semblait habitée par des hordes d’écrivains déçus, jaloux, envieux, toute une nation de conteurs tristes au répertoire invariable. Il leur manquait uniquement le temps libre pour s’adonner enfin à la littérature, pour produire le grand œuvre mûri depuis toujours. Ainsi, ma fonction oscillait au gré de mes interlocuteurs entre le petit maître à humilier et l’ami à convaincre. Cette fois-là, j’étais un confident, celui qui comprend les tourments de l’âme humaine, s’en inspire et fait office de factotum. Parle de moi dans tes livres, semblait-il supplier tout en me déballant sa vie, parle à ma place et fais-moi exister dans cet au-delà des mots qui rassure le lecteur et rend les personnages immortels.
Paul Rubinstein m’était tombé dessus, après vingt-deux années d’absence, dans ce bar de la rue de Siam où je buvais un verre. J’étais venu à Brest promouvoir mon dernier roman et, dissimulé dans l’assistance pourtant clairsemée de la librairie, il m’avait ensuite filé jusqu’au troquet. La rue m’avait été recommandée par la rumeur, mais je la trouvais en réalité bien aseptisée. Les quartiers conservent longtemps une réputation n’ayant plus lieu d’être. L’esprit s’en va, mais les histoires demeurent, conférant aux lieux une renommée usurpée. Je connaissais mal la ville. Ma visite initiale remontait à l’époque du lycée lorsque, le temps d’un week-end, j’avais suivi mon premier amour dans la campagne environnante. J’ai toujours eu du goût pour les villes terminus, celles d’où l’on partait autrefois et où l’on aboutit désormais, faute de terre encore disponible ou de nouveau continent à défricher. Je revenais à présent avec l’arrogance et la honte de celui qui a réussi. Arrivé à la gare le matin même, j’avais contemplé les voiles par centaines sur le plan d’eau et le paquebot norvégien à l’escale. Les images affadies de mon escapade adolescente me revenaient par bribes, comme attachées exclusivement aux immeubles sans grâce, au goulet de la rade et au vent soufflant sans discontinuer dans les avenues glaciales. J’y songeais à nouveau en écoutant Paul qui, les yeux d’un gris évoquant les cétacés, un bonnet de marin bien enfoncé sur le crâne, parlait maintenant sans discontinuer.
Sait-on jamais pourquoi l’on aime ? Longtemps, il avait été la victime de ces grands sentiments rendus inutiles par l’absence d’objet, comme ces courants de l’hémisphère sud qui tournent autour du pôle sans jamais rencontrer d’obstacle. C’est fréquemment le malheur de ceux qui ont trop à donner. La séduction repose nécessairement sur la frivolité. Paul l’ignorait alors. On veut plaire, sans être aimé, par crainte de la responsabilité, et comme je ne voulais pas vraiment qu’il me confie son histoire, la femme qu’il s’était choisie n’avait pas voulu non plus de cette charge terrifiante qu’est l’affection d’un faible.
Il n’avait jamais été beau, de cette beauté qui fait mal, plonge le spectateur dans l’embarras et le renvoie immédiatement à son humaine condition. Tout au plus avait-il connu cette sorte d’apogée physique très éphémère, située entre de longues années de modifications approximatives et un rapide déclin. C’est durant cette brève période, suscitant d’inhabituels regards, sans se douter le moins du monde que l’âge et la disgrâce l’attendaient presque immédiatement ensuite, qu’il avait entrepris de séduire.
Le patronyme de Paul avait exercé une fascination morbide sur cette enfant de la bourgeoisie catholique. Elle crut percevoir en lui les Symphonies de Malher et les stigmates du ghetto, le mont du Temple et le pain azyme. Il n’était en réalité qu’un gamin de Ménilmontant, grandi trop vite et plein d’idéaux fracassés. Elle venait d’un parc où paissaient les chevreuils et lui apparut comme la première terre habitée qu’on rencontre après des années de mer. Le charme est souvent le fruit de l’ignorance réciproque. Croyant s’adresser l’un à l’autre, ils interpellaient en réalité leurs propres fantômes. Dans un couple, on est toujours plus de deux. Il faut se coltiner les madeleines et l’on est jugé sur des similitudes souvent malencontreuses. À qui ressembles-tu ? Car je cherche la présence rassurante du passé et ne saurais me défaire de ces images qui me hantent, ou bien au contraire, j’aspire au changement et te mépriserais le cas échéant pour cette résurgence que tu incarnes malgré toi. Triste dilemme, qui ne se pose d’ailleurs pas, puisque l’on s’aime le plus souvent comme on se trompe de chemin.
Le sexe entre eux fut une catastrophe d’humiliations et de maladresses mutuelles. Je fus surpris et mal à l’aise que Paul acceptât sans pudeur aucune de me confier des secrets si peu glorieux. Preuve qu’il était déjà loin, le temps des vestiaires, où les garçons idiots imitent le brame et revendiquent des exploits imaginaires. Tâchant de comprendre ce qui lui était arrivé, il avait sans doute surmonté la peur et ne cherchait plus désormais ni compréhension ni pitié.
Chaque fois qu’il la pénétrait, le plaisir, pourtant relatif, avortait aussitôt l’étreinte esquissée. La soudaineté de la jouissance n’était pourtant pas le fruit d’une émotion justifiée. Elle n’était ni belle ni brillante ni pourvue d’aucune des qualités que l’on prête généralement aux femmes, mais seulement étrangère à tout ce qu’il était, de cette étrangeté qui relève du défi et suscite, chez les désespérés, des vocations amoureuses. Mortifié par la honte, il se confondait alors en excuses murmurées. Hypocrite par charité, elle minimisait l’échec. Il avait tellement peur de lui déplaire ou de la décevoir qu’il lui déplaisait et la décevait de manière préventive. Par le passé, il avait pourtant déjà eu l’occasion de prouver son ardeur. Comme tous les mâles, sa conception de la sexualité se limitait à un ensemble de performances quantifiables. Submergé par l’angoisse, son corps, qu’il croyait uniquement régi par une mécanique simple et disciplinée, le trahissait soudain. On dit que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Aimer et baiser simultanément leur est sans doute difficile. Lorsqu’elle surprenait dans son regard ce qu’elle croyait être l’ennui et qui n’était en réalité qu’un subterfuge voué à différer l’orgasme, elle le repoussait alors, dégoûtée. Le malentendu initial semblait croître de manière géométrique. Sans oser l’admettre, elle attendait d’un homme qu’il soit fort et indifférent, pas une chiffe larmoyante prompte à dégainer toute une rhétorique poétique en guise de virilité. Cette pose étrange, ainsi que son incapacité chronique à bander comme il se doit, longtemps, avec maîtrise et technique, faisait de lui une créature privée de sa composante masculine, féminisée par mimétisme et donc repoussante.
Tous les clichés, balayés avec un peu trop d’empressement par la révolution sexuelle, faisaient à présent office de fantasmes inavouables. Elle ne voulait pas d’un homme qui passe l’aspirateur, comme on en voit dans ELLE, mais d’un mastard bien baraqué. J’ai d’ailleurs lu quelque part, s’agissait-il également d’un magazine féminin, que les hommes partageant avec leur compagne le fardeau des tâches ménagères sont censés avoir une vie sexuelle plus satisfaisante. Paul, qui avait été élevé dans les années soixante-dix et considérait par conséquent l’égalité des genres devant la machine à laver comme une évidence, en était pourtant le contre-exemple absolu.
On refuse toujours d’admettre que l’on s’est trompé au début et la réalité du sentiment n’a rien à voir avec l’erreur. L’amour réciproque se contente finalement assez bien de l’incompréhension. On a déjà vu des couples plus mal assortis, mais il l’aimait comme on aime son bourreau, dans une version érotique du syndrome de Stockholm, la chérissant mieux encore à chaque nouvelle déconvenue. Comme il l’humiliait, sans même s’en rendre compte, en abrégeant involontairement leurs ébats, elle le vexait sans cesse à la moindre contrariété. Lui la dominait intellectuellement, réussissant de longues études là où elle échouait par oisiveté, mais son inaptitude en tant qu’amant contrebalançait cet affront. Il croyait évoluer dans un monde où la raison a supplanté la force brute, où la diplomatie a remplacé la guerre, mais en définitive, peu importe l’agrégation ou le concours général lorsque l’on bande mou.
Chez Paul, la cruauté du souvenir ne résidait pas uniquement dans la banalité de l’amour inassouvi. Elle ne l’avait pas quitté par déception, regret ou incompatibilité d’humeur. Elle ne s’était pas débarrassée de lui parce qu’en lieu et place d’un amoureux transi, elle aurait préféré un homme confiant et assuré. Elle aurait sans doute pu s’accommoder de la situation et se serait alors enfoncée, comme tant d’autres, dans une vie de couple ordinaire et frustrante, mais à toutes autres choses, elle avait privilégié l’argent.
Ils se voyaient toujours chez elle, dans un appartement faussement bohème et payé par ses parents. Après plusieurs mois seulement, elle émit le désir de se rendre chez lui, afin de découvrir sans doute ce qui l’intriguait encore, ce qu’elle n’arrivait pas tout à fait à cerner et qui la retenait à son corps défendant auprès de lui. Ils marchèrent un peu, du centre vers la périphérie de la ville, mais il fallut attendre les tout derniers mètres pour qu’elle comprît enfin sa méprise. À l’approche des grands ensembles qui défigurent le paysage urbain et barrent l’horizon de leur percée disgracieuse, elle ne put s’empêcher, à moitié incrédule, de lui demander : « Tu n’habites pas dans une cité, tout de même ? » C’est à cet instant précis que la vie de Paul Rubinstein vola entièrement en éclats. Lui qui avait grandi en privilégié dans un quartier populaire, qui partait au ski en hiver, à Marrakech l’été, lui dont l’apparence toujours soignée détonait dans la foule, dont l’éducation en faisait un esthète et la culture un lettré, découvrit soudain qu’il était pauvre, d’une pauvreté insigne, insupportable, comme une maladie répugnante et honteuse dont on ne se défait jamais vraiment et qui vous colle à la peau, même quand on revêt plus tard les oripeaux de la richesse. En réalité, ses diplômes ne valaient rien. Son intelligence était un hochet voué à distraire la bourgeoisie inculte. Le mérite se heurtait aux limites de son statut social. Une fois le mensonge évaporé, il ne resta plus rien de son existence fragile. Il était nu, éventré même, comme un quartier de bœuf, les tripes à l’air sur le trottoir. Il fallut pourtant tourner la clé de son logement HLM et subir, avec la nausée, toute la déchéance du papier peint à fleurs, de la vaisselle sale et de la moquette usée. Rien de son univers familier ne lui avait jamais paru aussi dérisoire et pathétique. Les détails insignifiants lui sautaient maintenant aux yeux, comme si son propre appartement était un meublé sordide qu’il visitait pour la première fois. Il aurait voulu s’enfuir à présent. L’humiliation du sexe minable lui paraissait bien douce en comparaison de cette offense terrible. Sans même le savoir, elle venait de le blesser pour toujours, saccageant sa vie, son enfance, sa croyance en l’amour et la justice, tout ce qu’il avait de plus précieux.
Durant cette nuit, allez comprendre, il la baisa plus longtemps et plus fort, sans la faire jouir tout de même, mais avec la dignité retrouvée d’un miséreux qui se voit offrir par l’existence la possibilité de se venger des riches et de leur arracher quelque chose, sinon leurs biens héréditaires, leur morgue et leur statut, tout du moins leur soumission à la bestialité ordinaire.
Ils se quittèrent au matin, lui aveugle et sourd à ce qui venait de se produire, elle déjà dans un ailleurs inaccessible. Elle mentit pourtant, par souci des convenances, ce qu’il ne comprit pas car, chez lui, la sincérité l’emportait sur la politesse. Ils se firent encore mille serments dégueulasses. Elle lui dit qu’elle l’aimait, sans rien comprendre aux mots qu’elle prononçait. De toute évidence, elle aurait déclaré n’importe quoi pour se débarrasser de lui au plus vite. Son étreinte avait désormais le parfum pisseux de la cage d’escalier, la couleur sombre de cette tâche d’humidité au plafond. Elle aurait supporté son corps malhabile, ses mains collantes, sa petite taille et son humour inepte, comme sa mère, avant elle, avait épousé le mauvais homme sans pour autant se dédire, par fainéantise et par lâcheté, mais elle ne pouvait tout simplement pas encaisser le robinet qui fuit, la baignoire percée et tous ces problèmes de l’arithmétique pauvre. C’était au-dessus de ses forces. Étrangement, elle vivait dans la peur du déclassement depuis qu’un beau jour de 1981, Pierre Mauroy avait dévalué le franc, égratignant ainsi le vaste patrimoine familial. La misère, qu’elle connaissait alors pour l’avoir vue au journal télévisé, était tout autour, prête à la submerger. Les lépreux de Calcutta, les immigrés maliens et les smicards étaient tapis dans l’ombre, à l’affût de la dot qui, seule, pourrait un jour les tirer de leur crasse millénaire. Elle avait misé sur ce Rubinstein comme on parie sur un cheval. En définitive, le pur-sang s’avérait être un canasson boiteux. L’exotisme, le charme de ce qu’elle croyait être les arts et la finance cosmopolites avaient fait place au nez crochu et au teint jaunâtre des caricatures d’avant-guerre. Un cliché chassait l’autre et ce qui, un moment auparavant, suscitait encore le désir et la curiosité, devenait soudain intolérable.
Elle partit ensuite pour le Pérou, en mission humanitaire. Les pauvres ont tout de même cette capacité à susciter la sympathie, pour peu qu’ils aient la bonne idée de vivre loin et de rester chez eux. C’est alors qu’enchaînant les catastrophes, il commit là sa seconde erreur. Désœuvré entre deux années d’études et laissé pour compte dans un Paris vidé par l’absence de l’être aimé, il prit la décision de se rendre en Israël.
Encombré la plupart du temps par de vagues origines juives qui ne lui avaient laissé, en guise d’héritage, qu’un nom de famille en trompe l’œil, il fut brusquement saisi par des interrogations mystiques. L’incertitude de l’identité fut certainement réveillée par la confusion des sentiments. Si c’était bien le Juif, pourtant inconsistant, qu’elle avait cru aimer en lui, peut-être pouvait-il, par amour, devenir celui-là. Ce pays en guerre dont il réprouvait souvent la politique et qui ne lui avait jamais paru ni familier ni accueillant s’imposa comme une soudaine évidence. Il aurait pu choisir Elat, ses hôtels balnéaires et la plongée sous-marine, mais il opta sans même y réfléchir pour un kibboutz de Galilée. Pris dans un délire incompréhensible, il voulait à présent contribuer à l’édification de l’État juif. Qu’il ait auparavant manifesté contre la colonisation des Territoires, signé des pétitions en faveur de la paix et boycotté les dattes en provenance de Gaza ne lui semblait en rien paradoxal. Soudain, il se découvrait des ancêtres bibliques, une appartenance ethnique, comme on s’entiche d’antiquités étrusques, ou de gastronomie coréenne. Si une constitution chétive ne l’avait précocement détourné du métier des armes, il aurait certainement poussé l’absurdité jusqu’à s’engager dans Tsahal afin de conquérir à lui tout seul la Judée-Samarie. Ses propres stéréotypes prenaient le dessus. Il s’imaginait déjà cueillant des oranges, un fichu sur la tête, chantant le soir à la veillée quelques chansons traditionnelles hâtivement apprises. Shlomo et Moïshe l’accompagneraient sûrement à la guitare, tandis que dans l’ivresse de la communauté enfin retrouvée, on partagerait le pain du labeur dans la poussière fertile et le rougeoiement du soleil couchant.
À peine débarqué à Tel-Aviv, il fut placé par le bureau des kibboutz dans une usine de détergent où il dut travailler en équipe de nuit. La réalité le rattrapait immanquablement, celle des sentiments factices et du capitalisme moderne. À vingt-trois heures, il embauchait avec les journaliers palestiniens, venus du check-point avoisinant où ils avaient attendu plusieurs heures qu’on veuille bien les laisser passer. Ne parlant ni hébreu ni un traître mot d’arabe, il était généralement cantonné aux tâches les moins qualifiées. En une journée à peine, il passa du statut d’amoureux déçu à celui de travailleur immigré et analphabète. Les Arabes, relégués aux postes subalternes, trouvèrent en lui un exutoire à leurs frustrations. Trop contents d’avoir enfin sous la main quelqu’un à brimer, ils le regardaient suer à grosses gouttes dans l’atmosphère torride de l’usine en tôle. Rapidement, il devint leur souffre-douleur et dut supporter les quolibets auxquels il ne comprenait rien mais dont il percevait évidemment toute la rancœur. En homme de gauche, fort de ses principes, il refusait de leur en vouloir et endurait son calvaire avec empathie. Non seulement il se sentait solidaire du prolétariat mais considérait son tourment comme une épreuve à surmonter par amour. Le délire était à son comble et Paul ne manqua pas d’en rire tout en me relatant ses misères. Son travail consistait alors à remplir d’immenses sacs de poudre à récurer à l’aide d’une machine dangereuse et imprévisible. Hébété par la chaleur et la fatigue, il écrivait chaque jour, durant la pause, de longues lettres enflammées, nouvelles épîtres de Paul, dans lesquelles, et sans bien le concevoir, il s’essayait à la littérature.
Je crus comprendre, à ce moment-là, pourquoi Paul m’avait choisi entre tous pour devenir le dépositaire de sa logorrhée. Je n’étais pas seulement l’ancien ami, perdu de vue, et qui de fait se tient à la meilleure distance, le psy bon marché qui n’ose pas dire non et dont on ne redoute pas le jugement. J’étais avant tout l’écrivain, celui qui couche sur le papier et valorise son trouble, tandis que Paul, malgré ses tentatives, avait échoué dans cette entreprise. Je vis dans son regard l’envie et le dépit. Comme beaucoup d’autres avant lui, il se trompait complètement quant à la réalité de l’écriture et surestimait le statut de l’écrivain qui, en vérité, n’est qu’un besogneux sans grade vivant d’expédients et de louanges trompeuses. Comme aujourd’hui, j’étais seul, sans beaucoup d’argent, épuisé par une tâche ingrate, à la merci d’une popularité volatile. Les livres invendus finissent par faire d’excellents cartons à pizza. Ma vie sentimentale était désertique et, même le sexe, un souvenir lointain qui, bien souvent, m’arrachait des larmes amères. Je n’avais ni famille ni rêve, rien qu’une nostalgie atroce. Devant lui, pourtant, je me taisais et jouais les fiers-à-bras, lui laissant croire, par mon silence complaisant, à la réalité de ses fantasmes idiots. J’incarnais, une fois encore, l’idée que l’on se fait du succès, et je le fis, comme toujours, avec délectation et goût de la revanche sur le triste sort.