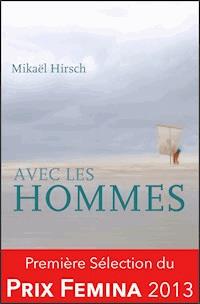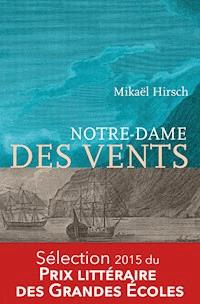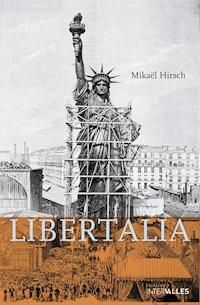
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Après l’effondrement du Second Empire et l’écrasement de la Commune de Paris, deux jeunes hommes quittent l’Alsace afin de rester français et se rencontrent sur la route de l’espoir.
Voulant s’affranchir des conventions de leur temps, ils revendiquent l’héritage de certains pirates et rêvent d’une terre promise, Libertalia, tout en devant composer avec la réalité parfois amère de la IIIe République.
De l’atelier de Bartholdi aux Batignolles, où s’édifie la statue de la Liberté, jusqu’à l’exposition universelle de 1889 en passant par le canal de Panama et la Tunisie coloniale, l’un et l’autre participent aux aventures qui font vibrer la presse à grand tirage, et grimpent les échelons de la société parisienne.
Trajectoire géographique, historique autant qu’humaine, Libertalia explore une époque où prend fin la Révolution et où naît la France d’aujourd’hui.
EXTRAIT
Alphonse avait grandi dans une famille de la petite bourgeoisie alsacienne ayant prospéré à l’ombre de la révolution industrielle. Son père était premier contremaître dans la plus grande filature de Mulhouse, maillon d’une chaîne vouée à l’oppression des masses. Rêvant de grands espaces, Fons avait fui l’enfermement de l’usine, l’accumulation du capital, l’église du dimanche et les ruines de l’Empire. Il avait fui intérieurement, bien avant de quitter Mulhouse pour ce qui restait alors de la France amputée. Il avait tracé des lignes imaginaires dans les champs et les bois, couverts des arpents de collines, établi des côtes destinées à légitimer une propriété qu’il honnissait. La mesure du terrain l’avait tiré de l’illusion matérialiste pour mieux le plonger dans une réalité faite de biens fonciers, de litiges de voisinage et de bornes déplacées. Il rêvait de cartographier des terres inconnues, des continents lointains et obscurs, des ténèbres de jungle. Il songeait à l’Abyssinie, à Madagascar. Au moment du choix, la Prusse ayant laissé aux Alsaciens la possibilité de quitter leur région jusqu’au 1er octobre 1872, ce n’est pas tant la France que Fons avait embrassée, car la bourgeoisie menait la danse des deux côtés du Rhin, mais une certaine idée de la liberté, celle de la Commune écrasée dans l’œuf un an plus tôt, celle du maître Proudhon. Enfin, il avait renoncé aux vêpres ainsi qu’aux repas familiaux, invariablement conclus par le sermon paternel.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
-
« Voici les deux amis sur la route de Paris, à pied, puis en bateau, sur la Marne. Un clin d’œil au Flaubert de L’éducation sentimentale, qui permet à Mikaël Hirsch de belles descriptions de la France d’alors, à la fois rurale et laborieuse. » -
Jean-Claude Perrier,
Livres Hebdo
-
« Je pourrais encore parler de ce roman des heures tant il est dense : 140 pages qu’il ne faut pas lire trop vite, de peur de perdre le fil mais surtout pour ne pas rater un mot – aucun n’est superflu -, une phrase ou une tournure qui (…) me plaisent de plus en plus à chaque livre de Mikaël Hirsch. Un auteur à lire absolument. » -
Yves Mabon
À PROPOS DE L'AUTEUR
Mikaël Hirsch est un écrivain français né à Paris en 1973. Deux de ses romans,
Le Réprouvé (2010) et
Avec les hommes (2013) ont figuré dans les sélections du Prix Femina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous désirions beaucoup, nous ne demandions rien. D’après Paris,
À Émile Brami
I LA CLOCHE DE DIX HEURES
Il se prénommait Baruch, comme Spinoza dont il ignorait tout et se nommait Lehman, comme son père Nathan, marchand de céréales à Fegersheim à l’époque où celle-ci n’était pas encore une banlieue-dortoir de Strasbourg, mais une petite commune agricole des bords de l’Ill. Migrant vers l’intérieur, il traînait dans un grand sac de cuir quelques sauf-conduits rédigés en lettres gothiques et du linge immaculé que lui avait donné sa mère.
C’est en 1872, peu avant Belfort, sur une route accidentée et longeant une forêt de hêtres, à hauteur de Rougemont-le-Château, que Baruch Lehman rencontra Alphonse Muller, dit Fons. Celui-ci avait lu Proudhon, se disait anarchiste, avait exercé la profession de géomètre auprès d’un notaire de Mulhouse et se trouvait assis, au bord du chemin, sous un ciel changeant qui annonçait l’orage.
Très tôt, Baruch avait ignoré le commerce du grain et délaissé l’étude des Écritures pour celle de la forge où le protestant Sonntag martelait du matin au soir le métal écarlate. Sa fascination pour les braises, aussi bien que son attachement contre nature pour un artisan goy, firent tout d’abord songer à un cas de possession. Baruch, « le béni », devait être habité par un dibbouk. Le maître de forges n’était-il pas, après tout, l’incarnation moderne du golem de Prague ? Le rabbi Bernheim pratiqua les rites d’exorcisme sans succès. On tenta de remettre l’enfant dans le droit chemin, mais jour après jour, il revenait à l’enclume et observait le laminage, jusqu’à l’épuisement du mystère. Le rougeoiement du fer, son éclat temporaire à la sortie du foyer, chaque coup de marteau arrachant à la matière lourde quelques poignées d’étincelles projetait au visage de Sonntag et sur les murs de la pièce obscure des traits de lumière, comme autant de balafres que ni le feu rassurant de l’âtre ni l’éclairage au gaz de la place Kleber ne pouvaient égaler. Nathan Lehman n’était pas homme à se laisser dicter sa conduite mais, comprenant que son fils n’accéderait jamais aux richesses du commerce ni à l’érudition talmudique, il accepta à contrecœur et en bonne intelligence que Baruch devienne l’apprenti du forgeron de Fegersheim, préférant d’une certaine manière le déshonneur à la ruine.
Alphonse avait grandi dans une famille de la petite bourgeoisie alsacienne ayant prospéré à l’ombre de la révolution industrielle. Son père était premier contremaître dans la plus grande filature de Mulhouse, maillon d’une chaîne vouée à l’oppression des masses. Rêvant de grands espaces, Fons avait fui l’enfermement de l’usine, l’accumulation du capital, l’église du dimanche et les ruines de l’Empire. Il avait fui intérieurement, bien avant de quitter Mulhouse pour ce qui restait alors de la France amputée. Il avait tracé des lignes imaginaires dans les champs et les bois, couverts des arpents de collines, établi des côtes destinées à légitimer une propriété qu’il honnissait. La mesure du terrain l’avait tiré de l’illusion matérialiste pour mieux le plonger dans une réalité faite de biens fonciers, de litiges de voisinage et de bornes déplacées. Il rêvait de cartographier des terres inconnues, des continents lointains et obscurs, des ténèbres de jungle. Il songeait à l’Abyssinie, à Madagascar. Au moment du choix, la Prusse ayant laissé aux Alsaciens la possibilité de quitter leur région jusqu’au 1er octobre 1872, ce n’est pas tant la France que Fons avait embrassée, car la bourgeoisie menait la danse des deux côtés du Rhin, mais une certaine idée de la liberté, celle de la Commune écrasée dans l’œuf un an plus tôt, celle du maître Proudhon. Enfin, il avait renoncé aux vêpres ainsi qu’aux repas familiaux, invariablement conclus par le sermon paternel.
Baruch n’avait plus sa place dans la communauté. Cet exil volontaire le libérait, en réalité, de son statut de paria. Longtemps, il avait erré entre sa vocation de ferronnier, les Sonntag qui l’avaient toujours reçu avec bienveillance et la Schule, où les fidèles lui jetaient des regards de réprobation. Ses propres parents le traitaient souvent comme un étranger et son frère cadet avait depuis des années pris sa place dans le cœur de son père. Sa mère seule lui conservait un semblant d’affection troublé par l’incompréhension. Lorsqu’il s’était rendu à la mairie, un an tout de même après la signature du traité de Francfort, et annoncé à sa famille qu’il avait finalement choisi le statut d’optant, se condamnant ainsi à quitter les territoires annexés sous trois mois, son père avait même accueilli la nouvelle avec un certain soulagement. Comme d’autres avant lui, juifs en rupture de ban, catholiques ou protestants, il avait donc quitté les marches de la mère patrie pour s’enfoncer plus avant dans ce pays qui avait toujours été le sien et qu’il ne connaissait pourtant pas. À Belfort, nouvellement promu au rang de territoire, il savait qu’il trouverait un centre d’accueil destiné aux réfractaires, comme un embarcadère juste avant cet océan de provinces qui s’étendait d’un seul tenant jusqu’à Brest et en pointillés jusqu’à Tassili du Hoggar.
Sur le bas-côté, Fons avait retiré ses chaussures lorsque Baruch s’arrêta à son niveau. Le premier avait l’air d’un commis aux écritures égaré en pleine campagne, et le second, marchant depuis déjà plusieurs jours, était couvert par la poussière de la route. Ces deux-là surent immédiatement qu’ils chemineraient ensemble, comme on s’associe aux cartes, par goût du jeu et par intérêt commun. Fons sortit de sa besace un morceau de pain blanc et de la viande séchée, puis invita Baruch à s’asseoir contre le terre-plein ombragé qui longeait la voie. Le vent se levait et les branches des hêtres bruissaient, annonçant la pluie d’été. Baruch accepta l’invitation et prit la nourriture. Sans rien laisser paraître, il décida d’enfreindre le tabou de la commensalité et mordit dans la chair dure et fumée qui, parce qu’elle venait de l’extérieur, était forcément impure. Tout d’abord, il crut sincèrement que la foudre allait lui tomber dessus, ou tout du moins qu’une nuée de sauterelles allait déferler sur le paysage, mais l’orage qui roulait au loin semblait tourner autour d’eux sans crever et les quelques sauterelles qui bondissaient dans les hautes herbes étaient trop occupées pour songer à le punir. Après quelques instants, il décida que le goût lui plaisait, que la compagnie de cet étranger le satisfaisait d’une curieuse manière et que cette saveur douceâtre et interdite devait finalement être celle de la liberté.
Ils marchèrent sans que la pluie vienne les rafraîchir et, arrivés à Belfort dans cette ancienne caserne qui accueillait maintenant et pour quelques mois encore ceux qui, comme eux, avaient choisi de tout quitter pour rester français, décidèrent d’y passer la nuit avant de rallier la capitale par leurs propres moyens. Les convois de réfugiés ne les tentaient guère. Les charrettes à bras s’accumulaient dans la cour, les ballots de linge et les cuivres s’entassaient en d’incroyables monticules. Rares étaient les familles, et les hommes jeunes, débraillés, fumant du tabac gris, faisaient les cent pas dans le gravier, ramenant ainsi le bâtiment à sa fonction première. On eût dit un grand attroupement de permissionnaires à l’entrée d’une guinguette, ou de quelque bordel de campagne. Tout autour, les véritables soldats, ceux du Reich qui occupaient toujours la ville, balayaient leur baraquement et s’acquittaient de la corvée de peluche. Une fois les massacres accomplis, les armées désœuvrées se livrent à des tâches féminines, comme pour s’excuser, maladroitement, d’avoir fait pleurer les mères.
Ils quittèrent Belfort au petit matin, après avoir passé la nuit sur des grabats poussiéreux. On leur avait vendu les orangeraies d’Oran, le grenier à blé de Constantine et les vignes de Sidi Bel Abbès. L’Algérie leur était présentée comme une terre sans maître, offerte en compensation des pertes subies. On leur avait même vanté les richesses de l’Ouest américain. Il subsistait, au nord du Texas, un vaste territoire qui ne s’appelait pas encore Oklahoma et où les survivants des guerres indiennes avaient été déportés en petit nombre. Il suffisait alors de suivre la route empruntée par le bétail pour s’y installer avec la complaisance des autorités et apporter ainsi la civilisation aux sauvages. Les Alsaciens valaient toujours mieux que les Peaux-Rouges, disait-on. Partout, la terre était à prendre, les hectares de désert, la poussière. L’adéquation entre ces hommes sans logis et ces contrées prétendument vides paraissait évidente, arithmétique.
Fons et Baruch passèrent la frontière dans la matinée, bien décidés à rejoindre Paris. Ils dormirent à la belle étoile dans les faubourgs de Lure, profitant de la chaleur des nuits de juin, contemplant la Voie lactée qui découpait nettement le ciel en deux hémisphères sombres. Les villes ne brillaient pas encore assez pour jaunir l’horizon. L’air était doux, mêlant la saveur des cerises fraîchement cueillies au parfum de l’herbe coupée. La vie leur paraissait tendre, emplie d’espoirs et de rêves, loin du bombardement des grandes cités de l’Est. Baruch se souvenait du bruit terrifiant des obus qui, par milliers, s’étaient abattus sur Strasbourg pendant des semaines entières. Le lointain grondait alors d’un roulement continu de tonnerre et de feu. Le jour, on n’y prêtait même plus attention, le vacarme devenait bruit de fond, mais la nuit, le rythme assourdissant des mortiers et la lueur rougeâtre qui embrasait la plaine lui rappelait la forge. À vingt kilomètres à la ronde, l’odeur de la poudre envahissait tout. Fons ne voulait plus entendre parler de Mulhouse. Il crachait sur les troupes du pays de Bade qui avaient occupé l’hôtel des postes, au bord du canal et jurait ses grands dieux que la propriété devait être abolie pour que cesse enfin l’avidité des empires dont les peuples étaient toujours les victimes.
Le troisième jour, ils arrivèrent à Vesoul, heureux, enivrés par l’amitié naissante et par cette soudaine liberté de mouvement qui leur avait tant fait défaut. Baruch avait le sentiment de s’être enfin affranchi du poids des conventions, des innombrables contraintes religieuses, de l’opinion de la communauté. Fons, quant à lui, rêvait au monde qui s’ouvrait devant eux, songeait à Paris. Pauvres et sans attache aucune, mais soutenus par la certitude d’une vie meilleure, ils s’appuyaient l’un sur l’autre et se contemplaient dans leurs différences et leurs similitudes. Fons ne connaissait rien aux Juifs, ne voulait rien en savoir. Il n’éprouvait ni curiosité ni ressentiment, et avec lui, Baruch se sentait par conséquent et pour la première fois de sa vie considéré comme un individu à part entière. Il n’éprouvait plus le besoin de se justifier ni de faire des excuses et ce sentiment d’indépendance, d’affranchissement même, dont il avait à peine soupçonné la possibilité jusqu’alors, le grisait totalement.
La ville, où de nombreux Alsaciens s’étaient installés par vagues successives, déployait ses arpents de tuiles et ses façades calcaires au pied de la Motte. C’était jour de marché et les habitants avaient envahi les faubourgs et les rues étroites du centre. Fons et Baruch traversèrent la place Neuve qui résonnait de chants patriotiques, d’amertume et de vengeance. Des maçons érigeaient une colonne en son centre, en mémoire des bataillons mobiles de la Haute-Saône, morts en défendant Belfort. Une jeune femme, figurant l’Alsace outragée, un grand nœud de ruban noir dans les cheveux, était acclamée par la foule des badauds. On préparait déjà une nouvelle guerre, on l’appelait de ses vœux, en placardant des cocardes et en fredonnant des chants patriotiques, sans considération véritable pour la République d’Adolphe Thiers mais plutôt en souvenir de l’armée du Rhin. Fons, mal à l’aise face à l’hystérie collective, pressa le pas. Le folklore nationaliste l’ennuyait tout autant que les démonstrations guerrières. Il considérait la région comme un nid d’exaltés revanchards et attendait de Paris un certain apaisement face à la réalité du siècle. Louise Michel était à Clairvaux, le Kaiser Wilhelm au château d’Urville et les Versaillais à l’Assemblée. Les guerres ne changeaient rien à l’ordre des choses, pire, elles y contribuaient.
— Tu connais un peu l’histoire de la piraterie ? demanda soudain Fons.
— Pas plus que ça.
— Oublie Barbe noire et Samuel Bellamy dont les illustrés nous ont vanté les aventures.
— Chez moi, on n’avait droit, pour ainsi dire, qu’au Talmud.
— Il y a deux siècles environ, Olivier Misson, capitaine de la Victoire, et son second, un prêtre défroqué nommé Carracioli, fondaient à Madagascar, au nord de Diégo-Suarez, une colonie qu’ils baptisèrent Libertalia. Pour emblème, ils choisirent le drapeau blanc et pour but, la défense de la liberté à laquelle les lois naturelles leur donnaient droit contre les ambitieux qui la leur avaient ravie. Ils voulaient bannir moquerie et rancune personnelle afin d’instaurer entre eux l’entente et l’harmonie, effacer les frontières entre les nations en mêlant les diverses langues pour n’en plus avoir qu’une. Ils avaient en vue un régime démocratique et instaurèrent une sorte de gouvernement. Ils demandèrent aux hommes, renommés Liberi, d’élire des représentants à l’assemblée qui aurait pour mission de voter les lois et de choisir un chef, qualifié de Grand Protecteur, pour une durée de trois ans. Tout devait être à tous et les seules différences fondées sur le mérite. Ni les Anglais ni les Hollandais qu’ils attaquaient régulièrement pour assurer leur subsistance n’arrivèrent à les déloger, et l’utopie perdura de nombreuses années. On dit que les indigènes, pour une raison inconnue, finirent par prendre le dessus et réduisirent le port en miettes, jusqu’à effacer toute trace de son existence. La nature exubérante de ces contrées fit le reste. Beaucoup de marins se sont risqués depuis dans le canal du Mozambique afin de clamer l’héritage de Misson ou plus simplement de prouver la réalité historique de cette aventure, mais en vain. Comme l’Atlantide de Platon ou l’Eldorado des conquistadors, Libertalia a sombré dans les flots de l’océan Indien et l’oubli de la majorité. Tu vois, l’histoire est pleine de pays disparus, de civilisations englouties et de rêves brisés. L’Alsace n’est plus, mais je crois qu’une nouvelle Libertalia est possible, ici ou ailleurs, et je compte bien m’y rendre un jour ou la bâtir de mes propres mains, s’il le faut.
— Je te suivrai sûrement. J’ai vécu jusqu’à présent dans l’ignorance du monde et les révolutions n’ont jamais eu bonne presse chez moi. Mieux valait un prince indulgent mais ferme à la vindicte d’une populace fanatisée. En 1848, les paysans de Durmenach ont brûlé les maisons de leurs voisins juifs. À Hirsingue, à Altkirch, pas loin de chez toi. On racontait cette histoire du Judenrumpel aux enfants, comme d’autres parlent du loup et de la galette de beurre, mais je n’ai jamais vraiment cru que Jérusalem fût ma véritable patrie. Je songeai en secret à un monde où les hommes puissent être égaux et sans querelle de foi, plutôt qu’à une terre promise à quelques-uns. Sans le savoir, je rêvais peut-être déjà à ta Libertalia.
Quelques kilomètres après Vesoul, ils traversèrent la Saône et s’arrêtèrent sur le pont qui enjambe un bras de la rivière. Des îlots d’algues vertes traînaient avec nonchalance dans le courant tiède. La lumière brillait à la surface des eaux. Des esquifs de joncs et de mousse dérivaient en direction de l’aval et du Rhône. Fons et Baruch s’accoudèrent au parapet dont la pierre marbrée de lichen réverbérait la chaleur du soleil.
— As-tu déjà observé un chien qui rêve ? demanda Fons.
— Les chiens sont mal vus chez nous.
— L’animal gémit, grogne un peu, sursaute, retrousse ses babines, mais une fois réveillé, il suffit d’une simple caresse, ou bien d’un os à moitié rongé, pour qu’il oublie tous ses tourments et retrouve la quiétude de la plus parfaite inconscience. L’homme est un chien qui rêve, rien de plus.
— Tu sais qu’à Strasbourg, chaque soir, à dix heures, la Zehnerglock de la cathédrale sonne en souvenir de l’époque où les étrangers et les indigents devaient quitter la ville pour la nuit. Avant, on soufflait dans une trompe pour chasser les Juifs responsables de la peste. Les deux sonneries n’ont rien à voir, mais se confondent quand même et parfois, lorsque le Niederwind soufflait en direction de Fegersheim, j’entendais le bourdon frapper ses dix coups et l’ai encore entendu la veille de mon départ. Toute ma vie, je n’ai aspiré qu’à une seule chose, la normalité.
— On part juste avant les mirabelles. Je crois que c’est la seule chose qui me manquera vraiment.
La route était rectiligne, traversant des vallons, des bois denses et quelques hameaux. Les malles-postes avaient cédé la place aux diligences qui elles-mêmes avaient disparu au profit des chemins de fer. On entendait parfois le sifflement du train que Fons et Baruch auraient pu choisir d’emprunter à Mulhouse, Belfort ou Vesoul. Ils n’avaient pu s’y résoudre. La marche n’était pas seulement une mesure d’économie, mais également une façon d’appréhender le territoire, de l’apprivoiser comme le corps d’une bête fascinante et sauvage. Ils voulaient parcourir plutôt que traverser et la foule des voyageurs, grisée par la vitesse et la vapeur, cette foule aveugle et sourde, encombrée de bagages et de chapeaux, de pipes et de gilets, sentant les œufs durs et l’eau de Cologne, leur donnait envie de marcher dans cette presque plaine qui séparait les Vosges du reste de la France.
Il leur fallut une journée supplémentaire pour parvenir jusqu’au plateau de Langres, alors que le rapide de Paris avait depuis longtemps déversé son flot de passagers fourbus et encrassés de houille sur les quais de la gare de l’Est. La forêt s’était amenuisée sur leur passage, comme usée par le vent qui soufflait en rafales, jusqu’à ne plus laisser çà et là que quelques bosquets maladifs. Les broussailles et les ronces trempaient dans des rigoles miroitantes. La route étroite et mal carrossée traversait maintenant des flancs déshérités, des champs pauvres et glaiseux, surgis de la lande rase. Les nuages s’accumulaient en masses monumentales et trouées de lumière. Un milan tournoyait lentement dans la grisaille. Le matin, le brouillard prenait possession de cette grande étendue infertile et trempait les vêtements des voyageurs égarés. Les villages avaient depuis longtemps disparu, comme repoussés à la périphérie du néant. On n’entendait plus les fers des chevaux, le grincement des essieux ou le bruit d’une hache, mais le clapotis permanent des gouttes qui perlaient, des buées qui s’écoulaient le long de ruines calcaire. La ligne de partage des eaux traversait ce vaste réservoir délaissé par les hommes et délimitait les bassins versants. Comme au sommet d’une montagne d’où l’on observe de tout côté les vallées environnantes, il suffisait aux marcheurs de choisir un cours d’eau pour épouser un climat, une direction, une ville et ses habitants. C’est là, dans un vortex invisible pour les yeux que se dessinait la géographie, que la terre solide et ferme envisageait déjà sa fin. L’effritement des côtes, toute l’érosion des temps, l’embouchure de la Meuse et le parfum de la Camargue résidaient en petit dans cet espace de gestation. Fons et Baruch avaient le sentiment d’évoluer entre parenthèses, en marge de l’histoire des hommes, dans une matrice dont l’ampleur dépassait toute ambition et toute crainte, et rendait l’insignifiance de la guerre plus absurde encore qu’elle ne l’était déjà. Il n’y avait rien à voir, ni volcan, ni glacier, ni tempête démesurée et pourtant, ce vide, incapable de susciter la moindre curiosité de prime abord, transpirait la grandeur et la force, au point que les individus perdus dans la friche étale, écrasés par une forme de beauté imperceptible, songeaient malgré eux à la divinité.
Peu avant l’arrivée à Langres, non loin de Balesmes, Alphonse entraîna Baruch sur un chemin accidenté qui descendait en pente douce au pied d’un ressaut érodé. Ils pénétrèrent dans un sous-bois d‘un vert uniforme où les rochers moussus, le lierre et les fougères formaient un taillis inextricable. Un filet d’eau rempli de salamandres courait sur un tapis d’éboulis tombés de la falaise. Remontant le courant ténu, ils parvinrent à une fontaine, une grille dans un mur de maçonnerie d’où s’échappait un clapotis cristallin.
— C’est là, déclara soudain Fons, après un moment de silence.
— Quoi ? demanda Baruch.
— La source de la Marne, qui coule à Paris, contrairement aux idées reçues.
— Tu as de drôles d’idées pour un géomètre.
— Justement, je sais ce que je dis.
— Comment savais-tu que c’était ici ?
— Je l’ai lu dans les livres. Et là, dit-il en pointant du doigt un rocher en forme de crâne, ça n’est pas le Golgotha, mais la grotte de Sabinus.
— La quoi ?
— Julius Sabinus était un Gaulois qui déclencha une révolte en 69 après Jésus-Christ. Défait par une tribu voisine restée fidèle à Rome, il dut se cacher avec sa femme dans cette grotte pendant dix ans, avant de se livrer à Vespasien qui le fit condamner à mort.
Fons et Baruch pénétrèrent dans la grotte dont les murs étaient verdâtres et blancs. Un large pilier soutenait la voûte oblique. Le silence régnait dans la cavité et le poids de tous les dieux païens s’abattit soudain sur les épaules des deux intrus. Dans la pénombre, les temps anciens et leurs mythologies en furent ravivés le temps d’un instant. La science livresque le disputait aux craintes monothéistes. On dansait pour les bacchanales tout en sacrifiant des animaux. Les vierges se livraient en offrande et le vin ruisselait en grandes gerbes colorées qui tachaient le lin blanc et les lèvres. Dans ce ventre souterrain, la jeunesse célébrait le mystère de la liberté contre les cultes officiels, contre l’État et la République des pères. Sabinus, quant à lui, n’avait sans doute jamais dansé au fond de sa tanière, mais avait établi une enclave hors du monde troublé. Les révoltes gauloises se mêlaient alors aux récits de piraterie. Sabinus avait-il été, sans le savoir, un prédécesseur du capitaine Misson ? Vespasien faisait maintenant office de chef malgache, tapi dans la forêt sombre de Rome. Les glaives et les machettes avaient depuis longtemps mis un terme à l’expérience.
— Ils se sont trompés, déclara soudain Fons.
— Qui ça ?
— Auguste Blanqui, Jules Vallès et tous les communards. Il n’y a rien à faire ici que subir le poids des siècles. Seul Misson avait compris que la liberté n’est pas une idée, mais bel et bien un endroit.