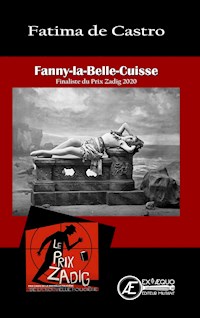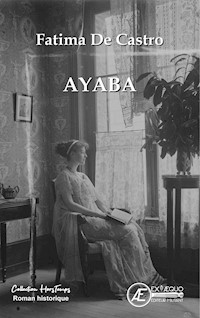
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Jusqu’au début du 20e siècle, la vie des femmes de la haute société était toute tracée : naître, épouser, enfanter, mourir. Aliénor de la Roche Jagu du Monteuil, jeune aristocrate normande, refuse cette ligne trop droite. Son caractère bien trempé, son amour de la liberté, son esprit indépendant vont la porter vers une quête d’elle-même qui ne sera pas sans conséquences. Entre 1900 et 1925, de sa Normandie natale jusqu’à Paris, de Paris au Bénin, la jeune femme livrera un combat pour vivre la vie qu’elle s’est choisie, contre vents et marées. Une lutte de tous les instants qu’elle nous livre à travers ce récit autobiographique haut en couleurs à une époque où le combat des femmes pour leur droit d’exister a été l’un des plus forts.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Fatima de Castro, chargée d’études passionnée d’histoire, aime à mettre en scène un passé pas si révolu que ça, entraînant le lecteur dans un ailleurs où tout devient possible. Le combat des femmes pour se faire accepter comme individus à part entière est l’un de ses domaines d’étude privilégié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fatima DE CASTRO
AYABA
Confessions d’une femme libre
(1900-1925)
(Évéïde 1)
Roman historique
ISBN : 979-10-388-0348-0
Collection : Hors Temps
ISSN : 2111-6512
Dépôt légal : mai 2022
© couverture : Scène de genre, jeune fille lisant, Madame Huguet, 1906 © — Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN-GP © 2022 — Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays Toute modification interdite
© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Éditions Ex Æquo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières Les Bains
www.editions-exaequo.com
À mon compagnon,
Mise en bouche
Du plus loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours entendu dire autour de moi que ma vie était toute tracée. Qu’il n’y avait plus qu’à mettre mes pas dans ceux de mes aïeules. En quelques mots, simplement grandir bien comme il faut, me marier bien comme il faut, être une mère bien comme il faut, et mourir si possible, car personne n’est maître de sa fin, bien comme il faut.
Il faut croire que cela est entré par une oreille pour se dépêcher de sortir par l’autre, aussi légèrement qu’une brise soufflant dans un voilage de soie. Comme le petit oiseau qui s’envole de l’objectif photographique, la flamme qui brûle en quelques secondes après le déclic. Certaines choses sont ainsi faites qu’elles ne le sont pas pour marquer certains caractères. Le mien, de toute évidence, se montrait rétif à toute forme de convenance sociale.
Ma vie était peut-être toute tracée selon les bons principes familiaux, mais selon mon point de vue personnel, mon destin n’appartenait qu’à moi. Je n’affirmerai pas en avoir eu la conscience claire et nette dès le départ. La chose s’est simplement imposée à moi d’elle-même, au gré des aléas de l’existence et d’un caractère que je tiens d’aïeules qui avaient le leur bien trempé.
Et puis, avouons-le, pour suivre une ligne de vie toute tracée, il me semble indispensable d’avoir une existence polie comme une agate du plus bel éclat, et un certain manque de personnalité. Suivre sans sourciller les préceptes transmis de génération en génération. Rester cloîtrée la majeure partie de la journée afin d’échapper à toute tentation. J’admets que, dans ces conditions, il devient facile de ne pas vivre et donc de ne rien risquer.
Je le confesse, je n’ai rien fait de tout cela. Aussi, tout est-il lamentablement parti à vau-l’eau. Enfin, selon l’idée commune. Parce que de mon propre point de vue, je ne vois pas ce qu’il y a de mal dans ma vie.
Lecteur, je vais te conduire par la main dans les méandres qui ont voulu que je rejoigne l’univers de ceux dont les pas n’ont pas suivi la voie toute tracée.
Je ne regrette rien. Je suis libre et le resterai.
L’époque était ainsi faite, et je suis fille de cette époque.
Si c’était à refaire, je le referai sans la moindre hésitation.
Lecteur, si j’ai un conseil à te donner, c’est celui-là : fais ce que tu as à faire, ne reviens jamais ni sur ta décision, ni sur le remord, et sur tout ne génère aucun regret. Chacun a son libre arbitre et la conscience de ses actes. Sans eux, personne n’est humain.
À Dieu va !
PREMIER TABLEAU
***
Lundi 1er janvier 1900
Naissance d’Aliénor Pénélope Marguerite de la Roche Jagu du Monteuil, votre servante, après un réveillon bien arrosé au Champagne brut de la Veuve d’Ambert.
Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Tante d’Ambert n’a jamais été veuve, pour la simple raison qu’elle n’a jamais été mariée. Elle possédait une petite vigne du côté de Reims, achetée après un boursicotage réussi, et dont le mousseux ne remplissait que les coupes familiales. Vendu à prix d’or, cela va sans dire. La famille est une chose ; les affaires en sont une autre. Et il fallait bien qu’elle vive de quelque chose, Rose Églantine d’Ambert.
Aliénor.
Tout de suite, on pense à la grande, portant couronne d’Aquitaine, et qui poussa des générations d’historiens à noircir des pages que personne ne lit. Évidemment, l’héritage aurait pu être prometteur, si j’avais pu avoir une vie aussi bien accomplie que la sienne. Une biographie qui n’en finirait pas, pleine d’aventures masculines et historiques, de voyages à travers la France et l’Europe. Marquer mon époque. Faire envie à tous les hommes. Être jalousée par toutes les femmes.
Plus modestement, Aliénor comme ma grand-mère maternelle, née d’Arcissac du Ménec, épouse d’Alcibiade Roger Alphonse de Beaumont-Latour. Rien à voir avec la duchesse, la grand-mère ! À faire transpirer les conteurs les plus imaginatifs. Imaginez une veillée bretonne au son des récits de la d’Arcissac : elle naquit, elle se maria, elle fit des enfants, elle mourut. Belle ligne droite toute tracée à la naissance et dont elle mit un point d’honneur à ne jamais dévier. On repassera pour le suspens historique et l’intrigue d’alcôve. Inutile de mettre une bûche trop grosse dans l’âtre, la soirée sera courte. Parmi les huit enfants que son mari trouva le temps de lui faire pour la distraire de son ennui ménager, ma mère : Hélène Marie Clothilde de Beaumont-Latour.
Pénélope.
Là encore, vous allez imaginer que des amoureux de récits homériques ont absolument voulu me mettre sur le dos la vie convoitée de la belle Grecque. Des journées entières s’égrenant sur Ithaque à attendre son maître, parti s’amuser du côté de Troie. Soyons rassuré : pas du tout le genre de la maison du Monteuil.
Pénélope fait simplement référence à une marraine que je n’ai jamais vue et pour cause. Elle vit cloîtrée dans un monastère au fin fond des montagnes. Une règle stricte lui interdit tout contact avec la vie réelle. Elle ne parle pas. Elle ne rit pas. Elle ne mange pas. Bien évidemment, elle ne fait pas l’amour, sauf à son crucifix, peut-être, la nuit, dans ses fantasmes. Bref, elle ne vit pas. Il est même miraculeux que sa congrégation l’ait autorisée à sortir dans le monde des vivants pour mon baptême. Mais que ne ferait-on pas pour permettre à un jeune être d’entrer dans la grâce de Dieu. Par un côté, elle ressemble un peu à la Grecque. N’attend-t-elle pas un époux qui ne reviendra peut-être jamais ?
Enfin, Marguerite.
Là encore, je vous avouerai en toute franchise que Faust n’y est pour rien. Toujours pas le genre de la maison du Monteuil. Aucune odeur de soufre infernal, d’or alchimique ni de jeunesse éternelle. Rien à voir non plus avec les frasques de la Reine Margot. Cela me vient tout simplement de ma grand-mère paternelle cette fois, une femme de caractère qui ne se laissa jamais marcher sur les pieds, dure autant que ferme, d’une ascèse à faire blêmir de jalousie Pénélope pourtant vouée à la plus grande indigence dans son monastère.
Chez Marguerite Edmée Chantal du Bois de Vanteuil, pas de place pour les fioritures, la perte de temps et le plaisir dévoyé. Malheureusement pour mon bon vivant de grand-père paternel, Marguerite est tombée enceinte dès sa nuit de noce, donnant naissance à mon père : Edmond Charles Édouard de la Roche Jagu du Monteuil. Un garçon dès la première coucherie, l’affaire était entendue. Madame de la Roche Jagu du Monteuil avait fait son devoir. La lignée était assurée. Pas la peine de perdre du temps en parties de jambes en l’air. Le grand-père n’avait plus qu’à se rabattre sur les soubrettes de plus en plus jeunes qui peuplaient le domaine familial.
Honorée de ces trois prénoms prédestinés, je pouvais entamer une vie aristocratiquement sereine en suivant les rails plantés depuis des générations.
Tout de même, ma vie commença sous l’aile de l’adversité. La concurrence affective entre les deux grand-mères était telle qu’il ne s’agissait pas de m’affubler du prénom de l’une sans que celui de l’autre n’apparût aussi. Il y eut, paraît-il, une lutte sans merci et un antagonisme sans faille au moment de l’inscription de mon identité. Je ne parle que par ouï-dire, mon jeune âge alors ne me permettant pas de me souvenir de ces combats titanesques. Qui devait avoir la préséance du prénom de tête ? La grand-mère maternelle ou la grand-mère paternelle ?
Le clan des Aliénor Pénélope Marguerite arrachait le chignon aux adeptes de Marguerite Pénélope Aliénor. Entre les deux, le prénom de ma marraine semblait jouer les arbitres, sans pouvoir apaisant. Mon baptême se transforma en pugilat. Le prêtre, suant dans sa chasuble, prit un peu d’eau des fonts baptismaux pour se rafraîchir le visage et en oublia son latin un bon bout de temps. J’en conclus, d’après mon identité actuelle, que la lignée maternelle l’emporta et que les tenants du clan paternel perdirent la bataille. Pour le reste, les révélations de famille n’étant pas non plus le genre des du Monteuil, rien ne transpira de ce que fut cette lutte. Quant au prêtre, lorsque je l’interrogeai sur la question des années plus tard, son visage devint pâle comme la mort et il disparut entre les colonnes de l’église comme si le diable cherchait à agripper ses jupes.
J’imagine toutefois qu’elle fut rude, cette lutte. Ma mère veillait toujours à ce que les plans de table des repas familiaux éloignassent les deux aïeules vindicatives. Dans mon enfance, l’une mettait un point d’honneur à m’appeler Aliénor, l’autre Marguerite. Difficile de conserver une personnalité saine, mais, déjà, j’avais cette faculté de retranchement qui me sauva à maintes reprises.
Fort heureusement, la nature m’a dotée d’un caractère à toute épreuve.
On pourrait s’étonner qu’un antagonisme aussi ridicule puisse miner ces membres de la bonne société. En fait, l’événement de ma naissance n’est que l’aboutissement d’une haine familiale née bien avant. Le choix de mes prénoms n’a servi qu’à alimenter une dégénérescence débutée en amont, très exactement neuf mois plus tôt, lors de ma conception.
***
Vendredi 30 juin 1899
Mariage d’Edmond Charles Édouard de la Roche Jagu du Monteuil, oisif de son état, avec Hélène Marie Clothilde de Beaumont-Latour, reine du bal des débutantes qui s’était tenu le 1er avril de la même année.
Certaines mauvaises langues prétendirent que la mariée, réputée pour sa ligne en limande sole, présentait un début de rondeur bien remarqué au moment de la cérémonie.
D’autres esprits mal affûtés prétendirent qu’une haine sans faille éclairait déjà le regard des deux grands-mères lorsque les « oui » s’échangèrent sous les voûtes romanes de Saint-Médard.
Le repas de noce organisé dans le parc du château des du Monteuil, prit des allures de règlement de compte. Ici, une sauce hollandaise malencontreusement renversée sur le tulle de la mariée. Là, le jabot du marié indélébilement taché par un vin rouge agressif. En soirée, pour une raison inconnue de tous, Marguerite et Aliénor furent toutes deux retrouvées dans la mare aux cygnes, des nénuphars plein la tête.
À l’heure de la nuit de noces, mon père fut découvert sur le foin de la grange, une main incompréhensiblement glissée dans les culottes rose fuchsia d’Adèle Joséphine Églantine du Plessis Javel, sa cousine préférée.
Ma mère, pendant ce temps, rendait dans une cuvette en étain son repas de noces. Elle n’en garda comme souvenir que le menu en simili taffetas imprimé en cinq cents exemplaires, deux alliances en or entrelacées dans le bec d’une colombe sommant la litanie des plats. Un symbole de paix qui n’amena aucune trêve dans cette guerre familiale.
D’après ma tante maternelle Adélaïde, faire entrer les deux mariés dans la chambre nuptiale releva du défi olympique. Avinés plus qu’il ne fallait – en particulier ma mère dans « sa situation », ajoutait souvent ma tante sur un ton entendu –, aucun d’eux ne tenait debout mais tous deux poussaient des cris à faire relever les morts. Des suppliques de condamnés demandant grâce. Ils s’agitaient, remuant bras et jambes pour qu’on les lâchât, menaçant les pauvres domestiques des pires horreurs s’ils s’évertuaient à poursuivre leur sale besogne.
Tante Adélaïde qui, contrairement au reste de la famille, ne met aucune omerta sur l’histoire du clan, aimait à me dire qu’il fallait pourtant bien qu’ils y entrassent dans cette chambre au lit unique. Pour « justifier » la chose. Quelle chose ? Ma présence incongrue dans le ventre de ma mère avant qu’elle ne fût officiellement mariée.
Car le fin mot de ce mariage précipité et non désiré n’était autre que la conception impromptue d’Aliénor Pénélope Marguerite de la Roche Jagu du Monteuil, votre servante.
En tout cas, c’était ainsi que tante Adélaïde résumait « l’affaire ».
***
« Ma conception est le résultat d’une erreur de jugement. »
Telle en est l’interprétation donnée par Adèle Joséphine Églantine du Plessis Javel, la fameuse cousine préférée de mon père.
D’après ce témoin direct, concerné au premier plan, je fus conçue le soir du bal des débutantes, celui où ma mère renversa bien des testostérones. Elle impressionna les jeunes hommes de la haute société en faisant une entrée remarquée dans sa robe parme parsemée de broderies diamantines. Des scintillements partaient de ses longs cheveux blond vénitien, savamment remontés sur sa nuque fine et blanche comme de la nacre.
D’après cette cousine, pourtant très en beauté elle aussi, on pouvait sentir les regards de gourmandise se poser sur cette novice tout juste sortie de chez les Sœurs de l’Annonciation. Grand-mère Aliénor tenait beaucoup à cette éducation stricte et moralisatrice.
Qu’apprit donc ma mère dans ce couvent huppé, caché au fond d’une vallée désertée par l’humanité ? Tout un tas de choses parfaitement inutiles de mon point de vue, mais fort considérées à l’époque dans l’éducation d’une jeune fille. Couture, broderie, aisance et grâce des mouvements, l’art de la table et, bien sûr, comment se comporter en digne épouse selon les critères catholiques, apostoliques et romains. Que des religieuses puissent enseigner cette dernière science m’a toujours laissée perplexe.
Ainsi donc, à 20 ans et dans la fleur de sa splendeur, Hélène Marie Clothilde de Beaumont Latour fit entrer la tempête de sa jeunesse dans la salle de bal du château de Mirecourt. À peine l’énorme porte de bois passée et le hall en marbres colorés traversé, son carnet de danse affichait complet. Elle ne savait si elle devait l’ivresse de la soirée au tournis que déclencha la cohue de tous ses prétendants ou au parfum capiteux qui émanait des bouquets de lys.
Selon la cousine Adèle, le tournis provenait certainement du passage sans préavis d’un cloître sombre et glacial à l’univers électrique et surchauffé de bras masculins saisissant pour la première fois la taille de cette jeune débutante. Mais bien sûr, cette version n’engage qu’elle.
***
Ce fut au plus fort de la soirée que les choses se corsèrent au château de Mirecourt.
Après des heures à tournoyer tout en avalant coupes de champagne de la Veuve d’Ambert sur cocktails aux alcools capiteux, Hélène n’était plus que rires et élucubrations. À gorge déployée, selon Adèle. Très peu convenable dans le grand monde où une certaine réserve est de mise. À croire que l’éducation des sœurs passait déjà au second plan.
À ce stade du récit, Adèle me confia qu’une idylle secrète s’était établie entre elle et mon père. Depuis leur plus jeune âge, ces deux cousins se vouaient un intérêt qui n’était pas pour déplaire aux familles respectives. Elles aussi voyaient d’un très bon œil l’alliance de leurs intérêts communs.
En se fréquentant assidûment pendant des vacances sur la côte ou au cours des soirées dans le meilleur monde, on espérait bien qu’un jour Edmond Charles Édouard projetterait de faire d’Adèle Joséphine Églantine une de la Roche Jagu du Monteuil.
L’âge de la puberté aidant, les jeunes promis se retrouvèrent de plus en plus souvent seuls, en de longues promenades romantiques, admirant main dans la main l’explosion de couchers de soleil sur la mer normande. Leurs yeux se perdaient en un avenir qui n’était plus à inventer, puisque déjà écrit et agréé par tous.
Comme je l’ai dit, l’âge de la puberté aidant, les jeux innocents commencèrent à éveiller d’autres sensations beaucoup moins pures qui appelaient à de nouvelles découvertes. De celles que la bienséance n’admettait pas hors mariage.
Le fameux soir du bal des débutantes au château de Mirecourt, mon futur père pensa venu le moment de demander officiellement la main de sa chère Adèle. Et puisque la décision était prise et les deux protagonistes d’accord, pourquoi remettre à plus tard les délices charnels promis par le mariage ?
Edmond et Adèle complotèrent de se retrouver dans l’une des multiples chambres du château de Mirecourt. Au plus fort de la soirée, dans la cohue générale, lorsque les groupes de discussion se seraient formés et que les valses tournoieraient, qui donc s’apercevrait de leur disparition ?
Tout avait été méticuleusement pensé par les jeunes gens.
Tout, sauf le grain de sable qui allait coincer si beau rouage.
***
La chambre Duguesclin, où jamais Duguesclin n’avait posé son séant puisque le château datait du 17e siècle, nichait au sommet de la tour sud-ouest, dominant les douves en eau qui cernaient le château. Tout à fait éloignée de la salle de bal, qui occupait l’intégralité du rez-de-chaussée.
Pour s’y rendre, il fallait quitter la salle de bal, traverser l’interminable hall d’entrée aux marbres colorés, monter l’escalier sans fin aux balustres verts, prendre à gauche le sombre couloir orné de portraits patibulaires qui regardaient le passant d’un œil mauvais, et enfin ne pas se tromper de porte pour ne pas risquer d’entrer chez n’importe qui.
Et c’est là que fut le hic !
Pour une raison ignorée de tous aussi bien que d’elle-même, l’ivresse étant sœur d’oubli, il se trouva qu’au même moment, au même endroit, ma future mère avait rendez-vous avec un inconnu dans la chambre Jeanne d’Arc, où jamais Jeanne d’Arc ne déposa les armes pour les mêmes raisons que Duguesclin.
Qu’allait donc faire Hélène dans une chambre étrangère, dans un château qui n’était pas le sien ? Retrouver un bellâtre sitôt sortie du couvent alors que l’éducation stricte et moralisatrice suintait encore par tous les pores de son esprit ? Impensable ! dirait plus tard Aliénor de Beaumont Latour. Ma grand-mère maternelle n’admit jamais une telle chose.
Si l’on en croit le récit chèrement arraché à ma grand-mère maternelle, sa fille aurait été attirée dans un traquenard par son ignoble gendre, débauché notoire.
Si l’on se reporte au récit de ma grand-mère paternelle, son précieux fils aurait été dévoyé par la harpie des Beaumont Latour, prête à tous les vices pour coincer si beau parti.
Quelle qu’ait été la vérité, le fait est que les deux jeunes gens se retrouvèrent sur le même jeté de lit en velours carmin. L’obscurité et l’alcool aidant, une fougue incontrôlable aveugla leur clairvoyance. Sans se rendre compte que l’autre n’était pas la personne attendue, leurs corps, libérés de l’interdit social, se jetèrent dans des cabrioles qui auraient fait rougir le marquis de Sade. Mon père, fort d’une expérience acquise dans les lieux de rendez-vous pour filles faciles, démonta ma mère qui se laissa glisser sans réticence dans ces voluptés nouvelles pour elle.
Il fallut attendre la fin des sportivités charnelles pour que chacun se rendit compte, trop tard, de l’erreur. Mon père tomba dans un état de léthargie hébétée, agenouillé face à la femme qui n’était pas celle qu’il croyait.
Ma mère couvrit sa nudité encore palpitante de plaisir en écarquillant les yeux sur l’entre-jambe masculin qu’elle découvrait visuellement pour la première fois.
Tous deux méditèrent sur l’intensité de la relation consommée avec l’inconnu qui partageait à cet instant le même lit. Enfin, je dis ça, mais tout cela sort de mon imagination. Je n’ai, évidemment, aucune idée de ce qui a pu se passer dans la tête de mes parents lorsqu’ils redescendirent sur terre une fois l’acte commis et moi-même entrée, à cet instant précis, dans leur univers qui allait devenir commun.
Et c’est ainsi que, pour rattraper une simple erreur de jugement le soir d’un bal des débutantes au château de Mirecourt, Edmond Charles Édouard de la Roche Jagu du Monteuil dut faire une croix sur les frous-frous roses de sa cousine, et que le 1er janvier 1900 naquit Aliénor Pénélope Marguerite de la Roche Jagu du Monteuil, moi-même.
***
Bien qu’innocente de toutes les accusations portées contre moi, ma naissance me causa beaucoup de tort. Je n’y étais pour rien mais j’incarnais pour chacune des parties la faute de l’autre. Et mon enfance, qui aurait pu être heureuse, s’en trouva chamboulée.
Pour les uns, j’étais l’enfant de la malveillance, l’objet de la captation des biens paternels par les Beaumont Latour, famille sur le déclin à cause d’un grand-père volage qui aimait la chair fraîche autant que la bonne chère.
Pour les autres, j’étais le résultat infortuné du détournement de la pureté d’une jeune fille élevée dans la religion par la concupiscence d’un débauché qui ne savait pas se maîtriser.
Il fallait donc remettre tout cela dans le droit chemin et nettoyer le soufre démoniaque qui planait sur mon âme enfantine. D’un commun accord, après le sevrage et dès mes premiers pas, je fus moi aussi envoyée au couvent, mais pas chez les Sœurs de l’Annonciation. La pratique démontrait assez l’insuffisance de leur éducation. Il n’était pas question, pour mon père, de réitérer le piètre exemple donné par ma mère.
Je passai donc ma jeunesse entre les murs encore plus sombres et encore plus froids des Sœurs de l’Immaculée Conception. Ce ne fut pas une sinécure. La rigueur était de mise dans tous les domaines. Le nombre de fois où je pleurais au souvenir du sein chaud et réconfortant de ma nourrice auvergnate ne se comptait plus.
Le lieu en lui-même était un appel à la folie furieuse. D’épais murs médiévaux à peine éclairés par quelques maigres meurtrières. De longues salles obscures aux tables de bois tristes. Pour l’édification des pensionnaires, de pieuses représentations de saints martyrisés, le corps en sang, le regard éperdu tourné vers le ciel, mains jointes, bouches ouvertes sur un désespoir qui ne sentait pas la rédemption. De quoi se demander si la foi incarnait réellement le réconfort que prônait le prêtre à la messe. En ce qui me concernait, je restais sceptique quant au pouvoir consolateur de la religion. Car rien ne venait réchauffer le désespoir de mon cœur d’enfant qui aurait préféré les jupes satinées de sa mère aux bures rêches des nonnes.
Le dortoir incarnait l’antichambre d’un pénitencier. Une enfilade de paillasses sur planches de bois, vingt filles par pièce, une religieuse noire comme un corbeau à l’entrée, veillant toute la nuit à la lumière d’une bougie, lisant à haute voix une hagiographie. Impossible de trouver le sommeil profond et réparateur dans ces conditions.
Parfois, certaines criaient en se réveillant d’un cauchemar sans doute dû au récit d’un martyr aux chairs déchirées par un fauve. D’autres pleuraient en silence, cachées sous l’unique couverture de laine drue. Chaque matin, nous n’étions toutes que bâillements et yeux gonflés, mutisme et mines pâles.
***
La journée commençait avec les poules, à cinq heures trente. Lever au clairon, si je puis dire, ou plutôt à la cloche. Dès qu’elle retentissait, notre gardienne se dressait d’un bond, frappant dans ses mains comme si le message de la cloche n’avait pas été assez clair. « Mesdemoiselles, levez-vous ! Assez dormi comme ça ! Le Seigneur vous appelle pour une nouvelle journée de prières et d’actions de grâce ». Phrase incontournable avec laquelle je me réveille encore, vingt-cinq ans après. Comme un automatisme qui serait entré dans ma tête sans que je parvienne à m’en défaire.
Pieds nus sur le froid des dalles en ardoise, nous avancions en silence vers la pièce d’eau. Un broc, un bout de savon noir et une bassine dans laquelle faire une toilette de chat à l’eau froide nous y attendaient. Autant dire que dans ces conditions, nous n’envisagions pas d’y passer des heures. À la hâte, nous lavions sans pudeur toutes les parties nauséabondes que le Seigneur nous a données. Puis, nous entrions rapidement dans la robe de feutre noire au col Claudine qui devait lui donner un petit air festif.
Les gros godillots lacés, la rangée de gamines prenait la direction du réfectoire, toujours en silence. Sur les lignées de tables, des bols de grès gris attendaient les pensionnaires, une tranche de pain de campagne beurrée à leur côté. À distance régulière, de lourds brocs de grès contenaient le lait tiède tiré des vaches du couvent.
Nous déjeunions frugalement à la lecture d’un chapitre des Évangiles qu’il fallait ensuite méditer toute la journée. Il ne s’agissait pas de dormir ou de se concentrer sur autre chose. À la veillée du soir, chacune devait donner son interprétation du passage lu le matin. Manquer à ce devoir revenait à passer une partie de la nuit debout dans le froid, pour rattraper la méditation négligée. S’il nous arrivait toujours au début de nous distraire de ce devoir, nous apprenions très vite à ne pas commettre l’erreur deux fois.
La tranche beurrée ingurgitée par notre estomac affamé, une sœur nous menait en rang serré vers la chapelle où nous attendait un prêtre en chasuble pour la première messe du jour. Son amplitude stomacale laissait supposer qu’il ne devait pas, lui, se contenter d’une tranche beurrée au petit-déjeuner.
Il officiait sous l’œil torve d’un Crucifié à la tête tombée sur un torse ensanglanté. Heureusement, il arrivait parfois que les premiers rayons du soleil jouassent avec les vitraux aux couleurs de gemmes. Alors, un festival de rouges vifs, de jaunes d’or, de vert prairie réjouissait mes yeux. J’imaginais des guirlandes joyeuses et scintillantes tombant des lourdes voûtes de pierre, entre lesquelles voletaient des oiseaux de paradis aux plumages enflammés. Je devinais de petits lutins surgis du tréfonds des dalles sépulcrales, venant chercher quelques trésors à emporter dans leur grotte débordant de coffres d’or et de pierreries.
Aux murs tristes pendaient de lugubres tableaux aux couleurs passées. Leur tristesse répondait à nos cauchemars nocturnes. À la place, j’imaginais des lits de rubis, des fleuves de saphir, des volcans en fusion coulant du Paradis. Je n’écoutais plus le monologue atone du prêtre nous mettant en garde contre l’enfer. Plutôt, je revisitais à l’aune de mon imagination les histoires entendues ou lues.
Celle du Prêtre Jean, habitant un royaume improbable survolé par des phœnix, parsemé de licornes, à la géographie pleine de pierres précieuses, était ma préférée. Je me mettais en quête de ce vieux roi aussi barbu que le père Noël, traversant des contrées hostiles, luttant seule contre des tribus païennes, pareille aux vierges saintes dressées contre les hordes barbares.
Je me voyais berbère chevauchant un cheval sauvage, cheveux au vent du désert, traversant montagnes enneigées et plaines stériles, hurlant le nom du Prêtre, l’enjoignant de paraître devant moi au nom de la sainte croix.
Je me transformais en sainte Geneviève défiant les troupes d’Attila, le sein palpitant. Le sanguinaire cavalier des steppes stoppait net son cheval fougueux face à moi. Inspiré par la peur du divin, il mettait pied à terre et s’agenouillait devant moi en signe de soumission inconditionnelle, embrassant dévotement le pied blanc de pureté qui sortait de sous ma longue robe de cotonnade. Vaincu par ma foi, il devenait le berger qui convertissait sa troupe de soldats barbares et ignorants.
Oui, j’aimais bien ces matins ensoleillés dans la triste chapelle où officiait le père Blaise. C’était là le seul moment de répit accordé à mon imagination d’enfant, orpheline des contes lus le soir par une mère aimante et des veillées familiales habitées par les fantômes d’une grand-mère attentionnée.
J’ai détesté mes parents pour cela.
***
Le reste de la journée s’égrenait en occupations sans intérêt et apprentissages à la vacuité abyssale. Enfin non, pas tout à fait. Je reconnais que prendre soin du bétail et apprendre les rudiments de l’œuf coque me furent bien utiles par la suite. Un sentiment d’indépendance né de la possibilité de s’en sortir seule. Mais le reste, tout ce qui sentait le fil et les tissus, l’art de bien langer un nourrisson et autres fadaises pour filles à marier transmises par des filles à jamais célibataires, me laissaient froide, voire suspicieuse.
Les cours, enfin ce qu’on appelait les cours du matin, ne servirent qu’à m’apprendre à lire et à écrire. Un peu à compter aussi, mais juste le nécessaire pour savoir combien de paires de bas encombraient nos tiroirs. N’oublions pas que la noble exécution des tâches financières était réservée aux hommes qui seraient nos époux. Par contre, lire et écrire permettaient de satisfaire à ce que la bonne société attendait de ses représentantes : correspondre avec le monde.
Les messieurs, apparemment, n’aiment pas trop ça. À croire que les livres et les lettres sont une perte de temps, un amusement laissé aux dames pour occuper leur matinée. Il est même très étonnant de constater, lorsque l’œil parcourt les rayonnages d’une bibliothèque, que les auteurs y sont majoritairement masculins alors que dans la réalité, l’homme se préoccupe fort peu de lire et encore moins d’écrire, si ce n’est dans des livres de comptes.
Il est vrai que j’ai toujours vu ma mère enfermée dans son cabinet de « travail » chaque matin que Dieu a fait. Cette infime pièce était lovée entre sa chambre et la bibliothèque de mon père. Cela peut paraître incongru puisque les hommes prêtent peu d’intérêt à cette activité, mais c’est ainsi. Mon père avait sa bibliothèque, deux fois plus vaste que le cabinet de travail de ma mère, remplie de livres reliés cuir vert et or qui s’alignaient jusqu’au plafond. Il n’y entrait que pour fumer le cigare avec ses semblables.
Ma mère, donc, s’attablait à son petit secrétaire encombré de fleurs et de papiers de toutes les couleurs pâles qui existent. Elle prenait la première enveloppe sur une pile qu’alimentait chaque jour le postier. Elle saisissait, selon son humeur, une plume métallique ou sa belle plume en verre de Venise. Dans un des tiroirs du secrétaire, des flacons de toutes les couleurs attendaient d’être choisis par sa main hésitante. Parme, bleu outremer, bleu azur, noir ébène, vert émeraude. Cela dépendait de qui lui écrivait et de son humeur.
J’étais donc prête, moi aussi, à prendre le relais maternel, mais également à assurer l’intendance de la maison. L’intérêt d’avoir appris à soigner les bêtes me permettait de remplacer le vacher, de sursoir au berger, de seconder le fromager, voire de m’épanouir en cuisine pour les adeptes de bouillies en tous genres. Ah ! J’oubliais qu’en cas de désistement soudain de la lavandière, mes mains ne rechigneraient pas à plonger dans l’eau glaciale du lavoir pour frotter une tache réticente.
La couture m’ennuyait profondément, mais s’il le fallait, je saurai tout de même repriser un bas déchiré ou remettre en place un col baladeur. Quant au reste, broderie et cætera, je mettais une très mauvaise volonté à accomplir des tâches dites de distraction dont l’utilité m’échappait. Si ce n’est pour se donner une contenance de salon en recevant une visite, la broderie de petites fleurs sur un carré de tissu encore plus petit me paraissait d’une futilité abyssale.
Je ne m’imaginais pas du tout, comme ma mère et les autres dames de son univers, passer mes après-midi assise près d’une fenêtre à bavasser tout en dessinant une fleur à l’aide d’une aiguille. D’autant qu’un autre mystère persistait que je ne m’expliquais pas. Au nombre de tissus brodés par ma mère, celle-ci aurait pu ouvrir une mercerie pour en faire commerce. Or, de manière tout à fait inexplicable, sitôt terminée, chaque pièce brodée disparaissait à jamais. Quel maléfice les volatilisait ? Je n’ai toujours pas la réponse à cette heure.
***
J’attendais le vendredi soir avec une impatience mesurée mais réelle. Passer la semaine au couvent n’était pas une sinécure, mais retourner au château familial ne valait guère mieux. Je devais toutefois me sentir privilégiée car beaucoup de mes camarades de galère devaient attendre les grandes fêtes religieuses pour fuir la tristesse des lieux. Elles ne sortaient jamais de cette tombe lugubre, oubliées des leurs, débarrassant leurs parents d’une présence indésirable.
Petite, je voyais leurs regards tristes derrière les carreaux suivre avidement mon départ, s’imaginant la chance de pouvoir respirer quelques heures dans un lieu vivant, loin de ce sépulcre perdu au milieu de nulle part. Adolescente, leurs regards avaient changé. Ce n’était plus de la tristesse, mais l’espoir de voir bientôt arriver la délivrance avec le mariage. N’importe quel mari plutôt que l’enfermement à vie.
Moi, bien que ma présence leur rappelât sans cesse leur fatale méprise, mes parents mettaient un point d’honneur à me faire revenir toutes les fins de semaine, en dépit des crises de nerfs et des tensions cauchemardesques que ma vue déclenchait chez eux. Et je leur en suis d’une reconnaissance infinie. Mes fins de semaine étaient tellement plus vivantes au château de la Roche Jagu ! Non pas tant grâce à la présence parentale, mais bien parce que ma vie pouvait enfin se réaliser, et pas uniquement en rêve.
***
Le signal de ma délivrance m’était donné par une carriole brinquebalante conduite par le vieux Jacob et sa jument tout aussi ancestrale, Poupoune. Le vieux Jacob était l’homme à tout faire de notre domaine, celui qui menait la danse de la domesticité dans les champs et à la ferme. Le pilier de mon enfance. Le chêne de mes joies et de mes espoirs. Je ne le quittais jamais, enfant, courant sans cesse derrière lui, agglutinée à ses moindres pas, lorgnant ses moindres gestes, du matin au soir. Parfois, ma présence le gênait car il avait peur de me blesser. Les jours de fauchage par exemple. Il craignait toujours que la faux happât une de mes petites jambes. Mais il suffisait que je commence à renifler, menaçant larmes, pour que tout de suite Jacob s’apaisât et me prît dans ses épais bras réconfortants de paysan. Jacob est le premier homme et le seul de ma maisonnée à avoir égayé mes joues de baisers sonores.
Je les guettais avidement, lui et Poupoune, derrière la grille qui séparait le monde des vivants du monde des morts, accrochée à elle comme un naufragé à son esquif, comme si ma vie en dépendait. Je savais qu’ils arrivaient au bruit de tonnerre que faisaient les sabots et les roues sur le pavé de la cour intérieure. À cet instant précis, plus personne ne pouvait retenir l’élan vital qui m’élançait au bas des escaliers. On n’entendait que mes gros godillots cogner le sol comme un diable fuyant l’eucharistie.
Plus personne n’existait. Ni religieuse vindicative. Ni amie larmoyante. Chaud devant ! Se trouver sur ma route à ce moment précis relevait de la pure inconscience.
Mon jeune âge et l’indifférence à ma position me jetaient dans les bras du vieux Jacob qui avait alors un rire profond et édenté en me prenant dans ses bras. Devait-il ou non accepter une telle familiarité avec sa jeune maîtresse en public ? Que diraient Monsieur et Madame si les religieuses révélaient l’intimité qui nous unissait ? Je m’en fichais, moi, de Monsieur et Madame. J’avais besoin de chaleur humaine, d’affection, d’un baiser sur ma joue, même s’il sentait le cheval à des kilomètres.
Et puis je prenais Poupoune dans mes petits bras. Poupoune était un cheval de trait massif, au sabot large, à la croupe disgracieuse, d’un blanc sale et taché. Solide et rompue à la tâche, elle n’avait d’autre utilité que de retourner la terre des champs et mener la carriole là où Jacob le décidait. Mais pour moi, elle incarnait la noble licorne venue sauver la sainte martyre des griffes du tyran lubrique qui en voulait à sa pureté. Je plantais un baiser sonore sur son gros museau humide, en me demandant toujours où elle avait bien pu cacher sa corne blanche. C’était le plus beau cheval du monde.
Le vieux Jacob m’installait alors du mieux qu’il pouvait sur le banc près de lui. Il avait posé une épaisse couverture à ma place, pour atténuer les chahuts du voyage. À l’arrière, il y avait souvent le résultat d’une course effectuée avant de venir me chercher. Parfois je sentais le chou-fleur ramassé dans nos champs. D’autres fois, du foin débordait sur la route. Des paquets aussi, pris en commande chez les boutiquiers de la ville, pour ma mère ou la cuisinière, l’épouse de Jacob.
Mais le vieux Jacob, je l’aimais particulièrement car il se montrait toujours attentionné. Il le connaissait bien, le couvent des Sœurs de l’Immaculée Conception. Il savait bien quel ordre militaire y régnait. Une fois passée la grande porte cochère qui se refermait sur mon soulagement, le vieux Jacob sortait de sous son banc un petit paquet secret qu’il me tendait avec un clin d’œil entendu.
Ah, j’ai encore dans la bouche le goût du bon croissant au beurre, la douceur de la petite brioche à la confiture d’abricot, le fondant de la douce amandine aux cerises confites ! Il prenait sur ses gages, le brave homme, pour m’acheter ces gâteries à la pâtisserie du village, en bonne place entre le château et le couvent.
Un secret bien gardé entre nous, une connivence à toutes épreuves, car si ma mère l’avait su, elle en aurait tout de suite conclu que l’échec de l’éducation reçue venait de ces douceurs qui ramollissent le caractère et annihilent la volonté.
Merci à toi, vieux Jacob, pour tous ces bienfaits. Que ton âme repose en paix. Je la chérirai tant que je vivrai.
***
Le reste du week-end mérite moins que je m’en souvienne. Hormis les instants de plénitude durant lesquels je me perdais, seule, dans le grand domaine à courir après une aventure imaginaire, je m’ennuyais à mourir. Je m’ennuyais, mais dans un cadre plus agréable que celui du couvent.
Le calme était la première différence de taille. Je n’ai jamais autant entendu parler que ces sœurs vouées au silence et l’exigeant de nous ! Les lectures qui n’en finissaient pas, jour et nuit ; les méditations à tire-larigot ; les messes incessantes ; les leçons de choses et d’autres. Jamais un moment de paix dans ce grand couvent qui, depuis le Moyen-âge, n’a pas dû connaître de période plus agressive.
Au château, au contraire, c’était silence, silence, et encore silence. Voilà, je vous l’accorde, le meilleur moyen pour maintenir la paix entre deux personnes ne pouvant se sentir et que le destin a réunies malgré elles. Et puis pour dire quoi, je vous le demande. Les seules paroles que ma mère adressait à mon père, cherchaient à savoir si son retard devait être imputable à l’autre « fille de mauvaise vie », en clair la cousine Adèle. À quoi mon père répondait que sur l’aspect « fille de mauvaise vie », ma mère se trouvait en bonne place pour en connaître un rayon. Dès lors, tout le château en profitait jusqu’au coucher des poules.
Il valait mieux, en effet, que le silence régnât en maître ! Et la taille du château permettait à chacun de trouver un coin reculé dans l’une ou l’autre aile, sans jamais qu’il fût possible de se croiser.
J’entendais bien sûr murmurer le personnel qui devait bien communiquer pour accomplir son travail. Mais ce n’était qu’une brise humaine, un souffle de voix, à peine perceptible dans l’immense espace inhabité du château.
Les seuls à passer outre le silence, aboyaient ou miaulaient à qui mieux-mieux. Une légion de chiens de chasse que mon père laissait traîner en liberté, au grand désarroi de ma mère qui trouvait cela fort inconvenant. Une horde de chats abandonnés et faméliques qui venaient se refaire une santé près des cuisines du château où Mariette, notre cuisinière, abandonnait les détritus. La rencontre entre les deux espèces créait immanquablement une animation revigorante en ce lieu voué au mutisme global et à la solitude individuelle.
Je m’amusais à les suivre à travers le parc, lorsque la meute prenait en chasse les félins qui couraient plus vite que leur ombre. Cela me valait, bien sûr, une leçon de bonne tenue de la part de ma mère à qui rien de ce qui se passait à l’extérieur n’échappait. Je n’étais officiellement autorisée à courir comme un garçon manqué que lorsque mes cousins – ou tout autre être portant caleçon –, me coursaient. Le but était d’éviter d’être rattrapée afin de préserver la bonne morale familiale.
De mon côté, je ne trouvais pas désagréable, parfois, de me laisser mettre la main dessus par Yvan, le petit-fils du vieux Jacob. Car Jacob avait un petit-fils cinq ans plus âgé que moi. C’était la deuxième raison qui me faisait aimer les week-ends au château. Je n’avais pas d’autre ami, pas d’autre enfant de mon âge, personne qui s’intéressât à moi sinon Jacob et Yvan. Et Mariette aussi, mais pour d’autres raisons, en particulier ses brioches fourrées à la confiture de cerise.
Avec Yvan, je jouais enfin avec quelqu’un de mon âge, ou presque. Au couvent, hors de question d’imaginer une seconde une relation conviviale avec mes pauvres sœurs en pénitence. Pas une seule minute ne nous était laissée pour jouer ou échanger. Nous n’avions que des relations distantes et polies. Je n’en tirai aucune amitié profonde et suivie.
Par contre, avec Yvan, quelle liberté ! Mes parents se préoccupant fort peu de mon quotidien au château, livrée à moi-même sauf pour l’heure maudite de la sieste, quand je ne courrais pas derrière Jacob, je suivais Yvan dans ses aventures. Entre chevalerie, « soldatesque » et exploration, nos jeux empruntaient tous les chemins de l’imaginaire. L’hiver, les batailles de neige faisaient rage. L’été misait sur celui qui nagerait le plus loin dans l’étang du domaine. Qui gagnerait la course jusqu’à l’arbre foudroyé ? Qui rapporterait l’eau de la source enchantée pour sauver Poupoune d’une mort certaine ?
Les jours où Yvan s’échinait à la tâche comme les adultes, trop fatigué pour jouer avec la gamine désœuvrée que j’étais, je trouvais tout de même le moyen de le voir. Le pauvre enfant rentrait épuisé, car son grand-père ne le ménageait pas malgré son jeune âge. Alors, en fin d’après-midi, pour pallier mon ennui solitaire, j’allais dans la dépendance où ils vivaient et qui abritait la cuisine, je montais à l’étage où je savais qu’Yvan se reposait, au milieu des parfums de girofle et de chou, et je m’installais tout contre lui sur le grabat qui lui servait de lit. Et tandis qu’il somnolait, je lui lisais une histoire que j’avais pris plaisir à chercher tout l’après-midi dans la bibliothèque paternelle.
***
En effet, lorsque Jacob ou Yvan n’avaient pas de temps à me consacrer, j’errais en cachette dans la bibliothèque de mon père dont il m’interdisait l’accès car la lecture, selon ses principes, dévoyait la moralité féminine. Qu’à cela ne tienne. À son insu, car il s’y trouvait rarement lui-même, je prenais des livres que je lisais soit dans un recoin profond du parc aux beaux jours, soit dans l’une des nombreuses pièces fermées du château en hiver. Comme mon père ne se servait des livres que comme cadre élégant pour son fumoir, il ne se rendît jamais compte de la disparition régulière de l’un d’eux.
Il y avait de tout et de rien. Je m’intéressais à chacun d’eux, sauf aux grimoires ennuyeux consacrés à l’art de la vénerie, les seuls usés par les mains oisives de mon père. De lourds volumes au cuir épais, aux dorures m’as-tu-vu, aux gravures infâmes. Je détestais voir ces images de mises à mort par une meute sanguinaire, le vainqueur posant près de la bête tuée, parfois un pied irrespectueux posé sur la panse refroidie. Une vraie misère. Une lecture sans intérêt. La seule chose qui pouvait avoir un peu de sens pour moi était la reconnaissance des espèces grâce aux livres dits naturalistes, décrivant les espèces, leurs vies, leurs habitudes. Mais sans plus, vraiment.
Non, personnellement, je laissais de côté cet espace pour me jeter sur tout le reste. Tout le reste, c’était des récits de voyages extraordinaires qui me mettaient l’eau à la bouche et que je partageais avec Yvan. Je m’imaginais amazone foulant les sables brûlants du Sahara, Inuit frigorifiée dans les neiges arctiques, Chinoise récoltant les feuilles de thé sur les monts célestes. Tout un univers rempli de promesses, bien éloigné de mon triste quotidien si bien léché, et qui servait de base à nos aventures dans le grand parc.
Je ne laissais pas de côté les ouvrages plus scientifiques, feuilletant avec plaisir les traités de botanique que je mettais en pratique dans le parc, ceux de zoologie qui m’intriguaient par l’étonnante diversité de la Création. Même les techniques m’intéressaient. La vapeur, l’électricité, le charbon. Tout cela, je le dévorais comme un trésor que personne ne pourrait me prendre une fois dans ma tête. Rien à voir avec les heures perdues au couvent à apprendre le point de croix ou à exécuter une reprise invisible.
Les hagiographies me laissaient perplexes. Je délaissais les histoires trop tristes d’hommes et de femmes dévorés par de pauvres lions affamés pour l’occasion. Je leur préférais les histoires plus étranges de vertus perdues, chose qui, pour moi, relevait à cette époque du mystère le plus total. Yvan, lui, gardait le silence et arborait un sourire énigmatique qui avait le don de m’exaspérer au plus haut point. Sous prétexte que nous avions cinq ans d’écart, il fallait toujours qu’il se prît pour le sage qui en savait plus long que la pauvre gamine que j’étais.
J’avais une vague idée théorique que quelque chose de mal se cachait dans ces relations secrètes entre l’homme et la femme. L’émoi causé par ma naissance me laissait envisager tout le diabolique de cette chose. Mais cette « situation » restait floue dans mon esprit. On m’apprenait qu’il fallait éviter tout risque, sans pour autant me dire en quoi consistait, justement, ce risque. Il n’était donc pas facile, pour moi, de comprendre ce qu’était cette pécheresse, cette femme de mauvaise vie qui encombrait la bouche de mes parents autant que des sœurs du couvent.
Alors, je me plongeai avec intérêt dans la vie de Marie-Madeleine, pécheresse par excellence, sauvée in extremis par son amour pour le Christ. Je lus le terme de « prostituée », sans aucune consistance concrète pour moi. Lorsque je demandai des éclaircissements sur ce point, mes parents, pour une fois à l’unisson, me répondirent par une raclée magistrale ; les sœurs de l’Immaculée Conception par un « oh ! » outré et une nuit au coin qui me firent comprendre que l’insistance à vouloir apprendre dans ce domaine était mal venue. Je décidai donc de m’adresser à moins forte partie puisque ni les livres, ni la bonne société ne satisfaisaient ma soif d’apprendre.
D’un pas décidé, je me rendis aux cuisines. Mariette y préparait son fameux lapin au calvados qui réconciliait tout le monde. Mon air buté, mes petits bras croisés sur une poitrine naissante, lui firent comprendre que l’heure était grave. Mariette interrompit son travail, s’installa à la longue table en bois encombrée de légumes, et attendit.
Mariette n’était pas une grande bavarde, caractéristique fort rare chez une domestique. Contrairement aux soubrettes que j’entendais souvent susurrer dans les couloirs, Mariette avait la conscience de son importance au sein de la famille. Elle savait occuper la place qui mettait tout le monde d’accord, qui dessinait de larges sourires de satisfaction sur des bouches la plupart du temps aigries. Sans elle, la paix n’aurait jamais eu de place dans notre famille déchirée. Mariette ne parlait pas. Elle agissait. Et sa cuisine mettait du baume au cœur de tous.
Aussi, selon son habitude, attendit-elle que la petite maîtresse exprimât son désir. Habituellement, ce désir consistait en une madeleine bien gonflée prise hors goûter, un éclair fourré de confiture de myrtille, ou un petit chausson aux écrevisses pour me mettre en appétit.
Cette fois-là, étant moi-même d’une nature directe, ce qui me valut souvent de passer un sale quart d’heure, je n’y allai pas par quatre chemins. « Qu’entend-t-on par péché de chair, Mariette ? », lui demandai-je sans détour, du haut de mes onze ans.
Sans plus de fioriture, Mariette hocha la tête, se leva, me prit par la main et nous nous dirigeâmes d’un pas alerte — parce qu’elle n’avait pas que ça à faire —, et en silence vers les clapiers situés non loin de la cuisine. « ‘tendez ici, d’moiselle, soyez patiente. Quand qu’vous verrez m’sieur Lapin monter su’ l’dos de M’dame Lapin, c’est’y d’là, vot’ péché d’chair », me dit-elle en me laissant au milieu d’une cinquantaine de lapins bondissants.
Et c’est ainsi que ledit péché de chair n’eut plus aucun secret pour moi. Après tout, les livres ne sont que théorie. Rien de tel que la pratique pour se rendre compte par soi-même !
Les sœurs de l’Immaculée Conception durent me supporter jusqu’à mes 15 ans. L’inverse, cela va sans dire, valait tout autant. Contrairement à mes petites camarades sagement embrigadées pour avoir la paix, ou par faiblesse de caractère, je ne m’en laissai pas conter durant toutes ces années. La première victime de ma vindicte fut le pauvre curé qui avait à écouter nos élucubrations de pécheresses en herbe, la veille de fêtes religieuses. Mais en même temps, franchement, que pouvaient bien avoir à confesser une flopée de fillettes élevées dans un bagne sans confort ni garçons, priant et cousant toute la journée ?