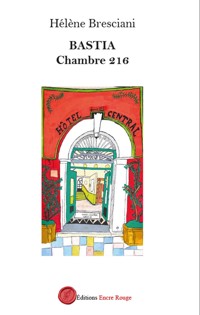
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encre Rouge
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
"Bastia, chambre 216"… c’est ici que la vie s’est remise à battre pour l’auteure qui pensait ne jamais revenir dans la ville où elle vécut ses plus belles années. Chambre 216… une nouvelle adresse sans passé, sans tristesse, sans souvenirs. Au coeur de Bastia, l’hôtel Central est l’un des plus anciens. Il appartient à la même famille depuis 1941. C’est un peu de son histoire qui nous est ici contée. Une histoire méconnue du plus grand nombre qui a fourni la trame de ce livre et a permis également de retrouver, année après année, séjour après séjour, d’autres raisons de retour, une autre manière plus curieuse encore d’appréhender la ville en la redécouvrant et en s’adressant à elle comme à un être familier que l’on n’a jamais cessé de chérir.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Née à Valle d’Orezza, en pleine Castagniccia,
Hélène Bresciani vit et travaille à Marseille. Professeure d’italien, puis rédactrice dans un grand quotidien marseillais, collaborant aujourd’hui à un hebdomadaire économique et juridique, elle signe ici son septième ouvrage.
La Corse et Bastia y sont comme à l’accoutumée mis en scène et donnés à voir et à aimer au lecteur, au travers d’histoires, d’anecdotes, de rencontres, de faits réels ou peut-être même – et qui s’en plaindrait ? – entièrement rêvés !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hélène Bresciani
Du même auteur
Deux, rue de la Marine, éditions Les Vents contraires, en collaboration avec Jeanne Bresciani, prix du livre corse 2000
Bastia, éditions Albiana, 2002
L’Altana, éditions Transbordeurs, 2006
IL(e)S et les silences, Stamperia Sammarcelli, 2016
Journal d’une amnésique, éditions A Fior di Carta, 2017
À Marie-Jean qui m’a donné le goût de l’Italie et qui a eu l’idée de ce livre… in memoriam
À Frédéric qui m’a permis de le réaliser et en attendant de voir mon portrait dans les escaliers…
Être vivant, c’est être fait de mémoire.
Philip Roth
Une trilogie ? Quelle idée !
Je me souviens avoir éclaté de rire, trop prise par l’instant présent pour seulement envisager un futur. Heureuse d’en avoir terminé avec ce premier « Bastia ». Satisfaite de l’éditeur trouvé. Comblée par la préface de l’ami Marie-Jean.
C’est alors que les choses se sont un peu gâtées. Tout a commencé avec le refus de l’éditeur d’accepter une préface. Inutile, a-t-il déclaré. Inutile la préface, inutile, la discussion. Que se cachait-il derrière ce refus aussi brutal que définitif ? Je ne l’ai jamais su, et cela ne m’a pas, je l’avoue, perturbée très longtemps. Attristée cependant. Et puis, qu’allais-je pouvoir dire à mon ami, comment lui expliquer ce soudain changement ? Lâchement, je choisis alors de me taire… Et lorsque le livre parut, déçu, vexé peut-être, Marie-Jean cessa pour sa part de m’adresser la parole. Nous nous rencontrions dans les librairies, sur le boulevard, aux terrasses des cafés sans nous saluer, sans nous regarder… tels deux adolescents attardés, un peu gênés certainement, mais bien ancrés dans notre décision de ne rien changer à notre attitude du moment.
Heureusement, notre fâcherie dura peu et un jour – je me souviens, c’était à la librairie Album, sous l’œil amusé et content de Gilbert, le directeur de l’époque – nous tombâmes quasiment dans les bras l’un de l’autre en riant de soulagement. Je fus heureuse ce jour-là ! Et tout se remit en place.
Mais la préface, alors ?
En rangeant quelques années de désordre, j’ai eu récemment, la surprise de la voir réapparaître. Avec ses petits caractères d’imprimerie, ses ratures, son papier jauni, froissé sur les bords. Elle avait dormi près de vingt ans dans un tiroir. Surprise de la retrouver, je l’ai relue. Et l’envie est enfin née en moi de lui donner vie. De rendre hommage à son auteur. Et, pourquoi pas – c’était son idée après tout - de tenter un troisième ouvrage sur Bastia, le second étant paru sous le titre « Journal d’une amnésique. Bastia et autres lieux au siècle dernier »…
La trilogie était en marche.
Et comme d’habitude, je me mettais en route, les pas dans mes pas, ne sachant où j’allais, les mains vides de tout bagage.
Le premier livre sur Bastia est sorti en 2002 aux éditions Albiana. Je n’avais d’abord pas songé à un éditeur corse. C’était pourtant une évidence. J’avais donc apporté mon tapuscrit à une maison d’édition aixoise avec laquelle j’entretenais quelques rapports prétendument amicaux. La note de lecture était revenue positive avec néanmoins quelques réserves qui ne m’avaient pas parues insurmontables. L’éditeur semblait favorable. J’étais aux anges… Lorsqu’il m’appela un jour de 2001, je partis le rejoindre en toute confiance. Nous étions le onze septembre et il était quatorze heures. Il me dit son regret de ne pouvoir me publier. Son grand problème avec mon livre c’était la Corse. J’aurais évoqué un autre département, il se serait prononcé favorablement, m’assura-t-il. Je l’ai regardé, interdite. J’ai écouté ses arguments sans vraiment les entendre et puis je suis partie. Je ne devais jamais le revoir.
Sur l’autoroute du retour, j’étais en colère, pleine d’une rage froide qui me faisait grincer des dents. Pour me calmer, j’ai allumé la radio. Et la nouvelle est tombée sur moi comme un couperet. Quatre avions de ligne venaient d’être détournés par des terroristes d’Al-Qaïda. Deux d’entre eux s’étaient écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center à New-York, un autre sur le Pentagone et le dernier dans un champ. 2.977 civils ainsi que les dix-neuf terroristes impliqués avaient perdu la vie.
11 septembre 2001 : Nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Et ma colère venait de passer au second plan.
Préface
Y aurait-il plus beau prélude à cette évocation-résurrection que le « Projet de préface » de Proust à son « Contre Sainte-Beuve » ?
Quelques tranches de pain grillé dans une tasse de thé lui faisaient « ressentir un trouble, des odeurs de géranium, d’orangers », lui donnaient « une sensation d’extraordinaire lumière, de bonheur ». De même, traversant une cour, le pied sur un pavé inégal et brillant Proust tressaille et voici surgir, dans un éblouissement, Venise qui dormait au fond de lui, « vie pure, conservée pure. »
Enfin, qu’ajouter à ces strophes superbes de Saint-John Perse*, choisies par l’auteur en exergue à son « ode » à Bastia ? Les vagues lustrales du poème « Exil », restituent Hélène Bresciani à sa « rive natale ».
Dans les années soixante, c’était hier, c’est aujourd’hui, Hélène a été mon élève en classe de Lettres Supérieures au lycée de Bastia. Je garde d’elle l’image inaltérée d’une jeune fille au charme impertinent. Son port de tête, un défi. Elle avait la vivacité impatiente d’une Artémis, en alerte, chassant le Temps.
Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris sa quête obstinée d’une ville qui s’enfouit dans les mystères de l’inconscient et réapparaît, fugace et immuable, dans l’éclat d’une lumière qui rend à la fois lucide et mélancolique.
Hélène Bresciani est habitée par sa ville, même quand elle en est éloignée, c'est-à-dire quand elle se fuit. Cette hantise est déchirure et enchantement.
L’ancrage mental et spirituel de l’auteur est dans ce vieux port balayé par un libecciu tonitruant, génie du lieu.
À Bastia, Hélène est saisie d’un amour panique pour cette ville charnelle qui cache ses tendresses derrière de hautes façades, ses toits gris tourterelle et ses remparts austères.
Inlassablement, de ruelles en traverses, de collines franciscaines en jardins secrets, de chapelles en cathédrales, elle remet ses pas dans ses pas de petite fille, d’adolescente, de femme. En quête de ce qui fut, de ce qui est. Elle fait « ses provisions » de rumeurs, d’odeurs, de parfums. Au bout de cette promenade amoureuse, il y a la mer qu’elle épouse.
Sur l’autre rive, celle de l’Exil, Hélène nourrit une indéfectible nostalgie pour la cité idéale dont l’âme se confond avec la sienne. La ville n’est-elle pas elle ? À force d’étreindre le corps labyrinthique de sa cité, elle s’y perd pour mieux se retrouver. Même si cette jeune femme effrontée a la pudeur de l’essentiel, sa quête est bien celle de l’absolu qui redonne à l’être son unité…
Comme il y a un « air de Paris », il y a une musique de Bastia, faite de mille bruits, d’un air d’opéra, d’un air de barcarolle, et de ces cloches qui se répondent, parfois non sans humour.
Dans « Deux, rue de la Marine », la partition de la ville était faite par les deux sœurs Bresciani à quatre mains. Cette fois, Hélène a voulu enrichir sa petite musique intérieure en se faisant accompagner d’un chœur, celui de ses amis qui ont gardé mémoire. À leur tour, ceux-ci convoquent, pour dire le passé et le présent de la ville, d’autres figures bastiaises modestes et glorieuses, des personnages pittoresques, malicieux et même érudits qui donnent à la ville sa voix, aux remparts, leur timbre coloré.
De rencontres en rendez-vous, de tous ces entretiens familiers qui sont la trame et font le charme bavard du livre, sourd le champ profond et polyphonique de la ville à la fois dans et hors du temps.
Non sans ironie, le parcours tissé d’anecdotes et d’impressions vives se conclut par l’historique, ponctué de dates, de la vieille cité génoise. Mais, comme le chante Saint-John Perse : « Il n’est d’histoire que de l’âme. »
En dehors de ce qui s’écrit et se chante, il n’y a plus que la mort.
Par la grâce de ce beau livre, Hélène Bresciani, en s’adressant à Bastia, s’assure de sa vie. Il n’est de limites à la ville que celles de son âme que n’emprisonne aucun cadastre.
Bastia, ville profonde, est un labyrinthe. Le fil d’Ariane qui permet de la traverser est tressé d’amour et de poésie. C’est bien le fil d’Hélène.
Marie-Jean Vinciguerra.
« … Comme celui qui se dévêt à la vue de la mer, comme celui qui s’est levé pour honorer la première brise de terre (et voici que son front a grandi sous le casque),
Les mains plus nues qu’à ma naissance et la lèvre plus libre, l’oreille à ces coraux où gît la plainte d’un autre âge,
Me voici restitué à ma rive natale… Il n’est d’histoire que de l’âme, il n’est d’aisance que de l’âme. »
Saint-John Perse. Exil
En février, régulièrement, l’amandier du jardin se couvre de fleurs. En février, chaque année je suis à Bastia. Le jour de la Saint-Valentin, nous fêtons l’anniversaire de maman et puis je reviens à Marseille. Avec au cœur, cette dernière vision. Celle de maman debout sur le pas de la porte, tellement triste, tellement seule. Elle me fait un petit geste de la main, soupire doucement, essaie de sourire et, dès que je disparais à sa vue, retourne à l’intérieur. Alors, alors seulement je laisse couler mes larmes. Jusqu’au rez-de-chaussée où m’attend le chauffeur qui m’emmènera à l’aéroport. Et très vite, je suis à Marseille. Où je décroche mon téléphone pour nos longs monologues quotidiens. Je dis monologues parce qu’elle ne m’entend quasiment pas mais qu’il lui suffit sans doute de me savoir là, au bout du fil qui nous relie. Ensuite je recommence à me plaindre. Car je me plains. Je me plains sans arrêt. Parce que j’abandonne mon arbre qui va fleurir sans moi. Parce que tous ces séjours bastiais vident mon escarcelle. Parce que mon monde s’est rétréci. Finis les voyages à l’étranger, oubliées les escapades italiennes. Parce que, quelle qu’en soit la durée, ma présence est toujours insuffisante et qu’on me le reproche. Et que chacun de mes départs ressemble à une fuite. Parce que maman se parfume trop aussi. Que peut-elle bien faire de tous ces flacons qu’elle me réclame à chaque fois ? Je m’aperçois plus tard qu’elle aime bien en offrir à celles qui lui font compliment de cette aura odorante qui la précède et qui demeure après son départ… Alors, il lui en faut toujours davantage. Et moi, j’acquiesce car je ne sais rien faire d’autre, tout en rêvant que les choses changent. Mais lorsque mes souhaits s’exaucent finalement, je me retrouve dans la nuit. Étourdie de douleur. Consciente d’avoir perdu tout ce qui m’habitait et qui ne reviendra jamais.
C’est en février, un matin un peu froid sur le port, que deux ambulanciers hilares ont emmené maman à l’hôpital de Bastia. Appelés en urgence par le médecin sitôt accouru, Ils se sont fait attendre. Puis, ayant enfin trouvé l’adresse indiquée, ils ont monté l’escalier bruyamment, sont entrés dans la chambre, l’ont installée sur un brancard dans ses vêtements de nuit, les pieds nus je me souviens, la tête dodelinante, le bas du pyjama mouillé. Peut-être ont-ils jeté une couverture sur elle, je ne me souviens plus. Ce dont je me souviens, c’est de la brusquerie. Ils se sont cognés à la porte, ont descendu les trois étages sans ménagement en heurtant les murs et je les ai perdus de vue. Plus tard j’étais à l’hôpital. J’y suis retournée chaque jour jusqu’à son dernier jour. Je l’écoutais se plaindre. Elle voulait rentrer chez elle et je promettais. Je disais plus tard. Elle réclamait de l’eau et n’avait droit qu’à cette boisson gélifiée qu’elle se refusait à avaler. En cachette, car il fallait éviter une fausse route, je lui faisais boire à la cuiller quelques gouttes prises au robinet de la chambre. Mais elle voulait l’eau de son village, celle de sa Funtana Maio. Elle voulait les jours heureux vécus auprès de ses treize frères et sœurs. Elle fermait les yeux et je voyais les mots se former sur ses lèvres. Ses dernières syllabes muettes avant de nous quitter « Ma – man » furent celles – là même qu’elle avait prononcées en premier lorsqu’elle avait commencé à parler.
Lorsque je suis rentrée à Marseille, le printemps s’annonçait, il neigeait au village et j’étais orpheline.
Ce deuil qui me laissait pantelante de douleur ravivait en moi le souvenir du précédent. Ce voyage à Marseille pour une opération qui ne put avoir lieu. Je venais de déménager et habitais provisoirement en centre-ville le septième étage d’un immeuble qui en comptait quelques autres. Maman avait suivi son mari et passait tout son temps à l’hôpital. Je la retrouvais plus tard après une journée de travail où je croyais refaire le monde. Et nous rentrions ensemble. Un soir, ivre de fatigue et de chagrin, elle partit seule. Elle avait les clés, tout lui semblait évident. Sitôt arrivée, elle prit l’ascenseur, appuya sur un bouton et sortit sans se préoccuper de l’étage où elle était parvenue. Perdue, elle sonna à toutes les portes sans comprendre où elle était. Se mit à trembler et resta là, ne sachant que faire. Jusqu’à ce que quelqu’un la guide enfin et lui fasse retrouver le bon étage.
Quelques jours plus tard, voyant qu’il n’y avait plus d’espoir, elle décida malgré le coût de louer un avion sanitaire – le temps pressait – et de ramener son mari à la maison. Ma stupéfaction fut grande lorsque je m’aperçus alors qu’elle ne savait pas libeller un chèque. Le compte était bien à leurs deux noms. Elle ne s’en était jamais servi. Mon père mourut dans son lit quelques jours plus tard. S’en était-il seulement douté ? Ou avait-il fait semblant de croire à un mieux possible ? Toujours est-il qu’il faisait des projets. Là, sur son lit d’hôpital. Bientôt, lui disait-il, bientôt, lorsque j’irai enfin mieux, nous monterons au village nous reposer. Il lui prenait la main, esquissait un pauvre sourire. Et nous y resterons tout le temps nécessaire, ajoutait-il… Belle promesse, car malgré les balades multiples, les champignons de l’automne, la cuisine de la tante Marianne longuement mijotée au-dessus du fucone, malgré l’eau des rivières et les vertus de l’eau minérale de la source d’Orezza… mon père, je l’ai toujours su, n’aimait pas vraiment ce village qui n’était pas le sien.





























