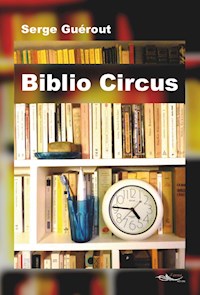
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
D'étranges événements ont lieu la nuit dans une bibliothèque universitaire parisienne. Heureusement, une équipe de scientifiques décide de mener l'enquête.
Que peut donc faire un SDF, à part lire, lorsqu’il squatte les nuits d’hiver le fond d’une salle de lecture dans une bibliothèque universitaire parisienne ? Celui-ci s’intéresse à la vie de Galilée, ayant tiré un ouvrage fort savant au plus près de sa couche. Au petit matin, il quitte les lieux après avoir proprement replié sa couverture entre les étagères et glissé sa brosse à dents entre deux livres. Mais que se passe-t-il lorsque la couverture est retrouvée maculée de sang près des poubelles du bâtiment ? L’homme n’a pas fait que lire, il a aussi regardé par la fenêtre et découvert des choses louches dans les laboratoires d’en face. Par chance, la police ne mettra pas son nez dans cette histoire où les enquêteurs ont nom Einstein, physicien canadien grand amateur de tango argentin, et « Sa Majesté », biologiste polonais à la limite de la clochardise et spécialiste du QI des abeilles. Le bibliothécaire s’appelle évidemment Simon Zebouc et les trois compères dénoueront l’intrigue sans manquer de nouer entre eux une amitié à la fois tendre et pudique, qui est le filigrane de cette histoire cocasse.
Plongez-vous dans un thriller cocasse et découvrez le récit surprenant des activités nocturnes un peu louches qui ont lieu dans la bibliothèque.
EXTRAIT
Ce lundi matin de la fin décembre, tout commença vers neuf heures quand Einstein fit irruption dans son bureau, la porte grande ouverte derrière lui.
« La porte Albert bon Dieu, on se gèle ici ! » lança le bibliothécaire sans hausser le sourcil plus haut que les genoux de son visiteur. Il faut dire qu’avec Marlène Dietrich, Einstein fait partie de ces rares personnes qu’on identifie immédiatement à leurs jambes nues, quoique pas dans le même registre. Si l’Ange bleu avait des jambes de déesse, celles du physicien sont plutôt d’un grand insecte : grêles et poilues, de surcroît tatouées aux mollets d’une feuille d’érable. Comme chaque lundi de décembre à mars, le thermomètre affiche 12 degrés. La faute aux économies de chauffage du week-end et aux fuites béantes autour des fenêtres, bourrées tant bien que mal avec du papier journal. Einstein s’en moque, vu qu’il vient du Canada. En visite sur le campus, il déambule hiver comme été dans un short de grosse toile kaki qu’on dirait tout droit sorti des surplus militaires d’El-Alamein, une chemisette à fleurs soixante-huitarde et des sandalettes monacales.
Ce matin-là, l’homme du grand Nord avait l’air plutôt remonté. Il repoussa la porte du coude et fonça sur Zebouc, perdant une sandale au passage et écartant du pied un carton de livres.
– Simon, cette fois, ça va babiller dans les maisonnettes, dit-il. Oublié, le violoneux en charentaises ! Je démontre noir sur blanc qu’il s’est planté sur toute la ligne.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Serge Guérout a été ingénieur en aéronautique, puis conservateur d’un fonds d’histoire des sciences à la bibliothèque universitaire Jussieu, à Paris. Ancien élève de l’Ecole polytechnique et de Sup’Aéro, il est l’auteur de
Science et politique sous le Troisième Reich (Ellipses), et éditeur scientifique des
Racines sociales et économiques des Principia de Newton, du philosophe russe Boris Hessen. Il a récemment publié un polar aux éditions Jean-Paul Gisserot :
Dernier bridge au Croisic.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Serge Guérout
BIBLIO CIRCUS
« L’univers, avec son élégante provision d’étagères, de tomes énigmatiques, d’infatigables escaliers pour le voyageur et de latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l’œuvre d’un dieu. »
Jorge Luis Borges (La bibliothèque de Babel)
À Jacques, Laurent, Stéphane et les autres.
Prologue
S’il y a une chose que Simon Zebouc déteste, c’est bien les vacances que prend son médecin. Ce moment où un type qu’il ne connaît pas s’arrête sur le seuil de la salle d’attente, la main tendue, referme derrière lui la porte de son cabinet, et après un petit quart d’heure renvoie son stéthoscope derrière sa nuque.
– Rien de grave, un peu d’anémie. Quelle est votre profession ?
– Je m’occupe de livres.
– Ah, libraire !
– Presque.
– Bibliothécaire ?
– Si vous voulez.
– Zebouc… C’est vrai que le nom s’y prête…
Et il continue avec un petit sourire, comme s’il ne doutait pas de l’accord de son interlocuteur avec ce qu’il va dire, ce qu’il ne peut manquer de dire :
– Ah, lire ! Si vous saviez combien j’aimerais passer, moi aussi, mes journées à lire…
Et puis encore, avec un rien d’hésitation :
– Vous ne m’en voudrez pas, bien sûr, mais de vous à moi, je me suis toujours demandé…
– Ce que ça fait, un bibliothécaire ?
– Vous avez deviné.
– Ce n’était pas difficile.
Et ainsi de suite, le dialogue peut se poursuivre un quart d’heure ou plus. Depuis le temps, Simon Zebouc en connaît toutes les variantes possibles. D’ordinaire, il y met fin en collant au toubib son chèque sur le coin du bureau, faute de pouvoir lui coller sa main sur le coin de la figure.
De retour dans la rue, Simon Zebouc passe sa mauvaise humeur sur quelqu’un ou sur quelque chose, ce quelqu’un se trouvant être, fort logiquement, le pharmacien d’en face, et ce quelque chose, parfois, le ballon d’un môme qu’il met rageusement en orbite au-dessus de la maison du potard.
– Le générique vous va ? C’est la même chose, sauf que le nom est imprononçable.
– Pas de problème. Je regarde le film dans la version que vous me proposez.
Le pharmacien ouvre de grands yeux, l’air de trouver que son vis-à-vis est effectivement bien anémié.
– Générique, film, jeu de mots, voyez pas ? Bon, laissez tomber.
Pharmacien, soupire Simon Zebouc, voilà au moins un métier enviable. On ne demande pas à un pharmacien ce qu’il fait de ses journées. Et pourtant, sait-il bien, ce monsieur, que la profession dont il porte fièrement le nom sur un petit insigne au revers de sa blouse blanche a inspiré le personnage le plus sot, le plus prétentieux, le plus plat de toute la littérature française ?
– Vous connaissez, monsieur Homais ?
– Ah, je crains fort que cette personne ne fasse pas partie de notre clientèle.
– Madame Bovary non plus, j’imagine ?
– Le nom de cette dame me dit quelque chose, attendez… oh, mais cela remonte à pas mal d’années…
– Je le crois aussi. Rajoutez-moi donc de l’Aspirine.
C’est ainsi, conclut Zebouc en quittant l’officine. Il y a des professions que l’on brûle de dévoiler à l’apéritif et d’autres qui peuvent avantageusement attendre le dessert, éventuellement une invitation ultérieure. Il y a même des professions dont on ne fait tout simplement pas état, surtout à table. Égoutier, par exemple, ou exécuteur des hautes œuvres. Mais il faut admettre que, s’il existe toujours des égouts, la peine de mort n’existe plus chez nous, alors qu’on y trouve encore des bibliothèques. Celle dont Simon Zebouc s’occupe, sur le campus universitaire Jussieu, existait encore l’hiver dernier, lorsque cette histoire a commencé. Une drôle d’histoire. À croire que, n’en déplaise au toubib, le métier n’est pas de tout repos.
Chapitre 1
Des Arènes de Lutèce, dans le cinquième arrondissement de Paris, jusqu’au campus universitaire Jussieu, il y a environ deux cents mètres et pas loin de deux mille ans. Vue des gradins de pierre du côté de la rue Monge, la tour centrale de l’université fuse vers le ciel comme un mégalithe surgi du futur en une nuit après des joutes nautiques ou un combat de gladiateurs, gigantesque brique noire et lisse, irréelle et menaçante. Si l’on veut en avoir le cœur net, on peut quitter les Arènes par la rue du même nom, on est bientôt sur la place Jussieu. La tour est bien là, gratte-ciel du quartier, avec ses vingt-trois étages dominant un quadrillage de petits bâtiments identiques qui jouxtent des tours rondes. Dans l’espace ainsi dessiné, les carrés d’herbe sont aussi rares que les cases noires d’un mots-croisés bien ficelé.
Jadis, c’est-à-dire tout de même quinze siècles après Lutèce, c’était le fief des marchands de vin de la capitale. Puis, au début du XIXe siècle, la consommation de vin des Parisiens s’envola, il fallut construire une nouvelle halle. À la fin du XXe siècle, on a bu beaucoup moins de vin, mais c’est le nombre des étudiants qui s’est envolé, sans qu’on n’ait pu, à ce jour, relier les deux phénomènes. La Halle aux vins a fait place à un campus universitaire. Il arrive encore aux usagers du campus de dire « la halle aux vins » au lieu de « la faculté des sciences », ce qui peut sembler un lapsus bizarre. Chaque matin, sur la petite place triangulaire plantée de paulownias, un arbre pas si courant dans la capitale, l’escalier mécanique remonte sans discontinuer des milliers de voyageurs qui n’ont qu’une destination : le parvis de la fac en face, avec peut-être un détour pour avaler un petit noir au comptoir des deux ou trois cafés qui font leur pelote grâce à la population de cette ville dans la ville.
Jussieu n’est pas la City, et le look de cette population n’est pas celui des banquiers londoniens. On rejoint rarement son labo, son amphi ou son bureau en costume-cravate, plus souvent en jean, en blouson ou en jogging, ou même dans des tenues plus bizarres encore, mais n’anticipons pas. Suivons plutôt ce jeune homme en duffle-coat beige et grosse écharpe rouge. Il s’appelle donc Simon Zebouc, la trentaine, doublant tout le monde, et va acheter Libé, échanger quelques mots avec le kiosquier, avant de prendre le chemin de la bibliothèque universitaire.
*
Ce lundi matin de la fin décembre, tout commença vers neuf heures quand Einstein fit irruption dans son bureau, la porte grande ouverte derrière lui.
« La porte Albert bon Dieu, on se gèle ici ! » lança le bibliothécaire sans hausser le sourcil plus haut que les genoux de son visiteur. Il faut dire qu’avec Marlène Dietrich, Einstein fait partie de ces rares personnes qu’on identifie immédiatement à leurs jambes nues, quoique pas dans le même registre. Si l’Ange bleu avait des jambes de déesse, celles du physicien sont plutôt d’un grand insecte : grêles et poilues, de surcroît tatouées aux mollets d’une feuille d’érable. Comme chaque lundi de décembre à mars, le thermomètre affiche 12 degrés. La faute aux économies de chauffage du week-end et aux fuites béantes autour des fenêtres, bourrées tant bien que mal avec du papier journal. Einstein s’en moque, vu qu’il vient du Canada. En visite sur le campus, il déambule hiver comme été dans un short de grosse toile kaki qu’on dirait tout droit sorti des surplus militaires d’El-Alamein, une chemisette à fleurs soixante-huitarde et des sandalettes monacales.
Ce matin-là, l’homme du grand Nord avait l’air plutôt remonté. Il repoussa la porte du coude et fonça sur Zebouc, perdant une sandale au passage et écartant du pied un carton de livres.
– Simon, cette fois, ça va babiller dans les maisonnettes, dit-il. Oublié, le violoneux en charentaises ! Je démontre noir sur blanc qu’il s’est planté sur toute la ligne.
Les premières phrases d’Einstein sont généralement incompréhensibles, ce qui n’a guère d’importance car il lui arrive de ressortir aussi vite qu’il est entré. Mais c’est rare. Le mieux est alors de le distraire en posant une question anodine.
« Peut-on savoir qui est le violoneux en charentaises ? », hasarda Zebouc sans quitter des yeux son écran d’ordinateur.
– Mais voyons Simon, Albert ! Mon homonyme, le grand Albert. À propos, moi c’est Nicolas.
– J’aime bien vous appeler Albert, vous devriez être flatté.
– Justement pas. Vous allez comprendre sur ma page internet. Que je te montre…
Ce doit être québécois, cette façon de mélanger le tutoiement au vouvoiement, soupira Zebouc en lui cédant la souris de l’ordinateur. Le physicien s’installa plus commodément sur le coin du bureau, fit disparaître de l’écran le travail du bibliothécaire et tapa d’un seul jet comme un pianiste un trait mille fois exécuté :
« www.einstein-s’est-trompé.ca »
Sa photo apparut en haut à gauche, même tenue qu’aujourd’hui sur fond de cabanes enneigées. Puis quelques confidences personnelles sur la passion de sa vie, le tango argentin, et sans transition des lignes d’équations qu’il souligna pour son interlocuteur de son index bagué d’une tête de mort.
– Comme tu peux le constater, je suis remonté aux fondamentaux afin que tout le monde comprenne, dit-il.
– Bien sûr, bien sûr.
Simon Zebouc n’a jamais rien compris à la théorie de la relativité, mais Einstein en a décidé autrement depuis le jour où il l’a surpris plongé dans une biographie de son homonyme, que le bibliothécaire feuilletait distraitement avant de la remettre en place sur les étagères. Pour le reste, il est donc canadien et, peut-être à cause du patronyme commun, il s’est mis en tête de démontrer que les théories de son glorieux aîné ne valent pas un clou.
Simon fit mine de parcourir l’écran tandis que l’autre allait récupérer sa sandalette au milieu du bureau, puis il leva les yeux sur son visiteur avec une lenteur calculée. Il avait devant lui un grand type mince d’un mètre quatre-vingt-dix au regard fichtrement intelligent, la cinquantaine, barbe grisonnante taillée court, disons Sean Connery en short dans Le Nom de la rose, et sans le capuchon de moine.
– Albert, commenta Zebouc, vous savez que c’est diablement intéressant ce que vous me montrez là. J’avoue que je n’avais jamais envisagé la théorie de relativité sous cet angle, et je compte bien y revenir à tête reposée car je n’ai pas beaucoup de temps ce matin. Mais j’y pense, il faut absolument que je vous présente à Sa Majesté.
– Sa Majesté ? fit le physicien d’un air soupçonneux.
Igor Sydlowski, dit Sa Majesté, est un réfugié d’origine polonaise plutôt désargenté, biologiste de son état, et depuis des années le lecteur le plus assidu de la bibliothèque. Il fait quasiment partie des meubles et ne comprend toujours pas pourquoi on lui présente tant de monde le lundi matin. C’est que, dans ces premiers moments de la semaine, Simon Zebouc ne se sent pas très bavard, et Sa Majesté lui sert commodément de joker pour reconduire les visiteurs qui s’attardent.
« Un type très intéressant, mon cher Albert, et qui ne paye pas de mine, vous verrez, non pas un de ces chercheurs moutonniers qui broutent tous le même carré d’herbe, plutôt un outsider comme vous, ne craignant pas de ferrailler contre les idées reçues. »
« Vous vous entendrez certainement », ajouta-t-il en l’invitant à le suivre.
*
On pénètre dans la salle de lecture par un petit couloir tapissé de thèses de doctorat à la dactylographie pâlie et aux noms d’auteurs calligraphiés sur le dos à l’encre de Chine, fleurant bon le vieux papier. La salle de la bibliothèque proprement dite s’étend toute en longueur, limitée à gauche par une grande baie vitrée d’où partent perpendiculairement les travées successives d’étagères à livres. Contre le mur opposé, on a installé une rangée de consoles d’ordinateurs et des présentoirs pour les revues scientifiques. Dans l’espace restant, bien mince en vérité, sont disposées une demi-douzaine de petites tables pour les lecteurs.
Et puis, il y a le fond de la salle, mais le fond semble si loin… À croire que les lieux se sont divisés d’eux-mêmes en deux espaces : il y a le devant, où il se passe des choses et où il passe du monde, et le fond où personne ne va et où il ne se passe rien. Du coup, on y a remisé toutes les tâches qu’on se réserve pour plus tard : les étagères tordues qui ne se montent plus qu’à coups de marteau, les livres à classer, généralement inclassables, les cartons de revues scientifiques léguées par la veuve d’un grand universitaire, généralement irremplaçable, sans compter le mobilier cassé à évacuer et, dieu sait pourquoi, les livres sur la vie des savants.
Bien sûr, cela fait désordre, mais quoi, a-t-on jamais poussé la porte des réduits de toute sorte dans les études de notaires, les abattoirs volaillers du Maine-et-Loire ou la gare TGV de Paris-Austerlitz ? Il en va de ces arrière-cours comme des eaux mortes dans les rivières : tout s’y accumule avec le temps, et le temps prend son temps, digère tout et vous fait comprendre à la longue qu’il est chez lui, alors on n’y va plus voir.
*
Les lecteurs, ce lundi matin, ne se bousculaient pas. Seul, Sa Majesté était arrivé dès l’ouverture des portes. Il avait dû, selon un rituel identique, gagner sa table habituelle, étaler son manteau de gros drap sur le dossier de sa chaise, et tirer d’un sac Tati en plastique des liasses de paperasses froissées et maculées de taches de graisse, le fruit de ses travaux des dernières années. Igor Sydlowski est un chercheur prolifique et, pourrait-on dire, un travailleur manuel que la révolution informatique a épargné. Jour après jour, il rédige avec un gros crayon noir des articles scientifiques qui ne trouvent place dans aucune revue de sa discipline, puis il les envoie à la Bibliothèque nationale de France, où leur trace se perd. À midi pile, il interrompt son labeur et casse deux œufs durs sur le bord de son siège, qu’il mange en tournant en rond entre sa table et le photocopieur. De temps à autre, il se penche par-dessus sa chaise pour apporter une correction à son travail, de sorte que son manteau, étalé en éventail sur le dossier, se retrouve constellé de débris de coquille ou de jaune d’œuf, comme autant de fleurs de lys brodées sur le drap sombre. D’où le surnom qu’il s’est acquis auprès du personnel. Le soir, Sa Majesté remballe à regret tout son fourbi, et Simon Zebouc a bien du mal à le pousser vers la sortie.
« Monsieur Sydlowski, claironna le bibliothécaire dans son dos, permettez-moi de vous présenter Einstein. »
L’autre se leva et cassa sa petite taille d’une brève inclinaison du buste. Une abeille ornait le devant de son T-shirt passablement effiloché, un bourdon noir le dos, les ailes déployées comme sur le blouson d’un motard. Cheveux en escaliers sur la nuque, comme coupés de la veille par un voisin de palier, il avait des mains fines de pianiste et un regard humble, presque fuyant, mais ce regard plongeait parfois dans le vôtre et vous mettait mal à l’aise, comme si on y découvrait, l’espace d’un instant, des choses qu’on ne voit pas souvent dans le regard des autres. Les deux scientifiques se jaugèrent brièvement, tandis que Zebouc s’éclipsait sans demander son reste. Que peuvent bien avoir à se raconter, s’interrogeait-il chemin faisant, un physicien spécialiste de la théorie de la relativité et un biologiste qui étudie le QI des abeilles ? L’échange de politesses qui parvint à ses oreilles un petit quart d’heure après les présentations eut tôt fait de l’éclairer sur la question :
– Non mais dites donc, Einstein de mes deux !
– Ah, mais permettez, espèce de petit apiculteur de merde !
Se pouvait-il que l’esprit de l’Encyclopédie se soit perdu dans ces murs au point que la physique et la biologie aient de nos jours si peu à se dire ? Il repoussa sa chaise et se hâta vers la salle de lecture. Entre les tables désertées par les autres lecteurs, Sa Majesté se traînait à quatre pattes sur le sol, portant Einstein sur son dos comme il aurait promené son petit-fils, sauf que le cher petit lui martelait le crâne avec méthode, un gros volume des Philosophical Transactions entre ses mains solides de bûcheron canadien.
« Einstein, lâchez ce bouquin tout de suite ! », ordonna Zebouc en s’arrêtant à trois pas, inquiet d’en prendre un coup, lui aussi.
– Simon, ce clochard de la recherche s’est permis de…
– Je ne veux pas le savoir. La reliure des Philosophical Transactions nous a coûté une fortune et vous êtes en train de la déglinguer.
Sa Majesté s’en prit un dernier coup vengeur et redressa prudemment la tête, l’air un peu sonné. Simon Zebouc l’aida à se relever et lui colla son royal manteau sur les épaules, histoire de restaurer sa dignité. Quant au physicien, il s’était assis à l’écart sur le coin de la table et feuilletait sur ses genoux nus le gros livre qui venait de lui servir de matraque, ses sandalettes dépassant sur une chaise. Il semblait soudain très absorbé.
« Philosophical Transactions, année 1934, murmura-t-il, il y avait un article d’un certain Robson sur le sujet, j’en suis sûr, ou peut-être Hobson… »
Sa Majesté lui lança un regard mauvais.
Manifestement, l’homme des abeilles attendait des excuses, mais le physicien s’exclama soudain :
« Simon, regardez ! Tome 234, année 1934 : « Could Einstein’s theory be wrong ? ». On osait encore l’écrire, à cette époque-là. Le grand Albert s’est planté, vous dis-je, sa théorie ne vaut pas un clou ! Votre Majesté, ajouta-t-il à l’intention du biologiste encore groggy, je suis confus. Sans notre rencontre, ce gros livre ne me serait pas tombé opportunément entre les mains. »
Igor Sydlowski, qui voyait sans doute les choses autrement, se frottait le crâne en grimaçant de douleur.
« Bien entendu, Majesté, nous déjeunons ensemble », reprit Einstein.
C’est ainsi qu’ils se connurent. Et dans un spectacle touchant de la fraternité retrouvée du savoir, le biologiste partagea à midi ses œufs durs avec le physicien. Ils avaient soudain tant de choses à s’expliquer l’un à l’autre qu’on ne comprenait pas comment ils avaient pu s’ignorer des années durant. Plus royal que jamais, le manteau de Sydlowski encadrait ses épaules étroites, son pantalon retombait en accordéon sur ses Adidas en bout de course, cependant que le short sans couleur d’Einstein, les poches gonflées par deux oranges achetées à la cafétéria de la fac, lui prêtait, vu de dos, un petit air de printemps à Roland Garros.
La température dans le bureau de Simon – un acteur majeur des lundis hivernaux sur le campus – redémarrait comme lui la semaine lentement. En milieu d’après-midi, elle avait passé les quinze degrés et le soir venu, il faisait presque bon, dix-huit degrés, un maximum pour la saison. En quittant la bibliothèque, Simon Zebouc retrouva les deux compères sur le parvis du campus. Ils semblaient devenus inséparables, vivants symboles de l’hiver et de l’été cheminant côte à côte. Einstein pédalait au ralenti sur un vélo d’enfant dont il heurtait le guidon de ses genoux nus, Sa Majesté trottinait près de lui, son manteau gonflé par la bise de décembre, une main tenant les gros sacs Tati bourrés à craquer de vieilles fringues et de science, l’autre massant discrètement son occiput si durement touché par le tome 234 des Philosophical Transactions. Longtemps après, en recherchant l’origine des choses, Simon se demanderait quelle idée l’avait pris de les inviter à boire un café sur la place Jussieu. Comme s’ils avaient quelque chose à discuter tous les trois. Ou était-ce le pressentiment que cela n’allait pas tarder à venir ?
*
C’est le lendemain que Simon Zebouc trouva la couverture au fond de la salle. Pliée en quatre, elle servait de coussin à Einstein assis en tailleur entre les deux dernières travées d’étagères, celle des vies de savants et des vieux téléphones au rebut.
« Albert, dit le bibliothécaire irrité, je sais bien que l’université n’est pas riche, mais nous avons quand même des tables et des chaises. »
Le physicien renfila ses sandalettes et plaida que la couverture était déjà là. Il s’était assis dessus pour rester près des livres.
– C’est votre faute aussi, ajouta-t-il, pourquoi fourrez-vous les biographies des savants au fond de la salle, parmi tout ce fourbi ? D’ailleurs la brosse à dents n’est pas à moi.
– La brosse à dents ? Quelle brosse à dents ?
Einstein prit encore quelques notes et lui désigna sans un mot, sur l’étagère inférieure, une brosse aux poils écrasés et un tube de dentifrice dans un verre en plastique, d’où pointait également un bouquet de crayons et un coupe-papier. Zebouc considéra les cartons éventrés, l’entassement de vieux Minitels, les étagères naufragées, et cette brosse à dents insolente à ses pieds qui semblait dire : « pourquoi pas moi ? »
« Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire, marmonna-t-il, vous pouvez vous lever une minute ? »
Le Canadien déplia sa grande carcasse, découvrant une couverture de gros drap gris foncé, genre chambre de caserne ou asile de nuit, plutôt malodorante. Dans un angle était cousue une étiquette portant la mention Entraide Saint Martin. C’est alors qu’un grognement d’aise monta du coin du réduit.
– Et ce chien ? s’étrangla le bibliothécaire, que fait ce chien à roupiller derrière ces cartons ?
– Mais je n’en sais rien, moi, je pensais que c’était le vôtre !
– Je suis bibliothécaire, Albert, pas vétérinaire. Cette salle est supposée héberger des livres, pas des chiens.
L’animal, un bâtard de labrador et d’épagneul à la robe indéfinissable, considérait les deux intrus avec étonnement, visiblement pas habitué à recevoir de la visite. Pris d’une idée, une malencontreuse idée, Simon Zebouc regagna la moitié habitée de la salle, où Sa Majesté écrivait fébrilement.
« Monsieur Sydlowski, dit-il, pouvez-vous m’expliquer d’où sortent la couverture, la brosse à dents et le chien, que je viens de trouver au fond de la bibliothèque ? »
L’autre le suivit docilement, avisa le spectacle, et se retourna, visiblement offensé :
– Monsieur Simon, quoi qu’en dise Einstein, je ne suis pas un SDF !
– Ce chien n’est tout de même pas venu ici tout seul. Et la brosse à dents encore moins.
– Et pourquoi m’appartiendrait-il, à moi plutôt qu’à un autre ? À Einstein, tenez, ils s’entendent comme larrons en foire.
Entretemps, Einstein s’était rassis et le clébard s’était installé sur la couvrante, son museau posé sur le short du physicien qui le caressait distraitement en feuilletant un livre. Sur le T-shirt de Sa Majesté, l’abeille commençait à faire les gros yeux.
« C’est-à-dire, bafouilla le bibliothécaire, je pensais… les œufs durs, les sacs Tati, les Adidas, votre éternel manteau un peu, comment dire, un peu… Je sais bien que dehors il gèle à pierre fendre… »
Igor Sydlowski le regardait, l’air peiné.
– Ah, ben voilà, dit Einstein en se penchant en avant, je me disais aussi…
– Quoi ?
– Les croquettes et l’écuelle d’eau. Il fallait bien qu’elles soient quelque part. Il les glisse derrière ce tas de machines à écrire avant de quitter les lieux.
– Qui ça, il ?
– Mais… le SDF qui dort chez vous ! Ou voyez-vous une autre explication à la présence de cette couverture, de cette brosse à dents et de ce chien au fond de votre salle ?
Il apparut qu’il n’y en avait guère, ou s’il y en avait une, elle semblait plus compliquée encore que la théorie de la relativité. Simon suggéra pourtant la femme de ménage, ajoutant que des tas de gens viennent travailler avec leur animal de compagnie, mais l’intéressé secoua les oreilles avec véhémence et le bibliothécaire n’insista pas. Einstein fit remarquer que le squatter – il fallait bien l’appeler par son nom – avait étendu sa couche au plus près des livres, et en conclut qu’ils avaient affaire à un esprit curieux. « Ce type s’intéresse à la vie des savants, dit-il. J’ai trouvé une Vie de Galilée glissée entre les plis de sa couvrante, un bon bouquin. Je l’ai remis en place sur les étagères. »
« N’empêche que cette couverture pue très fort », dit Simon Zebouc.
La bonne odeur des livres s’en était retirée de deux ou trois travées. Pourtant, le vasistas était demeuré entrouvert. Le visiteur quittait donc les lieux le matin en aérant sa chambre. Dans le verre en plastique, le tube de dentifrice n’avait pas été pressé n’importe comment, mais replié soigneusement de l’extrémité jusqu’au milieu. C’est bête à dire, mais cela rendait le bonhomme sympathique.
*
Un long rot sépulcral déchira le silence nocturne de la bibliothèque.
Yvon Le Floch, dit Quintefloche à cause de sa toux interminable de fumeur, se retourna sur sa couche, qu’il avait tirée hors d’un rayon de lune, et il se demanda s’il se rendormirait ou s’il continuerait à lire la vie de ce barbu au regard triste, « Galileo Galilei dit Galilée », « né à Pise le 15 février 1564, de Vincenzio Galilei, musicien et commerçant, et de Giulia Ammannati di Pescia ». Un brave type, ce Galilée, songeait Quintefloche, soutien de famille la moitié de sa vie, ribambelle de frères et sœurs, les dots des sœurs surtout, un vrai problème, « pour faire face à cette obligation, il se vit contraint de demander à la république de Venise une avance représentant deux ans de son salaire ». Rien que ça, s’étonnait-il, elle était bien sympa, la république de ce temps-là. De nos jours, vous pouvez toujours demander à votre patron deux ans de salaire d’avance pour faire un cadeau de mariage à votre frangine, je vous laisse deviner la réponse. Deux dots de ce calibre par les temps qui courent, il n’en faut pas beaucoup plus pour basculer dans la cloche. Et le Galileo Galilei, une fois SDF, qu’aurait-il fait de mieux que lui, Yvon Le Floch, front dégarni et barbe au carré lui aussi, quasiment son sosie sur la couverture du livre, oui, cela le rassurait de découvrir que son lointain aïeul, qui sait, en avait bavé comme lui un paquet d’années, « transformant son propre logis en une sorte de pension pour étudiants, quinze à vingt, auxquels il donnait des leçons presque quotidiennes ». Eh, dis-moi, Galilée la galère, à quoi ça t’a servi d’être un génie, si c’est pour avoir les mêmes emmerdes que tout le monde ?
Quintefloche s’en fut aux toilettes pour en avoir le cœur net. Il se planta devant le miroir, le bouquin à bout de bras, et se répéta que le look familial n’avait pas beaucoup changé en quatre siècles. « Galileo Galilei dit Galilée » ! Tu parles d’un blaze ! S’il suffit de répéter trois fois son nom pour être un génie, il peut en faire autant. Il verrait bien « Flochi Flocha dit Le Floch », et quant à dessiner la lune comme l’a fait son ancêtre, il est plutôt bien placé vu que, d’ordinaire, il n’a pas de toit au-dessus de la tête. Qu’est-ce qu’un SDF, à bien y réfléchir, sinon un astronome qui s’ignore ?
Peu après minuit, la porte de la bibliothèque fut poussée sans ménagements vers l’intérieur et le chariot d’ustensiles de la femme de ménage se profila dans le couloir d’accès à la salle de lecture. Quintefloche apaisa son chien de la main et se renfonça prudemment entre les travées d’étagères. Son dos lui cuisait encore des coups de balai de la nuit précédente, quand il avait essayé de l’entraîner dans sa chambrette du fond. Comme la nuit précédente, elle parqua le chariot dans les toilettes et quitta la bibliothèque sans même donner un coup d’aspirateur. Alors Quintefloche se cala plus commodément entre deux travées de livres et il attendit l’autre visiteur, celui du petit matin.
Chapitre 2
Il faudrait maintenant sauter quelques semaines. Quatre exactement, qui encadrèrent les vacances de Noël, et durant lesquelles Yvon Le Floch, dit Quintefloche continua sa lecture nocturne de la Vie de Galilée au fond de la bibliothèque.
Simon Zebouc s’en apercevait le matin à d’infimes détails. La couverture, toujours impeccablement pliée, glissait simplement de Lavoisier à Darwin, le verre à dents changeait d’étagère, bref l’hôte de ces lieux lisait beaucoup et déplaçait sa couche au gré de ses lectures. La vie des grands savants l’attirait visiblement, avec un penchant marqué pour Galilée sur l’étagère inférieure, sa table de nuit en quelque sorte. Sur la même étagère, Quintefloche inclinait la grosse pendule ronde de la salle qu’il décrochait du mur en arrivant. Il rapatriait aussi les crayons et le coupe-papier qui voisinaient dans le verre avec sa brosse à dents.
– Bizarre, s’étonna un matin Sa Majesté en louchant sur la pendule que Simon raccrochait au-dessus du bureau de prêt, d’ordinaire les clochards se moquent bien de savoir l’heure qu’il est.
– Peut-être pour penser à déguerpir avant l’ouverture de la bibliothèque, hasarda Zebouc, qui venait de reconduire le chien sur la place Jussieu auprès d’un trio de clodos qui semblaient le connaître.
– Peut-être.
Les jours et les nuits passèrent. Le mystère demeurait entier. Quand ils croisaient Simon, Einstein et Sa Majesté ne manquaient pas de lui demander « où il en était avec son SDF ». Le bibliothécaire répondait qu’il n’en savait pas plus qu’eux, ajoutant un jour qu’il comptait interroger la femme de ménage, un témoin idéal puisqu’elle nettoyait la salle tard le soir ou très tôt le matin.
Sa Majesté protesta aussitôt :
« Interroger la femme de ménage ? Mais monsieur Simon, vous n’y pensez pas ! Vous n’allez tout de même pas trahir ce pauvre bougre auprès de votre analphabète serbo-croate. Elle en parlera aussitôt aux types de la sécurité, et il va se faire expulser, c’est couru d’avance. »
Il convient d’expliquer ici que « l’analphabète serbo-croate », comme il la nomme, est l’ennemie jurée de Sa Majesté depuis le soir où, s’étant éloigné de sa chaise pour satisfaire un besoin naturel, il l’avait arrêtée in extremis à son retour alors qu’elle s’apprêtait à faire glisser, d’un geste large du bras, ses travaux du jour dans un grand sac-poubelle calé contre le bord de la table.
« Monsieur Sydlowski, dit Zebouc, ce n’est pas parce qu’elle porte un foulard sur la tête qu’elle est serbe ou croate. Et si vous ne laissiez pas traîner vos coquilles d’œuf à côté de vos manuscrits, ils y gagneraient en respectabilité. »
« Au fond, il ne gêne personne, ce type, observa un jour Einstein. Pourquoi aller lui chercher querelle ? »
« Ce bougre », « ce type », « notre pensionnaire », « notre hôte », bientôt « Galilée » tout court, lia donc Einstein, Sa Majesté et Simon Zebouc dans un secret commun. Ils étaient tout à la fois curieux de le connaître et attentifs à ne pas le déranger, ne parlant de lui qu’à la dérobée, et toujours avec une extrême pudeur. Il arriva même au bibliothécaire de garder le chien dans son bureau pour la journée, ne manquant pas de le sortir à l’heure de midi pour un petit pipi dans le quartier, après quoi l’animal était ramené au fond de la salle derrière les vieux Minitels, attendant son maître. Un soir, Simon surprit Sa Majesté déposant avant de partir un œuf dur sur la couverture pliée, comme on glisserait une soucoupe de lait pour un hérisson nocturne, et il eut bien du mal, le lendemain, à dissuader Einstein de noter sur un papier glissé dans la biographie de Galilée l’adresse de son site web « www.einstein-s’est-trompé.ca ».
– Il s’intéresse bien à Galilée, se défendit le physicien, pourquoi pas à Einstein ? Sans compter qu’il a des accès à internet gratuits dans la salle, et toute la nuit. Il ne peut que s’instruire en lisant mon point de vue sur la question.
– Je ne dis pas le contraire, Albert, répondit Zebouc, mais pour être franc avec vous, je ne crois pas que son problème premier dans la vie soit de savoir si la théorie de la relativité est vraie ou fausse.
Ainsi se distribuèrent les rôles. Sa Majesté voulait le nourrir, Einstein le cultiver. Simon Zebouc, qui hésitait sur le sien, porta la couverture au pressing, se disant qu’il devait d’abord veiller à ce que la salle de lecture n’empestât pas comme une chambrée de bidasses.
Le teinturier tint l’objet du délit à distance, et marmonna à son intention en respirant à l’économie : « Vendredi soir après 17 heures ». Simon s’assura que la boutique était vide et se pencha au-dessus du comptoir, faisant valoir qu’il aurait préféré le soir même avant 17 heures. « Vous comprenez… nous sommes en janvier, et je n’en ai pas d’autre. »
Le type le jaugea du regard, hocha la tête et ajouta qu’il ferait de son mieux. Zebouc regagna la bibliothèque où Sa Majesté le prit à l’écart.
– Monsieur Simon, il y a une chose que je ne comprends pas, dit le biologiste.
– Quoi ?
– L’alcool. Le vin. Tous les clochards boivent leur litre ou deux, c’est un minimum. Le fond de votre bibliothèque devrait sentir la vinasse.
– Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais je vous fais remarquer qu’il ouvre le vasistas avant de partir. Ceci peut expliquer cela. Un type délicat.
Délicat, Galilée l’était sûrement. Au point que l’ovoïde uniformité du menu royal commença bientôt à le lasser. Trop poli pour laisser l’œuf dur intact sur sa couverture repliée, le SDF astronome le faisait disparaître où il pouvait, dans le dernier tiroir du bureau de prêt, celui qu’on n’ouvre jamais, ou dans des endroits plus insolites encore.
« Ton oiseau de nuit a pondu dans le photocopieur », annonça un matin à Simon Zebouc son collègue Franck. Mal réveillé, Zebouc loucha vers la machine, tandis que l’autre continuait :
– Il a déposé son œuf dur dans le compartiment à papier. C’est un peu gênant parce que les lecteurs savent où est la réserve de papier, et rechargent la bécane eux-mêmes quand je suis occupé ailleurs. Si tu veux mon avis, on va bientôt passer pour une bibliothèque de dingues.
– Vous voyez, Simon, vous voyez ! renchérit Einstein, qui n’en manquait jamais une d’accabler Sa Majesté, son œuf dur, il ferait mieux de se le coller…
Dit plus poliment, il fallait bien admettre que, si l’offre culturelle était dans ces murs plus que variée, les œufs durs à la Sydlowski, en revanche, pouvaient bien lui peser à la longue. Convaincre Sa Majesté de suspendre ses rations de survie demanda de la part de Zebouc un peu de diplomatie. « Juste un moment, monsieur Sydlowski, l’affaire de quelques jours, le temps que l’appétit lui revienne. »
Un brin déçu, le biologiste proposa de remplacer l’œuf dur par un petit pot de miel de ses meilleures abeilles.
– Celles qui ont un QI de 190 ? ricana Einstein, le pauvre homme, je le plains.
– Franchement Sydlowski, dit le bibliothécaire, je préférerais éviter cette forme de ravitaillement. Je respecte beaucoup les abeilles surdouées, ce sont seulement leurs secrétions qui me gênent. Le miel liquide est l’ennemi des livres, voyez-vous, pas tout à fait comme le feu ou l’eau mais presque. Cela s’enseigne dans les écoles de bibliothécaires. À côté du miel, vos œufs durs sont une bénédiction pour nous, bien cuits et sans mayonnaise, j’entends, jamais de mayonnaise dans ces murs, même en tube !
Sa Majesté acquiesça, l’air désolé. Simon Zebouc se demanda de quoi serait fait le menu de son SDF pour le jour à venir. Mais le lendemain soir, la question ne se poserait plus.
*
Ce lendemain de la fin janvier, vers neuf heures du matin, Simon Zebouc tomba en arrêt sur la couverture abandonnée au rez-de-chaussée, en tas au pied de l’ascenseur.
Il la retourna et la découvrit maculée de taches d’un rouge sombre. À côté d’elle, on trouvait le bric-à-brac ordinaire des objets au rebut prêts à partir pour la benne de décharge : chaises cassées, vieux portemanteaux, classeurs à glissières d’un autre âge. Il n’attendit pas l’ascenseur, gravit les quatre étages à la hâte et se précipita vers le fond de la salle. Entre les deux rayonnages dévolus aux vies des savants, les quelques mètres carrés de linoléum demeurés libres au milieu des vieux cartons étaient nets, trop nets même, comme si on y avait passé une serpillière ou un torchon quelconque. Dans les travées voisines, en revanche, le sol était poussiéreux comme à l’accoutumée. La Vie de Galilée et la brosse à dents avaient glissé sous l’étagère inférieure, où le bol de croquettes avait éparpillé son contenu. Le chien était invisible. Pensif, le bibliothécaire retourna le petit livre entre ses mains. Des pages s’en détachaient d’elles-mêmes, il dégageait une odeur de tabac froid et une large tache de café dessinait à une fin de chapitre un continent incertain. « Encore un bouquin bon à jeter », marmonna-t-il machinalement. Et il se fit la réflexion que les livres des bibliothèques sont comme les jeunes filles des salles de bal de nos grand-mères : il y a ceux qui sont très demandés et ceux qui ne le sont jamais.
La dernière page était barbouillée de coups de tampon, souvenir du temps jadis avant l’ordinateur, comme un premier carnet de rendez-vous. La Vie de Galilée était manifestement passée en de nombreuses mains, et il en restait des annotations de toutes sortes, certaines savantes, d’autres beaucoup moins. La page blanche précédant le titre avait accueilli les adresses et les heures de rendez-vous que se donnent les étudiants, leur nombre ayant explosé depuis l’usage des téléphones portables. Simon recopia le tout sans trop y croire, puis il se pencha sur un marque-page assez sale qu’il supposa laissé par son squatter : un feuillet arraché d’une éphéméride de bureau et daté du 25 janvier, il y avait donc cinq jours. Il reconnut bientôt qu’il provenait de l’éphéméride du bureau de prêt, y ayant lu, noté de leur main, le nom de deux de ses collègues.
Zebouc regagna la partie peuplée de la bibliothèque, où Franck venait de tomber son cuir de vieux syndicaliste en manif, l’Huma déjà chiffonnée dépassant de la poche.
– Salut, Franck ! Pas encore vu Sa Majesté ?
– Apparemment, Sa Majesté ne s’est pas réveillé. Toute cette histoire de SDF doit le perturber.
– Mets-toi à sa place : un intellectuel un peu clodo qui rencontre un clodo un peu intellectuel, de quoi vous brouiller les frontières.
Le bibliothécaire désigna l’éphéméride sur le bureau :
– Vous arrive-t-il parfois d’arracher des feuillets des jours passés ?
– Jamais. Il nous sert à la fin du mois pour savoir comment on s’est réparti les permanences au bureau de prêt.
À en croire l’ordinateur, la Vie de Galilée avait réintégré son étagère trois mois auparavant et le livre n’avait pas été prêté depuis. Galilée le SDF n’avait donc pu se l’approprier avant le début d’octobre. Simon feuilleta l’éphéméride à rebours et vérifia que la page du 25 janvier en avait bien été arrachée. Puis il continua distraitement à remonter le temps du bout de l’index et trouva quatre autres jours manquants sur le bloc de l’année passée, échelonnés de la fin octobre au 20 décembre, veille des vacances universitaires.
– Il faudrait retrouver ces quatre feuillets de l’année dernière, dit-il à Franck.
– Pas simple. Tu veux en faire des cocottes en papier ?
– Galilée a bien pu les arracher du bloc. Au fait, il a disparu. Je veux dire : Galilée. Tout indique qu’il s’est fait virer manu militari du fond de la salle. Mais par qui, voilà la question. Et pour échouer où ? Mystère. Il nous reste son bouquin de chevet et un marque-page daté du 25 janvier. Je voudrais retrouver les autres et savoir ce qu’il y notait. Sa Majesté trouve bizarre qu’il ait décroché la pendule pour la garder près de lui sur sa couverture. Avait-il besoin de connaître l’heure exacte au milieu de la nuit ?
– Va savoir. Il pointait peut-être le passage des constellations, comme son ancêtre.
Au verso, le marque-page était rempli de chiffres et d’heures maladroitement griffonnés, séparés par des barres obliques dans un rébus incompréhensible. Un groupe de quatre chiffres figurait en marge, entouré au crayon rouge.
– 3257, lut-il. Tu veux bien appeler ce poste téléphonique ? Je me demande qui il pouvait bien connaître sur ce campus…
Franck fut d’avis qu’il n’y connaissait personne, mais qu’il avait certainement, la nuit, des besoins très terre-à-terre.
– Tiens, à ton avis, comment faisait-il quand il avait envie de pisser ? demanda-t-il à Simon avec un clin d’œil.
– Quel rapport ? Je suppose qu’il traversait la salle et utilisait nos toilettes.
– Et voilà ! Il traversait la salle et utilisait nos toilettes. Et que lui arrivait-il quand il passait au niveau du pilier central ?
– Comment veux-tu que je le sache ?
– L’alarme, Simon ! Une sonnerie à vous déchirer les tympans, et les vigiles sur le râble dans les cinq minutes. Sauf s’il avait pris soin de composer le 3257 pour la désactiver. Tu saisis ? 3257, ce n’est pas un poste téléphonique, c’est le code de l’alarme.
Le bibliothécaire haussa les épaules. Un SDF, donc. Un intellectuel, sans doute. Un original, sûrement. Se pouvait-il qu’il soit venu lire durant la journée ? Des visiteurs originaux, la bibliothèque n’en manquait pas. Le pickpocket de service ? Mais non, celui-là dormait dans une chambre d’hôtel, du côté des Halles. Un fidèle. Toujours le même depuis des années, guettant les vestons des lecteurs sur les dossiers de chaise en feuilletant trop distraitement des revues scientifiques sur les présentoirs. Dès qu’il l’avait repéré, Franck lui envoyait de loin un petit salut amical, l’autre remettait docilement en place la revue qu’il avait en main, et s’éclipsait avec un sourire gêné en guise d’au revoir. Les lecteurs pas nets, Franck avait fini par les repérer au moyen de sobriquets dont il baptisait l’un ou l’autre, et qu’il calligraphiait au-dessous de caricatures croquées dans un cahier d’écolier.
« Ton trombinoscope ! s’exclama Zebouc en claquant du poing dans la paume de sa main. S’il s’est pointé durant la journée, tu l’auras forcément dessiné. Il ne ressemblait sûrement pas à tout le monde. »
*
Franck a un vrai coup de crayon. Malheur au lecteur qui exhibe le moindre tic, même caché. Franck n’a pas son pareil pour forcer le trait. Quand on le surprend le visage fermé et les lèvres minces, une main traînant, comme oisive, sur son cahier d’écolier ouvert à une page blanche, on peut être sûr que sa paume cache un bout de crayon, et qu’il tient sa proie. Il l’exécute en quelques minutes, il y a du lion en lui, et lorsqu’un sourire adoucit ses traits, on sait qu’il a trouvé le sobriquet adéquat. Le voilà repu. Les mots le détendent, particulièrement les jours de mauvais temps.
Ces dernières semaines, Franck n’avait pas ouvert son cahier. Bougon, il étala L’Huma sur le radiateur électrique d’appoint et, suçotant son crayon, lança un regard désappointé sur les quelques lecteurs présents dans la salle, tous d’une affligeante banalité d’allure et de manières. Simon lui adressa un sourire compatissant. « Ils ne peuvent pas tous ressembler à Einstein ou à Sa Majesté », consola-t-il son collègue.





























