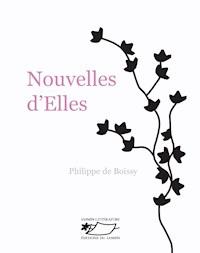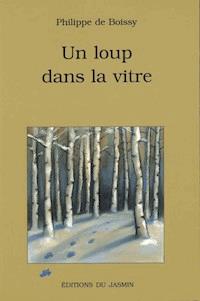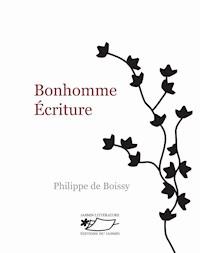
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Jasmin
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L’apprentissage de la langue, de la littérature, du monde enfin, conduit l’auteur de l’école à son destin d’écrivain.
D ’un trait léger et profond, Philippe de Boissy écrit son enfance, sauvée par l’écriture. Ce Bonhomme Écriture traverse la vie avec une force qu’il doit au pouvoir des mots entendus puis mis en pages, calligraphiés ou dessinés, ces mots qui permettent d’apprivoiser les peurs, de séduire, d’exprimer ses sentiments, de survivre en toutes circonstances. Une naissance à l’écriture, grâce à deux maîtres extraordinaires. L’apprentissage de la langue, de la littérature, du monde enfin, conduit l’auteur de l’école à son destin d’écrivain.
Découvrez un ouvrage dans lequel Philippe de Boissy écrit son enfance, sauvée par l'écriture.
EXTRAIT
La semaine suivante, M. Nicolas me fait dessiner la vraie vedette de la marine, traversant la rade de Toulon. Mais avant, il me demande de donner un titre à mon dessin écrit la semaine précédente. Il me demandait toujours des choses impossibles. Je lâche : Le bateau. Mieux que ça ! J’ajoute : Le bateau au salon. Bateau au NON ! Mieux que ça ! Bateau dans un salon. Oui ! Mieux que ça ! Bateau dans un salon en été. Bateau de Noël au salon. Bateau en mer au salon. Tapis de vagues et barque. Salon fenêtre et barque blanche. Je passe de l’angoisse à la trouvaille, et de la trouvaille au délire. J’écris en colonne des phrases où je mélange tout exprès. Salon à tribord de la mer. Barque à la cloche d’accostage. Coup de roulis dans un fauteuil. Fenêtre ouverte sur un tapis. Tapis de mer pour vedette.
Alors je vais dans le n’importe quoi. Bateau à quai sans maman. Le Pacha entre au salon. Georges Leygues sort de la maison. Je nage plus vite que ma mère. Alors il part vers le fond de la classe, les bras levés, sans que je sache s’il m’approuve encore. Il revient vers moi et conclut en souriant : On s’arrête. Tu dis n’importe quoi maintenant, mais c’est pas mal. C’est pour tout le monde pareil.
II prend ma liste et mon dessin, relit quelques titres, et me lance : Je l’aime bien, ta chaise-bateau. Allez, au travail. Je m’y mettais volontiers. Mais toujours dans l’espoir qu’une fois passé l’orthographe, l’accord des verbes, le foutu accent grave sur le a, et parvenu à rédiger des phrases cohérentes que je savais relire avec bonheur, nous déboucherions sur ces plages d’invention où tout était permis, sauf le délire. Mais c’était quoi, le délire, et ça commençait où ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Écrivain, peintre et poète,
Philippe de Boissy habite une ferme en Isère. Il a publié une trentaine d'ouvrages : poésies, nouvelles et romans, aux éditions Flammarion et dans des revues (NRF, Esprit, Sud…). Il a obtenu la bourse Guy Levis Mano de poésie en 1985, avec la publication de
La Lampe sous le boisseau. Il a été instituteur, professeur d'anglais et animateur chargé de la littérature à la Maison de la Culture de Grenoble, où il crée des ateliers d'expressions écrites en 1972, puis des ateliers d'écriture en 1974. Il lance en 1981 le Centre de création Littéraire de Grenoble, qui éditera plusieurs ouvrages de poésie, des nouvelles et des livres d'histoire dans la série « Modestie de l'Histoire ». En 2004, il reçoit le prix de poésie Charles Vildrac de la Société des Gens de Lettres pour son recueil
Jubilations du désert, aux Éditions du Jasmin. Lecteur à voix haute, il enregistre entre autres
Le Silence de la mer de Vercors. Il travaille actuellement sur des contes, et un récit :
L'enfant de ma tête (à paraître aux Éditions du Jasmin).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Du même auteur
DU MÊME AUTEUR
AUX ÉDITIONS DU JASMIN
Littérature
Nouvelles d’Elles,JASMIN LITTÉRATURE, 2012
Poésie
Petite suite des choses, 2009 (poésie)
Ça saute aux yeux, 2006 (poésie)
Jubilations du désert, 2003, Prix de poésie Charles Vildrac
de la Société des Gens de Lettres
Littérature pour la jeunesse
L’enfant de ma tête, récit autobiographique, 2004
La légende du Mont(Texte et illustrations), 2002
Un loup dans la vitre, roman, 2001
L’empereur et le poète(Texte et illustrations), 2000
La baleine bleue(Texte et illustrations), 2000
L’enfant et l’oiseau(Illustrations), 1999
L’histoire de Séédimwé(Illustrations), 1999
Pour l’actualité de Philippe de Boissy et une bibliographie plus exhaustive, consultez www.philippedeboissy.fr.
Titre
Copyright
Philippe de Boissy
Philippe de Boissy est né en 1933. Poète, peintre et écrivain, il a publié une quarantaine d’ouvrages. Animateur chargé de la littérature, il crée des ateliers d’écriture à La Maison de la Culture de Grenoble au début des années 1970. En 1981, il lance le Centre de Création Littéraire de Grenoble, qui édite plusieurs ouvrages de poésie et d’histoire.
Il a obtenu la bourse Guy Lévis Mano de poésie en 1985 avec La lampe sous le boisseau. Il a été lauréat du prix de poésie Charles Vildrac 2004 décerné par la SGDL pour son recueil Jubilations du désert, publié aux Éditions du Jasmin.
Tous droits de reproduction, de traduction
et d’adaptation réservés pour tous pays
© 2012 Éditions du Jasmin
www.editions-du-jasmin.com
Dépôt légal à parution
ISBN : 978-2-35284-423-5
Avec le soutien du
1
Quand ai-je vraiment commencé à écrire un mot ? Je n’en sais rien. Peut-être papa maman ont-ils fait partie d’une première écriture. Aurais-je débuté par l’amour ? Ce dont je me souviens le mieux, c’est de mon incapacité à écrire ce que j’adorais : coquelicot, camarade, et mon prénom, que j’avais réduit à deux syllabes orales, Pite, que mon père transforma en Le Pite. Ma grand-mère utilisait un terme que j’ai aimé très tôt sans savoir l’écrire. C’était charabia. Quand elle ne voulait plus entendre, elle disait : tout ça, c’est du charabia. Et le mot devenait merveilleux. Charabia, c’est tout le reste. Une histoire folle. Toute la vie à côté. Je l’employais parfois. Mal à propos, sûrement. Ce n’était pas de mon âge. L’ai-je écrit ? Non. Ce n’était pas au programme. J’échouais aussi avec spahis, vermicelle, édredon longtemps pris pour un animal, et deux termes épouvantables qui étaient chantés par ma sœur : la métempsychose se métamorphose. Chanson sur Paris, le tube des années trente ! J’admirais ma sœur pour ce savoir. En mettant le couvert elle chantait qu’en parlant un peu de Paris, la métempsychose se métamorphose… Aujourd’hui je m’interroge encore sur ma mémoire. Mon grand-père réglait tous les problèmes de communication par trois mots : c’est une histoire à dormir debout. Quand ma grand-mère se plaignait pendant le déjeuner du prix devenu exorbitant des salades ou des abricots, grand-père laissait tomber une simple phrase qui changeait la conversation du tout au tout. Il lâchait presque à voix basse : devant la mort cela n’a pas beaucoup d’importance. Toute ma vie devant les avatars du quotidien je me redirais cela.
Il m’est arrivé de rester debout, et d’essayer de m’endormir comme un cheval. C’était très dur. J’ai donc inventé des histoires à dormir debout en restant éveillé. C’était facile. Le pire, c’était que j’arrivais quand même à m’assoupir jusqu’à manquer de tomber. J’étais sur le point de faire une découverte, mais je ne tenais pas le coup. J’en étais parfois très proche. Ma mère me découvrant debout devant la cheminée me réveillait par un qu’est-ce que tu fais ? Je restais sans réponse, je répondais : rien et elle concluait que tant qu’à dormir je ferais mieux de me coucher. Grand-père avait raison on peut dormir debout.
Enfin, ma grand-mère, devant les grands événements du monde, la Seconde Guerre mondiale, s’exclamait Où ça nous mène ? J’avais écrit cela en un seul mot qui lui allait bien : ouçanoumène. Cela me plaisait bien. Cela devenait un nom africain ou étranger. Et ma voisine de campagne, Colette, devant d’autres catastrophes, s’exclame souvent : qu’est-ce qu’on peut faire ? C’est peut-être pour leur répondre que j’écris pour ainsi dire depuis toujours. « Le seul réel dans l’art, c’est l’art », a écrit Paul Valéry. Je suis donc un réaliste. Dans la citation de ma grand-mère on peut supprimer le où, et dire que le ça, c’est nous !
Je dois aussi aux gladiateurs qui mouraient dans les arènes, et à un certain docteur grec qui s’appelait Damien, d’avoir un jour réfléchi à ce que j’avais dans la tête : un kilo trois cents grammes de cervelle, selon mon livre de Sciences naturelles, chapitre : « Le cerveau, description et fonctionnement ». Enfant, j’étais aristotélicien. Je n’ai pas connu Aristote. Mais je faisais de mon cœur le lieu de mes intelligences, de mes sensations, de mes souvenirs. Damien soignait les gladiateurs. Quand ces malheureux perdaient la tête, et la vie, il regardait dans les crânes pour analyser les cerveaux. Il en conclut que le cerveau était le centre des sensations, l’initiateur des mouvements, un lieu de mémoire… Avant la Seconde Guerre mondiale, un enfant de mon âge avait bon cœur ou pas de cœur. J’ai souvent entendu cette expression dans la bouche d’un adulte : oh celui-là, il n’a pas de cœur, et cela m’étonnait toujours. C’était un vocabulaire courant. Il pouvait aussi n’avoir pas de cervelle. Avec Damien, le cœur dépendait de la tête. Mes études dans ce domaine s’arrêtèrent là. C’est donc en pleine enfance que j’ai découvert ce qu’on avait dans la tête. Je ne voulais pas plus devenir écrivain que pompier ou médecin. Ma mère me disait souvent pour m’encourager au travail scolaire que je devais travailler pour moi. Je suis sûr soixante-treize ans après, que je ne comprenais pas grand-chose à cette histoire. Moi qui ? J’avais l’impression que j’étais quelque chose ou quelqu’un à la maison et personne au travail préparatoire du cours préparatoire. J’avais l’impression que travailler pour moi c’était travailler pour un autre qui vivrait plus tard, ailleurs, gagnerait sa vie et oublierait peut-être l’enfant qu’il était. Apprendre à lire et écrire me paraissait moins intéressant que de jouer ou ne rien faire. Arriva donc le jour de la rentrée. Les Anglais appellent cela Black Monday. Je n’en savais rien. Ma mère m’emmenait donc avec ma sœur plus âgée que moi à l’institut Saint-Pierre proche de notre domicile. Nous habitions rue Traversière à Paris. Je n’ai pas non plus mémoire de ce lieu où je suis pourtant né. Je me souviens d’un fauteuil à dos rond, en tissu vert et d’une atmosphère un peu sombre. Je suivais le mouvement parce que ma sœur le suivait avec bonheur et que ma mère en me serrant la main me faisait comprendre à quel point elle tenait à ce fameux lundi de la rentrée. J’entrai comme tout le monde à l’Institut. Ma sœur fut avalée tout de suite par un couloir et des petites filles qui jasaient dans une cour semée de cailloux. Moi j’attendais avec maman l’arrivée de la personne qui devait diriger mes premiers pas vers la classe. Elle s’appelait Mère Marie de la Trinité de l’ordre des Augustines. C’était une véritable tour humaine, entièrement cachée par des robes et des tissus divers qui lui montaient jusqu’à la tête. Elle n’avait pas de cheveux mais un voile collé sur le front. Pas d’oreilles non plus mais un autre voile blanc qui tombait sur ses épaules. Je me souviens d’un gros visage chaussé de lunettes qui se penchait vers moi par moments avec un sourire assez mince. Le bruit que faisaient autour d’elle ces étoffes était lourd et me paraissait étouffant. Aujourd’hui je pense que personne n’aurait jamais pu commencer sa vie dans l’ombre d’un tel personnage. Je me trompais. Mère Marie de la Trinité me l’annonça en quelques mots qui enchantaient ma mère. On allait me confier à Sœur Marie-Bernadette qui fit son apparition dans la pièce. Elle était elle aussi couverte de robes à plis, de voiles et de tissus à manches longues. Elle avait un visage ovale, le teint mat, des sourcils très noirs, des yeux encore plus noirs que noir et pas de lunettes. Elle posa ses mains sur mes épaules, j’avais vu briller à un doigt un anneau d’or. Elle était donc mariée. Je donnerais cher pour savoir ce que j’avais en tête à ce moment-là. Jamais deux femmes comme ces deux-là ne pourraient m’apprendre à être camionneur ou chauffeur d’autobus et pourtant si. La tour de Saint-Pierre disparut après avoir salué ma mère, Sœur Marie-Bernadette me prit par la main. Après un bisou maternel et une recommandation incompréhensible : sois sage, écoute bien, travaille bien. Je n’avais pas besoin de dire oui, Bernadette à ma place avait déjà répondu Bien sûr.
On me mit en rang avec des petites filles. Que des petites filles, c’était la loi exception faite pour deux garçons. L’autre s’appelait et je me souviens de son nom, Jean-Louis Restoube. Il était, hélas, plus grand que moi et avait beaucoup de cheveux, un peu blonds. Comme il en avait trop, des mèches lui tombaient sur le front et presque sur les yeux. J’avais un peu honte de ma coiffure avec raie sur le côté droit, le tout maintenu en place avec de la gomina. J’étais assis à un bureau juste devant la chaire de Mère Marie de la Trinité et dès le premier cours après une prière que j’apprenais par cœur bien que ma mère me l’eût apprise, je dus faire des bâtons sur une ardoise. De beaux petits bâtons, de la même taille, séparés par le même espace si possible droits ou inclinés. Peut-être ai-je trouvé cela idiot. À la maison je savais faire des lettres de l’alphabet sur du papier avec un crayon mais là c’étaient des bâtons. Il fallait aussi ne pas parler ne pas bouger. Les petites filles étaient toutes pareilles et je trouvais cela horrible. Je m’ennuyais quand j’avais fini mes bâtons et je gigotais et tapais mes pieds sur le barreau de ma table. Alors au bout de trois jours Mère Marie Trinité m’attacha les pieds à la barre du pupitre avec des ficelles sans serrer et les petites filles s’esclaffèrent. J’étais si vexé que je ne bougeais plus. Je faisais semblant de très bien travailler. Mes bâtons tracés sur un premier cahier de bâtons avec des crayons et même des crayons de couleur devinrent superbes. J’étais assez fier d’une page entière recouverte de bâtons. Mère Marie de la Trinité le montrait en exemple aux petites filles et à Jean-Louis. Cela le fit bien rire. Ma mère était au courant. C’est peut-être après cette page-là qu’elle pensa pour la première fois que je ferais un jour l’École navale, Saint-Cyr ou pourquoi pas Polytechnique. Je ne pensais pas du tout devenir écrivain. Je ne savais même pas ce que cela voulait dire mais ma feuille de bâtons de plusieurs couleurs brandie devant un public, c’était pour moi une première réussite en écriture. J’étais sage. J’obéissais, c’était un bon début pour plus tard.
C’est probablement à cause de la déclaration de guerre que nous avons quitté la rue Traversière pour la rue de Lyon. Mon père était mobilisé. Notre nouvel appartement était grand et plus lumineux. J’avais une chambre pour moi seul. Je savais presque lire et écrire. Ce fut une seconde fois Black Monday. Mais plus de bonnes sœurs, un collège immense dans le quatrième arrondissement près de la Bastille. J’étais inscrit en classe de dixième. Ce n’était pas l’école communale, mais le collège des Francs-Bourgeois école chrétienne. Tous les enseignants étaient en civil. La classe de dixième donnait de plain-pied sur la cour, une cour d’honneur pavée depuis Sully qui avait fait construire un autre hôtel presque en face. L’intérieur de la classe était vieillot, un peu sombre, le sol était un vieux parquet rien à voir avec l’atmosphère et les bois vernis ou cirés des bonnes sœurs.