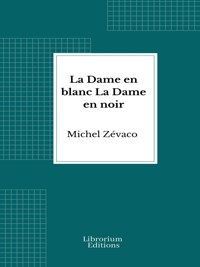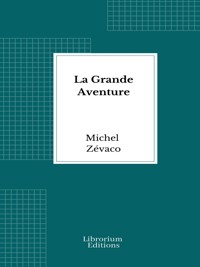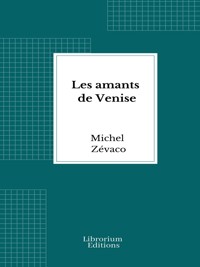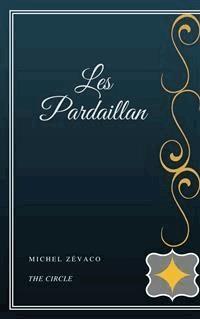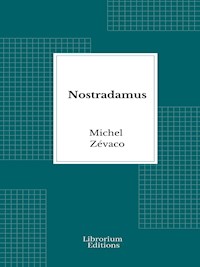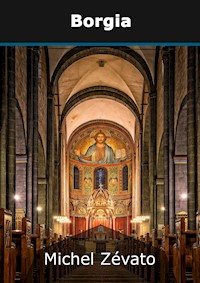
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ils aiment passionnément le crime, il ont le pouvoir, ils incarnent le mal. Michel Zévaco n'a pas tenté de réhabiliter les Borgia. Il reprend à son compte la légende sulfureuse et traite ses personnages comme on aime : à la hussarde. Un pur roman d'action, où les bons, les méchants et l'Histoire prennent des coups à chaque page.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Borgia
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXLLILIILIIILIVLVLVILVIILIXLIX - 1LXLXILXIILXIIILXIVLXVLXVILXVIILXVIIILXIXLXXLXXILXXIILXXIIILXXIVLXXVÉpilogueTablePage de copyrightMichel Zévaco
Borgia !
Michel Zévaco
Borgia !
roman
Borgia !
Édition de référence :
Paris, Arthème Fayard,
Le Livre populaire, 1906.
Sur la couverture :
Portrait de Lucrèce Borgia,
par Bartolomeo Veneto.
I
Primevère
Rome ! L’antique capitale du monde civilisé dormait, appesantie en une morne tristesse.
Une sorte de terreur mystérieuse et profonde glaçait la superbe cité jusque dans ses moelles. Rome se taisait, Rome priait, Rome étouffait.
Là où la voix puissante de Cicéron avait fait retentir la tribune d’un Forum tumultueux, psalmodiaient des voix sinistres. Là où les Gracchus avaient combattu pour la liberté, pesait de tout son poids le sombre et farouche despotisme de Rodrigue Borgia.
Et Rodrigue Borgia n’était qu’une personne dans la trinité menaçante qui régnait sur la Ville des Villes. Rodrigue avait un fils qui, plus que lui, représentait la Violence, et une fille qui, mieux que lui, symbolisait la Ruse !
Le fils s’appelait César. La fille s’appelait Lucrèce...
Nous sommes au mois de mai de l’an 1501, à l’aube du seizième siècle. Ce jour-là, le soleil s’est levé dans un ciel rutilant. La matinée est radieuse. Une joie immense est dans les airs.
Mais Rome demeure glacée, glaciale, car les prêtres règnent sur terre. Pourtant, devant la grande porte du château Saint-Ange, la forteresse qui, près du Vatican, hérisse ses odieuses tourelles, des hommes du peuple sont rassemblés par la curiosité.
Pieds nus, en haillons, la tête couverte de crasseux bonnets phrygiens, ils contemplent, avec une admiration pleine de respect, un groupe de jeunes seigneurs qui, réunis sur la place, paradent, causent bruyamment, rient aux éclats et dédaignent de laisser tomber un regard sur la tourbe qui, de loin, les envie.
Ces cavaliers, couverts de velours et de soie, par-dessus les fines cuirasses, parfois entrevues dans un mouvement des manteaux chatoyants, brodés d’or, montés sur de beaux chevaux, sont groupés près de la porte du château... Soudain, cette porte s’ouvre toute grande.
Le silence se fait. Les têtes se découvrent. Un homme à figure basanée, vêtu de velours noir, paraît sur un magnifique étalon noir et s’avance vers les jeunes seigneurs qui, sur une seule ligne, se rangent pour le saluer.
Il laisse errer ses yeux sur la ville qui, à son aspect, semble plus silencieuse encore, comme prise d’une angoisse.
Puis, sa tête tombe sur sa poitrine. Et il murmure quelques paroles que nul n’entend :
– Cet amour me brûle... Primevère !... Primevère !... Pourquoi t’ai-je rencontrée ?...
Alors, il fait de la main un signe aux cavaliers et la petite troupe, riant et caracolant, se met en marche vers l’une des portes de Rome tandis que, parmi les gens du peuple courbés, passe comme un frisson ce mot sourdement répété par des bouches haineuses et craintives :
– Le fils du pape !... Monseigneur César Borgia !...
En cette même matinée de mai, à sept lieues de Rome environ, sur la route de Florence, cheminait, solitaire, au pas de son rouan, un jeune cavalier, qui, sans hâte, insoucieusement, se dirigeait vers la Ville des Villes. Il paraissait vingt-quatre ans.
Son costume était fatigué, délabré. Il y avait plus d’une reprise à son pourpoint, et ses bottes en peau de daim étaient rapiécées par endroits.
Mais vraiment, il avait fière mine sous ses longs cheveux qui retombaient sur les épaules en boucles naturelles, avec sa fine moustache retroussée en crocs, sa taille svelte, hardiment découplée, ses yeux vifs et perçants, et surtout cet air d’ingénue gaieté qui rayonnait sur son visage.
Bien que le jeune homme n’eût ni l’allure, ni la physionomie d’un contemplatif, il semblait s’abandonner à une sorte de rêverie et son regard parcourait avec indolence la campagne romaine brûlée par le soleil, vaste plaine déserte et nue.
– Parbleu ! s’écria-t-il, voilà qui ne ressemble guère aux tant joyeux environs de mon cher Paris, avec ses bois ombreux, ses bouchons et ses guinguettes où l’on boit de si joli vin, et ses filles accortes... Allons, Capitan, un temps de trot, mon ami... et voyons si nous ne pourrons rencontrer quelque honnête hôtellerie où deux bons chrétiens comme toi et moi puissent s’abreuver...
Capitan, c’était le nom du cheval. Celui-ci dressa les oreilles et prit un trot relevé.
Dix minutes ne s’étaient pas écoulées lorsque le cavalier, se dressant sur ses étriers, aperçut au loin un petit nuage de poussière blanche qui, rapidement, s’avançait au-devant de lui. Quelques instants plus tard, il distingua deux chevaux lancés au galop.
Sur l’un d’eux flottait une robe noire : un prêtre ! Sur l’autre, une robe blanche : une femme !
Presque aussitôt, ils furent sur lui.
Le jeune Français s’apprêtait à saluer la dame blanche avec toute la grâce que la nature lui avait départie, lorsque à sa grande stupéfaction, elle arrêta net sa monture lancée à fond de train et vint se ranger près de lui.
– Monsieur, s’écria-t-elle d’une voix tremblante, qui que vous soyez, secourez-moi !...
– Madame, répondit-il avec chaleur, je suis tout à vous, et si vous voulez me faire l’honneur de me dire en quoi je puis vous servir...
– Délivrez-moi de cet homme !...
Du doigt, elle désignait le moine qui s’était arrêté et qui haussait dédaigneusement les épaules.
– Un homme d’Église ! s’exclama le Français.
– Un démon... Je vous en supplie, faites que je puisse continuer seule mon chemin...
– Holà, sire moine, vous avez entendu ?...
L’homme noir ne jeta même pas un coup d’œil sur celui qui lui parlait ainsi et, s’adressant à la jeune femme :
– Vous vous repentirez amèrement... mais il sera trop tard.
– Silence, moine ! éclata le jeune cavalier. Silence ou, par le ciel, tu vas faire connaissance avec cette épée !
– Vous osez menacer un prêtre ? fit le moine d’une voix fielleuse.
– Vous osez bien, vous, menacer une femme ! Arrière ! Tournez bride à l’instant, ou vous n’aurez plus jamais occasion de menacer qui que ce soit.
En même temps, le Français tirait son épée et marchait sur le moine. Celui-ci lança au jeune homme un regard de rage affreuse, puis, tournant bride, il s’enfuit au galop dans la direction de Rome. Une minute on put voir son manteau noir qui voltigeait au vent comme les ailes d’un oiseau de malheur. Puis il disparut.
Le jeune cavalier se retourna alors vers la dame blanche. Il demeura saisi d’admiration.
C’était une jeune fille d’environ dix-huit ans, d’une merveilleuse beauté. D’admirables cheveux d’un blond cendré encadraient harmonieusement un visage qu’éclairaient deux grands yeux noirs. Une sorte de grâce hautaine se dégageait de toute sa personne.
À ce moment, la rougeur de l’indignation empourprait son visage et la rendait mille fois plus belle encore. Elle aussi avait suivi des yeux l’affreux moine qui s’envolait comme un hibou.
– Je vous dois, dit-elle d’une voix pure et chantante, je vous dois toute ma reconnaissance, monsieur... ?
– Le chevalier de Ragastens, répondit le cavalier en s’inclinant profondément.
– Un Français !
– Parisien, madame...
– Eh bien... monsieur le chevalier de Ragastens, soyez mille fois remercié pour l’immense service...
– Bien faible service, madame, et j’eusse été heureux de tirer l’épée contre un ennemi sérieux, en l’honneur d’une dame aussi accomplie... Mais pourrais-je savoir pourquoi ce moine...
– Oh ! c’est bien simple, monsieur, fit la jeune fille qui ne put s’empêcher de frissonner. J’ai commis l’imprudence de m’écarter seule, plus que je ne devais... Cet homme s’est tout à coup approché de moi... Il m’a outragée par ses paroles... j’ai voulu fuir... il m’a poursuivie...
Il était visible qu’elle ne disait pas toute la vérité.
– Et vous ne le connaissez pas ? reprit le jeune homme.
Elle hésita un instant. Puis, se décidant :
– Je le connais... pour mon malheur !... C’est le vil instrument d’un homme néfaste et puissant... Oh ! monsieur, vous disiez que c’est là un ennemi peu sérieux... Ce moine est au contraire, pour vous, et dès ce moment, un redoutable ennemi... Si vous le rencontrez, fuyez-le... Si votre destinée est de vous trouver avec lui, n’acceptez rien de lui... Redoutez le verre d’eau qu’il vous offrira, le fruit dont il mangera une moitié devant vous, l’arme qu’il vous priera d’accepter... Redoutez surtout qu’il ne vous fasse saisir et jeter dans quelque oubliette du château Saint-Ange... Le moine que vous venez de voir s’appelle dom Garconio...
– Madame, reprit le chevalier de Ragastens, je vous rends grâce pour les inquiétudes que vous voulez concevoir à mon sujet... Mais je ne crains rien, ajouta-t-il en se redressant...
– Il faut que je vous demande un autre service...
– Parlez, madame !
– C’est de ne pas chercher à voir de quel côté je me dirige... de ne pas chercher à savoir qui je suis...
– Quoi ! madame !... Je n’aurai donc aucun souvenir de cette rencontre que je bénis... Je ne saurais même pas quel nom je dois mettre sur ce visage charmant qui va, dès cette heure, hanter mes rêves ?...
Le chevalier parlait d’une voix émue et tendre. Elle le regarda avec un intérêt non dissimulé. Un sourire vint se jouer sur ses lèvres.
– Je ne puis vous dire mon nom, dit-elle. De trop graves intérêts m’obligent à le tenir caché... Mais je puis vous dire le surnom que m’ont donné ceux qui me connaissent.
– Et quel est ce surnom ? demanda le Français.
– Quelquefois... on m’appelle... Primevère !...
Et, faisant un signe d’adieu, la dame blanche prit le galop et s’enfonça dans la direction de Florence...
Le chevalier était demeuré sur place, tout étourdi, ébloui par cette éclatante et fugitive apparition. Son regard demeurait invinciblement attaché sur la robe blanche qui flottait dans un nuage de poussière.
Il la vit tourner brusquement à droite et se jeter en pleine campagne. Puis elle disparut.
Longtemps, il demeura au même endroit... Enfin, il poussa un soupir.
– Primevère ! fit-il. Le joli nom ! Primevère... primavera... printemps ! Elle est belle, en effet, belle comme le printemps en fleur... Mais à quoi bon songer à cela ! Sans doute elle m’aura oublié dans une heure... Et quand même, que pourrais-je espérer, pauvre aventurier ?
Sur cette mélancolique réflexion, le chevalier de Ragastens poursuivit vers Rome son voyage interrompu.
II
Ragastens
La brillante escorte de jeunes seigneurs qui accompagnaient César Borgia trottait depuis près de deux heures sur la route de Florence. Le fils du pape interrogeait fiévreusement la campagne, et de temps à autre, un juron lui échappait.
– Enfin ! s’exclama-t-il tout à coup.
Et il se précipita au-devant d’un cavalier qui accourait vers lui.
– Dom Garconio !... Quelles nouvelles ? demanda César impétueusement.
– Bonnes et mauvaises...
– Ce qui veut dire ? Explique-toi, par la madone !
– Patience, monseigneur ! Mon ami Machiavel m’affirmait, hier encore, que la patience est une inestimable vertu pour les princes.
– Drôle ! Prends garde que ma cravache...
– Eh bien... j’ai vu la jeune fille...
Borgia pâlit.
– Tu l’as vue !... fit-il en frémissant.
– Je lui ai parlé...
– Garconio !... Je te ferai donner par mon père le bénéfice du couvent de Sainte-Marie-Mineure...
– Monseigneur, vous êtes un maître généreux...
– Ce n’est pas moi qui paie ! grommela César dans sa moustache... Mais achève !... Donc... tu lui as parlé ?... Qu’a-t-elle dit ?...
– C’est là que les nouvelles deviennent mauvaises...
– Elle refuse !...
– Elle se dérobe... Mais nous en viendrons à bout...
– As-tu su son vrai nom ?...
– Je n’ai rien su... sinon qu’elle se montre indomptable, pour le moment.
– Mais tu l’as suivie ? Tu sais en quel recoin elle se cache ?... Parle, tu me fais mourir...
– Monseigneur, j’ai suivi la jeune fille selon vos instructions et vous allez voir que si je n’ai pas encore découvert son nid, ce n’est pas de ma faute...
– Enfer !... Elle m’échappe...
– Je l’ai rencontrée près du bois d’oliviers, et ce fut un vrai miracle... Dès lors, je m’attachai à ses pas... je lui parlai comme il convenait... Elle voulut fuir... Je la serrai de près... Affolée, telle une biche aux abois, j’allais enfin savoir la vérité lorsque...
– Elle t’échappa, sans doute, misérable moine...
– Nous fîmes, continua dom Garconio sans broncher, la rencontre d’un jeune bandit qui me chercha dispute et fonça sur moi, l’épée à la main... Pendant ce temps, le bel oiseau blanc s’envolait...
– Malédiction !... Et cet homme... ce misérable... où est-il ?... Qu’est-il devenu ? Tu l’as perdu de vue aussi, lâche ?...
– Non pas ! Je l’ai épié de loin... Et, en ce moment même, le drôle déjeune à l’auberge de la Fourche, à vingt minutes d’ici...
– En route ! hurla le fils du pape en enfonçant ses éperons d’or dans les flancs de son cheval qui bondit en avant.
– Le compte du Français me paraît clair ! murmura le moine.
Ruée en un galop infernal, la troupe ne tarda pas à se trouver devant l’hôtellerie signalée par le moine.
C’était une méchante auberge, une sorte de bouchon de bas étage où le voyageur altéré ne trouvait pour se rafraîchir qu’un mauvais vin et de l’eau tiède. Un jardin s’étendait contre cette masure, le long de la route, dont il n’était séparé ni par un fossé, ni par une palissade quelconque. Dans ce jardin quelque chose se dressait, qui avait la prétention de ressembler à une tonnelle.
C’est sous cette tonnelle recouverte d’une toile, à défaut de verdures grimpantes, que déjeunait en effet le chevalier de Ragastens.
– Voilà l’homme ! fit le moine.
César examina d’un œil sombre le jeune homme qui, à l’arrivée soudaine de ces nombreux cavaliers, avait salué, puis s’était remis tranquillement à son déjeuner.
Ragastens avait reconnu le moine et, aussitôt, il avait rajusté la ceinture de cuir qui soutenait son épée et qu’il avait dégrafée. Puis, son œil perçant, en parcourant le groupe, avait aussi reconnu un autre homme. Et celui-là, c’était César Borgia !...
– Parbleu ! murmura le chevalier entre ses dents, la rencontre est admirable. Ou je me trompe fort, ou ma bonne étoile m’a ménagé une heureuse surprise...
Cependant, Borgia s’était tourné vers les jeunes seigneurs qui l’entouraient et, s’adressant à l’un d’eux :
– Que te semble, dit-il d’un ton goguenard, de cet illustre seigneur qui déjeune en ce palais ? Parle franchement, Astorre.
Le chevalier ne perdit pas une syllabe de cette interrogation et il en saisit le sens méprisant.
– Oh ! oh ! pensa-t-il, je crois que décidément la surprise n’aura rien d’heureux et que ma bonne étoile n’y est pour rien...
Le seigneur que Borgia avait interpellé s’était avancé de quelques pas. C’était un homme d’une trentaine d’années, taillé en hercule, avec une encolure de taureau, des yeux sanglants... Il avait, à Rome, une réputation de spadassin terrible. Les quinze duels qu’on lui connaissait s’étaient terminés par quinze morts.
Le colosse considéra un instant le chevalier et éclata d’un gros rire.
– Je pense, dit-il, que je vais donner à ce magnifique inconnu l’adresse du savetier qui raccommode les bottes de mes domestiques...
Il y eut un éclat de rire général. Borgia seul demeura sérieux, mais il fit un signe imperceptible à Astorre. L’imagination de celui-ci étant à bout de ressources, il se contenta de répéter la même plaisanterie :
– Je lui donnerai aussi l’adresse d’un tailleur pour recoudre son pourpoint... Mais j’y pense, ajouta-t-il...
Il s’avança encore.
– Eh ! monsieur... je veux vous rendre un service... car votre air me plaît...
Le chevalier de Ragastens se leva alors et s’avançant à son tour :
– Quel service, monsieur ? Voudriez-vous, par hasard, me prêter un peu de cet esprit qui pétille dans vos discours ?
– Non, répondit Astorre sans comprendre. Mais si vous voulez passer chez moi, mon valet a mis de côté son dernier costume... Je lui ordonnerai de vous en faire présent... car le vôtre me paraît en mauvais état.
– Vous faites allusion sans doute, monsieur, aux nombreuses reprises qui ornent mon pourpoint ?...
– Vous avez deviné du premier coup !...
– Eh bien, je vais vous dire... Ces reprises sont une mode nouvelle que je veux acclimater en Italie... Aussi, il me déplaît fort que votre pourpoint, à vous, soit intact, et j’ai la prétention d’y pratiquer autant d’entailles qu’il y a de reprises au mien...
– Et avec quoi, s’il vous plaît ?...
– Avec ceci ! répondit le chevalier.
En même temps, il tira son épée. Astorre dégaina.
– Monsieur, dit-il, je suis le baron Astorre, garde noble, avantageusement connu à Rome.
– Moi, monsieur, de la Bastille, au pied de laquelle je suis né, jusqu’au Louvre, on m’appelle le chevalier de la Rapière... parce que ma rapière et moi ne faisons qu’un... Est-ce que ce nom vous suffit ?...
– Un Français ! murmura César Borgia étonné.
– Va pour la rapière, riposta Astorre. Cela me permettra de faire coup double... car je vais vous briser et vous percer en même temps...
Les deux hommes tombèrent en garde et les fers s’engagèrent.
– Monsieur le baron Astorre, vous qui avez un si bon œil, avez-vous compté combien il y a de reprises à mon pourpoint ?
– Monsieur La Rapière, j’en vois trois, répondit Astorre en ferraillant.
– Vous faites erreur... Il y en a six... Vous avez donc droit à six entailles... et en voici une !
Astor bondit en arrière, avec un cri : il venait d’être touché en pleine poitrine, et une goutte de sang empourpra la soie grise de son pourpoint. Les spectateurs de cette scène se regardèrent avec surprise.
– Prends garde, Astorre ! fit Borgia.
– Par l’enfer ! Je vais le clouer au sol...
Et le colosse se rua, l’épée haute.
– Deux ! riposta Ragastens en éclatant de rire.
Coup sur coup, le chevalier se fendit trois fois encore. Et, à chaque fois, une goutte de sang apparaissait sur la soie. L’hercule rugissait, bondissait, tournait autour de son adversaire. Ragastens ne bougeait pas.
– Monsieur, dit-il, vous en avez cinq déjà... Prenez garde à la sixième.
Astorre, les dents serrées, porta sans répondre une botte savante, celle qu’il réservait aux adversaires réputés invincibles. Mais, au moment où il se fendait, il jeta un hurlement de douleur et de rage en laissant tomber son épée. Ragastens venait de lui transpercer le bras droit.
– Six ! fit tranquillement le chevalier.
Et, se tournant vers le groupe de spectateurs :
– Si quelqu’un de ces messieurs veut se mettre à la mode...
Deux ou trois des jeunes seigneurs sautèrent à terre.
– À mort ! crièrent-ils.
– Holà ! silence... et paix !
C’était Borgia qui parlait. Dans l’âme de ce bandit, il n’y avait qu’un culte : celui de la force et de l’adresse. Il avait admiré la souplesse du chevalier, son sang-froid, son intrépidité. Et il s’était dit que c’était là, peut-être, une excellente recrue...
– Monsieur, dit-il en s’avançant, tandis que ses compagnons s’empressaient autour d’Astorre, comment vous nommez-vous ?
– Monseigneur, je suis le chevalier de Ragastens...
Borgia tressaillit.
– Pourquoi m’appelez-vous « monseigneur » ?
– Parce que je vous connais... Et, ne vous eussé-je pas connu, qui ne devinerait, à votre prestance et à votre air, l’illustre guerrier que la France admire comme un grand diplomate sous le nom de duc de Valentinois et que l’Italie salue comme un moderne César sous le nom de Borgia ?
– Par le ciel ! s’écria César Borgia, ces Français sont plus habiles encore dans l’art de la parole que dans l’art de l’épée... Jeune homme, vous me plaisez... Répondez-moi franchement... Qu’êtes-vous venu faire en Italie ?...
– Je suis venu dans l’espoir d’être admis à servir sous vos ordres, monseigneur... Pauvre d’écus, riche d’espoir, j’ai pensé que le plus grand capitaine de notre époque pourrait peut-être apprécier mon épée...
– Certes !... Eh bien, votre espoir ne sera pas trompé... Mais comment se fait-il que vous parliez si bien l’italien ?...
– J’ai longtemps séjourné à Milan, à Pise, à Florence, d’où je viens... et puis, j’ai lu et relu Dante Alighieri... C’est dans la Divine Comédie que j’ai pris mes leçons.
À ce moment, dom Garconio s’approcha de Borgia.
– Monseigneur, dit-il, vous ne savez pas que cet homme a osé porter la main sur un homme d’Église... Songez que, sans lui, Primevère serait en votre pouvoir...
Ragastens n’entendit pas ces mots. Mais il en devina le sens. Il comprit, à l’expression de sombre menace qui envahissait le visage de Borgia, que son affaire allait peut-être prendre mauvaise tournure.
– Monseigneur, dit-il, vous ne m’avez pas demandé où et quand je vous ai connu... Si vous le désirez, je vais vous l’apprendre...
Le chevalier déganta rapidement sa main droite. Au petit doigt de cette main brillait un diamant enchâssé dans un anneau d’or.
– Reconnaissez-vous ce diamant, monseigneur ?
Borgia secoua la tête.
– C’est mon talisman, reprit le chevalier, et il a fallu que j’y tienne pour que je ne le vende pas, même pour me présenter en une tenue décente devant vous... Voici l’histoire de ce diamant... Un soir, il y a quatre ans de cela, j’arrivais à Chinon...
– Chinon ! s’exclama Borgia.
– Oui, monseigneur... et j’y arrivai le soir même du jour où vous y fîtes une entrée dont on parle encore en France... Jamais on n’avait vu, et jamais sans doute on ne verra rien d’aussi magnifique... Les mules de votre escorte étaient ferrées d’argent... et quant aux chevaux, ils portaient des clous d’or à leurs fers... et ces clous tenaient à peine à la corne, en sorte que mules et chevaux semaient de l’or et de l’argent sur votre passage, et que la population se ruait pour ramasser ces bribes de votre faste...
» Le soir, vers minuit, vous commîtes une grande imprudence... Vous sortîtes du château... seul !... Ayant franchi la porte de la ville, vous vous dirigiez vers une certaine demeure écartée, de riche apparence, lorsque...
– Lorsque je fus attaqué par trois ou quatre malandrins qui en voulaient sans aucun doute à mes bijoux...
– Tout juste, monseigneur... Vous rappelez-vous la suite ?
– Par le ciel ! Comment pourrais-je l’oublier ?... J’allais succomber. Tout à coup, un inconnu survint et s’escrima si bien de l’épée qu’il mit en fuite les drôles...
– Ce fut alors, monseigneur, que vous me donnâtes ce beau diamant...
– C’était vous ?...
– ... en me disant qu’il me servirait à me faire reconnaître de vous partout où vous seriez, dès que j’aurais besoin d’aide et de protection...
– Jeune homme ! Touchez là... Mon aide et ma protection vous sont acquises... Dès cette heure vous êtes à mon service et malheur à qui oserait seulement vous vouloir du mal !...
Un regard circulaire jeté autour de lui appuya ces paroles. Toute l’escorte, jusqu’à Astorre, dont le bras était bandé, jusqu’à dom Garconio, s’inclina devant le jeune Français qui, d’une façon aussi imprévue, venait de conquérir la faveur de César Borgia.
– En route, messieurs, commanda celui-ci. Nous retournons à Rome. Quant à vous, jeune homme, je vous attends ce soir, à minuit... Minuit, ajouta-t-il avec un singulier sourire, c’est mon heure, à moi !...
– Où vous trouverai-je, monseigneur ?
– Au palais de ma sœur Lucrèce... Au Palais-Riant... Tout le monde, à Rome, vous l’indiquera.
– Au Palais-Riant !... À minuit !... On y sera !...
Le chevalier de Ragastens s’inclina.
Quand il se redressa, il vit la troupe des seigneurs qui s’éloignait dans un nuage de poussière. Mais, si vite que s’éloignât cette troupe, le chevalier n’en distingua pas moins deux regards de haine mortelle qui lui furent jetés à la dérobée : l’un par le baron Astorre, l’autre par le moine Garconio.
Ragastens haussa les épaules. Il acheva tranquillement son modeste déjeuner et, ayant payé son écot, se remit en selle.
III
Le Palais-Riant
Il était environ quatre heures de l’après-midi, lorsque le chevalier de Ragastens pénétra dans la Ville Éternelle. Il avait fait au pas le reste de la route, tant pour donner du repos au brave Capitan qu’il aimait comme un bon et fidèle compagnon, que pour se livrer à l’aise à ses méditations...
Enfant du pavé parisien, le chevalier de Ragastens avait jusqu’à cette époque vécu un peu au hasard. Il n’avait connu ni son père, ni sa mère.
En effet, celle-ci était morte en lui donnant le jour. Et quant à son père, pauvre gentilhomme gascon, venu à Paris pour tâcher de faire fortune, il avait succombé à la misère, alors que le petit chevalier tétait encore le sein d’une nourrice.
Cette nourrice, marchande de hardes sous un auvent placé à l’encoignure de la rue Saint-Antoine, presque en face la grande porte de la Bastille, s’était attachée au petit orphelin. Elle s’était mis en tête d’en faire son successeur dans son négoce de friperies.
Or, étant devenue veuve, elle prit un amant pour remplacer le digne homme que l’on venait de porter en terre. Le petit chevalier avait alors sept ans.
L’amant de la fripière était un clerc. Vrai savant qui lisait, écrivait, et même calculait. Toute la science du clerc passa de son cerveau à celui de l’enfant.
À quatorze ans, celui-ci en savait presque autant qu’un abbé. La digne fripière rêvait déjà pour lui de flamboyantes destinées, lorsqu’une épidémie de petite vérole l’emporta.
Le jeune chevalier suivit en pleurant, jusqu’au cimetière, le corps de celle qui lui avait servi de mère. Puis il revint, s’ébroua, sécha ses larmes et dans la boutique de la défunte, choisit un équipement complet dont le principal ornement était une immense rapière qui traînait sur le pavé dès qu’il cessait d’appuyer sur la poignée.
Vers l’âge de dix-huit ans, c’était un fieffé spadassin, redouté dans les cabarets et tavernes, grand coureur de filles, grand videur de brocs de Suresnes, un peu dépenaillé, friand de la lame, l’épée toujours à moitié hors du fourreau, courant la prétentaine, rossant le bourgeois et battant le guet : enfin, un vrai gibier de potence.
Le chevalier était surtout une nature aventureuse. Généreux, il partageait ce qu’il avait – quand il avait ! – avec de plus pauvres que lui. Il défendait les faibles avec sa bonne rapière. Il n’eût pas commis une mauvaise action. Mais, sans ressources, n’ayant pour guide que son robuste appétit d’aventures, jeté d’ailleurs dans un milieu d’une morale infiniment élastique, il vivait comme il pouvait, prenait son bien où il le trouvait...
Un beau jour, celui qu’on appelait le chevalier La Rapière et qui, entre la Bastille et le Louvre, était devenu ce qu’on appelait une « Terreur », disparut soudain.
Nous le retrouvons assagi. Les bonnes qualités l’ont emporté sur les mauvaises. Le chevalier de Ragastens a jeté sa gourme et, à bon droit, il peut alors se considérer comme un parfait gentilhomme.
Au moment où le cavalier franchit la porte de Rome, il conclut, en secouant la tête comme pour laisser derrière lui un passé qui était bien mort :
– Me voici avec deux ennemis sur les bras : le signor Astorre et le moine Garconio. J’ai menacé l’un et malmené l’autre. Oui, mais j’ai un protecteur puissant...
Et le chevalier jeta autour de lui un regard conquérant. Pourtant, dans cet avenir rose et or qu’il entrevoyait, un point noir obscurcissait son horizon. Bien qu’il s’en défendît, il pensait à cette mystérieuse inconnue au nom si doux, au visage plus doux encore, et ce fut avec un profond soupir, qu’il répéta :
– Primevère !... La reverrai-je jamais ?... Qui est-elle ?... Pourquoi cet horrible moine la poursuivait-il ?...
Cependant, ayant tout à coup levé la tête, il s’aperçut que des gens le regardaient avec curiosité. Il jeta les yeux autour de lui et vit qu’il se trouvait sur un pont.
– Quel est ce pont ? demanda-t-il à un gamin en lui jetant une menue pièce de monnaie.
– Excellence, c’est le pont des Quatre-Têtes...
– Et le Palais-Riant, le connais-tu ?
– Le palais de la signora Lucrézia ! s’exclama l’enfant, avec une évidente terreur.
– Oui, sais-tu où il est ?
– Là ! fit le gamin en étendant le bras.
Puis, il s’enfuit comme s’il eût eu à ses trousses une armée des diables d’enfer. Le chevalier se dirigea dans la direction qui venait de lui être désignée, réfléchissant à cette étrange frayeur qu’avait manifestée l’enfant.
Une fois encore, il demanda son chemin à un homme. Et l’homme, au nom du Palais-Riant, le regarda tout à coup d’un air sombre, puis passa son chemin en grommelant une malédiction.
– Étrange ! murmura le chevalier.
Il arriva enfin sur une place déserte. Au fond de cette place se dressait une somptueuse demeure. Une double rangée de colonnes en marbre rose, que doraient les rayons du soleil à son déclin, formaient une sorte de galerie couverte qui s’étendait en avant du palais.
Au fond de cette galerie, par une large baie ouverte, on apercevait un escalier monumental, également en marbre... Quant à la façade du palais, elle était décorée de motifs d’ornements, précieux travaux de sculpture antique pris, raflés au hasard des trouvailles parmi les trésors de l’ancienne Rome.
Le chevalier se dit que ce devait être là le Palais-Riant qui, à coup sûr, méritait son nom grâce à la profusion de statues blanches et riantes qui l’ornaient, grâce aussi à la profusion de plantes rares et de fleurs merveilleuses qui formaient, sous la galerie, un incomparable jardin.
En avant de ce jardin, pareils à deux statues équestres, deux cavaliers immobiles, silencieux, montaient la garde. Ragastens s’adressa à l’un d’eux.
– C’est ici le Palais-Riant ? demanda-t-il.
– Oui... au large ! répondit la statue d’un ton menaçant.
– Diable ! murmura le chevalier en poursuivant son chemin, voilà un palais bien gardé.
La place était déserte : pas un passant... pas une boutique ouverte. On eût dit d’un lieu maudit ! Ragastens poussa son cheval et une cinquantaine de pas plus loin, en entrant dans la rue qui faisait suite à la place, il se trouva devant une hôtellerie. Là, la vie semblait renaître, mais avec une sorte de crainte et d’hésitation encore.
Ragastens mit pied à terre et pénétra dans l’hôtellerie qui, par un singulier caprice du patron, ou par un excès de bizarre latinité, s’appelait Auberge du beau Janus.
Le chevalier demanda une place à l’écurie pour Capitan et une chambre pour lui. Un domestique s’empara du cheval et l’hôtelier conduisit Ragastens à une chambrette du rez-de-chaussée.
– C’est humide, observa-t-il.
– Nous n’en avons pas d’autre disponible.
– Je la prends tout de même, parce que vous êtes tout près du Palais-Riant.
– Vous êtes bien servi, fit l’hôte étonné, car de votre fenêtre vous pouvez justement voir le derrière du palais.
L’hôte ouvrit la fenêtre ou plutôt la porte-fenêtre, et Ragastens reçut au visage une bouffée d’humidité.
– Qu’est-ce que cela ? fit-il.
– Cela ?... C’est le Tibre, donc !
En effet, le fleuve coulait entre deux rangées de maisons, sans quai, sans berge. Derrière chaque maison, un escalier de quelques marches aboutissait au ras de l’eau. Devant sa porte-fenêtre, un de ces escaliers montrait quatre marches de pierre verdâtre.
– Tenez, reprit l’hôte, voyez là-bas... au coude du fleuve, cet escalier plus large que les autres... c’est celui du Palais-Riant.
– Bon ! fit Ragastens en rentrant et refermant la porte, cette chambre me plaît, tout humide qu’elle est...
– On paie d’avance, seigneur, observa l’hôte.
Le chevalier s’exécuta.
Puis, ayant demandé du fil et une aiguille, il s’absorba en une méticuleuse réparation de ses pauvres effets, qu’il brossa, battit, nettoya de fond en comble. Après quoi, il dîna de bon appétit.
Ces diverses occupations le conduisirent jusqu’à neuf heures. Une heure plus tard, Ragastens, flamboyant de propreté, l’épée au côté, attendait avec impatience le moment de se rendre au palais de Lucrèce Borgia.
Un profond silence pesait sur la ville, endormie depuis longtemps. Seul, le sourd murmure du Tibre qui roulait au pied de la maison ses eaux grisâtres, élevait dans la nuit des voix tristes comme des plaintes fugitives. Le chevalier les écoutait avec une émotion dont il n’était pas le maître... Il se secoua pour échapper à cette impression nerveuse. Bientôt, d’ailleurs, il allait être minuit...
Le chevalier souffla sa chandelle et, drapé dans son manteau, s’apprêta à sortir. À ce moment, une plainte plus déchirante monta du fleuve. Ragastens tressaillit.
– Cette fois, murmura-t-il, ce n’est pas une illusion... c’est une voix humaine.
Un nouveau cri de détresse se fit entendre. On eût dit qu’il venait de retentir dans la chambre. Ragastens frémit... Ses tempes se mouillèrent. Pour la troisième fois une plainte s’éleva, étouffée comme un râle d’agonisant.
– Cela vient du Tibre ! s’écria Ragastens.
Il s’élança, ouvrit la porte-fenêtre... La nuit était opaque. Le Tibre, resserré entre les maisons au haut desquelles on apercevait à peine un pan de ciel étoilé, roulait des flots noirs. À tâtons, le chevalier descendit les quatre marches ; il se baissa... allongea les mains.
Ses mains rencontrèrent une étoffe soyeuse. L’étoffe couvrait le corps d’un homme. L’homme râlait, haletait. Ragastens le saisit par les épaules.
– Qui êtes-vous ? demanda l’inconnu.
– Ne craignez rien... un étranger... un ami...
– Il n’y a pas d’amis... Oh ! je vais mourir... Écoutez !...
L’homme incrusta ses mains sur les dalles... Ragastens voulut le tirer de l’eau...
– Non ! fit l’homme dans un hoquet d’agonie... inutile... je vais... mourir... mais je veux... me venger... Écoutez...
– J’écoute ! fit Ragastens, les cheveux hérissés.
– Le comte Alma... prévenez-le... prévenez sa fille... il veut l’enlever... il ne faut pas...
– Qui, le comte Alma ? Qui, sa fille...
– Sa fille !... Béatrix... Primevère !...
– Vous dites, fit Ragastens d’une voix rauque d’angoisse, vous dites qu’il veut l’enlever... Qui ?...
– Celui qui vient de me tuer... mon...
À ce moment, l’homme fut secoué d’un spasme mortel... il se raidit... ses mains lâchèrent la pierre, le corps roula dans l’eau... et disparut dans un remous des flots noirs.
Ragastens se redressa. Ses yeux fouillèrent avidement l’ombre épaisse. Mais en vain !
Alors, il rentra dans la chambre, et essuya son visage couvert d’une sueur d’angoisse.
– Oh ! prononça-t-il sourdement, quel est cet horrible secret que je n’ai pu saisir !... Elle s’appelle Béatrix... elle est la fille du comte Alma... Et quelqu’un veut l’enlever... Mais qui ?... Qui ?...
À ce moment, l’heure sonna lentement à Saint-Pierre.
– Minuit, fit le chevalier bouleversé.
Et il s’élança au dehors, courant vers le Palais-Riant où l’attendait son illustre protecteur, César Borgia.
IV
Les nuits de Rome
À peu près au moment où le chevalier de Ragastens se transformait en tailleur et s’occupait à recoudre à son pourpoint quelques passementeries destinées à en rehausser la bonne mine, César Borgia, escorté de quatre jeunes gens, pénétrait au Palais-Riant.
César et son escorte traversèrent rapidement ces magnifiques salons où se trouvaient accumulées les merveilles de l’art italien. Ils arrivèrent à une porte de bronze doré que gardaient deux Nubiens, noirs comme la nuit, muets comme le silence.
César fit un signe. L’un des Nubiens posa le doigt sur un bouton et la porte de bronze s’ouvrit.
... Là commençait la partie intime du palais.
Dès que César et ses amis eurent franchi la porte, elle se referma sans bruit. Ils se trouvèrent alors dans une sorte de vestibule, aux hautes murailles de jaspe.
Face à la porte de bronze se trouvait une porte en bois de rose incrusté de délicates orfèvreries d’argent...
Cette fois, c’étaient deux femmes qui gardaient la porte : deux femmes nues, d’une sculpturale beauté, assises ou plutôt à demi couchées sur d’épais coussins...
Cette porte s’ouvrit mystérieusement comme la première, sur un signe de César. Toujours suivi de son escorte, il pénétra alors dans une pièce de moindre dimension, mais d’un luxe plus raffiné, plus subtil.
Une musique douce où dominaient les accords d’harmonie de flûte, de viole et de guitare, se faisait entendre en un murmure à peine perceptible. Et cette musique, arrivant comme par bouffées mystérieuses, se mêlait de voix féminines qui chantaient la gloire et l’amour.
Il n’y avait pas de meubles dans cette salle, hormis un dressoir et une immense table ; mais çà et là, une profusion de larges et moelleux coussins, des tapis épais, richement brodés, invitait au repos.
La table dressée supportait des plats d’une fabuleuse richesse dans lesquels des fruits glacés, des confitures exotiques, des pâtisseries délicates dont Lucrèce avait seule la formule et qu’elle faisait pétrir dans son palais...
Autour de cette table, plusieurs hommes déjà avaient pris place. Ils n’étaient pas assis, mais à demi couchés sur une sorte de lit, à la mode des anciens Romains.
Parmi eux se trouvait une femme, une seule : la maîtresse du palais, la Circé de cette caverne enchantée, la prodigieuse magicienne qui régnait sur les sens des hommes, la sœur de César, la fille du pape, Lucrèce Borgia !
– Comme vous venez tard, mon frère !
– Excusez-nous, ma chère Lucrèce, répondit César, ces seigneurs et moi, nous sommes rentrés à la nuit, après une longue promenade sur la route de Florence...
– Vous êtes pardonné... mais vous ne dites rien à votre frère ?
César se tourna vers un homme qui, près de Lucrèce, avait tressailli d’inquiétude en voyant entrer César. C’était François Borgia, duc de Gandie, deuxième fils du pape, frère de César et de Lucrèce.
Les deux frères se tendirent la main avec un sourire. Mais chacun d’eux surveillait étroitement chaque mouvement de l’autre.
Lucrèce se pencha tout à coup vers François, saisit sa tête à pleines mains et l’embrassa sur la bouche.
– Voilà de l’amour fraternel, ricana César, ou je ne m’y connais pas ! Et pourtant, je suis expert en la matière...
– C’est vrai, fit Lucrèce, j’aime François... c’est le meilleur d’entre nous.
– Vous me comblez, ma sœur, dit avec inquiétude le duc de Gandie... vous oubliez que si notre maison est glorieuse, et le trône pontifical de notre père inébranlable, nous le devons à l’épée de notre cher César...
– C’est juste ! reprit César. J’ai assez joliment manié l’épée... L’arme blanche, c’est mon affaire...
En disant ces mots, il sortit son poignard et, d’un coup violent, l’enfonça sur la table. Un frémissement parcourut les convives. François pâlit affreusement. Mais Lucrèce éclata de rire.
– Soupons ! fit-elle gaiement.
Elle avait jeté un rapide coup d’œil sur une portière en étoffe de brocard qui s’était agitée doucement.
Aussitôt les servantes commencèrent leur office.
Lucrèce Borgia était vêtue – mais juste assez pour apparaître aux convives plus désirable encore. Une gaze légère recouvrait sa nudité, sa beauté, un peu massive – des formes qui semblaient taillées en plein marbre.
De temps à autre, elle jetait un regard furtif vers la portière de brocard qui frémissait imperceptiblement. Mais si léger que fût ce frisson de l’étoffe, il suffisait à Lucrèce pour lui faire comprendre que quelqu’un la regardait et l’écoutait.
– Que dit-on dans notre bonne ville de Rome ? demanda-t-elle.
– Parbleu, madame, on raconte une chose fabuleuse, inouïe, incroyable...
– Et que raconte-t-on, duc de Rienzi ?
– Duc ! interrompit François Borgia d’un ton presque suppliant.
– C’est une histoire d’amour ! reprit le duc.
– Voyons l’histoire... dit Lucrèce... L’amour... la seule chose vraie, la seule digne qu’on vive et qu’on meure pour elle !...
En même temps, elle enlaçait le cou de François...
– Racontez, duc ! ordonna-t-elle d’une voix pâmée.
– Oui, oui ! s’écrièrent les convives. De l’amour ! Ne parlons que d’amour !
– Oh ! continua le duc de Rienzi, c’est un amour pur et virginal. J’ai presque de la honte à le dire ici...
– Parlez, fit César d’un ton bref.
– Puisque c’est vous-même qui l’ordonnez, monseigneur... On dit donc qu’un célèbre capitaine, le plus noble qui soit, se trouve amoureux...
Les regards convergèrent vers César.
– Mais, reprit le duc, amoureux comme il ne le fut jamais. Lui qui, assure-t-on, avait un cœur de bronze, a maintenant un cœur de colombe... il soupire, il gémit... Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que l’objet de sa flamme se trouve être une inconnue que nul n’a pu approcher... Et enfin, où l’histoire devient invraisemblable, mais demeure pourtant véridique, c’est que l’inconnue loin d’accueillir avec transport et reconnaissance les offres de ce grand capitaine, les repousse et les dédaigne !...
– Et le nom du bel amoureux ? demanda Lucrèce.
– Cherchez ! bégaya le duc de Rienzi tout à fait ivre... Il est parmi nous...
– Inutile ! gronda César Borgia. L’amoureux, c’est moi !... Et malheur à qui trouverait à y redire !...
– Monseigneur !... Croyez...
– Quant à la femme je vous jure que, sous peu, elle aura cessé de me dédaigner !...
Lucrèce éclata de rire.
– Ainsi, mon cher César, fit-elle, vous me trahissez ?... Vous m’abandonnez ?...
– Non pas ! répondit César qui sentait son cerveau se troubler dans une ivresse envahissante, ivresse du vin, ivresse des sens, ivresse de l’orgueil.
Et il continua, balbutiant :
– Non, Lucrèce, je ne te trahis pas, tu es à moi ! Comme elle sera à moi, elle aussi !... Comme ta femme, Rienzi, a été à moi !... Comme tout doit être à moi ! à moi ! à moi seul ! Entendez-vous, vous tous !...
Il haletait. Son regard lançait des éclairs sanglants... Ce fut à cette minute précise que Lucrèce, se levant, saisit François, duc de Gandie, dans ses deux bras.
François subit ce baiser, avec une pâleur croissante. Il essaya vainement de se dégager...
– Enfer ! rugit César Borgia qui, d’une poussée furieuse, repoussa la table.
En même temps, il saisit son poignard qui était resté planté devant lui et, hagard, s’avança sur son frère François... D’un bond, il fut sur lui.
Son bras se leva, puis s’abaissa dans un geste foudroyant. L’arme pénétra tout entière dans la poitrine du duc de Gandie. Celui-ci tomba à la renverse. Sa bouche vomit un flot de sang.
Les spectateurs de cette scène, épouvantés, demeurèrent comme pétrifiés. Lucrèce s’était reculée, simplement, et un singulier sourire vint errer sur ses lèvres.
– À moi, râlait l’infortuné duc de Gandie... à moi !... Oh !... je brûle... De l’eau !... par pitié !... Un peu d’eau...
– Ah ! tu veux de l’eau, fit César dans un ricanement sinistre. Attends, mon frère, je vais te faire boire !...
Alors on vit une chose monstrueuse. César Borgia se baissa, saisit son frère par les pieds et, traînant ainsi le corps dont la tête livide s’ensanglantait sur les dalles, il l’emporta en hurlant :
– De l’eau pour mon frère François ! De l’eau pour l’amant de Lucrèce !... Toute l’eau du Tibre pour le duc de Gandie !...
César parcourut ainsi une enfilade de pièces et parvint enfin à une dernière porte. Il l’ouvrit lui-même... Le Tibre était là qui coulait dans la nuit. César souleva le corps et, d’une poussée violente, le lança dans le fleuve.
Les témoins de cette scène s’étaient enfuis, blêmes d’horreur et d’effroi... Alors Lucrèce Borgia s’élança vers la portière de brocard, la souleva et pénétra dans une sorte de cabinet à peine éclairé.
Là, un vieillard aux traits rudes et empreints d’une indéfinissable malice était assis dans une sorte de fauteuil. Ce vieillard avait tout entendu, tout vu !... C’était le père de François, duc de Gandie, le père de César, duc de Valentinois, le père de Lucrèce, duchesse de Bisaglia, c’était Rodrigue Borgia... C’était le pape Alexandre VI...
– Êtes-vous content, mon père ? demanda Lucrèce.
– Per bacco, ma fille, tu as été un peu loin... Ce pauvre François !... Enfin, je dirai moi-même une messe pour le repos de son âme !... C’est dommage, peccato !... C’était un bon diable, ce François... mais... mais le duc de Gandie gênait mes projets... Allons, adieu, ma fille... je te donne la bénédiction pontificale, que ce nouveau péché te soit entièrement remis...
Lucrèce s’inclina. Le pape se leva, étendit la dextre. Lorsque Lucrèce Borgia se releva, son père avait disparu.
V
Les caprices de Lucrèce
Lucrèce Borgia rentra dans la salle du festin et s’aperçut qu’elle était vide.
– Les lâches, murmura-t-elle, ils ont fui... l’ivresse de l’épouvante a remplacé dans leurs veines l’ivresse de la volupté... Ah ! il n’y a pas d’hommes !... Mon père en fut un... mais c’est un vieillard... Pourquoi la nature m’a-t-elle donné ce sexe, à moi... à moi qui me sens d’appétit à dévorer un monde...
Elle se renversa sur une pile de coussins, et s’étira.
Une ombre se dressa près d’elle tout à coup. Elle tourna négligemment la tête.
– C’est vous, mon frère ? dit-elle en tendant la main à César.
Il venait de rentrer, et qui l’eût vu en ce moment n’eût jamais pu supposer que cet homme venait d’assassiner son frère. Il montrait un visage enjoué à sa sœur qui, de son côté, le regardait en souriant. C’était quelque chose d’effroyable que le double sourire de ce couple monstrueux.
– Méchant ! fit Lucrèce, pourquoi avez-vous fait du mal à ce pauvre François ?... Vous étiez donc jaloux ?...
– Ma foi, oui, Lucrèce... Il me déplaît que, devant mes amis, en quelque lieu que ce soit, en quelque circonstance qui se présente, je ne sois pas le premier...
Lucrèce hocha la tête et demeura pensive.
– Au fait, reprit-elle soudain, mais tu hérites, mon César... Cette mort t’enrichit, toi déjà si riche... et l’« accident » te fait duc de Gandie...
– C’est vrai, petite sœur... mais tu auras ta part. Je te réserve un million de ducats d’or sur la succession... es-tu contente ?...
– Mais oui, répondit Lucrèce avec un bâillement. J’avais justement envie de bâtir un temple...
– Un temple ? s’écria César étonné.
– Oui... un temple à Vénus... Je veux rétablir son culte dans Rome... Je veux que le temple s’élève entre Saint-Pierre et le Vatican... Et, tandis que notre père dira sa messe, au prochain jour de Pâques, en son temple chrétien, je veux, moi, dire la mienne en mon église païenne, et nous verrons qui des deux aura le plus de fidèles.
– Lucrèce, s’écria César, tu es vraiment une femme admirable. Ton idée est sublime.
– Moins que ton idée de t’emparer de l’Italie et d’en faire un seul royaume dont tu serais le roi, le maître absolu, mon César...
– À nous deux, Lucrèce, lorsque j’aurai réalisé mon plan, à nous deux, nous dominerons le monde et nous le transformerons...
À ce moment, un bruit de clameurs s’éleva près d’eux. Ils prêtèrent l’oreille. Le bruit venait des appartements du palais.
Lucrèce jeta un manteau de soie sur ses épaules et, précédée de César, s’élança dans le vestibule aux statues, puis ouvrit la porte de bronze. Le frère et la sœur s’arrêtèrent sur le seuil.
Une trentaine de domestiques hurlant, vociférant, tourbillonnant, se bousculant, se culbutant, entouraient ou essayaient d’entourer un homme, un étranger qui tenait tête à toute la meute enragée.
– Quel est l’insolent ?... s’écria Lucrèce.
Elle allait s’élancer. César la saisit par le poignet et la retint.
– Eh ! s’écria-t-il, c’est mon petit Français... Je lui avais donné rendez-vous ici, à minuit... Par le diable ! Quel gaillard ! Quels coups ! Pan ! à droite ! Pan ! à gauche ! En voici deux à terre... et deux autres qui crachent leurs dents !
César, enthousiasmé, battit des mains, frénétiquement ! L’homme qui s’escrimait contre la meute des valets, à la grande admiration de César et à la grande satisfaction de Lucrèce, était en effet le chevalier de Ragastens. Comme minuit sonnait, il s’était élancé de l’auberge du Beau-Janus.
– Oh ! l’abominable vision ! songeait-il tout en courant. Cet homme dans le Tibre !... Ce malheureux qu’on vient d’assassiner... oh ! ces deux mains crispées sur la dalle... ce corps qui disparaît dans les eaux noires... Et ces paroles mystérieuses... On veut enlever Primevère !... Et celui qui veut l’enlever, c’est précisément l’assassin ! Mais qui est cet assassin ?... Où le trouver ?... Comment prévenir le comte Alma ?... Il faut que je raconte ces étranges événements à l’illustre capitaine qui m’attend... Lui seul, à Rome, est assez puissant pour démêler la vérité, et prévenir peut-être de nouveaux meurtres !...
En monologuant ainsi le chevalier atteignit rapidement le palais de Lucrèce. Il voulut pénétrer sous la colonnade que nous avons décrite. Mais les deux gardes équestres se jetèrent au-devant de lui.
– Au large ! ordonnèrent-ils.
– Eh ! l’ami, fit Ragastens, doucement, que diable ! On m’attend en ce palais...
– Au large ! répondit le garde.
– Vous êtes bien entêté, mon cher !... Je vous dis que je suis attendu... par monseigneur César Borgia, s’il vous plaît !... Place donc !...
Non seulement le cavalier n’obéit pas à cette injonction, mais encore une douzaine de valets, attirés par le bruit, accoururent et se ruèrent sur le chevalier.
– Oh ! oh ! s’écria Ragastens, il paraît que la valetaille est enragée en ce beau pays... Morbleu !... Est-ce qu’ils oseraient porter la main sur moi ! Arrière, valets !
De fait, l’air du chevalier devint si terrible que les domestiques reculèrent, effarés. Mais le garde, lui, fonça sur le jeune homme. Ragastens comprit que sa victoire serait de courte durée et qu’il allait être cerné, malmené, s’il ne faisait pas un exemple salutaire.
En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, il s’élança sur le garde et se suspendit à sa jambe, cherchant, par de violentes secousses, à lui faire perdre l’équilibre.
À la première secousse, le garde vociféra un « sang et tripes ! » à faire trembler les fenêtres des maisons environnantes, et se raccrocha à la crinière de son cheval.
À la deuxième secousse, il leva le pommeau de son sabre pour en assommer son impétueux adversaire. Mais il n’eut pas le temps de mettre ce projet à exécution.
Une troisième secousse venait de se produire, plus violente que les deux premières. La bouche du cavalier, qui s’apprêtait à envoyer à toute volée un nouveau juron bien senti, demeura entrouverte et silencieuse de stupéfaction. Ragastens, de son côté, avait reculé de plusieurs pas et avait failli tomber...
Qu’était-il arrivé ?... Avait-il lâché prise ?... Non !... Il arrivait tout simplement qu’à force de tirer sur la jambe du géant, Ragastens avait fait venir l’énorme botte du cavalier, et que celui-ci, hébété de surprise, demeurait déchaussé d’un pied, mais toujours vissé sur son cheval, tandis que le chevalier, emporté par l’élan de la secousse, reculait, tenant à pleines mains une botte gigantesque...
Il y eut une débandade parmi les valets. Mais cette hésitation fut de courte durée. Les assaillants avaient reçu du renfort. Ils étaient maintenant une trentaine, armés de bâtons.
Ragastens jeta les yeux autour de lui et se vit entouré de toutes parts.
– Ah ! maroufles, tonna-t-il, ah ! ramassis de primauds ! C’est à coup de bottes que je vais vous chasser...
Et il fit comme il avait dit !... Saisissant la botte par le pied, il se servit de la tige comme d’une masse d’armes et exécuta un moulinet terrible. En même temps, il se dirigea vers l’escalier qu’il atteignit en quelques enjambées toujours poursuivi par la meute hurlante.
Au bout de l’escalier, Ragastens se vit dans une salle immense... Il choisit son champ de bataille, et s’accula à un coin. Alors, ce fut épique.
Ragastens manœuvrait sa tige de botte comme Samson dut jadis manœuvrer sa mâchoire d’âne pour en assommer les Philistins. Cette tige tourbillonnait, voltigeait au-dessus de sa tête.
À chaque instant, comme une claque retentissante, elle s’abattait sur une tête, sur une joue, sur un dos... Il y eut des cris de douleur, des grincements de dents, des menaces apocalyptiques proférées à tue-tête par la bande affolée. Cela dura jusqu’au moment où, une dizaine de valets étant hors de combat, les autres reculèrent en désordre, en appelant au secours...
Maître du champ de bataille, sans une égratignure, son manteau à peine dérangé, Ragastens partit alors d’un éclat de rire formidable et s’écria :
– Allons, valets ! Allez prévenir votre maître que le chevalier de Ragastens est à ses ordres...
– Je suis tout prévenu, fit une voix, vous vous chargez de vous annoncer vous-même, monsieur !...
Ragastens se retourna et se trouva en présence de César et de Lucrèce. Une seconde, il demeura ébloui, fasciné par la beauté fatale de la fille du pape. Lucrèce vit l’effet qu’elle venait de produire et elle sourit. Mais déjà le chevalier se remettait, s’inclinait et répondait :
– Monseigneur, et vous, madame, daignez m’excuser d’avoir quelque peu malmené vos valets... Je n’ai d’autre défense à présenter que l’ordre que vous m’aviez donné de me trouver ici à minuit... Or, pour être à un tel rendez-vous, j’eusse passé à travers une légion de démons...
– Venez, monsieur, dit César, c’est moi qui suis coupable de n’avoir pas prévenu ces imbéciles...
Ragastens suivit le frère et la sœur, tandis que les valets, courbés jusqu’au sol, demeuraient stupéfaits de l’accueil fait à cet intrus si mal vêtu.
Près des Nubiens, postés à la porte de bronze, Lucrèce s’arrêta un instant. Les deux muets n’avaient pas bronché. Ils avaient une porte à garder : ils la gardaient.
– Et vous, demanda-t-elle, qu’eussiez-vous fait si on eût essayé de franchir cette porte ?
Les noirs sourirent largement en montrant une double rangée de dents éblouissantes. Ils touchèrent du bout du doigt le fil de leurs yatagans, puis ils montrèrent le cou du chevalier.
– C’est clair ! fit celui-ci en riant : ils m’eussent tranché le col. Mais, pour avoir le bonheur de vous contempler, madame, je jure que j’eusse affronté ce péril...
Lucrèce sourit de nouveau. Puis, ayant tapoté la joue des deux Nubiens, ce qui parut les plonger dans une extase de ravissement, elle passa, suivie de César et du chevalier.
Elle les conduisit dans une sorte de boudoir dont Ragastens admira le luxe raffiné. Mais le chevalier se garda bien de laisser paraître les sentiments qui l’agitaient.
– Ma sœur, dit alors César, monsieur est le chevalier de Ragastens, un Français, un enfant de ce pays que j’aime tant... Son titre de Français serait donc une suffisante recommandation à vos bontés, ma chère sœur... mais ce n’est pas tout : lors de mon voyage à Chinon, M. le Chevalier que voici me sauva la vie...
– Oh ! monseigneur, vous êtes trop bon de parler de cette misère, fit le chevalier ; je ne vous ai rappelé cette aventure que pour me faire reconnaître...
– J’aime les Français, dit à son tour Lucrèce, et j’aimerai M. le chevalier particulièrement, pour l’amour de vous, mon frère... Nous vous pousserons, chevalier...
– Ah ! madame, je suis confus de la faveur que vous me faites l’honneur de me témoigner si promptement.
– Vous la méritez, fit Lucrèce avec enjouement. Mais j’y pense, ajouta-t-elle tout à coup... Vous devez avoir besoin d’un rafraîchissement, après cette grande bataille... Venez, venez, chevalier !
Elle le saisit par la main et l’entraîna. Le chevalier fut agité d’un frisson. Cette main tiède, langoureuse, parfumée avait serré la sienne.
L’aventurier ferma les yeux une seconde, la gorge nouée par l’angoisse d’inexprimables voluptés.
– Tant pis ! songea-t-il. Je risque gros peut-être... Mais la partie en vaut la peine.
Et sa main, fortement, presque brutalement, rendit la pression amoureuse à la main de Lucrèce. L’instant d’après, ils se trouvaient dans la fabuleuse salle des festins...
Enfiévré, Ragastens se crut transporté dans quelque paradis mahométan... Lucrèce elle-même plaçait devant lui des cédrats confits, des pastèques glacées par un procédé qu’elle avait imaginé, puis elle versait dans sa coupe un vin qui moussait et pétillait.
– Buvez, dit-elle avec un regard qui acheva de bouleverser le chevalier... C’est du vin de votre pays... mais je le fais traiter par une méthode spéciale...
Le chevalier vida sa coupe d’un trait. Ses veines charrièrent des flammes...
Il goûta aux confitures que lui présentait Lucrèce. Et ses tempes se mirent à battre, tandis que son imagination s’ouvrait à des visions délirantes...
– Madame, s’écria-t-il, je bois, je mange, j’entends, je vois... et je me demande si je ne fais pas quelque rêve splendide après lequel la réalité me paraîtra plus cruelle !... Où suis-je !... Dans quel palais enchanté !... Dans la demeure de quelle adorable fée !...
– Hélas ! vous êtes simplement chez une mortelle... chez la pauvre Lucrèce Borgia, qui cherche à se distraire et qui y arrive rarement.
– Quoi ! madame, vous seriez malheureuse ? Ah ! dites quel vœu vous avez formulé... lequel de vos désirs est resté inassouvi... Morbleu ! quand je devrais remuer le monde... quand je devrais, comme les Titans de jadis, escalader l’Olympe pour aller demander le secret du bonheur...
– Bravo chevalier ! s’exclama César. Et s’il ne suffit pas de l’Olympe, nous escaladerons le ciel pour demander au Père Éternel la recette des confitures idéales par quoi Lucrèce se tiendra satisfaite !...
– Je ne suis qu’un gentilhomme sans fortune, répondit Ragastens en reprenant son sang-froid. Mais j’ai un cœur qui sait vibrer, un bras qui ne tremble pas et une épée ; je les mets, madame, à votre dévotion, trop heureux si vous daignez en accepter l’hommage.
– J’accepte cet hommage, dit Lucrèce, avec une gravité qui fit tressaillir le chevalier.
– Et maintenant que vous voilà l’homme-lige de la duchesse de Bisaglia, reprit César, voyons, chevalier, à vous trouver une situation officielle où vous puissiez utiliser vos talents... Je puis obtenir de mon père un brevet de garde-noble pour vous.
– Monseigneur, fit le chevalier, rappelé par ces paroles à la réalité, je vous avoue que j’aimerais mieux autre chose.
– Diavolo ! Vous êtes difficile, mon cher ! Les gardes-nobles doivent prouver six quartiers de noblesse... et, après tout, ajouta-t-il, avec une brutalité voulue, j’ignore, au fond, qui vous êtes...
Ragastens se leva et se campa fièrement.
– Monseigneur, dit-il d’une voix mordante, vous ne m’avez pas demandé mes parchemins à Chinon.
– Aïe ! je suis touché ! fit César.
– Quant à mes titres de noblesse, ils sont écrits sur mon visage ; chez nous, les gentilshommes se devinent au premier coup d’œil... et ces titres, je suis prêt à les contresigner du bout de ma rapière.
– Bravo ! Bien riposté !...
– Puisque vous pensez que je suis venu en Italie pour monter la garde dans les églises, autour d’un vieillard qui dit des prières, adieu, monseigneur !...
– Eh là ! Quel diable d’enragé êtes-vous donc... ? Je sais, parbleu, que vous méritez mieux ! Aussi, ne vous l’ai-je proposé que pour vous éprouver... Vous me plaisez, tel que vous êtes... La manière dont vous avez arrangé mon terrible Astorre, dit l’Invincible, vos réponses, votre air, et jusqu’à cette magnifique volée, tout à l’heure... ah ! cela surtout... j’en ris encore...
César se renversa, riant en effet à pleine gorge. Le chevalier se rassit, en souriant.
– Donc, vous voulez entrer à mon service ?...
– Je vous l’ai dit, monseigneur !
– Eh bien, c’est fait, monsieur... Dans peu de temps, je vais recommencer la campagne contre certains principicules qui se croient tout permis... Mais je m’entends... À ce moment-là, je compterai sur vous, chevalier. Les hommes braves et spirituels sont rares... je vous connais depuis quelques heures, mais le peu que j’ai vu me répond de vous... Chevalier de Ragastens, vous entrerez en campagne sous mes ordres, à la tête d’une compagnie.
– Ah ! monseigneur, fit Ragastens en bondissant, que dites-vous là ?... Vous voulez vous moquer, sans doute...
– Après-demain, au château Saint-Ange, venez chercher votre brevet...
Ivre de joie, tous ses rêves dépassés d’un coup par la plus singulière fortune, le chevalier s’inclina, saisit la main de César et la porta à ses lèvres...
– Maintenant, vous pouvez vous retirer, monsieur... Un mot encore, cependant. Ce matin, lorsque vous fîtes peur à ce bon Garconio, vous avez rencontré une jeune dame vêtue de blanc et montée sur un cheval blanc ?...
Il allait parler... Il cherchait les mots qui devaient assurer à Primevère les bonnes grâces de César... Tout à coup, une pâleur livide s’étendit sur son front. Les paroles s’étranglèrent dans sa gorge...
En s’inclinant, Ragastens avait jeté les yeux, par hasard, sur la mosaïque de marbre qui formait le plancher de la salle. Et il venait d’apercevoir une large tache de sang !...
Pourquoi cette vue arrêta-t-elle les mots irréparables qu’il allait proférer... Frémissant, il se tut...
– Eh bien, monsieur, fit César, vous alliez dire...
– J’allais dire, monseigneur, que j’ai en effet rencontré la dame dont vous me parlez et que j’ai bien regretté d’avoir interrompu la conversation de ce digne moine, lorsque j’ai su qu’il était à vous !
– Ainsi, reprit Borgia devenu sombre, vous ne la connaissez pas ?...
– Comment la connaîtrais-je, monseigneur ?... J’ignore son nom : je ne sais même pas par quel chemin elle a disparu...
– Bien, monsieur... Vous pouvez vous retirer. Après-demain, au château Saint-Ange... N’oubliez pas !
– Diable, monseigneur, pour oublier, il faudrait que j’eusse perdu l’esprit.
Et Ragastens, de l’air le plus naturel du monde, fit une profonde et gracieuse salutation à Lucrèce, qui lui donna sa main à baiser. Puis il sortit, se réservant de réfléchir à la découverte qu’il venait de faire.
Ses soupçons éveillés, il se demandait maintenant si toute cette aventure, commencée comme un beau rêve, n’allait pas aboutir à quelque traquenard. Avec un frisson, il se rappela les avertissements de Primevère. À ce moment, une petite main douce saisit la sienne et une voix lui glissa à l’oreille :
– Venez, et ne faites pas de bruit...
Ragastens était brave. La voix n’avait rien de sinistre au contraire... Et pourtant, il fut saisi d’un malaise. Mais il se remit promptement et, s’en remettant à sa bonne étoile, il suivit son guide féminin.
Après des tours et des détours, il se retrouva tout à coup dans la salle des festins. La vaste pièce était maintenant faiblement éclairée par un seul flambeau. Le cœur de Ragastens battait à rompre.
– Ne bougez pas... ne remuez pas, murmura son guide, et attendez ici... jusqu’à ce qu’on vienne vous chercher.
Puis la servante qui avait conduit le chevalier disparut.
Les yeux de Ragastens furent aussitôt invinciblement attirés vers la tache de sang... Elle était là encore... Il s’approcha sur la pointe du pied... se baissa... toucha le sang... il n’était pas encore complètement coagulé.
– Il y a une heure à peine que ce sang a été répandu ! murmura-t-il... Oh ! Qu’est cela ?...
Une autre tache apparaissait plus loin... puis d’autres... tout un chemin rouge, une piste sanglante ! Haletant, il suivit cette piste, courbé sur les dalles, pas à pas...
Il arriva à une porte et mit la main sur le verrou... La porte s’ouvrit... Au-delà, la piste continuait...
Guidé par elle, Ragastens traversa plusieurs salles et parvint enfin à une dernière porte qu’il ouvrit. Il étouffa alors une exclamation de surprise épouvantée. Il se trouvait au bord du Tibre !...
Un instant, il eut la pensée de se laisser glisser dans le Tibre, de se sauver... Mais l’idée de fuir – de fuir devant une femme ! – le révolta.
Il raffermit son épée, ferma la porte et rapidement, d’un pas léger, regagna la salle des festins, toujours obscure et silencieuse. Quelques minutes pleines d’angoisse s’écoulèrent.
Enfin la même servante reparut. Comme tout à l’heure, elle le prit par la main et lui fit traverser trois ou quatre pièces obscures. Elle s’arrêta alors devant une porte et lui dit simplement :
– Vous pouvez entrer.
Ragastens hésita une seconde ; puis, haussant les épaules, poussa la porte...
Il se trouva au seuil d’une sorte de réduit mystérieusement éclairé, comme le sont les chapelles, pendant les nuits de prières.
Au fond de ce réduit, sur un amas de peaux de panthères, une femme !... Une femme nue qui souriait, les bras tendus... C’était Lucrèce !...