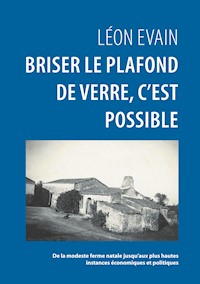
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre retrace le parcours de l'auteur depuis sa naissance dans la modeste ferme en Pays de Retz (Loire Atlantique), en passant par les études à la grande ville jusqu'à la vie professionnelle parisienne dans une grande multinationale de l'informatique. Cet ouvrage souhaite montrer aux jeunes générations issues d'un milieu modeste qu'il est possible d'évoluer vers de belles situations même si même si le milieu familial est peu favorable par des moyens financiers limités. Ces jeunes réussissent à briser le "plafond de verre" où ils sont enfermés sans le savoir. On dit souvent qu'ils ont réussi à prendre "l'ascenseur social". Les recettes de la vente de ce livre sera reversée aux actions de Promotion des études Scientifiques délivrées par les Ingénieurs et Scientifiques de France.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
A Nicole
A Olivier et Emmanuelle
A Gurvan, Stérenn, Côme, Léandre et Clotilde
Et à tous les jeunes lecteurs et leurs familles qui, un peu inhibés par leur origine familiale modeste, prendront de l’assurance et iront découvrir le monde pour mieux exploiter leurs capacités.
En souvenir de mes parents émérites Agnès et Léon, mes grands-parents racines de la famille Marie et Eugène, Philomène et Henri et mes brillants grands oncles Emile, François et Pierre.
Ceci est une autobiographie, elle relate des faits vécus avec des personnages tout aussi réels. Afin de préserver la confidentialité des personnes extérieures à la famille, il a été fait appel à des noms et prénoms d’emprunt.
Seules les photos titrées sont issues de l’album familial.
Avant-propos
La vie est une suite de rencontres et de choix qui après coup deviennent déterminants dans le déroulement de cette existence.
Très souvent, l’environnement familial façonne inéluctablement la vie future des enfants qui y naissent.
Les jeunes issus des milieux citadins sont quelquefois mieux informés que les enfants de la campagne nés dans un environnement souvent plus modeste financièrement et culturellement.
Certains de ces jeunes ruraux peuvent néanmoins réussir à briser le « plafond de verre » qu’ils se fixent et où ils sont enfermés sans s’en apercevoir.
Dans le langage courant, il est convenu de dire que ces jeunes ont réussi à prendre « l’ascenseur social » qui les fait passer d’une condition modeste à un profil de vie de condition supérieure.
Au siècle dernier, ceci était particulièrement vrai pour les enfants de paysans. En ce 3ème millénaire, les moyens d’information et les facilités de voyage lissent un peu mieux ces disparités, néanmoins globalement les citadins font souvent de meilleures études et obtiennent de meilleures positions sociales que les ruraux.
Dans ce modeste écrit, mon parcours personnel doit donner espoir et envie aux enfants et aux parents qu’il est possible d’aller vers une belle réussite, même si le point de départ n’est pas dans les quartiers riches et huppés des grandes villes.
« Notre vie est un voyage constant de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment, mais le train continue.
La vie c’est le train, ce n’est pas la gare ».
Paulo Coehlo
Sommaire
____
Une jeunesse à la campagne
Le Pays de Retz dans les années 50
Nos ancêtres les paysans
Un jour de 1949
La vie familiale en Pays de Retz
Une nouvelle vie
Modernisme et mécanisation
Animaux et nourriture
Les pratiques religieuses à mi 20ème siècle
En route vers le paradis
Fêtes de Pâques au village
Le train à vapeur
La grosse Bertha
Effluves alcoolisées
Tragédie à la campagne
En avant la musique
Le géant de la musique
La valeur ajoutée
Les vacances paysannes
Les trois frères Pruneau
L’oncle propriétaire
L’oncle entrepreneur
L’oncle ingénieur
Le tablier de grand-mère
L’expédition dans les marais
Les vendanges automnales
La route sous la mer
Le voyage à la capitale
L’enseignement élémentaire
L’école Saint Roch
Un recrutement particulier
Les petits jobs estivaux
La grande ville
L’arrivée à l’internat
Des repas bien studieux
Des ablutions originales
Retour à la ville
Les loisirs à la ville
Des brebis blanches et des brebis égarées
Le lycée Livet à Nantes
Louis-Ange-Hyacinthe Pommeraye
Le grand saut parisien
Les études capitales
A chacun son langage
Un pied dans la rue, l’autre dans l’aristocratie
Les premières armes à EDF
Au service de l’armée
Une vie très spartiate
En route vers le monde
En route pour l’Amérique
Une arrivée mouvementée en terre étrangère
Un déjeuner au sommet
Un repas pour 5000 convives
Les quatre opérations
Le conflit Euro-Américain
Au cœur des finances de la France
Des helvètes enthousiastes
Une conférence européenne au sommet
Des histoires singulières
La marée à San Francisco
Un dossier explosif
Le petit pingouin Finlandais
Les romains et la navette spatiale
Le méchant bug menaçant les mille milliards
Les mille milliards et après
La vache et l’ordinateur
Dis-moi c’est quoi l’intelligence artificielle
De brillants parcours
Djamila la berbère
A l’école dans la piscine
Tous les chemins mènent à Rome
Un parcours très atypique
Une banale conversation
Des scientifiques engagés
A peine 1%
Les aléas de la politique
Au plus haut sommet de l’état
En guise de conclusion
Et moi je reste là
Le train de ma vie
Aux jeunes générations
Le Pays de Retz dans les années 50
Depuis 1790, année de création des départements français, la Loire Inférieure numérotée 44 était le département du cours inférieur de la Loire près de son embouchure sur l’océan atlantique.
Le nom avait une connotation dévalorisante. En 1957 il lui fut donné le nom bien plus ambitieux de Loire Atlantique, qui du coup, rompait la numérotation selon la liste alphabétique du nom des départements.
Néanmoins le découpage administratif du royaume par département était basé sur le principe d’un temps de déplacement maximum d’une journée pour aller à cheval à la ville chef-lieu. Peut-on imaginer aujourd’hui qu’il faille un jour pour se rendre à la ville principale de la région. Maintenant en avion en ces mêmes 24 heures, on y fait quasiment le tour de la planète.
Dans ce département, le Pays de Retz est resté quant à lui la partie sud de l’estuaire de la Loire formé par le triangle élargi et très approximatif des villes de Nantes et St Nazaire, et de l’ile de Noirmoutier.
Au 15ème siècle, disciple de Jeanne d’Arc, le seigneur Gilles de Retz (que l’on écrivait alors Gilles de Rais) était le maître des lieux dans son château de Machecoul. Il était bien connu pour son goût prononcé pour les petits enfants ce qui lui valut l’échafaud.
Bien que situé au sud de la frontière naturelle qu’est la Loire, le pays de Retz est à la confluence des influences de la Bretagne et de l’Anjou. Ce pays bocager de marais et de zones humides a été une terre d’accostage pour les pirates Vikings et les marchands de la Hanse en quête du sel de la baie de Bourgneuf. C’est donc un pays varié issu de multiples identités.
Au centre de ce pays de Retz, éloigné de la côte atlantique et des villes centres telles que Nantes ou Saint Nazaire, la bourgade de St Père en Retz était au siècle dernier une contrée majoritairement paysanne comptant 2500 habitants. C’était un carrefour marchand pour les animaux et les produits agricoles, la tradition de la foire subsiste d’ailleurs encore de nos jours.
En ce temps-là, cette population rurale vivait quasiment en autarcie, du fruit de son élevage et de ses cultures.
Les fermes de l’époque étaient loin de gérer les centaines d’hectares nécessaires à la viabilité d’une exploitation agricole d’aujourd’hui.
Comme ses voisines, l’exploitation de La Garnière couvrait tout au plus 21 ha. Pour y faire vivre les deux grands parents, les deux parents et les cinq enfants, on y trouvait le cheval de trait, le cheptel de 5 à 6 vaches, 3 à 4 cochons, et la dizaine de poules minimum pour satisfaire le gros appétit du coq de la basse-cour.
Les terrains étaient quant à eux couverts de prairies, ensemencés de 4 à 5 ha de blé et d’autant de champs de pommes de terre, de choux et betteraves pour la nourriture des animaux et des hommes. Un modeste jardin potager faisait l’appoint sur les autres légumes.
La vie était rude, cadencée par les travaux au fil des saisons : labours et semailles des céréales en automne, travaux d’entretien et coupe du bois de chauffage pendant l’hiver, activités printanières pour les légumes, récoltes en été.
A longueur d’année et chaque jour, sans possibilité de souffler un moment, la vie était inlassablement rythmée par la traite des vaches deux fois par jour quelle que soit la météorologie, tôt le matin à 7h, et le soir vers 18h.
La maison familiale regroupait sous un même toit les trois générations. Cette maison m’a vu naitre et passer les premières années de ma vie.
Il est important de ne pas oublier d’où l’on vient pour comprendre où l’on veut aller.
Proverbe africain
Nos ancêtres les paysans 1
Afin de mieux comprendre la vie en milieu rural, il peut être utile de revenir sur l’environnement et la hiérarchie de nos aïeuls paysans dans l’Ouest de la France.
Cette partie occidentale de la France est une terre de bocage entourée de haies. Autrefois, les parcelles avaient une surface de quelques centaines de mètres carrés, elles étaient accessibles par des chemins creux, les habitations isolées étaient dissimulées et entourées de saules têtards un peu têtus.
Ces terres peu riches étaient cultivées selon l’assolement triennal : la première année pour la culture du blé, la seconde pour les légumes et céréales de printemps et la dernière année la parcelle était laissée en jachère pour se régénérer.
Les baux étaient majoritairement signés selon une convention de métayage, la rémunération au propriétaire se réalisait en nature par la livraison d’une partie de la récolte.
Le bail par fermage propose le paiement d’un loyer fixe en argent, il a été adopté plus tardivement.
Au tout début du siècle dernier, l’échelle sociale était bien marquée :
- En bas de l’échelle un très petit nombre de paysans totalement démunis ne possédaient pas de biens, ils étaient réduits à la condition de mendiants. Ils ont disparu au cours du 20ème siècle.
- Un peu plus haut dans la hiérarchie, les paysans dépendants disposaient de micro parcelles, ils étaient ouvriers agricoles pour le compte de plus gros exploitants.
- Disposant d’une exploitation de moins de 10 ha sans matériel de labour, les petits paysans étaient en dessous de l’indépendance économique, ils devaient exercer un métier complémentaire.
- Les cultivateurs eux disposaient jusqu’à 20 ha. Possédant un train de labour, ils accédaient à l’indépendance économique et pouvaient même vendre quelques surplus.
- Avec 30 ha en fermage ou en métayage, les paysans aisés se faisaient aider par une main d’œuvre familiale.
- La catégorie la plus riche des paysans dominants pouvait exploiter plus de 100 ha en fermage avec des salariés.
On peut considérer que le seuil de dépendance économique pour faire vivre une famille complète nécessitait une surface cultivable d’environ 10 ha avec un cheval, sa charrue, le tombereau ainsi que le jardin et les animaux.
En Pays de Retz, la majorité des exploitations étaient des cultivateurs à la limite de l’autosuffisance.
Dans cette société rurale, ces différentes catégories paysannes étaient bien reconnaissables chacune par :
- Leur type d’habillement
- Leur type d’alimentation
- Leur place à l’église
- Et les marques de respect réciproques
Il était très difficile de s’extraire de sa condition de naissance pour s’élever socialement.
Le mariage et l’héritage étaient des moyens exceptionnels pour avancer. L’apprentissage, le départ pour la ville et la possibilité de payer des études aux enfants étaient d’autres voies d’évolution.
C’était déjà des moyens d’émancipation.
Il y a 120 ans nos ancêtres paysans représentaient 50% de la population active, de nos jours, ils ne pèsent guère que moins de 3 à 4%.
C’est donc l’environnement vécu par mes parents et grands-parents, cultivateurs à la ferme de La Garnière en Saint Père en Retz.
Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source et un arbre sans racine.
Proverbe chinois
1 Extraits de Hiérarchie et ascension sociale de nos ancêtres paysans, Thierry Sabot, Editions Thisa
Un jour de 19492
Au milieu du 20ème siècle, le niveau d’éducation était souvent limité au diplôme du Certificat d’Etudes Primaires.
Ce sésame permettait à chacun de savoir lire, écrire et compter.
Les personnalités du bourg avaient reçu un niveau d’éducation supérieur, c’étaient Monsieur le Maire, Monsieur l’Instituteur, Monsieur le Curé mais aussi le Notaire et le Médecin.
Le vieux docteur Mouillé soignait tant bien que mal les patients du Pays de Retz, il faisait partie de l’ancienne génération. Son principal outil de travail était son vieux stéthoscope limé par le temps, sinon c’était la prise de pouls et les seules palpations avec ses doigts noueux. Il avait appris que le sang était un élément primordial de la santé et qu’il fallait réguler son fonctionnement, il avait pour cela deux cordes à son arc : les sangsues et les ventouses.
Petit animal de la famille des vers annelés, la sangsue était utilisée depuis plus de 2 000 ans dans l’antiquité égyptienne. Collée à la peau, avec ses 240 dents elle mordait et aspirait le « mauvais sang » à l’endroit de la congestion, avantage supplémentaire sa salive était anti-inflammatoire et anticoagulante. Il était fortement conseillé de ne pas ôter l’animal au risque d’arracher la peau. Une fois bien gavé, son festin terminé, l’animal se détachait de lui-même. A son apogée, la France en importait chaque année plus de 57 millions d'Europe de l'Est.
La ventouse est un récipient en verre et en forme de cloche. On chauffait la ventouse en y insérant et en y enflammant du coton imbibé d’alcool, le feu éteint, l’oxygène avait disparu, on posait la ventouse sur le dos du malade. En refroidissant elle aspirait la peau, une petite incision sur cette peau boursouflée suffisait à provoquer la réaction.
Le Dr Mouillé constatait le résultat, mais n’en connaissait pas les raisons du fonctionnement. En fait, ces deux dispositifs permettaient de diminuer la tension, d’éliminer les toxines et de traiter le sang pour le fluidifier et éviter les embarras cardiaques, les ventouses agissaient aux points de notre acupuncture d’aujourd’hui, tout s’explique.
Son traitement de prédilection consistait à accrocher son chapeau sur le pied de lit, à faire ingurgiter au malade la potion bien améliorée et quand le chapeau commençait à danser, on arrêtait le traitement.
Nouvel arrivé dans le pays, le jeune Dr Frimaudeau utilisait peu son petit bureau de la rue Gloriette, il préférait plutôt se déplacer chez ses patients, jusqu’aux fermes les plus reculées. Jean Frimaudeau a publié un livre de souvenirs qui reflète sa vie de l’époque dans la campagne de St Père en Retz, « Les Hôpitaux de plein vent2 », le présent article est bâti sur les témoignages de cette parution.
Il faut imaginer que la plupart des voies de circulation n’étaient pas totalement empierrées. Le pétrole n’était pas encore pleinement exploité, son sous-produit le bitume n’avait pas encore atteint toutes les régions du pays. Les déplacements se réalisaient majoritairement par transport hippomobile en tombereau pourvu de très grandes roues à rais en bois cerclées de métal. Il permettait de passer sans difficulté les profondes ornières de l’époque.
Faute du cheval qui dormait et de l’attelage qui demandait beaucoup de temps à se former, le mercredi 19 janvier 1949 vers minuit, mon père a donc enfourché son vélo et sabots de bois aux pieds il est allé quémander l’aide au Dr Frimaudeau car la naissance était proche.
La ferme n’était qu’à deux kilomètres du bourg, il lui fallait quand même de quinze à vingt minutes pour franchir à pied avec le vélo à la main le chemin boueux de la ferme puis pédaler le dernier kilomètre de la route communale, non pas sur un lisse et bel asphalte du 21ème siècle mais plutôt sur un très irrégulier mélange de gravillons et de terre prompt à faire déraper la bicyclette en cas de freinage trop appuyé. Seule la lueur de la lune éclairait le chemin et permettait d’éviter une chute fatale.
Le bruit des sabots et de la cloche de la maison réveillaient sans difficulté le médecin. Surpris du bruit inopiné, un renard chapardeur en goguette s’échappait queue basse en s’éloignant sur la pointe des pattes le long du bâtiment.
Tout ensommeillé et légèrement vêtu de sa longue chemise jusqu’aux genoux, à travers la fenêtre ouverte de sa chambre, le médecin prenait note de sa future urgence : « Oui ! Qu’est-ce que c’est ? » « Ben les contractions se rapprochent docteur ». Le médecin allait donc endosser son costume de « metteur au monde à la campagne ».
Il enfourchait alors sa motocyclette Dresch 500, moyen de déplacement plus rapide et surtout moins fatigant que la bicyclette. Il n’était pas rare qu’en cours de route, soudainement la moto décide d’arrêter là sa mission, coûte que coûte le reste du parcours devait alors se faire à pied.
Au loin tout près du bouquet d’arbres, la faible lueur montrait le chemin de la maison. Fallait-il prendre la ligne droite au risque de s’enliser dans les bourbiers ou bien faire le grand détour par les chemins ruraux ? Sous la lune et le vent qui sifflait, la campagne givrait, du piquet de clôture à la plus fine branche, tout était blanc, les flaques d’eau étaient vitrifiées.
Tandis que l’air frais sentait agréablement la fumée de bois et que la mare immobile sommeillait gentiment, le gel fendait les lèvres des ornières devenues aussi tranchantes que le soc de la charrue.
Bien à l’abri dans sa niche, étonné par cette activité nocturne inhabituelle, le chien n’osait pas émettre le moindre jappement, il ne pouvait pas imaginer que l’aventure humaine se poursuivait, l’arrivée d’un être neuf dans les prochaines heures. Finalement une « vie de chien » ce n’est pas si mauvais.
Sur le seuil de la maison, le docteur cassait les mottes tassées sous ses semelles lors de son récent périple à pied. D’habitude utilisée pour remonter le goût du café, la bouteille d’eau de vie était sortie pour servir de désinfectant en cas de nécessité.
Assis sur la pierre de l’âtre sous l’auvent de la cheminée, près du chat enroulé la tête dans les pattes et à côté du chien qui venait quémander quelque nourriture, notre médecin attendait l’heure de l’enfantement, le cou fléchi par la menace du sommeil.
De temps à autre, un grain de blé lui tombait sur la tête par les intervalles des planches du grenier et sous l’emprise du feu qui couvait, la bûche éclatait en lançant une flèche de feu tandis qu’une famille de grillons venaient visiter les cendres tièdes.
Le moment arrivait, il accrochait alors au bouton de son veston sa toute nouvelle et moderne lampe de poche à piles. Malheureusement un faux contact l’obligeait à revenir aux classiques dispositifs d’éclairage. Les bougies étaient prestement allumées toute flamme dansant pour accueillir le nouveau-né à 4h30 du matin, soit une semaine de moins que l’anniversaire des neuf mois du mariage.
Le premier cri poussé, l’enfant était allongé dans son berceau en osier bien enveloppé dans une couverture en triple épaisseur pour le protéger du froid glacial de la pièce, fort loin des 37° du ventre de la mère 10 mn auparavant. La sœur garde-malade viendrait visiter la mère et le nouveau-né dès le lendemain.
Le docteur jetait alors sur les braises du genêt des landes qui relançait le feu nouveau et s’embrasait comme pour fêter l’arrivée de la nouvelle âme.
Peut-être surpris par l’arrivée précoce de la naissance, les parents n’avaient en aucune façon pensé au prénom du nouveau-né, il fallait se décider rapidement pour la déclaration à la mairie, plus beaucoup de temps pour réfléchir longuement, finalement tout simplement il allait porter le prénom de son père. La suite de la vie allait apporter son lot de télescopages entre les correspondances destinées soit au père, soit au fils. Cet ancien prénom de vieux lion allait me servir plus tard pour des jeux de mots amusants et dérider les futurs auditeurs lors de conférences un peu austères.
Une fois la naissance bien assurée, la grand-mère Marie se proposait d’offrir une douzaine d’œufs au bon docteur, suite à quoi le Dr Frimaudeau repartait pour le bourg.
Au détour du chemin, au loin dans la brume se profilait sa moto toute habillée de blanc et restée en l’état sous le clair de lune. L’astre se cachait et réapparaissait au gré de la brume qui flottait dans le paysage, signe de la vie qui nait et qui disparait.
Le clocher de l’église sonnait tout juste ses sept coups annonçant l’appel de la messe du matin et l’aube à l’horizon commençait à effacer les derniers mégots des étoiles.
La tâche de la journée allait alors commencer pour notre médecin de campagne, comme si la nuit entière lui avait permis un repos réparateur plein de rêves merveilleux bien au chaud sous sa couette.
Ainsi va le cycle de la vie car la vie est un éternel recommencement
2 Extraits de Les Hôpitaux de plein vent, Jean Frimaudeau, Editions Siloë
La vie familiale en Pays de Retz
La vie de famille n’était pas toujours aisée, les trois générations prenaient leur repas en commun, la grand-mère Marie préparait la nourriture y compris pour le bébé, ma mère n’avait aucune liberté ni autorité pour alimenter son nourrisson, les grands parents décidaient de tout pour tout le monde.
La jeune mère de famille devait quémander à sa belle-mère les quelques francs nécessaires pour l’achat d’un vêtement pour le bébé. La grand-mère donnait alors ses consignes d’habillement pour être digne d’aller à la foire, sous peine d’un retour forcé au logis pour changer de casquette et ainsi se conformer rapidement aux codes vestimentaires non négociables édictés par l’aïeule.
La maison de famille disposait en tout et pour tout comme pièce de vie d’une pièce principale commune. Grâce au feu de bois, on y cuisait les aliments et on y prenait ses repas autour d’une table en long avec un simple banc en bois rustique sans dossier, impossible donc de s’adosser sur cette assise rudimentaire. Le long du grand mur, deux armoires en châtaignier étaient médaillées de tous leurs gonds et fermetures en bronze.
Une unique ampoule électrique blafarde de quelques watts pendue au bout d’un fil torsadé venant du plafond fournissait tant bien que mal une lueur minimale à la pièce. Lors de nos déplacements, les ombres des habitants couraient sur les murs laissant imaginer la présence de quelque être malfaisant. L’électricité venait d’arriver, les lampes à pétrole étaient néanmoins toujours en usage dans les bâtiments pour animaux. Prénommées « lampes tempêtes », elles étaient pourvues d’un réservoir de pétrole lampant aujourd’hui appelé kérosène. Avantage considérable de ces lampes, elles fonctionnaient toujours malgré les coups de vent, elles étaient donc utilisables à l’extérieur sans risque de s’éteindre comme les bougies. Le retour à ces lampes et bougies était fréquent lors des hivers venteux qui abattaient les branches et endommageaient les lignes électriques aériennes peu solides.
Une seconde pièce était la chambre à coucher pour… tout le monde. Dans cette même chambre pouvaient dormir les trois générations tout juste séparées par un simple rideau. Ainsi dans cette pièce, on pouvait y passer toute la vie, du berceau en osier au dernier lit du coin à baldaquin paré de son christ et de sa croix de guerre qui face à face se dévisageaient.
Du côté opposé, près de l’étable, se tenait la laiterie où l’on écrémait le lait pour en séparer la crème et en faire le beurre salé.
Je n’ai pas cité car ils n’existaient pas, ni un quelconque lieu pour se laver ou encore moins un lieu, disons de commodités.
Ceci se passait dans la cabane au fond du jardin. L’été, les insectes et particulièrement les mouches voletaient joyeusement et venaient se poser un peu partout dans tous les recoins de la cabane, coins propres ou moins propres, pour y finir sur nos bras et nos joues. Heureusement il y avait le papier journal soigneusement déchiré en fragments individuels et enfilé sur un vieux clou rouillé. Pendant l’hiver, le gel ne permettait pas de s’y recueillir trop longtemps, le froid intense pouvait d’ailleurs complètement bloquer dame nature. A la lueur de la lampe de poche, le seul voyage hivernal vers la cabane dans la pluie et le vent était une épreuve peu agréable, aux pieds les sabots de bois eux aussi étaient très froids. Les divers bruits de pluie et de vent dans les arbres, les cris de chouette et autres animaux nocturnes ne faisaient qu’ajouter à la frayeur de la nuit. Tout près de là sous l’effet du vent, une boite de conserve abandonnée sifflait son cri plaintif de douleur dans l’inquiétante pénombre.
Dans un coin de la cour devant la maison, le tas de fumier se décomposait. Comme dans les films sur la vie d’autrefois, entouré de ses poules, le coq à la recherche de quelque vermisseau était fier d’y être juché sur ses ergots. Ainsi fort de sa constitution, à l’image d’un sultan dans son harem, la nature lui permettait de satisfaire quotidiennement jusqu’à vingt-cinq poules.
De notre côté, tout près de là dans la rigole d’eau couleur brunâtre qui s’échappait, debout dans nos bottes, nous y pataugions et nous y inventions des dérivations de cours d’eau, des barrages pour la navigation de nos bateaux, je veux dire de menus bouts de branches ressemblant peu ou prou à une embarcation.
Ainsi se déroulait la vie de famille de trois générations sous le même toit.
Le fils d'un paysan aime la terre, le fils d'un pêcheur aime la mer
Une nouvelle vie
Un beau jour par bonheur, il fût décidé que la jeune famille de 4 enfants irait habiter dans une petite habitation de 40 m2 attenante au corps de ferme. Nous y étions heureux car nous avions deux pièces rien que pour nous, une cuisine d’au moins 15 m2 et la chambre d’au plus 25 m2 pour y faire dormir les 6 occupants.
La chaleur humaine de ses habitants suffisait quasiment au chauffage de la pièce. Bien au chaud dans ces quarante mètres carrés, même sans écouter la radio nous avions rapidement une bonne connaissance de la météorologie extérieure. Nous entendions très bien le vent passer dans les jointures délabrées des fenêtres et la pluie battre fortement les tuiles du toit. D’ailleurs nous devions disposer des seaux pour recueillir les fuites d’eau qui s’écoulaient du plafond lambrissé, gare au malheureux qui se levait la nuit et pouvait renverser une bassine à demi remplie. La forte humidité intérieure se retrouvait sur les murs qui suintaient de haut en bas.
Au début des années 50, la révolution est arrivée à la ferme, l’installation d’un système de distribution d’eau du puits. Inimaginable, il suffisait d’un tour de robinet pour que l’eau jaillisse, évitant la corvée du puisage manuel de l’eau à la fontaine avec la chaine et le seau. Le nouveau système de distribution servait en tout et pour tout quatre points d’eau : un unique robinet dans la cuisine de chacune des deux maisons et autant pour chacune des deux étables.
Au même moment, les animaux ont donc eux aussi bénéficié de ce luxe. Sans qu’on les sorte de l’étable pour aller à la mare, ils pouvaient boire en sérénité tout en restant au chaud. L’hiver la situation devenait critique car les conduites d’eau enterrées peu profondément cédaient les unes après les autres sous le gel intense de l’époque, nous n’avions plus d’eau courante pendant toutes les semaines de grand froid, la vie continuait néanmoins, le puits était toujours là pour notre approvisionnement quotidien.
Ce n’est que cinq ans plus tard, qu’un chauffe-eau à bouteille de gaz monté sur le robinet de la cuisine permettait d’avoir tant l’eau courante froide que l’eau courante chaude, chaque chose en son temps, mais gare à la bouteille de gaz vide qui nous laissait sans eau chaude le temps nécessaire pour aller à la ville en acheter une nouvelle avec la charrette à cheval.
La maitresse de maison était peu aidée dans ses tâches ménagères. L’arrivée de la machine à laver le linge lui a apporté une aide précieuse. Fini les corvées harassantes du battage manuel du linge au lavoir, en particulier les couches de coton des enfants ou bien les mouchoirs de tissu bien garnis tout au long de la journée. Le lave-linge « Conord » modèle Cadette de l’époque a permis de réduire la corvée de chauffage de l’eau dans la cheminée, la fée électricité chauffait automatiquement l’eau du linge puis le brassait sans peine. Luxe suprême, la machine était dotée d’une essoreuse à rouleaux qu’il suffisait de tourner à la main pour, comme disait la réclame de l’époque, « éliminer sans peine l’eau du linge ». Il fallait quand même des heures pour réaliser cet essorage très manuel.
Dans le bourg de St Père, une équipe de bénévoles a magnifiquement restauré un lavoir, signe des usages du siècle dernier. Des scènes de reconstitution nous remémorent la vie des ménagères des temps anciens.
La ferme a vu aussi l’arrivée du réfrigérateur. Incroyable, il n’était plus nécessaire d’enfouir la viande dans le charnier de sel ou bien de la faire sécher comme jambon ou lard fumé dans la cheminée. Fini de ranger à tout vent dans le garde-manger le beurre qui bien qu’à l’abri des mouches devenait rance très rapidement, grâce au « Frigidaire » il était devenu de bonne qualité à longueur de jours.
Plusieurs enfants étaient déjà scolarisés en internat à l’extérieur, il fallait se déplacer à la Poste pour prendre des nouvelles de la progéniture en demandant à la préposée au guichet de bien vouloir lancer l’appel téléphonique pour ensuite le transférer vers une cabine individuelle. Il a été possible en 1963 de se doter d’un téléphone, un beau matériel à cadran tournant. Il est sans doute utile de préciser aux générations d’aujourd’hui que c’était un téléphone à fil avec combiné filaire lui aussi, l’usager devait ainsi rester près de son téléphone. Cet objet était bien mis en évidence dans l’entrée de la maison pour montrer notre modernisme. Vu son coût d’usage, il était souhaitable de ne l’utiliser que pour les cas extrêmes de maladie ou besoins urgents. Il était enfin devenu possible d’avertir d’une sortie d’internat anticipée.
Par chance, c’était l’un des premiers téléphones de nouvelle génération entièrement automatisé. Il n’était plus nécessaire de demander à la demoiselle des PTT du bureau local de bien vouloir brancher la bonne fiche de connectique dans la bonne prise et d’attendre ainsi que les autres demoiselles se relaient de ville en ville pour brancher la liaison jusqu’au correspondant souhaité. Ainsi il fallait donc attendre plusieurs minutes que la liaison se mette en place de point en point à condition que les fils ne soient pas déjà tous occupés auquel cas il fallait attendre la libération d’une liaison. La demoiselle écoutait discrètement la conversation et quand il n’y avait plus d’échanges, elle débranchait son fil tout simplement.
A l’époque, on demandait de vive voix le numéro 22 à Asnières, maintenant la numérotation à dix chiffres offre 10 milliards de numéros disponibles uniquement en France. Nous ne pouvions pas imaginer que soixante ans plus tard, en quelques secondes par téléphone sans fil, on pourrait joindre un ami aventurier en plein cœur des montagnes du Népal ou bien un autre sur son voilier au milieu de l’océan.
Merveille de la technique de nouvelle génération, avec ce téléphone très moderne, il suffisait maintenant de composer le numéro sur le cadran tournant et miracle, quelques dizaines de secondes plus tard, le correspondant pouvait nous répondre… si l’une des rares lignes en service n’était pas déjà occupée. En effet, le réseau téléphonique était embryonnaire, le temps d’obtention d’une ligne téléphonique se chiffrait couramment en années.
Ainsi à la campagne, les années cinquante ont été le lieu de grands progrès pour le confort de ses habitants.
C'est bien joli, le progrès ? Demain, quand on offrira un livre à un gamin, il le tournera dans tous les sens pour savoir où il faut mettre les piles.
Coluche
Modernisme et mécanisation
Une autre révolution a apporté la connaissance dans les chaumières reculées, l’arrivée de la télévision en 1965. Avec l’unique chaine, nous avions les images de l’information au-delà de notre village. Notre source de renseignements n’était plus uniquement liée aux potins de la foire bimensuelle et à l’unique radio à usage exclusif du grand père Eugène. Le samedi soir, la Piste aux Etoiles avec le célèbre présentateur Roger Lanzac nous enchantait des clowneries et autres animaux du cirque, animaux tellement différents de ceux de la ferme. Nul besoin de télécommande, il n’y avait qu’une seule chaine. D’ailleurs les animaux exotiques, les footballeurs, les speakerines fort bien coiffées et maquillées annonçant les programmes en jolie robe colorée,… étaient tous en noir et blanc car la télévision ne savait pas mieux faire. La couleur n’est arrivée que dans les années 1970, la vie télévisée devenait alors plus proche du naturel. Quoique comparées à la technique Ultra Haute Définition d’aujourd’hui, les couleurs étaient un peu délavées, mais c’était le progrès, nous nous contentions d’un écran pesant tout de même de 20 à 30 kg, il affichait modestement 625 lignes entrelacées, les images étaient donc très grossières.
Grâce à ce téléviseur, la famille a pu assister en direct à l’alunissage d’Apollo 11 le 21 juillet 1969 à 4h du matin. Résonne toujours en moi le premier pas de l’homme sur l’astre céleste et la célèbre phrase d’Armstrong descendant de son échelle : « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité ». Un tel message nous marque éternellement, un demi-siècle plus tard, l’homme n’a toujours pas remis les pieds sur cette même lune.
A cette même époque, nous en avions terminé avec les déplacements à vélo ou en charrette à cheval. Désormais toute la famille pouvait se déplacer grâce à la voiture automobile, une superbe Simca Aronde grise. Elle avait un grand format pour l’époque et roulait sans encombre à 50 km/h, disons qu’au vu de la photo récente, la grande taille de la voiture d’hier ressemble plutôt à un tout petit modèle d’aujourd’hui. Au chaud ensemble tous les six, nous pouvions facilement franchir sans fatigue les neuf km qui nous séparaient des autres grands parents à St Viaud. Une échappée de quarante km à Nantes était même envisageable.
« Marin et Matelot » les deux bœufs Parthenaisiens bien cornus étaient les animaux de trait utilisés par mon grand-père Eugène. Ces deux bovidés qui avaient perdu leurs atouts virils étaient bien dociles et calmement en force tiraient leur charge sous la direction de leur bouvier.
Certains exploitants encore moins fortunés utilisaient non pas deux bœufs mais deux vaches, à la fois pour le lait, la viande et les travaux des champs.
Quand mon père a repris en main l’exploitation, sa première décision a été d’avoir un cheval. « Turenne » était docile, il s’accommodait bien de tous les travaux de précision qu’on lui confiait : transports, labours, récoltes,… Ses hennissements et ses trots pour aller en charrette à la ville résonnent encore dans nos oreilles d’enfants. Le maréchal-ferrant était chargé de maintenir en état ses sabots ferrés qui claquaient sur la route lors du trottinement du retour à la ferme. J’ai encore en tête les odeurs de sabot de cheval brûlé par le fer rougeoyant tout juste sorti du foyer et posé vif sur la corne de l’animal.
A l’image de ses oncles Pruneau, mon père souhaitait évoluer dans la vie. Les travaux de la ferme étaient éreintants. Lors des labours derrière le cheval, la tenue de la charrue devenait épuisante.
Le Crédit Agricole, banque tout juste créée venait d’installer un bureau à St Père. Le gérant faisait le tour des fermes pour convaincre les habitants de sortir leur argent de dessous l’oreiller pour aller le déposer à la banque. C’était une expérience loin d’être gagnée : les menues économies allaient être confiées à un tiers en dehors de la famille qui, de plus, était un inconnu habitant la ville, je veux dire le bourg tout proche à 1 km.
C’est au même moment que, fort des avoirs qui entraient à la banque, celle-ci pouvait consentir des prêts. Nouveau fonctionnement révolutionnaire, il n’était plus nécessaire d’amasser pour pouvoir acheter. On pouvait posséder un bien sans avoir les liquidités.
Fort de ce constat, mon père s’est lancé dans l’aventure d’un prêt pour l’achat d’un tracteur, un Massey Ferguson TE 20 de 30 cv fort bien appelé « Petit Gris ». Il était le premier à posséder un tel engin, le premier et seul tracteur de l’époque à relevage des outils intégré et assisté par l’hydraulique. Autre nouveauté, il était chaussé de pneus et non plus de roues métalliques rigides, une amélioration de confort fort bienvenue pour son conducteur. Afin d’alléger la dette et surtout rassurer la banque sur la capacité de remboursement, cet achat s’était réalisé conjointement avec son beau-frère Louis Leduc. Ils se partageaient ainsi l’usage de la machine, le reste du temps c’était le rude et exténuant retour aux animaux de trait.
Bien qu’ayant quitté l’école à 14 ans, l’ingénieur irlandais Harry Ferguson venait d’inventer le relevage hydraulique qui n’a toujours pas été remplacé à ce jour, dès lors il a permis aux engins de ne plus seulement trainer les outils comme le faisaient les animaux, mais désormais de les lever.
Grâce à Ferguson, l’homme pouvait désormais utiliser un tracteur pour soulever les charrues, une benne, une fourche,… Même les tracteurs géants d’aujourd’hui pourvus de mille et une technologies électroniques et informatiques gardent le système Ferguson de relevage des outils. En langage courant, on appelle cela une rupture technologique, celle-ci date donc de 1926, à ce jour, aucun inventeur n’a encore trouvé une meilleure solution. Enorme différence de taille, sur le Petit Gris on s’y installait quasiment à califourchon, sur le Massey d’aujourd’hui, il faut escalader l’échelle de 5 à 6 barreaux.
A cette époque, mon père avait su détecter, comprendre et utiliser la révolution de la nouvelle technologie naissante et les avantages qu’elle apportait. Cela lui permettait de labourer en une heure ce qui lui demandait auparavant un jour avec le cheval, bien assis sur son tracteur et non plus soulevant la charrue à pied derrière l’animal.
Je me souviens des douleurs à la croupe suite à une trop longue assise sur le siège entièrement en métal rigide perforé bien loin des suspensions hydrauliques et des cabines climatisées d’aujourd’hui. A chaque creux et bosse du terrain, le petit conducteur novice sursautait sur son siège bien raide, cela lui permettait de respirer un grand coup et ainsi de mieux avaler la poussière qui s’élevait au passage des outils.
Les commandes n’étaient pas assistées par l’hydraulique, les pédales agissaient directement sur les freins ou l’embrayage, elles nécessitaient une force physique certaine. De par mon jeune âge et ma petite corpulence de pré-adolescent, il n’était pas rare que pour actionner simultanément les pédales de freins et de débrayage, je sois amené à me mettre debout de tout mon poids sur ces deux pédales tout en agrippant le volant pour donner plus de force à mon geste, j’arrivais ainsi à maitriser les chevaux mécaniques du « Petit Gris » et à l’immobiliser tant bien que mal à l’endroit envisagé.
Par accord commercial avec le vendeur, il était précisé que le dit tracteur serait exposé Place de la Mairie lors de chaque foire bimensuelle du mardi.
Mon père était très fier de montrer son tracteur et d’en vanter les mérites.
Ses collègues agriculteurs ne comprenaient pas comment un petit paysan, pauvre de surcroit, pouvait s’acheter une telle machine. Il fallait bien expliquer ce qu’était un prêt et surtout son fonctionnement.
Un voisin probablement très jaloux de cet achat lui a un jour lancé : « Dis donc Léon, t’as un tracteur, quand est-ce que tu t’achètes un avion ? ».
C’était la vexation suprême pour le petit cultivateur qui voulait aller de l’avant. J’étais présent lors de cette humiliation.
Pour faire honneur à mon père, je me suis promis ce jour-là d’aller de l’avant comme lui pour corriger cette trop indigne offense.
La jalousie est vaine, elle n'empêche pas le destin.
Proverbe nigritien
Animaux et nourriture
A la ferme, les animaux étaient le centre des préoccupations quotidiennes. Ils étaient les animaux de trait pour les travaux des champs, mais aussi la nourriture carnée et le lait.
Pour cultiver les 21 ha, un cheval et deux bœufs étaient une aide précieuse pour les exploitants, le cheval était plutôt utilisé pour les travaux de précision tels que la plantation ou le binage des légumes, les deux puissants bœufs avec leur pas lent étaient plus adaptés pour les travaux de force, labours, moissons.
J’ai peu connu les travaux des bœufs solidement reliés entre eux au niveau des cornes par un joug en bois. Je garde néanmoins en mémoire les mots typiques de leur conduite :
Pour avancer : T... t...hu..u..ue
Virer à droite : Hue-oh…
Virer à gauche : Tiouque-hu…
Pour arrêter : Ou... oh... oh...
A la ferme on y vivait en quasi autarcie, les habitants consommaient presque exclusivement les produits de leurs récoltes et leurs animaux d’élevage.
Les pommes de terre étaient cueillies en été pour y être consommées tout le reste de l’année. Elles servaient tant à la nourriture des hommes que des animaux.
Pour la cuisson aux animaux, dans la buanderie près de l’auge aux cochons, il y avait une grosse marmite chauffée au feu de bois.
Lors de la cuisson, l’eau bouillante fumait et la vapeur s’échappait par le couvercle soulevé par la pression, les patates étaient alors à point.
Par ce couvercle légèrement entr’ouvert, on pouvait saisir une pomme de terre toute brûlante.
Jetées telles quelles dans la marmite, les restes de terre qui les couvraient avaient presque disparu. Néanmoins jamais de ma vie, je n’ai mangé de pommes de terre aussi délicieuses. Le reste de la marmite était de ce pas directement donné aux cochons qui en grognaient de plaisir comme les enfants que nous étions.
Les divers animaux de la ferme étaient consommés selon les besoins. Durant la semaine au gré des saisons, nous bénéficions de larges rations de choux, de haricots et de pommes de terre, le pain, le beurre et les œufs complémentaient ces légumes, les adultes recouvraient leur énergie par de bonnes rations de vin rouge du pays un peu âcre prompt à revigorer les corps fatigués. Pour le dimanche, jour de prière et de bonne chère, nous avions droit à un bon plat de viande, à base des produits de la basse-cour, peut-être une poule pondeuse un peu fatiguée ou bien une pièce de porc engraissé aux pommes de terre.
Les poules désignées pour servir de nourriture étaient saisies prestement pour y subir un coup de couteau fatal au fond de la





























