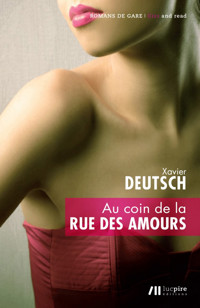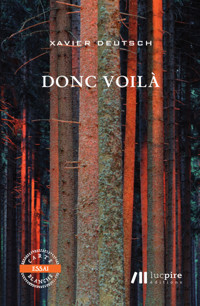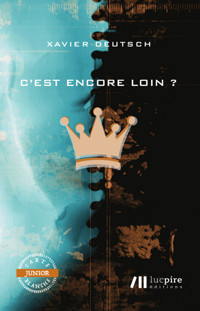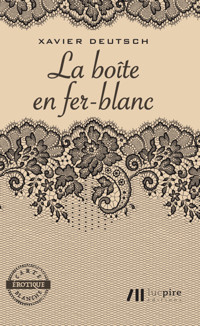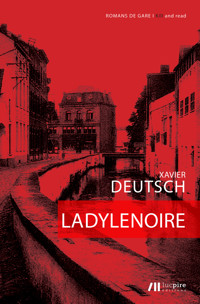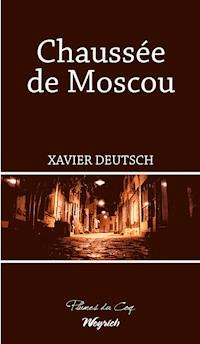
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Secrets et mystères au cœur des Ardennes françaises.
Département des Ardennes, au bord de la France. Le bourg de Baison. Deux pâtures plus loin, une forêt : la frontière belge est à portée de fusil. L’hiver s’achève. Le maire, Basile Rouillon, a les mains dans les poches. Il administre des citoyens turbulents et ordinaires avec bonhomie.
La nuit, une femme se balade nue dans les rues, des fugitifs traversent le pays et cherchent l’abri de la frontière. Au matin, une délégation moldave est attendue au musée d’Art moderne. La vie semble rouler devant elle, comme il faut. Pourtant, le fond de l’air effraie… « Quelqu’un sait quelque chose que nous ne savons pas. »
Basile Rouillon sort les mains de ses poches. Il va faire de son mieux.
Un thriller régional qui saura vous tenir en haleine !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Un univers [...] étriqué mais terriblement prenant et à moult reprises déstabilisant"
(DH.be, le 02/10/2014)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1965 à Louvain,
Xavier Deutsch a écrit et publié à ce jour une quarantaine de romans. Docteur en philosophie et lettres, il a rédigé des textes pour divers journaux belges. Ses pérégrinations en Belgique en compagnie de la photographe Marina Cox en 1999 lui valent une publication hebdomadaire dans
La Libre et a écrit une chronique hebdomadaire dans
Le Soir, de 2005 à 2007. Outre son talent d'écrivain, Xavier Deutsch nourrit une grande passion pour la photographie.
EXTRAIT
Jean-Claude est l’amant de ma sœur. Je l’aime bien. Il porte la moustache et ça me rassure. C’est toujours périlleux de s’appuyer sur des vérités générales : Hitler et Staline portaient la moustache, mais Georges Brassens aussi. Ça ne veut rien dire. Les vérités générales, ici, on s’assied dessus. On serait même du genre à leur inventer le plus grand nombre d’exceptions possible pour le plaisir de les contrarier. On ne fait pas aller les choses dans le sens commun. On ne se fie qu’à soi-même et qu’à son propre jugement. J’aime bien Jean-Claude et sa moustache. Il sent le jambon, l’humus et le feu de sapin. Il sent aussi la sueur un peu rance, il ne se lave pas chaque jour, ça m’est égal. À quoi ça sert ? D’ailleurs il existe des femmes que ça réchauffe, qui viennent se frotter à ce type d’odeur, ça les rend folles, ça les fait sortir de leur trou. C’est le son de l’homme qui sent comme ça, la grande chanson du labeur et du pain quotidien. On est des Gaulois et, si on a inventé le savon à coups de cendre et de résine, c’est pour s’en servir avec respect, avec modération. On ne gaspille pas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur tient à remercier trés vivement le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’aide et le soutien précieux qui lui ont été apportés lors de l’écriture de ce roman.
L’homme est curieux par nature, avide de savoir et de connaître. Il repousse les ténèbres et n’a de cesse de questionner les mystères du monde pour y porter la clarté.
Aristote
Aristote est un con.Basile Rouillon, maire de Baison.
Jean-Claude est l’amant de ma sœur. Je l’aime bien. Il porte la moustache et ça me rassure. C’est toujours périlleux de s’appuyer sur des vérités générales : Hitler et Staline portaient la moustache, mais Georges Brassens aussi. Ça ne veut rien dire. Les vérités générales, ici, on s’assied dessus. On serait même du genre à leur inventer le plus grand nombre d’exceptions possible pour le plaisir de les contrarier. On ne fait pas aller les choses dans le sens commun. On ne se fie qu’à soi-même et qu’à son propre jugement. J’aime bien Jean-Claude et sa moustache. Il sent le jambon, l’humus et le feu de sapin. Il sent aussi la sueur un peu rance, il ne se lave pas chaque jour, ça m’est égal. À quoi ça sert ? D’ailleurs il existe des femmes que ça réchauffe, qui viennent se frotter à ce type d’odeur, ça les rend folles, ça les fait sortir de leur trou. C’est le son de l’homme qui sent comme ça, la grande chanson du labeur et du pain quotidien. On est des Gaulois et, si on a inventé le savon à coups de cendre et de résine, c’est pour s’en servir avec respect, avec modération. On ne gaspille pas.
Jean-Claude a le tempérament forestier, ce qui est conforme à sa fonction, et j’aime quand les choses prennent une tournure conforme à ce qu’on en attend. Je ne suis pas un aventurier, on ne m’a pas élu pour en être un. Je suis le gars tranquille qui aime sa petite routine et ne cherche pas d’histoires. Jean-Claude et moi, on n’a pas grandchose à s’apprendre l’un à l’autre, et ça repose. Il porte la moustache, c’est bien, c’est conforme. Il est l’amant de ma sœur : plutôt lui qu’un autre. Je connais ma sœur. Elle est rustique. Elle aime le cuir et le crin, elle est faite comme nous, Jean-Claude et moi, elle ne se pince pas le nez. Elle a des formes faites pour plaire, aussi, pour plaire à un type comme Jean-Claude qui est du genre petit sec, d’une ossature peinte en gris, les épaules tenaces et le bassin fort. Pas grand. Un genre de renard si on veut. Et ce visage triangulaire qui regarde par ci et par là, et cette moustache. C’est bien. Quand nous ne sommes que lui et moi, je lui ressers volontiers la même saillie : « Tu préfères les bêtes à plume ou à poil ? » Rapport à ma sœur : « la bête à poil ». C’est un trait de finesse, il faut saisir, mais Jean-Claude est un être aussi délicat que moi et me répond en clignant de son œil : « Je les bouffe à plume et je les saute à poil. »
C’est entre nous. On se rejoint facilement, lui et moi, sur la plupart de nos opinions, du moins sur celles qui méritent d’être partagées. Les autres ne valent rien. On se rejoint sur nos pensées profondes, et au café de l’Écluse. Le café de l’Écluse est le seul, du village, qui mérite qu’on le mentionne. Pas du tout parce qu’il serait meilleur qu’un autre, que la bière y serait mieux servie, que la patronne y serait plus avenante. Mais simplement parce qu’il n’y en a pas d’autre.
La commune de Baison est peu de chose. On possède le canal qui part à la Marne, et l’écluse, et le café. On ne compte pas cinquante maisons. L’église, la mairie, le tout-venant, avec l’école et trois boutiques. Le village est venu se construire le long de la chaussée de Moscou qui vient du nord, passe là, et file au sud-est vers la Meurthe-et-Moselle. Le fait est que, si on a du temps devant soi, si on prend la chaussée de Moscou, et si on pousse au-delà de la Meurthe-et-Moselle, on trouvera sans doute l’Alsace, le Rhin, les vastes plaines inconnues d’Allemagne et qu’on peut aboutir à rencontrer Moscou. Cela n’a rien à voir. La rumeur nous rapporte que le nom de la chaussée, et nous y tenons, vient de ce que, dans le dix-huitième siècle, quand le roi de France a fait creuser le canal, des pontonniers avaient été appelés de Russie pour rétablir des routes que l’ouvrage avait coupées. L’histoire est belle et nous plaît bien. On n’a jamais été scrupuleux sur la vérité historique, à Baison.
Un agrégé d’histoire, venu de Charleville-Mézières enseigner son savoir au collège de Pisson, a bien tenté un jour de nous faire boire une théorie dépourvue d’intérêt. Il soutenait – je me le rappelle peu, j’ai bien essayé d’oublier, mais c’est toujours difficile de faire comme si on n’avait pas entendu – que la chaussée tenait son nom de la forêt de Mochou, qu’elle traverse. La prononciation avait glissé quelque part dans une ornière d’un siècle ancien… Nous n’avions pas envie de savoir. Le type est vite reparti vers sa préfecture ou vers une autre.
Je me suis d’ailleurs laissé dire qu’il était de mœurs douteuses : il habitait un vieil appartement de gendarmerie réaffecté où la lumière brillait chaque soir jusqu’à des minuit, une heure du matin, et pour y quoi faire ? Je n’écoute pas les raisons d’un homme qui passe les nuits à ne pas dormir.
De l’autre côté, par le haut, le nord-est, on y va peu. C’est la Belgique. On rencontre la frontière à six kilomètres : un bois, deux pâtures et on marche en Wallonie. C’est un peu notre « ligne bleue des Vosges » à nous, nos Pyrénées. Pour mieux dire, notre Bois-d’Amont, qui sépare le département du Jura du canton de Vaud. Enfin c’est la Belgique de ce côté-là et on ne s’y porte, à Florenville ou à Virton, que pour se procurer du tabac, c’est pas souvent. Me voilà rendu silencieux, aussitôt que j’évoque la Belgique. Je ne me reconnais qu’à peine. Je comprends pourquoi. Il existe toujours un moment dans l’existence où il faut détourner le visage et la conversation, et les porter vers la gauche.
Jean-Claude et moi, donc, lorsque nos fonctions nous le permettent, aimons à nous retrouver au café de l’Écluse. Nos fonctions obéissent aux souplesses que je veux bien leur donner : je suis le maire de Baison, Jean-Claude est le garde forestier. S’il reçoit formellement ses ordres de l’Office national des forêts, c’est tout de même bien moi qui, chaque début de semaine, lui attribue ses tâches. Le bois de Mochou est du domaine municipal ! Ça nous laisse du temps devant nous.
Or donc, ce 28 février, au moment que le grand ciel passe du blanc vers le brunâtre et développe, sur le 5e degré de longitude est, le haut signal du crépuscule, nous y sommes : Jean-Claude et moi. Il y a là aussi mon beau-frère Leonid, et sa femme qui se trouve être ma sœur. Nous sommes en famille pour ainsi dire. Leonid et Jean-Claude servent dans le même corps, ça crée une fraternité de caserne, même si mon beau-frère n’a pas besoin de le savoir. Mon garde forestier, ma sœur et moi, c’est bien assez, trois personnes sur quatre, pour connaître à quoi s’en tenir. Nous allons sur la fin de l’hiver, le ciel ferme un peu plus tard chaque soir et Jacqueline a la main tout près de celle de Jean-Claude. Ils jouent. Ils savent que Leonid ne voit rien et quand bien même. Ce ne sont pas leurs mains qui se rapprochent, ce sont leurs verres de bière. On a la main sur le verre, c’est conforme. De quoi parle-t-on ? Je n’y suis pas. J’entends le son grêle de l’hiver qui s’en va dehors, j’ai les pensées en Meurthe-et-Moselle. Nous devons avoir l’air, tous les quatre, plus vieux que nous le sommes.
Lorsqu’Iermil entre soudain. Il pousse la porte d’une façon qui veut tout dire. Le ciel entre avec lui, le ciel avec ses embruns, ses claques sonores, le ciel de mars qui s’invite en février. D’ailleurs, ce n’est pas Iermil qu’on regarde, c’est la porte. Qu’il la referme donc ! Mais Iermil, lui, c’est moi qu’il regarde.
Iermil, Iermil Aubert, ouvrier, délégué syndical à l’usine de papier de Chesnois-le-Monsieur : un être fait de deux parties, l’une fort vaste (celle du haut) et l’autre menue (celle du bas), et reliées souvent par une cystite. Il a le corps comme un coffre, deux grandes branches de bras finies par des doigts étranges qui paraissent autonomes les uns des autres, et une tête ronde, rubiconde, où le nez fort, les yeux exorbités, le crâne ceint d’une couronne de cheveux clairs portés en volutes sur sa tonsure, contribuent à lui donner l’aspect d’un homme d’un autre temps. Je l’imagine parfois en marchand de tonneaux sur la Baltique aux siècles de la Hanse, voire en riche patricien du Bas-Empire occupé, dans sa demi-toge, à grignoter le raisin que lui tend un éphèbe numide…
Mais ce soir-là le pauvre ne ressemble qu’à lui-même. Ses jambes fluettes d’homme cachectique supportent encore par la force de l’habitude le grand fût creux de son tronc, et de ses deux mains munies d’un mouchoir il s’éponge les yeux, la bouche et le front.
Il m’avise et me dit d’un coup d’un seul, sans bonjour ni merci :
— Basile, on ne trouve plus Catherine.
Catherine est sa fille, qu’il élève seul en même temps qu’un fils plus jeune, depuis que sa femme a été découverte dans la forêt de Mochou huit ans plus tôt. Elle s’était rompu un anévrisme et ça faisait quatre jours qu’elle était froide quand on l’a découverte. Malheureuse affaire.
Je lui demande :
— Depuis quand ?
On connaît Catherine, on ne s’émeut que lentement. Cette gamine est habitée d’une curiosité si vaste envers la Terre entière et ses habitants qu’on l’a déjà retrouvée en maints endroits du département. Elle est sans malice, elle s’encombre peu des inquiétudes qu’elle génère, et on ne s’alarme habituellement que lorsque quarante-huit heures sont révolues. Elle a quinze ans. Elle en comptait quatre de moins au début de ses escapades. Elle est mignonne. Elle revient toujours avec des cadeaux pour son père et son petit frère : une théière en fonte, un sac de noix… Pas moyen de savoir d’où elle les obtient et chacun y va de sa petite supputation qu’il chique et remâche aussi longtemps qu’elle a du goût. Un jour de l’an passé, fin juin, après avoir été retrouvée par les gendarmes devant le porche d’une église à Clermou-le-Franc, elle a sorti de sa besace un portrait de saint Joseph au pastel, façon Renaissance italienne. Il était beau, il semblait authentique et véritable (pour ce que nous en pensions) et Iermil est allé le confier au musée. Car Baison possède un musée, ce musée possède une histoire, et cette histoire comporte quelques détails intéressants.
Il me répond :
— Depuis hier.
— Hier quelle heure ?
Il n’en sait rien. Catherine ne vit pas sous cloche, elle prend la tangente quand ça la regarde et ne prévient personne, sûrement pas son père. Il écarte deux bras si longs qu’en tirant un peu il toucherait les murs opposés de la salle du café (qui n’est pas grand). Sa bouche, en même temps, s’ouvre dans une grimace d’ignorance et d’impuissance.
Je fais :
— Bon.
Iermil n’est sûr de sa fille que lorsqu’il la voit dormir dans son lit, et boire son café le matin. Et moi, je n’encourage pas la conversation. Je produis le minimum qu’il a le droit d’attendre de moi. Je suis le maire, je devrais m’intéresser à la chose, déclencher des procédures, appeler des gens. Dans le fond, je me demande si je suis la bonne personne pour porter l’écharpe autour du ventre. C’est une question que je me suis posée quelquefois et qui revient comme les saisons. Pour occuper la fonction, il faut avoir le souci d’autrui, accepter qu’on vous sollicite, qu’on vous pose la main sur l’avant-bras quand vous poussez la porte du café de l’Écluse. On ne se rend pas compte du nombre de concitoyens qui aiment poser leur main sur l’avant-bras d’un maire ! Avec ce petit mot fatal : « Dis donc, Basile… » D’autres s’amusent à me donner du Monsieur le maire, mais ça relève à peu près de la dérision. Je pense que certains doivent aimer ça. Il existe combien de municipalités, en France ? 36 568 communes en métropole, 181 dans les DOM et dans les TOM, 33 en Nouvelle-Calédonie. Quelque chose comme ça. On peut chipoter sur les virgules. Sur 37 000 maires, certains doivent aimer ça. Se faire solliciter, réveiller au milieu de la nuit. Sentir une main se poser sur l’avant-bras. Une gamine est allée voir si l’herbe est verte à six kilomètres de chez elle, on appelle le maire. Il n’y a que nous, et les pompiers, les vétérinaires et les curés qu’on réveille en pleine nuit. Je n’ai pas la vocation, je n’aime pas les bêtes malades. J’apprécie de dormir mes nuits entières. Iermil dit :
— Y a autre chose.
— Vas-y.
— Le faune.
J’ignore pourquoi je regarde vers ma sœur, puis Jean-Claude, ensuite je demande quel faune, et Iermil me répond :
— C’est un infirmier de la clinique qui m’a dit un mot, comme quoi il aurait vu un type à travers bois. Un homme sale ou un noiraud, mal peigné, à moitié nu, et qui se sauvait du côté de Protestat. L’infirmier disait : « Comme un faune tel qu’en lui-même ».
— Ah.
— Si Catherine est sortie, j’aime autant pas savoir qui traîne.
Je me tourne, cette fois bien franchement, vers Jean-Claude, et je lui demande :
— Tu as entendu parler de ça ?
Il se mord la bouche avant de répondre derrière sa moustache :
— Un peu. Presque rien.
Il regarde ses doigts comme s’il avait à leur reprocher quelque chose et, puisque tout le monde se tait, il ajoute :
— C’est encore courant qu’il y ait des gens qui passent, et qu’on ne revoit plus.
Je fais :
— Bon.
Depuis douze ans que je suis le maire, à Baison, je n’ai pas encore éclairci la question de savoir si les petits événements de ce type me déplaisent ou me conviennent. Ils changent de l’ordinaire et me donnent de l’importance ; mais dans le fond je ne déteste pas mon ordinaire, et cela ne rime à rien de se donner plus d’importance que notre part à tous. Il existe des procédures, je devrais les connaître. Je ne les connais pas. Il existe des adjoints pour ça. Je suis tout de même quelqu’un de consciencieux, j’ai le respect du mandat qu’on m’a confié. Je suis partagé. Alors je demande à Jean-Claude :
— Tu pourrais jeter un coup d’œil ?
— À quoi ?
— Ce type dans les bois.
Il a visiblement d’autres projets. Je connais mon homme, je sais ce que c’est quand il regarde droit devant lui d’un œil devenu soudain terne et froid. Il dit :
— Ça ne sert à rien, il va faire sombre. Il faut attendre demain.
— Tu peux monter jusqu’à la clinique, demander s’ils ont vu quelque chose ?
— C’est un boulot de gendarmes. Appelle la brigade à Pisson. T’en profiteras pour signaler que la gamine est sortie.
Il n’a pas tort. Je soulève quelque chose en moi, le sens du devoir, la besogne à tenir, le principe de fidélité aux mœurs de la République. Que sais-je ? C’est très beau, ce que je fais là. Tout le monde ne se serait pas levé de sa chaise. Je dis à Iermil :
— Viens avec moi.
Nous sortons.
Catherine s’est glissée dans une fissure, à la recherche de quoi ? On se le demande un peu, fort peu en somme. Chacun y va de son idée. On connaît la sauterelle jusqu’à un certain point et, au-delà de ce qu’on sait, on extrapole selon nos préférences.
Nous raffolons de ces rumeurs, à Baison. Elles se révèlent à nous comme des sardines glissant dans les reflets de la Soute. Cela n’a pas de bon sens, vu qu’on ne risque pas souvent de croiser des sardines dans l’eau douce mais, de loin, avec le soleil dans les joncs, sur le crépuscule, et quand on n’y entend rien, on peut confondre la sardine avec l’ablette. C’est ça : le jour qu’une rumeur montre son écaille, on évite de la regarder sous la lampe, on la considère de biais, on s’efforce de ne rien y connaître, pour le grand bonheur de se laisser prendre dans le sirop de sa tromperie.
Nous n’y consacrons pas nos journées. Nous avons de la besogne à abattre. Ce n’est pas un mode de vie, à peine un état d’esprit, mais je mesure à quel point nos opinions, nos attitudes même, obéissent à cette pente : la vie descend la rue, elle ne remonte pas la rivière.
À partir de là…
Naturellement, à marcher sur du vaseux plus souvent que sur du ferme, on n’est jamais sûr de savoir où on met le pied. Qu’importe. On s’y fait, on n’a guère connu que ça, on est à vrai dire né dedans, et quand on trébuche ce n’est pas de haut. La chaussée de Moscou, par exemple. Nous tenons beaucoup à l’histoire du roi de France, du canal qu’on a fait passer par chez nous, et des pontonniers russes.
Il ne reste pas de trace des ponts construits par les Russes, même dans les archives paraît-il, mais nous possédons un arsenal d’arguments et, lorsque les arguments viennent à nous manquer, nous savons l’art difficile d’en fabriquer de nouveaux : les ponts étaient faits de bois, il est normal qu’on les ait remplacés ; les archives ont brûlé mais les révolutions servent à cela, la nôtre a proprement rempli son office, il y a toujours des archives qui brûlent quelque part.
À Baison, la rumeur relève du patrimoine municipal, du principe général, et de la chronique ordinaire. Elle travaille en nous de la même façon que la chaussée de Moscou structure le village : elle est notre axe, notre charpente faîtière. On s’adosse à des croyances bien plus solidement qu’à des vérités. Une vérité n’a pas de goût, pas de bouquet. Ça ne sent rien, ça n’est pas fait pour nous. Tandis que la rumeur, l’hypothèse mille fois redite de la gauche à la droite et marche arrière, l’éventualité qui se tient devant nous et occupe toute la largeur de la route, on la construit nous-mêmes, on la savoure durant le temps nécessaire, on la retourne quand elle a fini de servir et la voilà qui sert encore ! Lorsqu’une vérité nous est imposée, on la corrompt si elle nous déplaît. Ça nous arrive souvent. Je ne doute pas que cette particularité soit répandue très au-delà des bornes de la commune et des frontières du département : elle est consubstantielle au genre humain, pour ainsi dire. Les Chinois la connaissent, les Inuits la propagent, on la rencontre à Ottawa. Les femmes l’ourdissent pas plus mal que les hommes, les enfants la recueillent avec habileté, les vieillards avec délectation, les bonnes sœurs avec professionnalisme. De toutes parts, et en toutes langues, depuis les siècles, les siècles des siècles. Mais à Baison, c’est différent : nous avons la chaussée de Moscou. Et Catherine. On tient à elle comme les Russes tiennent à leur tsarine de jadis.
À partir des pontonniers du roi de France, c’est devenu la coutume. Iermil, Leonid. Moi, on m’a prénommé Basile. C’est russe. À cause des pontonniers venus de Moscou.
Notre facteur s’appelle Dobromir. Il existe un portrait du cardinal Jean de Bonsy, exécuté vers 1615 (le portrait, exécuté, pas le cardinal) par le Dominiquin, et conservé au musée Fabre de Montpellier. Le facteur, qui couvre les six rues de Baison, qui est natif de la commune, et avec qui j’ai volé des prunes quand nous étions gamins, lui ressemble étrangement. Les mêmes yeux qui se plantent en nous, le même sourire (par un effet curieux, le sourire du cardinal est empreint de malice, quand celui de notre facteur a quelque chose de niais, et c’est le même sourire pourtant), les doigts potelés… Ne manque à Dobromir que la toque, la chasuble et le surplis. Il se prénomme Dobromir, donc, ainsi que la plupart d’entre nous, au village. C’est-à-dire : il n’y a de Dobromir que lui, mais nous sommes une importante proportion de concitoyens à avoir été baptisés d’un prénom russe : mon meilleur ami s’appelle Fiodor, le cantonnier du bourg est Varfolomeï, Leonid est mon beau-frère et le chauffeur de l’autobus municipal, un bougre mince et petit, qui a tenté de se laisser pousser la moustache bien qu’il ait peu de poil, se prénomme Igor. La coutume ne s’applique qu’aux enfants mâles sans que l’on sache exactement pourquoi, et les filles s’appellent chez nous Marguerite comme tout le monde. Sauf Catherine.
Parce que des pontonniers sont arrivés chez nous, depuis toutes les Russies, fabriquer des passerelles sur un bras de canal. C’est dire s’il ne s’agit pas de nous les retirer, nos rumeurs. Le petit agrégé d’histoire qui est venu prétendre nous imposer sa vérité, sur l’origine supposée réelle de la chaussée de Moscou, en a été pour ses frais.
L’homme sage marche mieux, il marche plus loin dans le crépuscule que dans la claire vision (proverbe maison).