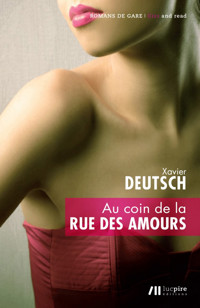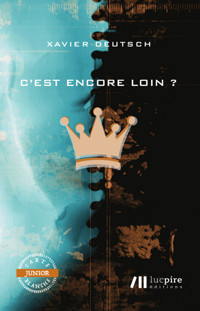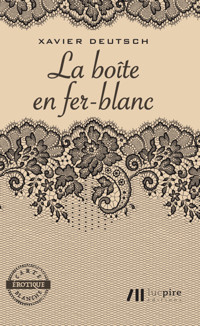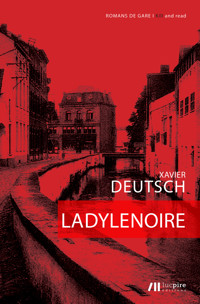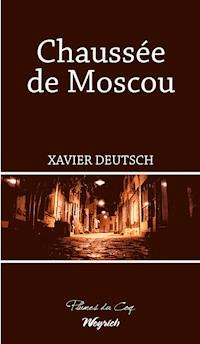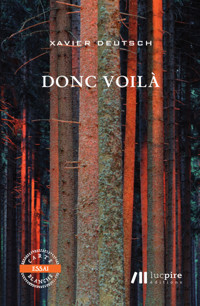
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luc Pire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cela faisait un moment que, considérant autour de moi le monde comme il tourne, je ressentais un embarras.Je me demandais d’où cela venait et, partant du principe que, si j’éprouve une démangeaison quelque part, je ne suis peut-être pas tout à fait le seul dans le cas, j’y ai regardé de plus près.Il en est résulté ce texte. Un essai, un pamphlet, un état des lieux, un regard sans tabou sur cette époque étrange.De Copernic au féminisme, du gps à l’art contemporain, de la tyrannie de l’émotionnel au pouce opposable, tout y passe. Et moi, je me sens mieux.Donc voilà.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donc voilà
Xavier Deutsch
Donc voilà
Éditions Luc Pire (Renaissance S.A.)
Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo
éditions Luc Pire
www.editionslucpire.be
Donc voilà
Corrections : Christelle Legros / La Plume alerte !
Mise en pages : Martine Gillet
ISBN : 9782507055202
© éditions Luc Pire, 2017
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication
ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique
ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
À Laurent, l’air en automne
Si vous voulez adresser un message à quelqu’un
sans que la NSA lise votre mail,
sans que les Grandes Oreilles épient
votre conversation, il existe un moyen très sûr :
prenez un bout de papier, un stylo,
écrivez une lettre que vous glissez dans une enveloppe. Collez-y un timbre et confiez le tout à la poste.
Comment dire ?
Ceci n’est pas du tout un roman. Lorsqu’il n’écrit pas de romans, un romancier achète son pain, son bois, ses pommes et lit le journal. Il cultive son jardin, roule à moto, lit le journal. Il boit un verre de Rulles (triple), regarde l’existence depuis sa fenêtre, et lit le journal.
Sa journée se termine, il s’assied, il pose un coude sur le coin d’une table, lit le journal et se prend à songer au grand cours des choses.
Un romancier, quand il n’écrit pas de romans, pense un peu. Comme tout le monde.
C’est difficile, pour peu qu’on s’y arrête parfois, de ne pas penser. On regarde la Terre tourner. On se met à y réfléchir certains soirs (ou matins : à vrai dire, moi, je suis plutôt du matin). Il faut s’en donner l’occasion. La Terre ne tourne ni plus ni moins vite qu’au temps des dinosaures, mais les hommes qui la peuplent se comportent d’une si étrange façon que la lenteur, la méditation sur le cours des choses, le silence semblent être devenus marginaux, presque saugrenus. Ce n’est pas la Terre qui donne à penser, mais ce brouillard sidérant que les humains ont répandu si généralement qu’il en est venu à corrompre leurs propres cerveaux.
J’aime bien les gens qui s’arrêtent et qui réfléchissent. Ils ne font en général pas beaucoup de bruit. Il y a des moines. Des penseurs. Des vieux. Des journalistes parfois. Des gars qui s’assoient quelque part sur une chaise. Ils pratiquent l’exercice de l’écart et du recul. C’est intéressant.
J’aime bien quand, devant un comportement singulier, quelqu’un prononce une explication qui remonte au temps de la chasse au mammouth. Ça, c’est du recul !
Il est difficile de dater les premières guerres dans l’histoire humaine, ça semble s’être produit une cinquantaine de siècles avant Jésus-Christ (comme en témoigne le charnier de Talheim par exemple), mais les historiens s’accordent sur l’idée selon laquelle les premières guerres ont été déclenchées pour des motifs qui avaient à voir avec la possession d’un territoire. Quand les humains étaient nomades, il ne leur venait pas à l’esprit qu’on puisse se disputer pour un bout de pâture. La sédentarisation a entraîné le concept nouveau de propriété foncière, de clôture : ce qui se trouve de ce côté-ci de la clôture est à moi ; si je veux obtenir ce qui se trouve de l’autre côté de la clôture, et qui n’est pas à moi, il faudra que je le conquière. Il s’est trouvé des aventuriers pour sauter au-dessus des clôtures et le propriétaire les attendait avec un couteau en os de renne ou quelque chose d’approchant. Tite-Live raconte que c’est pour avoir franchi le sillon sacré tracé par Romulus en vue de délimiter leurs territoires respectifs que Remus a été tué par son frère, pris de colère. Pour finir, Hitler déclare que les Sudètes appartiennent à l’Allemagne et George Walker Bush décrète que les champs pétrolifères irakiens se trouvent de son côté de la clôture. Ça se termine assez mal en général.
Bref. Je dis ça pour évoquer l’idée du recul nécessaire.
On vit une drôle d’époque et je ne suis pas absolument certain de m’y sentir à l’aise. Alors je prends du recul et j’essaie de savoir ce qui coince. Partant du principe que, si j’éprouve une démangeaison quelque part, je ne suis peut-être pas tout à fait seul dans le cas, ça m’intéresse d’y regarder.
Au commencement
Au commencement, l’homme avait la vie facile. Je ne parle pas des inconvénients (dont il avait d’ailleurs relativement peu conscience) comme l’illettrisme, le bacille de Koch ou la mortalité infantile. Je me place sur un point de vue un peu plus métaphysique : l’homme occupait la Terre et la Terre occupait le centre de l’univers. Ça relevait d’une conception confortable des choses, à partir de laquelle il regardait l’existence autour de lui comme un propriétaire terrien. Les humains de l’époque pouvaient éprouver un chagrin d’amour, souffrir d’une blessure de guerre, déplorer une disette et même ressentir une contrariété à voir tout leur village exterminé par la peste noire, le problème se cantonnait à la sphère physique ou émotionnelle.
Là-dessus apparurent successivement des gars comme Copernic, Darwin, Freud et Einstein.
Copernic déclara que le Soleil ne tournait pas du tout autour de la Terre, mais qu’au contraire, c’était notre planète qui se baladait sur une orbite héliocentrée pendant trois cent soixante-cinq jours et six heures avant de recommencer le même parcours sans originalité. Aujourd’hui, ça semble anodin, mais il faut se mettre à la place des gens de l’époque : on leur balance soudain un énorme coup sur l’arrière du crâne ! On retourne complètement leur vision du monde. On leur dit un truc aussi renversant que, par exemple, ceci : « En fait, on ne vous l’a jamais dit, mais ce sont les ratons laveurs qui sont fils de Dieu, et vous, pauvres humains, vous êtes à leur service. » Ça secoue.
D’ailleurs, c’est bien simple : personne n’y a cru, à la théorie héliocentriste de Copernic, sauf les curés. Les ecclésiastiques sont les gens les plus malins du monde et ils comprirent si bien la théorie de Copernic qu’ils la combattirent et s’efforcèrent d’obtenir, par exemple, l’abjuration de Galilée (qui, vieux et trouillard qu’il était, ou peu enclin à mourir pour une idée, s’empressa de la leur procurer). D’une certaine façon, Copernic soutenait un propos assez proche de ce que Jésus avait proclamé quinze siècles auparavant : les premiers seront les derniers, renversez les anciennes assises, etc. Les grands prêtres qui avaient obtenu de Ponce Pilate l’exécution de Jésus étaient à peu près les mêmes que les copains de Torquemada : l’Inquisition sous Philippe numéro 2 remplissait le même rôle que le Sanhédrin à l’époque d’Hérode. Ça relevait de la conservation des stabilités acquises.
Les braves moines dominicains qui s’opposèrent aux nouvelles hypothèses formulées par les astronomes jouaient leur rôle : faire triompher l’inertie à laquelle aspire à peu près tout le monde. L’idée de progrès, l’idée qu’il faut que les choses évoluent est assez contemporaine, et je ne pense pas qu’il faille l’accepter aveuglément.
Le mouvement était donné. Après Copernic (et Galilée, Kepler, des gars comme ça) vint Darwin. Je ne vais pas vous refaire toute l’histoire, vous la connaissez : les espèces animales n’ont pas été créées en sept jours, par Dieu, sous leur forme définitive, mais elles sont l’objet d’une longue adaptation. Les espèces apparaissent, évoluent, certaines s’éteignent, d’autres mutent, se diversifient. Mais un problème, plus émotionnel qu’intellectuel, se posa aux hommes à qui on avait affirmé depuis leur baptême qu’ils avaient été façonnés d’un coup d’un seul par Dieu à partir d’une boulette de terre glaise : si nous n’avons pas été faits à l’image de Dieu (comme c’est écrit dans la Genèse), alors à quoi ressemblons-nous et de quoi sommes-nous faits ?
Entre parenthèses, je me demande de quelle façon auraient réagi les Chinois, les Papous et les Patagons s’ils avaient eu sous les yeux L’Origine des espèces, précipitamment publié à Londres en novembre 1859 : peut-être n’y auraient-ils pas vu les mêmes inconvénients que les Européens ? (Précipitamment, parce qu’un certain Wallace s’apprêtait à faire paraître un texte très proche de celui de Darwin : il aurait alors privé de notoriété le savant le plus illustre de ce xixe siècle qui, pourtant, en a vu défiler quelques-uns. Wallace, pour sa part, est demeuré inconnu : il n’avait qu’à houspiller son éditeur. On a connu quelques autres histoires fameuses de courses à la gloire, dans la deuxième moitié de ce siècle qui s’est tout entier jeté dans les bras du progrès et de la compétition : qu’il se soit agi de l’invention du téléphone ou de l’avion. Mais il faut que je contienne chez moi cette tendance à la digression. Je suis comme ça, j’aime bien enfiler les idées les unes avec les autres, et je m’éloigne alors de mon propos. Je vous promets d’y prendre garde.)
Donc, Darwin. L’homme occidental reçoit sur l’arrière du crâne un deuxième coup de gourdin. À peine avait-il intégré l’idée que la Terre tournait autour du Soleil, à peine la contusion était-elle atténuée, voilà qu’on lui assénait un autre choc de nature comparable : tu descends du singe, mon fils ! (Plus exactement : le singe et toi descendez d’un ancêtre commun.)
Sous ses pieds, métaphysiquement, la terre tremble. Une fois encore, les religieux montent au balcon et brandissent la Bible, mais ils sentent que leur cause est à peu près perdue. Dans le xvie siècle encore délicieux, il existait assez d’âmes ardentes pour rejeter les théories contraires à la religion. Mais la Révolution française était passée par là, qui avait bouleversé l’ancien ordre des choses et, en plein xixe siècle, l’âge entre tous de la foi en la science, en la technique, en le progrès, le sentiment religieux devenait de plus en plus décoratif et ne constituait plus une véritable réponse. Darwin secoua bien quelques esprits fabriqués à l’ancienne, il ne fut jamais convoqué devant les tribunaux ecclésiastiques pour répondre de ses principes dans une chambre de torture.
Du coup, quand Freud brandit à nouveau la matraque pour la troisième grande commotion, l’homme occidental commence à s’habituer. Pire, il se met à aimer ça. Il aime tout : la théorie nouvelle qu’on vient lui servir à l’arrière du crâne et la controverse qui s’ensuit presque inévitablement. Freud dit : « Mes bien chers frères, ne croyez pas que vos actes soient dictés par votre volonté, par votre libre arbitre et votre conscient. Du reste, votre conscient ne pèse pas lourd. Au contraire, ce qui vous soulève et vous émeut, et vous meut, et vous constitue, c’est une espèce d’innommable magma, un réservoir sombre et puant sous les bras, contradictoire, difficile à connaître et à cerner, un bouillon de culture où macèrent depuis votre naissance deux grands ingrédients : le désir sexuel et le désir de mort. Éros et Thanatos. Un chaudron turbulent que je nomme l’inconscient, et que vous gagneriez à fréquenter de plus près si vous en avez la patience et le courage, et je formule à cet usage un outil que je nomme psychanalyse. » Bigre !
L’homme occidental a beau s’être accoutumé aux tremblements métaphysiques, il reçoit la secousse en fronçant les sourcils. Déjà qu’il avait dû entendre que la Terre était un satellite du Soleil et que les espèces descendaient du lézard, voilà qu’à présent, on lui fait comprendre que, au lieu de l’être sensé, pondéré, industrieux qu’il croit être, sa réalité intrinsèque, son moi profond, son « fond des choses » relèvent d’une sorte de marais putride sur lequel il a finalement peu de prise.
Fatalement, il se trouva encore quelques curés pour voler dans les plumes de Freud mais, cette fois, ce furent des curés d’un autre genre. Les ecclésiastiques avaient baissé la garde depuis un certain temps et la nouvelle religion avait formé des servants dévoués : les scientifiques. Au nom de la science, donc, au nom des principes sacrés de la raison, les théories de l’inconscient et la psychanalyse furent brûlées sur des bûchers dont les braises ne sont pas éteintes au moment où j’écris ces lignes.
Tout ceci est très schématique. J’ai encore plein de choses à sortir de mes poches et je ne suis pas du genre à aligner six cents pages. J’ébauche, j’évoque, je trace une trajectoire. Si le détail vous intéresse, il existe des livres très documentés sur toutes ces questions passionnantes.
Bon. Einstein, comme si ça ne suffisait pas, comme si la vocation définitive des scientifiques de toutes les disciplines consistait à nous éberluer, déclare, en 1919, que la réalité physique sur laquelle on a l’impression de pouvoir s’appuyerdepuis la création de l’univers est relative. Le temps, l’espace, tout ça, c’est relatif. Que la Terre tourne autour du Soleil, une fois qu’on s’est habitué à l’idée, ça n’empêche pas de planter ses carottes. Et que les espèces vivantes soient soumises à l’évolution, ça nous est finalement égal du moment que le mouvement est à ce point lent qu’on ne s’en aperçoit pas. Quant aux idées sulfureuses sur l’inconscient, elles ont été formulées grosso modo pendant une période où les Européens avaient l’esprit occupé par des questions autrement accaparantes, entre 1914 et 1918, de telle sorte que peu de monde se sentit bouleversé sur le moment même. Par contre, venir nous dire que l’espace et le temps ne sont pas des données inflexibles, mais que « ça dépend », voilà qui en a secoué plus d’un.
Pour Einstein, pas de tribunal ecclésiastique, pas de contestation populaire. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1921. Einstein était un enfant du sérail, un membre de la Communauté scientifique, il n’avait à redouter que quelques débats contradictoires et polis organisés par de chers confrères. Lesquels confrères occupaient des postes prestigieux dans des universités prestigieuses, touchaient à la fin du mois des salaires avantageux : la théorie de la relativité resta pour eux une vue de l’esprit, un principe séduisant, mais circonscrit à leurs traités de physique.
Si j’étais de mauvaise foi, et si j’extrapolais un peu, je dirais qu’il n’y a eu que les habitants d’Hiroshima et de Nagasaki (ceux, ensuite, de Tchernobyl et de Fukushima) pour éprouver matériellement les conséquences ultimes des travaux d’Einstein. Mais ce n’est pas mon genre. Et cependant, même s’il s’est trouvé peu de lecteurs pour éplucher dans le détail la théorie de la relativité, tout le monde a perçu le tremblement, tout le monde en a ressenti l’onde sourde au fond de ses viscères.
Les travaux respectifs de Copernic, Darwin, Freud et Einstein produisirent donc des secousses d’intensité variable au moment où ils eurent lieu, mais leurs effets sont profonds et durables. On aurait tort de sous-estimer l’effet induit sur les consciences par les coups de bélier que portèrent tour à tour ces quatre savants sur les consciences de l’homme occidental. Quand les fondements de l’entendement humain sont ébranlés, on peut, en effet, continuer de cultiver ses carottes, mais un scrupule (du latin populaire « scrupulus », petit caillou, d’où, par extension figurée : « inquiétude de la conscience » ; un peu d’étymologie ne nuit pas) s’immisce dans l’esprit comme un calcul rénal.
Tout ça pour dire quoi ? Que ça devient de plus en plus difficile, pour les hommes, d’exister sur des bases constantes. Que l’homme occidental (donc l’homme tout court : soyons de bon compte, c’est tout de même l’Europe qui conduit la pensée contemporaine à travers le vaste monde, jusqu’à nouvel ordre) a le vertige sans très bien savoir pourquoi. Et ça, c’est très nouveau, au regard de la longue histoire des peuples.
Est-ce que c’était mieux avant ? Houlà !
Ça dépend. À certains égards, c’était mieux avant. Ou plus confortable, ce qui n’est pas forcément mieux. Ou peut-être que oui, mine de rien. Ça dépend.
Mais je n’en ai pas terminé avec l’histoire de ce grand inconfort de l’homme occidental.
Parce que le xxe siècle a trouvé mieux pour déstabiliser les fondements : il a inventé le féminisme.
J’appuie sur « pause »
Avant de continuer, je vous adresse une proposition purement méthodologique.
Une digression, si vous voulez, mais utile.
Notre époque est à ce point éprise de rapidité qu’elle verse dans la précipitation. Le rapport au réel dans sa globalité ne supporte plus la lenteur. Du téléchargement d’une vidéo sur un Mac à la livraison d’une commande d’escarpins, de la préparation d’un repas aux rapports sociaux, tout doit aller vite. On s’indigne de devoir attendre quatre minutes la réponse au mail qu’on vient d’envoyer. La pensée puis son corollaire, la communication, n’avaient aucune chance d’échapper à ce grand syndrome de l’immédiateté. Il en est résulté un phénomène qui est la paresse intellectuelle et son incarnation qui est l’usage du slogan.
Un journaliste, par exemple, dispose de trois minutes et vingt-huit secondes pour questionner son invité sur les arcanes les plus complexes de la dette publique, du dérèglement climatique, de la violence capitaliste ou de l’existence de Dieu. C’est court. L’invité tente de simplifier, mais ça le contraint souvent, à son corps défendant, à des raccourcis qui travestissent sa pensée. Exercice compliqué. Auquel le journaliste (lui-même tenu à trois minutes et vingt-huit secondes parce qu’il doit laisser la place à la pub qui va suivre) oppose une forme particulièrement indigente de l’argumentation : le slogan.
Imaginez que je veuille établir que, par exemple, les moines dominicains de l’Inquisition avaient des raisons pour soumettre Galilée à la question ; que ces raisons étaient peut-être (compte tenu du système de pensée qui était le leur) sincères ; et qu’on a tort de considérer un fait ancien avec un regard contemporain, aussitôt le journaliste me lancera : « Mais vous faites l’éloge de l’obscurantisme ? »
L’obscurantisme, c’est pas mal, comme slogan. Il y en a d’autres. Tout un petit catalogue de mots rapides, lapidaires, devant lesquels on se sent soudain réduit à l’impuissance.
Si je laisse entendre que les réseaux sociaux ne constituent pas nécessairement un progrès pour l’être humain, on me répondra qu’il faut « vivre avec son temps ». « Vivre avec son temps » est un grand classique dans la panoplie dont dispose le journaliste indigent ou le contradicteur pressé. Dire qu’il faut vivre avec son temps, ça semble tout résoudre, tout élucider. Il faut vivre avec son temps, et passons à autre chose.
« Il faut vivre avec son temps » est l’un des mantras les plus consternants de ceux qui peuvent être prononcés. Une de ces phrases qui exonèrent de penser. De penser finement.
(Un jour, j’ai écrit une lettre au patron d’une chaîne de radiotélévision de service public francophone belge pour lui poser les deux questions suivantes : « J’entends que, dans de nombreuses émissions, l’animateur invite le téléspectateur ou l’auditeur à visiter la page Facebook de l’émission s’il veut obtenir un supplément d’informations. D’une part, ne possédant pas de compte Facebook, n’ayant aucune envie de me connecter à un réseau social de ce type, je me trouve privé d’une partie significative des informations que vous devriez normalement me fournir. D’autre part, Facebook étant une entreprise privée, cotée en Bourse, je me demande quel montant elle verse à vos chaînes sur base annuelle pour que vous lui fassiez une publicité quotidienne aussi intensive. » Il m’a répondu qu’il fallait vivre avec son temps.)
L’usage du slogan relève d’une sorte de blanchiment de la pensée. Un petit coup de « vivre avec son temps » et vous obtenez une pensée toute propre, prétendue incontestable. C’est aussi un missile : un slogan pulvérise toute possibilité d’argumentation complexe et fine. Il atomise, éparpille, et ne laisse derrière lui qu’un journaliste satisfait d’avoir respecté le timing et un interlocuteur groggy.
(Loués soient les articles de fond et les émissions qui permettent à leur invité de disserter lentement.)
Ce qui est intéressant, c’est de questionner la base sur laquelle s’appuie le slogan. La valeur qui le soutient. « Vivre avec son temps » revient à soutenir que le progrès, la contemporanéité constituent une valeur. Voilà qui en dit déjà long sur les nouveaux dieux de l’époque.
Taxer quelqu’un d’obscurantisme relègue cette personne dans un brouillard qui, aux yeux de tous, est considéré comme méphitique, délétère et puant. J’ai beau vouloir faire entendre que je préfère ignorer si le monstre du Loch Ness existe vraiment, j’ai beau soutenir que le mystère et ses parfums sont parfois enviables, délicieux, préférables aux lumières insipides de la vérité, on me servira de l’« obscurantiste » jusqu’à la fin de la conversation. Laquelle conversation n’a, en général, pas beaucoup de chance d’aboutir à un résultat convaincant.
« Le retour au Moyen Âge » est un bel autre exemple de cet arsenal. Si je soutiens que le nucléaire est terriblement dangereux, si je prétends que je préfère rallier le village voisin en marchant sur un joli sentier de campagne qu’en prenant ma voiture, ou si je revendique le principe de simplicité volontaire, il se trouvera quelqu’un pour me dire que je prône le retour au Moyen Âge. Le Moyen Âge tout court, d’ailleurs, semble être frappé de malédiction. C’est pourtant une période fascinante à bien des égards, pour peu qu’on s’y intéresse. De manière générale, on dirait qu’il suffit de se référer au passé pour disqualifier, par exemple, une loi. « Cette condamnation s’appuie sur un décret de 1830 ! » Oui, et alors ? Qu’une loi de 1830 soit encore d’applicationme donne d’abord à penser que c’est un excellent texte, puisqu’il a franchi les époques. Possible que la situation à laquelle s’applique ce décret a varié au point de le rendre obsolète, mais alors je veux qu’on me l’explique et qu’on ne se contente pas d’un slogan lapidaire.
Les paresseux du bulbe en possèdent un arsenal. Si vous évoquez l’idée d’un monde démilitarisé, on vous enverra du « doux rêveur » ou du « pacifiste » et tout sera dit. Si vous pensez qu’il est peut-être utile de réfléchir à la question du bien commun pour ne pas laisser les multinationales privatiser ce qui appartient à l’humanité (l’eau, le vivant, les semences par exemple), ou qu’on peut imaginer une forme d’allocation universelle qui mettrait chaque citoyen à l’abri de la nécessité, ou qu’il serait interdit de gagner plus de 20 000 euros par mois, parce qu’aucun être humain n’a réellement besoin d’un salaire mirobolant, on réglera le débat d’un bon gros « communiste » lapidaire qui vous envoie dans les cordes : on vous assimile à Staline ou Mao, et là encore, tout est dit. Si je m’interroge sur l’intérêt qui existe à franchir la Manche sur un pédalo, on me répondra que « c’est pour une bonne cause ». Hé oui, les valeureux pédaleurs ont pris soin de recueillir des fonds au bénéfice des enfants frappés d’une fâcheuse pathologie et je n’ai, dès lors, plus qu’à la fermer.
Bon. Ma digression est utile si elle permet de pointer un des syndromes d’une époque fatigante : la paresse intellectuelle. Et un de ses avatars visibles : le slogan.