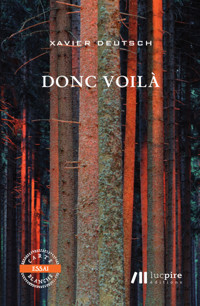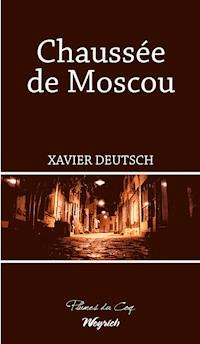Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luc Pire
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Eté 1944. Alors que les Alliés traversent l’Europe pour la libérer de l’Occupation allemande, un cadavre est découvert dans une petite maison du bord de la Dyle, quai du Trompette, à Wavre. Un cadavre, alors que la fin de la guerre approche ? Quoi de plus banal ? Un policier pressent cependant que cette mort ne doit rien aux circonstances historiques et qu’on se trouve en présence d’un meurtre crapuleux. En dépit de ce que lui recommande son chef et sans craindre les balles qui sifflent de toutes parts dans la dernière confrontation entre les libérateurs britanniques et les soldats allemands, il cherche à résoudre cette étrange affaire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
XavierDeutsch
Xavier Deutsch est né à Louvain le 9 février 1965. Il est docteur en philosophie et lettres de l’Université catholique de Louvain. Il exerce le métier de romancier. Il a obtenu le prix Rossel en 2002 pour son romanLa belle étoile, paru au Castor astral.
Depuis janvier 1989, Xavier Deutsch a publié une trentaine de romans, pour adultes et pour adolescents, des dizaines de nouvelles, des pièces de théâtre, des chroniques dans la presse, des contributions de toutes natures. Parmi ces textes,Au coin de la rue des Amoursest paru aux éditions Luc Pire en 2012.
www.xavierdeutsch.be
©éditions Luc Pire
[éditions Naimette sprl]
Esplanade de l’Europe, 2A bte 2
4020 Liège
www.lucpire.be
Coordination éditoriale :éditions Luc Pire
Graphisme : [nor]production
www.norproduction.eu
Illustration de couverture : la Dyle à Wavre
ISBN : 978-2-87542-119-7
Version imprimée également disponible en librairies
Droits de traduction et de reproduction
réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle,
de cet ouvrage est strictement interdite.
Romansde gareIKilland read
Xavier
Eugène Lambot01
C’est ballot. Si Eugène Lambot était mort trois jours plus tard, il aurait vu les troupes du 2e bataillon des Welsh Guards entrer dans Wavre par le nord, par la chaussée de Bruxelles, et libérer la ville.
Mais Eugène Lambot était mort le 3 septembre 1944. Un dimanche ! Plus exactement, sa dépouille fut découverte par sa logeuse, Léonie Deremme, le dimanche 3 septembre en fin de matinée, mais celle-ci ne possédait pas les connaissances utiles pour déterminer la datation précise du décès, pas davantage que l’agent Firmin Bidoul qui fut appelé sans retard sur les lieux.
Il fallut composer avec la conjoncture et la conjoncture ne se prêtait pas aux protocoles qu’imposent d’ordinaire les devoirs de bonne police. Des bombardements avaient eu lieu depuis la veille, particulièrement sur Ottenbourg et Basse-Wavre, sans qu’on sût très bien de quel camp ils venaient. Les troupes allemandes étaient rendues nerveuses par l’avancée de la 2e division blindée américaine, et l’on commençait à voir quitter leurs tanières des poignées de partisans, les armes à la main. Les gens ne sortaient que lorsqu’une circonstance impérieuse les y poussait. Léonie Deremme avait considéré la mort brutale d’Eugène Lambot comme une circonstance impérieuse : s’étant mise en recherche d’un agent de la police, elle avait découvert Firmin Bidoul faisant une ronde, non loin de chez elle.
L’agent Bidoul était un jeune homme déluré, finaud. Lorsqu’il avait suivi la mère Deremme jusqu’au quai du Trompette où le drame avait eu lieu censément, et qu’il s’était rendu à l’étage, et qu’il avait franchi la porte laissée ouverte par la logeuse, il avait émis un commentaire bref :
– Bigre.
L’agent Bidoul avait beau ne posséder aucune compétence en médecine, il avait cru pouvoir conclure dans ce sens définitif : le mort était mort. Le corps gisait sur le parquet dans une position qu’il aurait été fort inconfortable de garder dans l’hypothèse où, par exemple, Eugène Lambot s’était mis en tête de faire une bonne blague à Léonie Deremme. Si Eugène Lambot avait voulu se faire passer pour mort, il ne se serait certainement pas tordu la jambe gauche sous le poids du reste de sa carcasse. Il n’aurait pas davantage déboîté lui-même son épaule droite, laquelle avait quitté son articulation probablement dans la chute qui avait suivi le brutal trépas du pauvre homme.
Enfin, s’il était resté un doute dans l’esprit de l’agent Firmin Bidoul, il lui aurait suffi de prendre la mesure de ce flot de sang noirâtre qui, s’étant écoulé d’un large trou dans la tempe, avait formé une sorte de nappe malodorante sur le parquet. L’agent avait poussé son sens de la vérification jusqu’à porter un doigt sur la surface de cette tache noire et, après avoir reniflé cette substance collante, il avait eu cette sentence :
– C’est du sang.
– Misère !
Léonie Deremme n’était pas de nature impressionnable et la guerre n’avait pas entamé son caractère mais, si c’est une chose d’entendre parler des morts de Stalingrad ou de Pearl Harbor, c’en est une autre de considérer son propre locataire trucidé en son propre logis. Elle était contrariée. L’agent Bidoul fit du regard le tour de la pièce. Il y avait un lit, au pied duquel avait chu le cadavre. Puis une table en bois blanc, une chaise, et une petite commode où sans doute Eugène Lambot serrait ses effets. Sur la tablette de la commode, une cuvette, un broc, une petite coupelle qui contenait encore le quart d’un savon. Sur la table, deux livres. L’agent Bidoul en déchiffra les titres mais n’en retira aucune conclusion significative : il s’agissait d’horticulture. Pour un homme ne possédant pas même un bac à fleurs.
Il se tourna vers le mort : Eugène Lambot devait avoir la quarantaine, ce que lui confirma plus tard Léonie Deremme. Il était vêtu d’un pantalon gris retenu par une paire de bretelles qui ne s’étaient pas décrochées dans l’incident, et d’une chemise blanche, maintes fois ravaudée aux manches, mais d’une propreté suffisante pour empêcher de penser que la victime était un homme négligent de lui-même.
Que faire ? L’agent Bidoul se porta vers la fenêtre, ouverte, et se pencha par acquit de conscience. Il vit la Dyle couler sous le mur. On se trouvait à l’étage, et la pièce donnait sur l’arrière de l’immeuble.De l’autre côté de la rivière s’alignaient les sinistres bâtiments de l’abattoir : des façades en briques badigeonnées de lie-de-vin, qui n’invitaient pas à la camaraderie. Ayant regardé en bas de la fenêtre puis en face, l’agent Bidoul leva enfin les yeux en l’air et il vit le ciel. Un beau ciel de septembre, d’une lueur tendre qui, doucement, penchait vers l’automne, mais qui n’avait rien à lui apprendre. Pas un avion ne transperçait l’azur : les bombardements s’étaient interrompus.
L’agent Bidoul se détourna de la fenêtre, prit la chaise par son dossier et s’y assit. C’était tout ce qu’il pouvait faire. Il considéra la logeuse, une femme replète qui poussait devant elle une poitrine confortable, très confortable, au point qu’elle éprouvait le besoin de joindre ses mains sur son ventre. Elle portait une robe de coton, noire, très ordinaire, mais elle avait un aspect soigné. Un chignon retenait ses cheveux gris. Elle approchait de la soixantaine. Ses yeux, passé l’émoi nécessaire dont elle avait cru bon de faire preuve, se posaient à présent sur l’agent Bidoul comme s’il s’était agi de prendre sa mesure. Ce garçon ne devait pas avoir plus de vingt et un ans. Il avait un bon visage, des yeux vifs, un air franc. Une petite moustache un peu trop claire. Un corps élancé qui n’avait pas encore tout à fait terminé de recevoir sa forme définitive. Son uniforme, son képi, son baudrier, ses bottes mêmes avaient encore un peu l’air d’un déguisement. Une arme lui pendait à la ceinture mais on hésitait à la prendre au sérieux. D’autant qu’il se mit à poser à Léonie Deremme des questions étonnantes. Il demanda :
– Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
– Bah.
La grosse dame eut un geste. Elle regarda par terre la tache de sang noir. La guerre avait apporté assez de malheur et il avait fallu, alors que les Américains ou les Britanniques arrivaient du côté d’Overijse et qu’on parlait d’en finir enfin, qu’Eugène Lambot se fît trucider. Chez elle ! Et comment avait-il fait son compte ? Ce n’était pas à elle, Léonie Deremme, à déterminer tout cela. Elle escomptait qu’on la débarrassât de cet encombrant cadavre. Avant d’affranchir la ville de Wavre, elle aurait bien aimé d’abord qu’on libérât sa maison.
L’agent Bidoul n’était pas aidé. Il prit un petit carnet dans une poche de son costume et mouilla la pointe de son crayon.
– Nous disons donc…
– Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
– Nom, prénom, qualité.
– Deremme, Léonie, logeuse.
– Mais non. Pas vous. Lui.
– Ah. Eugène Lambot. Ça faisait deux ans qu’il louait chez moi. Deux ans et demi, on va dire.
– Profession ?
– Si je savais seulement. Je crois bien qu’il avait été représentant, dans le temps, et qu’il cherchait un nouveau poste.
– Depuis deux ans et demi ?
– Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne le connaissais qu’ainsi, pas mieux.
– Marié ? De la famille ?
Léonie Deremme eut l’air de soulever des souvenirs. Puis elle répondit :
– Il a eu quelqu’un, mais vous dire s’il était marié, je ne pourrais pas.
– Et cette personne ?
– Est partie un beau jour. Un dimanche, c’est facile à se rappeler.
– Il y a longtemps ?
– Ça va faire sept mois, vu que c’était en février.
L’agent Bidoul chercha des yeux quelle autre question il aurait pu trouver à poser. Il regarda le mort, qui n’avait pas bougé d’où il se tenait, et demanda :
– Vous n’avez pas une idée, vous, des fois ?
– Une idée sur quoi ? lui fit Léonie Deremme.
– Avez-vous noté la présence d’une arme dans la chambre ? Non, chère madame ! Il a donc bien fallu quelqu’un pour pénétrer ici, viser ce malheureux, et faire feu ! D’où ma question : avez-vous une idée de la personne qui a pu commettre un tel acte ?
– Comment voulez-vous que je le sache ?
– Eugène Lambot avait-il des ennemis ?
– Pas davantage que d’amis. C’était l’homme à rester des heures, des jours entiers, ici, à lire des ouvrages qu’il revendait aussitôt qu’il les avait terminés. Si j’entendais trois fois le son de sa voix sur une journée, c’était qu’il manquait de sucre pour sa tartine.
– Il mettait du sucre sur sa tartine ?
Léonie Deremme regarda l’agent Bidoul en se demandant si la réponse à cette question était réellement de nature à découvrir l’auteur du geste tragique auquel Eugène Lambot avait succombé. Elle répondit, à tout hasard :
– Des fois.
Mais son air était assez éloquent et l’agent Bidoul comprit qu’il était temps pour lui de s’en référer à son supérieur. Il tapota son carnet d’une main sur l’autre avant de le ranger dans sa petite poche de poitrine, dont il referma le bouton, et déclara d’un air entendu :
– Bien bien, je sais ce qu’il me reste à faire.
– C’est heureux.
– Ne touchez à rien aussi longtemps qu’on n’est pas venu vous dire quoi ou qu’est-ce.
Il eut encore un regard vers la fenêtre et crut bon de donner à Léonie Deremme un conseil de prudence :
– Si jamais les bombardements reprenaient, abritez-vous dans la cave. D’ailleurs ne sortez pas de chez vous, il va faire dangereux. Moi, je vais…
Il prit un air grave pour ne pas terminer sa phrase. La logeuse préféra ne rien ajouter. Elle suivit l’agent dans l’escalier, dans le corridor d’entrée, puis elle referma derrière lui la porte.
Il était alors deux heures et quarante-six minutes de l’après-midi.
Léonie Deremme02
Après avoir quitté le logis de la dame Deremme,quai du Trompette, l’agent Bidoul courut à travers les ruelles qui, de la Dyle, permettaient de rejoindre le commissariat sans risquer de rencontrer une patrouille allemande. Il n’avait en principe rien à en redouter mais, par ces temps de déroute, mieux valait ne pas chercher la compagnie de la bête blessée.
Les rues, d’ailleurs, étaient à peu près désertes. Autochtones comme occupants, chacun semblait attendre un événement. L’agent Bidoul laissa bientôt derrière lui le perron de l’église Saint-Jean-Baptiste et se rendit où son devoir l’appelait. Au planton qui gardait l’entrée du poste, il demanda si le commissaire Vermeulen était visible. Il obtint une réponse négative.
– Sapristi !
– Un dimanche, tu penses, ajouta le collègue avec finesse.
– Que faire ? Dieu ! Que faire ?
– Qu’est-ce qui t’agite, Bidoul ?
L’agent donna l’impression de réfléchir, comme s’il hésitait à livrer l’affaire au planton, puis il lâcha :
– Un défunt, quai du Trompette.
– Ah.
L’homme, un petit rond qui avait comme LéonieDeremme cette façon de réunir ses doigts boudinés juste sur la ceinture, considéra Bidoul sans paraître plus ému que nécessaire. Il allait sur ses quarante-cinq ans. Il était de nature placide, portait sous le nez une petite moustache en brosse, et devait songer sans doute qu’un défunt en temps de guerre ne donnait pas matière à se mettre en frais. Il ne se mouilla guère et prononça :
– C’est fâcheux.
– Que faire ?
– Qu’est-ce qu’il a d’urgent, ton défunt ?
Comme Bidoul regardait le planton sans répon-dre, celui-ci ajouta :
– Il ne va pas mourir deux fois. Laisse-le refroidir. On ne verra pas le commissaire avant demain, peut-être mardi.
– Ça m’embête beaucoup !
– Peut-être mercredi.
– Bigre !
Un avion passa au-dessus de la ville à une altitude telle qu’on ne pouvait identifier de quelle armée il venait. L’agent Bidoul ni le planton ne s’en alarmèrent : l’appareil volait seul. On n’avait un bombardement à redouter que dans le cas où se présentait une escadrille.
L’avion s’éloigna mais le problème de l’agent Bidoul restait entier. Le planton considérait son jeune collègue d’un œil navré. Il aurait aimé pouvoir aider un peu toutefois sans se compromettre. Il tenait à sa tranquillité. Alors tout de même il lui demanda :
– C’est quoi, ce défunt ?
– Quai du Trompette, chez une dame qui loue sa chambre. Attends.
Il sortit de sa poche de poitrine ce petit carnet qui avait reçu quelques notes et lut :
– Eugène Lambot, la quarantaine, sans emploi. Une munition lui est passée par la tête, il gît de son long sur le parquet de la pièce.
– Bah. Il aura pris une balle perdue. Des fois ça canarde un peu de ce côté.
– Négatif. Sa fenêtre donne sur la Dyle. En face, la grande muraille de l’abattoir. J’ai bien regardé. Pour qu’une balle atteignît la tempe à Lambot, il aurait fallu que, tirée de la chaussée de Bruxelles par exemple, elle effectuât une courbe, un arc de cercle pour entrer par la fenêtre. Ça se voit peu.
– C’est juste.
Le planton était pensif. Il avait gardé les pouces dans la ceinture et regardait Bidoul par en dessous comme pour se tenir à l’écart d’un embêtement qui ne le concernait pas.
– C’est fatal, ajouta l’agent Bidoul dans un soupir, quelqu’un a pénétré chez Mme Deremme, a gravi l’escalier, s’est présenté auprès d’Eugène Lambot et lui a tiré un noyau dans le crâne avant de redescendre par où il était venu.
– Et le commissaire qui n’est pas là…
– Et le substitut ?
– Lequel ? demanda le planton.
– T’en connais beaucoup ?
Le petit homme rond, sans retirer les pouces qu’il avait dans la ceinture, écarta les coudes et fit une grimace pour montrer qu’il ne savait pas. L’agent Bidoul posa les yeux vers son collègue qu’il dépassait d’une demi-tête. Il songeait à bien des choses, de vastes pensées faisaient leur chemin à travers plaine, entre le sens du devoir et la complication des circonstances. Un homme passa par là, un vieux marchand de bicyclettes qui tenait une boutique rue Haute. Il s’avança vers les policiers. Il avait la tête chaude et le cheveu gris, et le regard incertain. Son petit corps progressait à la façon d’un rideau pris par le vent, à ceci près qu’il n’y avait pas de vent. Il fut bientôt en face du planton et lui demanda :
– Y a rien d’ouvert ?
Le planton, l’œil gai, eut le mouvement de répondre par une saillie telle que, par exemple, « Ah, mais nous sommes ouverts, nous autres… » Il se retint car il craignait que le vieil homme le prît au mot et s’engageât par la porte du commissariat. Un rire de ventre lui secoua la ceinture et, ne pouvant y renoncer finalement, il prononça :
– Ah, mais nous sommes ouverts, nous autres…