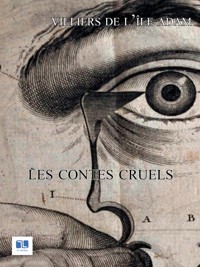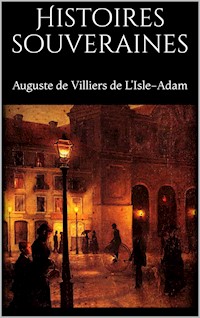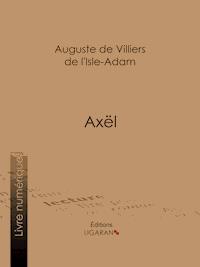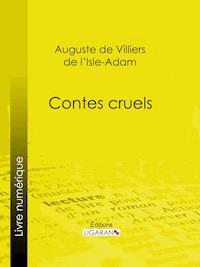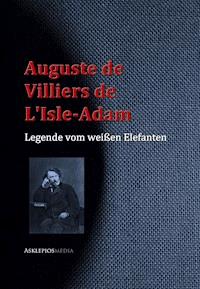Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "La simplicité, l'enjouement, les prévenances de notre hôte nous rendirent inoubliables ces jours heureux : une grandeur natale ressortait pour nous du laisser-aller qu'il nous témoignait..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335028966
©Ligaran 2015
À. M. Henri Mercier.
Ce qui cause la réelle félicité amoureuse, chez certains êtres, ce qui fait le secret de leur tendresse, ce qui explique l’union fidèle de certains couples, est, entre toutes choses, un mystère dont le comique terrifierait si l’étonnement permettait de l’analyser. Les bizarreries sensuelles de l’Homme sont une roue de paon, dont les yeux ne s’allument qu’au-dedans de l’âme, et, seul, chacun connaît son désir.
Par une radieuse matinée de mars 1793, le célèbre citoyen Fouquier-Tinville, en son cabinet de travail de la rue des Prouvaires, assis devant sa table, l’œil errant sur maints dossiers, venait de signer la liste d’une fournée de ci-devants dont la suppression devait avoir lieu le lendemain même, entre onze heures et midi.
Soudain, un bruit de voix, – celles d’un visiteur et d’un planton de garde, – lui parvint de derrière la porte.
Il releva la tête, prêtant l’oreille. L’une de ces voix, qui parlait de forcer la consigne, le fit tressaillir.
On entendait ; « Je suis Thermidor Moutonnet ! de la section des Enfants du devoir !… Dites-lui cela ! »
À ce nom, Fouquier-Tinville cria :
– Laissez passer.
– Là ! je savais bien ! vociféra, tout en pénétrant dans la pièce, un homme d’une trentaine d’années, et de mine assez joviale, – bien qu’une sournoiserie indéfinissable ressortit de l’impression que causait sa vue… Bonjour. C’est moi, mon cher : – j’ai deux mots à te dire.
– Sois bref : mon temps n’est pas à moi, ici.
Le survenu prit un siège et s’approcha de son ami.
– Combien de têtes pour la prochaine, demanda-t-il en indiquant la pancarte que venait de parapher son interlocuteur.
– Dix-sept ; répondit Fouquier-Tinville.
– Il reste bien une petite place entre la dernière et ta griffe ?
– Toujours ! dit Fouquier-Tinville.
– Pour une tête de suspecte ?
– Parle.
– Eh bien, je te l’apporte.
– Le nom ? demanda Fouquier-Tinville.
– C’est une femme !… qui… doit être d’un complot… qui… Combien de temps demanderait le procès ?
– Cinq minutes. – Le nom ?
– Alors, on pourrait la guillotiner demain ?
– Le nom ? ?
– C’est ma femme.
Fouquier-Tinville fronça le sourcil et jeta la plume.
– Va-t-en ; je suis pressé !… dit-il : nous rirons plus tard.
– Je ne ris pas : j’accuse !… s’écria le citoyen Thermidor d’un air froid et grave avec un geste solennel.
– Sur quelles preuves ?
– Sur des indices.
– Lesquels.
– Je les pressens.
Fouquier-Tinville regarda de travers son ami Moutonnet.
– Thermidor, dit-il, ta femme est une digne sans-culotte. Son pâté de jeudi dernier, joint à ces trois flacons de vieux Vouvray – (que tu sus découvrir en ta cave derrière des fagots de meilleur aloi que ceux que tu me débites) – fut bon, fut excellent. Présente mes cordialités à la citoyenne. – Nous dînons ensemble, demain soir, chez toi. Sur ce, fuis, ou je me fâche.
Thermidor Moutonnet, à cette réponse presque sévère, se jeta brusquement à genoux, joignant les mains, des larmes aux yeux :
– Tinville, murmura-t-il comme suffoqué par une surprise douloureuse ; – nous fûmes amis dès le berceau ; je te croyais un autre moi-même. Nous avons grandi dans les mêmes jeux. Laisse-moi faire appel à ces souvenirs. Je ne t’ai jamais rien demandé. – Me refuseras-tu le premier service que j’implore ?
– Qu’as-tu bu ce matin ?
– Je suis à jeun, répondit Moutonnet en ouvrant de grands yeux, ne comprenant évidemment pas la question.
Après un silence :
– Tout ce que je puis faire pour toi, c’est de lui taire, demain soir, à table, ta démarche incongrue. Je ne puis croire que tu oses plaisanter, ici – ni que tu sois devenu fou… quoique, d’après ce que tu demandes, cette dernière supposition soit admissible.
– Mais… je ne peux plus vivre avec Lucrèce !… gémit le solliciteur.
– Tu as soif d’être cornard, citoyen : je vois cela.
– Ainsi… tu me refuses !
– Quoi ? de lui faire couper le cou parce que vous avez des mots ensemble ?
– Oh ! la carogne ! Voyons, mon bon Tinville, au nom de l’amitié, mets ce nom sur ce papier, je t’en prie… pour me faire plaisir !
– Un mot de plus, j’y mets le tien ! grommela Fouquier-Tinville en ressaisissant la plume.
– Ah ! par exemple… pas de ça ! cria Moutonnet, tout pâle, en se relevant. – Allons, soupira-t-il c’est bien ; je m’en vais. Mais ajouta-t-il – (d’une voix de fausset hystériquement singulière, pour ainsi dire, et queson ami ne lui connaissait pas), – j’avoue que je ne te croyais pas capable de me refuser, après tant d’années de liaison, ce premier, cet insignifiant service qui ne t’eût coûté qu’un griffonnage ! – Viens dîner demain, tout de même, – et motus à ma femme : ceci entre nous seuls ! acheva-t-il d’un ton sérieux et, cette fois, naturel.
Thermidor Moutonnet sortit.
Resté seul, le citoyen Fouquier-Tinville, ayant rêvé un moment, se toucha le front du doigt avec un froid sourire ; puis, ayant haussé les épaules comme par forme de conclusion, prit sa liste, en inséra le pli dans une large enveloppe, écrivit l’adresse, scella, et frappa sur un timbre.
Un soldat parut.
– Ceci au citoyen Sanson ! dit-il.
Le soldat prit l’enveloppe et se retira.
Tirant un oignon d’or de son gilet en gros de Naples fleuri d’arabesques tricolores, et regardant l’heure :
– Onze heures, murmura Fouquier-Tinville : – Allons déjeuner.
Trente ans après, en 1823, Lucrèce Moutonnet (une brune de quarante-huit ans, encore dodue, fine et futée !) et son époux Thermidor, s’étant expatriés en Belgique au bruit des canons de l’Empire, habitaient une maisonnette d’épicerie florissante, avec un coin de jardin, dans un faubourg de Liège.
Durant ces lustres, et dès le lendemain de la fameuse démarche, un mystérieux phénomène s’était produit.
Le couple Moutonnet s’était révélé comme le plus parfait, le plus doux, le plus fervent de tous ceux que l’amour passionnel enlaça jamais de ses liens délicieux. Le pigeon, la colombe ; tels ils se semblèrent.
Ils réalisèrent le modèle des existences conjugales. Jamais le plus léger nuage entre eux ne s’éleva. Leur ferveur fut extrême ; leur fidélité presque sans exemple ; leur confiance, réciproque.
Et, cependant, le mortel auquel il eût été donné de pouvoir lire au profond de ces deux êtres, se fût senti bien étonné, peut-être, de pénétrer le réel motif de leur félicité.
Thermidor, en effet, chaque nuit, dans l’ombre où ses yeux brillaient et clignotaient, pendant que l’accolait conjugalement celle qui lui était chère, se disait en soi-même.
– Tu ne sais pas, non ! toi, tu ne sais pas que j’ai tenté le possible pour te faire COUPER LA TÊTE ! Ha ! ha ?… Si tu savais cela, tu ne m’accolerais pas en m’embrassant ! Mais, – ha ! ha ? seul je sais cela ! voilà – ce qui me transporte !
Et cette idée l’avivait, le faisait sourire, doucement, dans les ténèbres, le délectait, le rendait amoureux jusqu’au délire. Car il la voyait alors sans tête : et cette sensation-là, d’après la nature de ses appétits, l’enivrait.
Et, de son côté, Lucrèce, également, se disait par une contagion, avec le même aigu d’idées, en de malsains énervements :
– Oui, bon apôtre, – tu ris ! tu es content ? Tu es ravi !… Eh bien, tu me désireras toujours. – Car tu crois que j’ignore ta visite au bon Fouquier-Tinville, – ha ! ha ?… et que tu as voulu me faire COUPER LA TÊTE, scélérat ! Mais, – voilà ! je sais cela, moi !… Seule, je sais ce que tu penses, – et à ton insu. Sournois, je connais tes sens féroces. – Et je ris tout bas ! et je suis très heureuse, malgré toi, mon ami.
Ainsi, le bas d’insanité sensorielle de l’un avait gagné l’autre, par le négatif. Ainsi vécurent-ils, se leurrant l’un l’autre (et l’un par l’autre), en ce détail niais et monstrueux où tous deux puisaient un terrible et continuel adjuvant de leurs macabres plaisirs ; – ainsi moururent-ils (elle d’abord), sans s’être jamais trahi le secret mutuel de leurs étranges, de leurs taciturnes joies.
Et le veuf, Thermidor Moutonnet, sans enfants, demeura fidèle à la mémoire de cette épouse, à laquelle il ne survécut que peu d’années.
Quelle femme, d’ailleurs, eût pu remplacer, pour lui, sa chère Lucrèce ?
C’était au lendemain d’une fête vénitienne, donnée par Mme Nina de Villard en son légendaire petit hôtel de la rue des Moines. On dînait dans le jardin. Parmi nous, se trouvait l’invité de passage, un long et bel amateur mondain qui, depuis les hors-d’œuvre, nous observait avec stupeur, en son habit noir. L’on jouissait de la douceur de se sentir méprisé de ce brillant individu. Vers le café, sur un coup d’œil que nous échangeâmes, sa perte fut résolue : – M. Marras, donc, lui tendit, gravement, un monstrueux paradoxe – auquel, se prenant comme à de la glu, l’attendrissant éphèbe, avec un suffisant sourire, répliqua :
– Cependant, Messieurs, si vous attendez après les mots, votre poésie n’aura souvent pas de sens ?…
– Oh ! répondit, d’un ton froid, M. Jean Richepin, le sens n’est qu’une plante parasite qui pousse, quand même, sur le trombone de la sonorité.
– La sonorité ? reprit le « gommeux », les yeux un peu hagards : mais… le bruit n’est rien : il est des vers discrets, dont le charme…
– Enfin, rimez-vous pour l’œil ou pour l’oreille ?
– Pour l’odorat, Monsieur, répondit, avec mélancolie, M. Léon Dierx.
– Vous riez ? Soit. Mais, au bout du compte, le sentiment, qu’en faites-vous ? essaya de reprendre le malheureux élégant, en se tournant vers M. Stéphane Mallarmé. – L’élégie, en dépit de nos mœurs, demeure, quand même, d’un succès assuré près des femmes… Dès lors, pourquoi s’en priver ? – Vous ne pleurez donc jamais, en vers, Monsieur ?
– Ni ne me mouche ! répondit, de sa voix didactique et flûtée, M. Stéphane Mallarmé en élevant, à la hauteur de l’œil, au long du geste en spirale, un index bouddhique.
Durant ce colloque, Nina et les habituées féminines de ces soirées, pour ne point rire au nez de l’intéressant jeune homme, étaient rentrées dans la maison.
– Vous n’êtes, alors, d’aucune école, Messieurs ? continuait celui-ci,
– Nous sommes de l’école des Pas-de-Pré-face ! répondit, en souriant, M. Catulle Mendès.
– Tiens !… Je vous croyais de celle de M. Leconte de Lisle, – ( !) – murmura le pschutteux désorienté : et, à ce propos, ajouta-t-il en se tournant vers moi, – compte-t-il donner, enfin, bientôt, quelque chose de… sérieux, Leconte de Lisle ?
– Non, Monsieur, répondis-je en m’inclinant : il vous laisse ce soin.
Voyant qu’il avait affaire à des gens insociables, incompréhensibles, qu’il devait renoncer à convertir, l’amateur s’écria, sans transition vaine, après avoir tiré sa montre et en se levant :
– Avant de vous quitter, j’eusse voulu présenter mes devoirs… – Où sont donc ces dames ?
– Mais, au salon… je pense !… répondit négligemment M. Marras.
Sur cette réplique, toute naturelle, – mais dont l’intonation bizarre le fit presque chanceler, – le brillant invité de passage, saluant à l’anglaise, rentra, s’échappa très vite et, sans doute, court encore, – irréprochable.
C’est ainsi que l’on évinçait poliment les curieux dans cette maison fantaisiste et charmante. Lorsque tout le monde fut revenu au jardin, M. Marras, pour dissiper l’impression quelconque laissée par l’intrus, voulut bien nous lire quelques scènes d’une féerie compassée, aux épithètes voltaïques où ferraillaient mille adverbes, où les amoureux ne s’exprimaient qu’en langue médicale. Après les éclats de rire, nous nous laissâmes aller au silence de la soirée d’automne, qui était d’un bleu pâle et très douce.
Maintenant, Nina, dans sa robe de chambre aux éclatantes fleurs japonaises, se balançait, une cigarette aux lèvres, en un fauteuil américain, sous un magnolia : près d’elle, M. Marras parlait d’arcanes magiques avec un adepte, M. Henri La Luberne, et ce sympathique savant, Charles Cros, dont la récente mort, si chrétienne, me rappelle cette soirée d’étoiles.
Entre des feuillées, M. Jean Richepin, passant la tête, considérait avec « le sourire silencieux du trappeur » M. de Polignac, le jeune et sympathique incendiaire à la mode, l’anarchiste à la tenue correcte, aux manières exquises, – lequel causait, à voix basse, avec M. Henri Delaage, le medium, qui, entre deux évocations, venait parfois consumer un Cigare-des-Brahmes en ce séjour.
Près du jet d’eau qu’elle semblait écouter, Mlle Augusta Holmès, la grande musicienne, au bercer d’un hamac, regardait vaguement la nuit. – Je vois encore, en ce crépuscule, la tête de Lucius Verus, d’un jeune peintre, M. Franc Lamy, un disparu de nos réunions, mais dont nous avons tous admiré, aux derniers Salons, les toiles si curieusement lumineuses, si remarquables par la délicatesse des tons et la richesse des lignes, notamment sa Narcissa.
Debout, appuyée à la petite charmille, qu’elle dépassait presque de son front, la belle Manoël de Grandfort méditait sans doute l’une de ses fantaisies de la Vie parisienne ou de Gil Blas : – dans une allée, se promenant, sous la clarté lunaire, MM. Catulle Mendès et Stéphane Mallarmé devisaient.
Une plaisante incidence vint égayer, en ce moment, le jardin. Des cris s’élevaient du côté d’un guéridon solitaire, auprès duquel, aux lueurs d’une bougie et ses lunettes d’or sur le nez, l’auteur de la chanson célèbre : À la Grand-Pinte, M. Auguste de Châtillon, venait de lire, à l’auteur des Roses remontantes, M. Toupié Béziers, une récente poésie intitulée : Moutonnet. Or, il était arrivé que, discutant une rime, le fougueux dramaturge, en gesticulant, avait fait sauter au ciel, sans le vouloir, les lunettes du poète, lesquelles, retour des astres, s’étant accrochées à une branche folle, y demeuraient suspendues – « damonoclétiquement » selon la remarque de M. de Polignac. L’on accourut, pour éviter, s’il se pouvait, l’effusion du sang. Mais, en homme de 1830 et en parfait gentleman, M. Toupié Béziers, modulait déjà les regrets qu’il devait à son vieil ami, – lequel, cependant, aigri par l’éloquence de son offenseur, évita, par la suite, le voisinage du trop nerveux écrivain, et lui garda, secrètement, rancune de cette incartade, – qu’il ne lui pardonna qu’en mourant.
Bientôt nous nous réunîmes autour de quelques verres de champagne, qui furent placés sur une table verte, sous les ombrages. Nous étions un peu las de la fête de la veille et la conversation se ressentait de notre tendance un peu physique au recueillement.
Nous étions aussi sous l’influence mélancolique de cette stellaire obscurité, où, froissées par le vent de septembre, des feuilles tombaient déjà, tout près de nous.
Ce fut alors que Nina, se tournant vers M. Léon Dierx, qui se trouvait assis auprès de moi, le pria de dire quelques vers.
Léon Dierx avait alors trente ans, à peu près. On avait représenté de lui un drame en un acte, en vers, La Rencontre, se résumant en trois scènes d’une donnée amère, mais laissant l’impression d’une très pure poésie.
Nous avions connu M. Dierx, autrefois, chez M. Leconte de Lisle. C’était un pâle jeune homme, aux regards nostalgiques, au front grave ; il venait de l’île Bourbon, dont l’exotisme le hantait. En ses premiers vers, d’une qualité d’art qui nous charma, Dierx disait le bruissement des filaos, la houle vaste où s’endormait son île natale, et les grandes fleurs qui en encensaient les étendues ; – puis, les forêts, les lointains, l’espace, et les figures de femmes, ayant des yeux merveilleux, Les yeux de Nyssia, par exemple, apparaissaient en ses transparentes strophes.
Avec les années, sa poésie s’est faite plus profonde. Sans l’inquiétude mystique dont elle est saturée, elle serait d’un sensualisme idéal. Bien qu’il devienne peu à peu célèbre dans le monde supérieur de l’Art littéraire, ses livres : les Lèvres closes, la Messe duvaincu, les Amants, Poèmes et Poésies, etc., édités par M. Lemerre, sont peu connus de la foule, – et je suis sûr qu’il n’en souffre pas.
C’est qu’en cette poésie vibrent des accents d’un charme triste, auquel il faut être initié de naissance pour les comprendre et pour les aimer ; c’est que, sous ses rythmes en cristal de roche, ce rare poète, si peu soucieux de réclame et de « succès », connaît l’art de serrer le cœur ; c’est qu’il y a, chez lui, quelque chose d’attardé, de mélancolique et de vague, dont le secret n’importe pas aux passants.
Et le fait est que la sensation d’adieux, qu’éveille sa poésie, oppresse par sa mystérieuse intensité ; le sombre de ses Ruines et de ses Arbres, et de ses Femmes aussi, et de ses deux, surtout ! donnent l’impression d’un deuil d’âme occulte et glaçant. Ses vers pareils à des diamants pâles, respirent un tel détachement de vivre qu’en vérité… ce serait à craindre quelque fatal renoncement, chez ce poète, – si l’on ne savait pas que, tôt ou tard, les âmes limpides sont toujours attirées par l’Espérance.
Quant à la physionomie de M. Dierx, elle donne l’idée de l’un de ces enfants du Rêve, désireux de ne s’éveiller qu’au-delà de toutes les réalités. Aussi, en toute sa noble poésie, semble-t-il qu’il ait le front touché d’un rayon de cette Étoile du soir que chanta, dans les vallées, au pays des visions du Harz, Wolfram d’Eischembach.
Voici le court poème qu’alors nous récita M. Léon Dierx, – poème dont j’ai précieusement gardé l’autographe :
Ne sont-ce pas là des vers exquis et adorables ?… Nous étions encore sous leur charme lorsque nous nous séparâmes, la soirée finie.
C’était, jadis, une coutume sacrée, chez les Juifs, de déchirer ses vêtements lorsqu’on entendait un blasphème ; – si bien qu’en toute compagnie suspecte, les méfiants se bouchaient d’emblée les oreilles, par économie. – Et comme, au temps du Christ, le luxe des habits fut, au dire des historiens, poussé plus loin même qu’au temps de Salomon, les tailleurs de Jérusalem durent être singulièrement surmenés par les perpétuels renouvellements de gardes-robes qu’entraînèrent, en Israël, les graves professions de foi des premiers martyrs. La hausse du byssus et de l’hyacinthe dut être considérable. Ce fut au point qu’au cours des tortures où l’on appliquait les néophytes, l’assistance, en prévision de leurs séditieuses extases, adopta le biais subtil de se dévêtir d’avance, – (comme au massacre de saint-Étienne, par exemple, où saint-Paul, encore Gentil, accepta de surveiller le vestiaire).
C’est qu’alors, en effet, l’on ne pouvait repriser, retaper ni recoudre les vêtements sacrifiés sur l’audition d’un blasphème ; c’était pour de bon que l’on s’en séparait. – Aujourd’hui, les tailleurs israélites ont imaginé une boutonnière pratique, à l’usage des fervents : elle est close d’un simple fil qu’en mémoire des aïeux l’on fait, en souriant, sauter d’un coup d’ongle, à l’occasion. Ainsi, les israélites qui, nous dit-on, comblaient tout récemment de leur présence la salle du Théâtre-Libre, où l’on donnait l’Amante du Christ, n’eussent eu qu’un point à faire, de retour en leurs foyers, pour réparer le désordre de leur toilette, si, d’aventure, quelques propos de la mystique saynète les eussent effarouchés.
Mais non : – le poète, en sa conciliante sagacité, a su leur épargner jusqu’à cet insignifiant labeur. À l’entrée de son héros, il s’est produit, au contraire, un « effet » de recueillement, une impression « profonde ». Israélites et chrétiens ont ressenti, en un mot, cette qualité de respect signifiant qu’on trouvait Notre-Seigneur très bien, très impressionnant, très raisonnable, très sympathique et que l’on était de son avis. Tous l’ont applaudi chaleureusement pour lui témoigner de la haute et mélancolique estime où chacun le tenait. Dieu, reconnaissant de ces inespérées marques de déférence, est venu saluer le public. – Messieurs et dames se sentaient édifiés, grandis ; d’aucuns ne retenaient leurs larmes qu’à grand-peine. Tout le monde, avec une entente cordiale, avait l’air de vouloir, décidément, traduire l’« Aimez-vous les unsles autres ! » par l’« Embrassons-nous et que ça finisse ! … » C’était d’un touchant capable de faire sangloter, en une soudaine accolade, M. Drumont et M. Zadoc Kahn, avec d’entrecoupés Nous ne nous quitterons plus ! – Dans un coin, l’on entendait Siméon, le vieux marchand de lorgnettes, balbutier un vague Nunc dimittis. Si bien qu’en ces temps de Zutisme induré (qui sont, peut-être, les « révolus »), l’on pouvait conclure de ce spectacle que les suprêmes prédictions des Prophètes sont en voie d’accomplissement, – bref, qu’au train d’indifférence où s’abandonnent les chrétiens modernes, les Juifs (revenus, enfin, des conversions purement financières, et s’apercevant que l’Or lui-même non seulement n’est pas le Messie, mais ne sert, en résumé, qu’à se procurer, – après avoir affamé tout le monde, – de plus solitaires caveaux de famille), – vont se convertir, en toute hâte… POUR NE RIEN LAISSER PERDRE.
Ce miraculeux dénouement, nous ne l’espérions pas à si brève échéance. Il n’était, au fond de nos esprits, qu’à l’état de désir, – assez naturel, d’ailleurs !… Ne sommes-nous pas tous israélites, en notre premier père ?… – Certes, pèlerins de ce globe sidéral, nous avons un peu marché, en des sentiers divers, depuis le décès de ce mystérieux ancêtre. Quelques-uns se sont même croisés en route ; – mais, à la fin des fins, si des malentendus nous ont, jusqu’à présent, divisés, aujourd’hui, – n’est-il pas vrai ? – les prestiges de la Science… l’effort de tous vers la justice… l’idée, surtout, du vingtième siècle et des suivants, tout cela semble fait pour inciter, vers la plus oublieuse des fusions, les hommes de bonne volonté !… – Donc, à la nouvelle de ce qui s’était passé, en cette mémorable soirée, au Théâtre-Libre, le devoir que m’indiquait le Sens-commun ne pouvait être autre que de mêler, avec enthousiasme, mes humbles accents à l’allégresse de cette précursive petite fête de famille, – d’en complimenter, avec feu, l’heureux promoteur, – et de m’occuper d’autre chose.
D’autant mieux que, selon des rumeurs bien fondées, toute une pléiade de jeunes littérateurs, ayant remarqué qu’en dehors de toute question de talent, le simple sujet traité par l’auteur de l’Amante du Christ, provoquait l’attention, les controverses, et faisait tapage, se sont mis à l’ouvrage et se proposent d’inonder nos scènes de fantaisies mélo-évangéliques, dont Notre-Seigneur sera l’un des personnages principaux. – Ce qui nous ménage des effusions nouvelles.
Pour conclure, ces présumables fruits, plus ou moins brillants, de la Libre-Pensée, ne relevant que de la Critique littéraire de laquelle je ne fais point partie, – pourquoi m’en serais-je autrement inquiété ?
Soudain, voici que, dans le Figaro du 2 novembre récent, les mots : « Avant tout, je suis un chrétien fervent, » (signés de l’auteur de la pièce, M. Rodolphe Darzens) me passèrent sous les yeux ; et voici qu’ailleurs il ajoute : « Catholique, apostolique et romain ».
Ayant pris acte, j’attendis la luxueuse brochure, – précédée d’une eau-forte de Félicien Rops – et je viens de la lire.
– Maintenant, à titre de simple passant, je dois soumettre aux intéressés les très humbles réflexions suivantes – non que je m’exagère l’importance intrinsèque de cette tentative théâtrale – mais parce que c’est la première et qu’il est bon de prendre des mesures préventives contre l’imminence des ouvrages annoncés. Puis, pourquoi le journal le Gil Blas n’aurait-il pas, de temps à autre, une note grave, – à l’usage des personnes atteintes d’âme ?
1° La « pièce » est patronnée d’une préface due à l’auteur de l’Histoire d’Israël, le notoire M. Ledrain. – Cet éclairé personnage, exhumant de bifides redites, s’y ingénié, – le baiser de l’Euphémisme aux lèvres, – à nous révéler que Notre-Seigneur n’est qu’« un nabi de la verte Galilée, le plus séduisant des fils de l’homme, un juste, un jeune maître de haute raison, etc. » – Ce qui revient à le traiter d’imposteur. – Il ajoute : « À l’exception de la femme de Magdala, qui ne le quitta point, le doux crucifié fut, sur le Calvaire, abandonné de tous, même de son père. » Or, pourquoi la Vierge sainte, l’évangéliste saint Jean, sainte Véronique, le Larron sanctifié, Joseph d’Arimathie, les saintes Femmes, gênent-ils, comme de négligeables comparses, le disert, l’émérite préfacier ?
Parce que tout l’intérêt de la Passion semble se résumer, pour cet esprit supérieur, en les préoccupations que voici – « La Magdeleine aime-t-elle Jésus