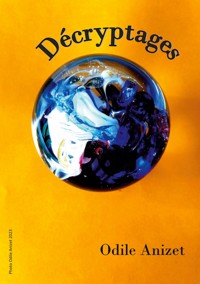Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'image est aujourd'hui trop souvent associée à la vérité. Pourtant, elle renferme en elle des trésors d'interprétation. J'ai choisi ici de me saisir d'oeuvres connues ou non, d'hier et d'aijourd'hui et d'inventer des histoires humaines. Ces textes sont une sorte de miroir sur nos vies et je vous invite, lecteur, à écrire votre propre version.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table
Avant-propos
Partie 1
1.Elle me porte sur son dos
2.Petit matin
3.Enfin partis
Partie 2
1. Fenêtre sur huis clos
2. Instants volés
3. Le choix de Sara
4.Sur un banc
5.Le bouquet de jonquilles
6.La pierre bleue
Partie 3
1.Rendez-vous manqués
2.Parle-moi
3.Scène de ménage
4.Joie de vivre
Partie 4
1.Fantaisie parisienne
2.Des barbelés en fleurs
3. Héliotropes
4. Danse, petite, danse
Avant-propos
« Si on pouvait le dire avec des mots, il n’y aurait aucune raison de peindre. » Edward Hopper
L’image est aujourd’hui trop souvent considérée comme une représentation exacte de la réalité et, par là même, comme une vérité. Pourtant, elle renferme en elle des trésors et permet ainsi de multiples interprétations.
J’ai choisi de me saisir d’œuvres connues ou non de peintres et photographes d’hier et d’aujourd’hui. Merci à eux d’avoir ainsi créé des univers aussi généreux.
C’est un vrai plaisir d’entrer, comme par effraction, dans l’existence de personnages qu’un artiste a mis en scène. Juste une façon de s’immiscer dans une scène, comme un invité qu’on n’attend pas, un indiscret qui se dissimule derrière un autre titre.
Êtres aux prises avec les convenances, s’aimer un jour ou toujours, vivre en famille ou simplement profiter d’un instant de bonheur : les hommes et les femmes dont il est question ici sont des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui, qui disent leur époque, ses crises ou ses absurdités. Mais ils tracent aussi l’éternel sillon de l’existence humaine.
Ces textes sont une sorte de miroir sur nos vies et je vous invite, lecteur, à écrire votre propre version.
Odile Anizet
Partie 1
“La liberté c'est toute l'existence, Mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances ; et les travaux, les bureaux, les maisons.”
René Clair - A nous la liberté
Elle me porte sur son dos
« Le courage, c’est ce qui fait la différence entre les gens » Marie-Laure de Decker
Regards sur l’apartheid - Marie-Laure de Decker- 1972
Elle me porte sur son dos….C’est ce que dit la photo que je viens de retrouver dans les papiers de mon père, ceux qui sont arrivés de Durban après sa mort. Au dos : « Durban- 1964 »
Elle, c’est Mbaly, ma nanny. Elle vit chez nous, dans un minuscule réduit, à côté de ma chambre parce qu’elle doit être là pour moi, à toute heure. Nounou à plein temps, sans répit, sans vacances, sans d’autre enfant que celle d’un autre, son baas blanc.
Mon père n’est pas riche. Né à Durban, d’une famille anglaise implantée depuis le XVIIIème siècle, il travaille au port, comme chacun de ses frères, comme l’ont fait son père, son grand-père. Nous habitons dans la presqu’île de Bluff, un quartier blanc alors que la famille de Mbaly est cantonnée au district d’Umlazi, un endroit sans confort où la maladie décime bien des nourrissons.
Je crois que c’est là qu’est prise la photo. Pourquoi nous y trouvons-nous ? Je ne m’en souviens pas ; j’ai quatre ans. J’essaie d’en imaginer la raison : un de ses enfants malades ? Son mari qui a eu un accident à la mine ? Sa mère peut-être ? La mienne ne doit rien savoir. Oui, je pense que nous sommes à Umlazi. La presqu’île est plus propre, moins triste ; il y a des jardins où s’étalent jacarandas et flamboyants, de belles dames qui prennent le thé sur leur terrasse et des enfants blancs qui jouent sur des pelouses vertes. Dans ces habitations circulent sans bruit des domestiques noirs qui s’occupent de rendre aisée la vie des blancs.
Longtemps je n’ai pas compris que j’étais blanche. D’abord parce que j’ai quitté l’Afrique du Sud quand j’avais dix ans, me retrouvant avec ma mère et ma sœur dans le fog anglais de Londres. Et puis, jusque là, il y avait Mbali pour m’aider en tout. Je sentais bien que nous n’étions pas sur le même pied d’égalité, enfin, je sentais quelque chose comme ça parce que ma mère la tutoyait et n’attendait d’elle qu’obéissance et soumission, sans jamais se soucier de qui elle était, ni de comment elle vivait. Nous n’avions pas la même couleur de peau mais cela ne voulait rien dire pour moi. C’était ma Nanny et je crois qu’elle m’aimait. Il y a chez les femmes une capacité à ne pas haïr pour rien. J’étais une enfant, vulnérable, sans autre attention que la sienne, sans autre affection que la sienne. Je n’étais pas blanche ; elle n’était pas noire ; j’étais une petite fille ; elle était ma Nanny.
Sur la photo, je tiens ma poupée par le bras, nonchalamment, comme l’antithèse de ces bras qui me soutiennent, me portent et me protègent de la boue, de la saleté des rues. Je suis juste aggripée à ses épaules, légèrement aggripée, comme mûe par une indicible confiance. Je n’ai pas conscience du monde dans lequel je vis. Je ne sais pas encore que Mbaly a laissé ses enfants à sa mère, son mari à la mine d’or du Transvaal.
Ce qui me revient, c’est qu’elle sait me distraire en me racontant l’histoire d’Abiyoyo ou m’apaiser en me chantant « Thula baba », la berceuse qui m’annonçe le retour de mon père, celui d’une étoile qui le précèderait pour le guider vers moi.
Thula thul, thula baba, thula sana,
Thul'ubab uzobuya, ekuseni.
Thula thul, thula baba, thula sana,
Thul'ubab uzobuya, ekuseni.1
Mais moi, je ne le vois pas revenir parce qu’alors, il est sur le port et rentre bien tard à la maison, s’il rentre même parfois. Je sens ma mère malheureuse, ce malheur qui la fait rudoyer les domestiques, crier contre ses enfants quand elle les croise incidemment.
Mbali m’apprend aussi les comptines avec sa voix grave que ses propres enfants n’entendront jamais. Mais il y a surtout « Shona malanga » :
Shona !
Shona malanga !
Shona malanga shona !
He sizo dibana
Dibana, dibana2
Je découvre bien plus tard que c’est un chant de lutte contre l’apartheid. Mais pour moi alors, c’est seulement une mélodie, des sonorités, un rythme qui me donnent envie de taper dans les mains et de danser. Alors je tape dans mes mains, je danse et Mbali tape dans ses mains et danse avec moi, avec ce drôle de sourire parfois, ce regard humide qui m’interpellera plus tard, beaucoup plus tard, quand je comprendrai. Mais il sera trop tard. Je serai déjà loin d’elle, de ce pays et de ses bouleversements.
Sur ce cliché, j’ai l’air détendu, heureux. Je n’ai pas peur. Je suis une enfant sur le dos d’une femme. Je suis pieds nus. Peut-être sommes-nous parties à la hâte ? Elle, elle a un air sombre que je ne lui connais pas. Je dois être trop lourde et je la fais souffrir. Ou elle a peur d’être surprise ainsi, moi blanche sur son dos de noire, dans une société qui nous sépare et où la police a des yeux partout.
Que se passe-t-il ensuite ? Elle a dû me ramener à la maison. Qu’ai-je vu de son quartier, de sa maison, de sa vie ? Ai-je rencontré ses enfants, sa mère dans la case qu’ils partagent et que j’imagine comme celle que j’ai pu voir lors de mon voyage à Soweto, après, bien après les événements qui devaient changer à tout jamais l’Afrique du Sud ?
Mes souvenirs d’enfance n’en gardent aucun trace et j’en pleure de rage et de chagrin.
1Sois sage, sois sage petit homme, sois sage bébé, Sois sage, Papa sera de retour au matin. Sois sage, sois sage petit homme, sois sage bébé, Sois sage, Papa sera de retour demain matin.
2 Descends ! Que le soleil descende ! Que le soleil descende, descende ! Jusqu'à ce que nous nous retrouvions ! Nous nous retrouvions, nous nous retrouvions !
Petit matin
« Winter » Georges- Henry Boughton-1833-1905-
—D’où venez-vous ma chère ?
—Ah, vous êtes là. Il fait froid ce matin, ne trouvez-vous pas ? Il vaut mieux être très habillé ! Ainsi j’apprécie le manchon que vous m’avez fait confectionner avec ce vilain renard qui dépeuplait le poulailler !
—…
Il se tient à distance, une main appuyée sur ce fichu parapluie vert qu’elle déteste tant, pour l’avoir si souvent vu frapper les épaules des domestiques, l’autre main ancrée sur la hanche, coude ouvert. Il est là, face à elle, dans son pardessus élimé, homme vieillissant et qui demande des comptes.
Lui demander des comptes à elle ? Et en vertu de quoi ? Parce qu’elle est son épouse, sa bien plus jeune épouse ? Mais c’est ainsi, n’est-ce pas ! Il en a le droit ; il a tous les droits. Sa mère ne le lui a-telle pas seriné, juste avant leur mariage ?
« La femme appartient à son mari qui peut en faire ce que bon lui semble. C’est notre lot à toutes, ma chérie et ce ne sont pas les quelques contestataires qui manifestent à Washington qui y changeront quelque chose ! Soumets-toi, sinon tu seras malheureuse. »
Se soumettre ? Et pourquoi ? La femme serait donc « civilement morte »3.
Louise fuit pourtant le regard de son mari, tête basse, les yeux dissimulés par le large chapeau noir garni de quelques plumes, mains recroquevillées dans le manchon de renard roux. Que lui dire d’autre que cette remarque sur le temps qu’il fait ? D’ailleurs, il n’y a rien d’autre à dire que cela. Lui confier ce qu’elle vient de faire serait la condamner à la damnation, à la répudiation qui sait !
— D’où venez-vous, ma chère, par ce froid ?
—Je me promène, répond Louise de sa voix douce. J’aime le froid. Ne trouvez-vous pas que l’hiver est une belle saison ? Certes, le froid est mordant mais il donne du rouge aux joues.
—Ce rouge ne vient-il pas d’autre chose, ma très chère ?
Louise lève les yeux vers cet homme qu’elle n’a jamais aimé et n’aimera jamais. Qu’il est laid, posté devant elle en accusateur ! Planté, devrait-elle dire, les deux jambes écartées, la mine sèche et l’air chafouin. Comment a-t-elle pu partager sa couche ? Revivre cette étreinte d’une rare laideur la fait frissonner.
—Vous avez froid et vous sortez par ce temps glacial ! Regardez vos bottines : détrempées comme si vous aviez fait des kilomètres dans la neige. D’ailleurs les avez-vous faits, ces kilomètres ? Vers la cabane de chasseurs peut-être ? Pour y retrouver un homme, non ? Allons répondez ! Vous n’êtes pas en mesure de fuir, de mentir. Vous me devez la vérité car je suis votre époux et je suis responsable de vous. (Silence) Madame, j’attends ?
Louise soupire en levant les yeux. Elle croise un instant le regard noir de John Boughton.