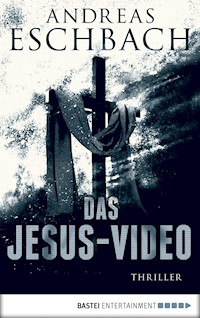Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Épris de liberté et d'indépendance, généreux de tempérament, les Galates avaient émigré du fin fond de la Gaule jusqu'en Asie mineure. Convertis à Christ par la prédication de Paul, ils étaient maintenant en grand danger de perdre leur liberté en se laissant asservir par des gourous judaïsants. L'épître aux Galates est destinée à leur ouvrir les yeux sur le salut complet et parfait que Jésus nous a acquis par sa croix. Après une courte notice biographique sur Auguste Sardinoux, notre numérisation ThéoTeX reproduit l'édition de 1837 de son Commentaire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322472109
Auteur Auguste Sardinoux. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Pierre Auguste Sardinoux est né le 22 janvier 1809 à Anduze (dans le Gard). Après des études de théologie à Montauban, Strasbourg, Heidelberg, il a occupé les fonctions d'aumônier protestant et de professeur d'allemand au collège de Tournona. Il est ensuite pasteur à Faugères (dans l'Hérault), avant d'être appelé en 1847 comme professeur d'exégèse à la Faculté de théologie protestante de Montauban. En 1856 il fonde à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, un des premiers instituts de prise en charge des enfants sourds ; ces derniers étaient encore jugés à cette époque comme obligatoirement muets. Mais grâce à la méthode oraliste du professeur Kilian, ils apprennent à parler dans cette école, qui aujourd'hui s'appelle le CROP (Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole). Auguste Sardinoux, prend sa retraite en 1875, nommé Doyen honoraire de la faculté de Montauban ; il décède le 2 février 1890.
En plus de ce commentaire sur l'Épître aux Galates, Auguste Sardinoux a profité de sa maîtrise de la langue allemande pour traduire plusieurs articles de théologiens contemporains, de Tholuck en particulier.
L'orthographe du présent livre a été quelque peu modernisée afin de faciliter la lecture, qui par ailleurs reste complètement fluide, malgré un français distant de presque deux siècles. A côté de l'érudition caractéristique des pasteurs de cette époque le lecteur sera peut-être surpris et amusé par quelques envolées lyriques, chantant le triomphe à venir du christianisme, dans une réforme morale et complète de la société. Il faut se rappeler qu'au 19e s. l'idée neuve de progrès absorbait les esprits et les poussait à s'interroger sur le sens de l'histoire et sur la destinée de l'humanité. Le Millénium semblait plus proche que l'Apocalypse, et on pouvait espérer entrer dans le premier sans passer par la seconde. Depuis, le ciel s'est assombri, les échos des grandes idéologies sociales se sont tus l'un après l'autre ; cependant la promesse de Dieu subsiste toujours, sûre et entière. C'est pourquoi l'assurance de l'auteur, en tournant nos regards vers le terme ultime de l'Histoire, en nous résumant rapidement le plan grandiose et divin pour les hommes, fait encore du bien aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Sardinoux ne s'occupe pas ici d'eschatologie, il suit de près le texte biblique ; sa doctrine est parfaitement évangélique ; sa monographie sur l'Épître au Galates reste donc un excellent commentaire.
En entrant inconnu et pour la première fois dans le domaine de la publicité par des études d'un genre trop longtemps délaissé parmi nous, il m'a paru convenable de dire l'esprit et le but de ce Commentaire en répondant en peu de mots à ces deux questions : Qu'est-ce que l'Écriture sainte ? et comment faut-il la lire ?
A part le témoignage permanent que Dieu nous donne de sa puissance, de sa bonté et de ses perfections infinies dans le spectacle sublime de la création, cet Éducateur paternel a déployé autour de ses enfants la vertu d'une parole plus saisissante, d'un langage plus direct, plus humain, d'une sollicitude et d'un amour plus profondément incisifs. Son adorable sagesse a jalonné la route de l'humanité et la pente des siècles, de législateurs, de rois, de prophètes, destinés comme des échos de sa grande voix, à annoncer et à préparer l'œuvre inouïe de la rédemption ; et lorsque par des enseignements et des institutions messianiques, par des promesses inspirées et par des révélations progressives, les temps ont été accomplis et la terre disposée à recevoir son Sauveur, alors le Verbe lui-même s'est manifesté. Il a paru ce Verbe qui avait sillonné de ses feux le pèlerinage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avait foudroyé de ses éclats l'Horeb et le Sinaï, qui avait étincelé sur le fleuve Kébar, à Tékoah, et préparé la Palestine aux splendeurs du Jourdain, à la transfiguration du Thabor et à la gloire à la fois sombre et éblouissante du mont des Oliviers et du Golgotha. Il a dressé sa tente au milieu de nous, Lui la vérité et la sainteté, la vie et la lumière, l'amour et la rédemption en personne ; et créant un nouveau monde nourri de son essence, fécondé de son amour, arrosé de sa vie, pénétré de son esprit, inondé de sa lumière et baptisé de son sang, il lui a ouvert depuis sa tombe glorifiée jusque dans le sein de son Père, la perspective des cieux, de l'éternité et du bonheur.
Ce travail éducateur de rédemption et de régénération se déployant dans l'humanité à travers les âges, opéré par le Verbe éternel qui le couronne de son incarnation et de son triomphe, se reflète splendide de sagesse et de grâce dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Expression écrite de la Parole divine, règle de la foi et de la vie chrétiennes, autorité suprême et unique dans les intérêts sacrés, ces Livres forment le cycle religieux le plus admirable qu'il soit donné à l'homme de contempler. Partant de la création du monde, de l'homme, et de leur union vivante avec Dieu pour dérouler après la chute une double histoire, humaine et divine, humiliante et glorieuse, celle de l'humanité, et si j'ose le dire, celle de Dieu, ils sont là comme le tableau fidèle de ce grand et magnifique drame qui, commençant à l'origine des choses et se concentrant dans la rédemption, se noue et se dénoue en Christ, pour se consommer par la rentrée progressive des êtres dans le sein du Créateur, drame dont les acteurs sont Dieu, Jésus-Christ et les hommes, et dont le théâtre est l'univers et l'éternité. A cette plénitude de révélations, à cette rondeur infinie de plan, à ce majestueux ensemble de pensées et à cette harmonieuse unité d'œuvre, l'homme est bien obligé de reconnaître le cachet d'une origine divine, origine qui brille encore dans la nature du contenu de la Bible, dans sa force vivifiante et dans le rôle historique régénérateur que Dieu lui a assigné. Voyez en effet si ce Livre des livres n'est pas à la fois dans les annales de notre histoire, le levier qui ébranle, l'axe qui centralise les mouvements sociaux, le foyer qui les vivifie, la vertu divine qui leur imprime leurs nouveautés palingénésiques, la Colonne lumineuse qui nous guide dans les déserts de l'impuissance humaine et dans les magnificences de Dieu ! Voyez si surtout depuis dix-huit siècles il ne verse pas des flots croissants d'animation dans la vie religieuse et morale, intellectuelle et littéraire, politique et civile, spirituelle et physique, individuelle et sociale ! si Livre de tous, Livre pour tous et sur tous les grands et immortels intérêts de notre race, il ne fait pas graviter de près ou de loin autour de lui, les affections, les volontés, les imaginations et les espérances de l'homme, et n'incline pas vers Dieu le torrent des pensées de la terre et de la vie de ce monde ! Oui, la Bible dans un avenir toujours plus près de nous, régnera assise au foyer domestique comme au conseil des rois et des peuples, génie de chacun et de tous, parce qu'elle est la lumière des intelligences, la sainte inspiration des cœurs, la vertu des volontés, la règle des vraies croyances, la source des mœurs pures et la charte divine de tous les devoirs et de tous les droits. Telle est notre foi ; nous souscrivons de grand cœur à ces paroles de Luther : « L'âme n'a rien où elle trouve la vie, la piété, la liberté, les sentiments du vrai christianisme si ce n'est dans le saint Évangile ou la Parole de Dieu annoncée par Jésus-Christ lui-même » ; « C'est par la Parole de Dieu qu'il faut réprimer tous les abus, c'est par elle qu'il faut conduire et diriger les consciences avec indulgence et avec douceur comme Jacob conduisait et ménageait ses troupeaux ». Nous nous écrions avec Calvin : « Lisez Démosthène ou Cicéron, Platon ou Aristote et tels autres livres de ce haut rang ; je confesse que ces grands hommes vous attireront d'une façon merveilleuse à la lecture de leurs ouvrages, vous réjouiront, vous émouvront, vous raviront même, si vous voulez, en admiration ; mais si de là vous passez à la lecture des saintes Écritures, vous sentirez qu'elles vous piqueront jusqu'au vif, qu'elles vous pénétreront tellement le cœur et entreront si avant dans les replis de votre âme et de votre esprit, dans vos jointures et dans vos moelles, que toutes les forces qu'ont les philosophes ou les orateurs à persuader, ne sera que fumée en comparaison de l'efficace de ce sentiment. D'où il est aisé de conclure que les saintes Écritures ont je ne sais quoi de divin qui surpasse de beaucoup toutes les qualités et toute l'industrie des hommes. »
Mais comment doit-on lire cette Parole ? Avec foi. S'il est nécessaire d'être vivifié par le sentiment du patriotisme pour avoir une pleine intelligence de Salluste et de Tacite, et par le feu de la poésie pour goûter Homère et Pindare, ou par l'amour de la philosophie pour s'élever avec Platon sur les hauteurs de ses pensées, pour bien comprendre la Bible, ce monde spirituel écrit, pour brûler de ses divines flammes, pour vivre de sa vie et planer avec elle sur ses célestes hauteurs, il faut la foi, cet organe Spirituel analogue au principe divin qui anime l'Écriture, et dont le jeu est aussi nécessaire à la vie morale que la respiration l'est à la vie physique. Il faut, c'est-à-dire, l'humilité du cœur basée sur le sentiment de notre misère et sur le besoin de notre rédemption ; la réceptivité d'âme du centenier de Capernaüm et de la femme Cananéenne ; une aspiration ardente vers les choses invisibles qu'on espère ; l'altération d'un cœur desséché qui se tourne vers le torrent de l'esprit ; l'amour qui s'épanouit pour recevoir, embrasser et vivre ; il faut une communion de cœur avec Jésus-Christ, un goût des réalités célestes et un commencement de vie et de mouvement spirituel dans les choses divines. Qu'on ouvre la Bible avec ce regard candide et filial, et bientôt l'âme, à travers la couleur locale, le costume israélite et la voix palestinienne du Livre des livres, sentira le rayonnement pénétrant de l'élément divin qu'il renferme et les frémissements de l'Esprit de vie qui se meut sous son enveloppe. Bientôt tout dans la Bible lui parlera de Dieu, de sa nature, de ses perfections, de ses desseins, de ses gratuités, de ses richesses et de sa miséricorde ; de l'homme et de son esprit, de ses devoirs, de sa destination, de ses misères ; de Jésus-Christ son Sauveur, de son amour, de son esprit et de son œuvre de sanctifiante rédemption. Elle saisira sous le voile juif, les traits fondamentaux de sa physionomie réelle et idéale, elle lira dans les replis de son cœur, elle retrouvera son histoire secrète et publique, intime et patente, et se voyant ainsi face à face, dans sa nudité dévoilée, avec le Saint des saints, elle s'écriera : « Voilà l'homme et voilà Dieu ! » C'est ainsi que toute âme humaine peut expérimenter que « l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice, afin que nous soyons accomplis pour toutes sortes de bonnes œuvres », « et que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient ». Aussi nous disons volontiers avec Clément d'Alexandrie, avec Origène, avec Augustin, « Si vous ne croyez pas, vous ne connaîtrez pas », et avec Anselme et Schleiermacher : « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois afin de comprendre, car celui qui ne croit pas, n'expérimentera pas, et celui qui n'a pas expérimenté ne peut pas comprendre » ; mais nous ajoutons avec l'auteur déjà cité des Stromates « S'il est possible de croire sans science, ce n'est pas seulement dans la pauvreté mais aussi dans la richesse scientifique que l'on peut bien et sainement vivre ».
Pour compléter notre pensée nous disons donc, lisez la Bible avec science. Puisque la vertu de l'Évangile doit animer toutes nos facultés, l'intelligence aussi bien que le cœur et la volonté doit avoir sa part de foi, de lumière et de vie, et cette part, dans ses moyens comme dans ses résultat », s'appelle science. Si le cœur est indispensable comme base première et source de la vie dont il est le sanctuaire, des idées claires, précises, qui fixent la raison, qui régularisent les sentiments, qui donnent du nerf à l'enthousiasme, qui purifient les élans de l'âme et qui assoient ses forces spontanées sur l'unité, l'ordre et l'harmonie, ne sont pas moins nécessaires pour éviter les écarts dangereux d'un sens charnel, d'une exaltation déréglée, d'un mysticisme délirant, d'un illuminisme superbe ou d'une ténébreuse superstition.
D'ailleurs la Parole de Dieu s'est faite humaine, historique ; elle a été écrite dans un temps, chez un peuple, avec des langues et au milieu de circonstances donnés et qui ne sont plus ; pour la saisir pleinement dans son fond et dans sa forme, il faut dès lors entreprendre des travaux auxquels sans doute tous les hommes ne sont pas appelés, mais dont ils doivent connaître les résultats, si conformément au précepte d'un apôtre ils veulent ajouter à la foi la science qui la rend pure, ferme, complète, et pouvoir rendre compte de leurs convictions. C'est donc un devoir sacré pour les conducteurs de l'Église d'être versés dans la connaissance des langues primitives de la Bible ; d'approfondir par des études grammaticales et philologiques-historiques la valeur des mots, l'artifice de leur construction, le génie d'une langue à telle époque de son existence ; d'étudier l'origine et l'histoire des destinées du Canon biblique en général et de chacune de ses parties en particulier, les questions si importantes qui se rattachent à un écrit et qui jettent tant de jour sur son contenu, comme celles de son authenticité, de son auteur, de son caractère, de son but, de son plan, de sa forme, de son style, du temps et du lieu où il a été composé et des circonstances qui l'ont fait naître ; de travailler à la pureté, à l'intégrité du texte ; de déterminer les lois d'une saine interprétation ; de connaître à fond le théâtre des événements de l'Ancien et du Nouveau Testament, la géographie, l'histoire et la chronologie bibliques, le peuple juif, sa constitution civile et ecclésiastique, sa vie publique et privée, ses habitudes, ses préjugés, en un mot son état religieux, moral et social. On ne saurait se passer de ces ressources philologiques, critiques, herméneutiques et archéologiques dont l'ensemble constitue la théologie exégétique, lorsqu'on se propose de posséder clairement et d'expliquer un livre antique, surtout si ce livre, comme la Bible, est plein d'idées encadrées dans des choses individuelles, concrètes, qui supposent des situations, des besoins et une éducation particuliers à un peuple et quelquefois à une génération, et si, composé par des personnes diverses de temps, de lieu, de caractère, de culture et de position, il présente des formes variées de rédaction selon que l'histoire ou la prophétie, le dogme ou la morale prédominent.
La nécessité de cette science exégétique ressort encore d'autres considérations non moins puissantes. C'est à elle que se rattachent, bien plus c'est d'elle, que dépendent les études historiques, dogmatiques et pratiques, parce que l'histoire, les symboles et l'organisation de l'Église ont pour point de départ et pour règle la Bible. Comment comprendrez vous, l'origine, la formation et l'établissement du christianisme ; la vie, les mœurs, les croyances, le culte, la magnifique littérature, les apologies, la constitution, les luttes et les grand déchirements de l'Église sans une connaissance profonde du Livre divin qui a été et qui est le centre de toutes ces grandes choses, le tronc de toutes ces branches, l'arbre de tous ces mouvements, le secret de tant de puissance et la source d'une si prodigieuse fécondité ? Comment parler de christianisme biblique, comment exposer dans leur génération divine, en un système bien coordonné, les vérités chrétiennes sur Dieu, le monde et l'homme, sur Christ et son œuvre, sur l'Église et les destinées finales de l'humanité, si l'on n'a pas été élevé à l'indispensable école de l'Écriture sainte bien lue, bien comprise, bien expliquée ? Il y a plus ; dans la primitive Église et de tout temps dans la nôtre, la science et surtout la science exégétique fut la colonne mère de l'édifice théologique et chrétien. C'est elle qui donne à toutes les. parties de l'encyclopédie théologique leur couleur, leur forme, leur esprit et leur part de vérité ou d'erreur ; c'est elle qui nous explique pourquoi l'école idéaliste d'Alexandrie différait tant de l'école réaliste de l'Asie mineure sur la trinité, l'anthropologie, la christologie, l'Église, la sainte Cène et : la doctrine des destinées finales ; c'est par elle que les premiers docteurs combattirent le matérialisme charnel des Juifs et la théosophie phantastique des gnostiques pour établir le réalisme chrétien ; c'est elle qui a enfanté les luttes modernes de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie, du supranaturalisme et du rationalisme, de l'école historique critique et de l'école philosophique contemplative. Or, je le demande, indiquer la souveraineté d'action que les principes et les études exégétiques ont exercée sur la foi, les doctrines et la vie de l'Église, signaler la dépendance profonde des convictions et des sentiments envers le savoir, n'est-ce pas établir l'importance immense, la nécessité d'une science biblique positive et vraie ?
Il est bon enfin d'ajouter qu'en parlant ainsi nous ne faisons que rester fidèle à l'esprit de l'Église universelle et de la nôtre en particulier. En effet, par quoi se distinguent les siècles les plus rapprochés des origines chrétiennes ? Par des travaux scientifiques très nombreux ; par des écoles exégétiques à Alexandrie et à Antioche principalement d'où sortirent les grands docteurs, les orateurs célèbres, les dogmatistes vigoureux, les interprètes profonds, les Pères puissants d'action, et cette vaste et si riche littérature chrétienne qui ne connaît pas de rivale. Qu'est-ce qui produisit les nombreuses versions, les paraphrases, les commentaires, les catéchèses, les traités des Clément d'Alexandrie, des Origène, des Denys d'Alexandrie, des Hierakas, des Grégoire Thaumaturge, des Théognoste, des Pierius, des Méthodius, des Julien l'Africain, des Athanase, des Cyrille, des Grégoire, des Eusèbe de Césarée, d'Emise et de Pamphylie, des Grégoire le théologien et de Nysse, des Basile, des Théophyle, des Diodore de Tarse, des Théodore de Mopsueste, des Chrysostome, des Théodoret, des Isidore de Péluse dans l'Église d'Orient, et des Tertullien, des Cyprien, des Lactance, des Jérôme, des Alavius Victorinus, des deux Hilaire, des Ambroise, des Pelage, des Julien d'Eclane, des Augustin, des Posper d'Aquitaine, des Cassiodore et des Grégoire-le-Grand dans l'Église d'Occident ? — Le besoin fondamental et profondément ecclésiastique de la science. Expliquer les livres saints et découvrir leur véritable sens en s'entourant de tous les moyens convenables à ce but, telle fut en effet la tâche et la passion des plus sages, et des plus éloquents docteurs, tel fut le secret de leur force dogmatique, de leur gloire littéraire et de leur puissance apologétique ; tant il est vrai que la science est une satisfaction que réclament également et l'Évangile et l'Église, et la foi et la vie, et les luttes du monde et les triomphes de la croix !
N'oublions pas aussi que c'est par de fortes études, que les hommes de la réformation ont balayé du sanctuaire les erreurs et les abus qui le souillaient. A peine l'Italie réveillée par Pétrarque, Boccace et les réfugiés de Bysance a-t-elle ébranlé de son savoir la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre ; à peine les arts et les sciences, la géographie et l'histoire anciennes et modernes, la jurisprudence romaine, la littérature grecque, la philosophie et la philologie ont-ils reparu à l'époque de l'invention du papier ordinaire et de l'imprimerie, que toutes ces ressources sont appliquées aux intérêts moraux et religieux en Allemagne, en France, en Suisse ! Nicolas de Lyre, Laurent Valla, Ficino, Aggricola, Huss, Érasme, Reuchlin, Ulrich de Hutten abordent le Noureau Testament avec les nouvelles richesses philologiques. Zwingle avait étudié la philosophie, la physique, l'astronomie, la théologie ; il lisait dans les textes originaux, Platon, Aristote, Thucylide, Plutarque, Cicéron, le Nouveau Testament, et avait beaucoup conversé avec la Bible et les Pères. Luther connaissait Cicéron, Virgile, la jurisprudence, la dialectique, la philosophie, la physique, saint Augustin, Gerson, saint Bernard, Tauler, et il à dit quelque part : « Nul ne peut comprendre les Bucolique ou les Géorgiques de Virgile s'il n'a été berger ou agriculteur pendant cinq ans, ni les Lettres de Cicéron s'il n'a vécu vingt ans dans quelque république célèbre ; qu'on sache donc que nul ne peut savourer les saintes Écritures s'il n'a gouverné des églises cent ans durant, avec les prophètes comme Élie et Élizée, avec Jean-Baptiste, Christ et les apôtres ». Calvin avait aussi pâli à l'étude de la théologie, de la jurisprudence, de la philosophie, du syriaque, de l'hébreu et du grec. Savez-vous où était la réforme avec son cachet distinctif ? au château de Wartbourg où Luther, consacrait ses veilles à la traduction de la Bible, et dans ce couvent du Docteur où s'assemblait en conférence toutes les semaines, pendant quelques heures avant le souper, ce qu'il y avait à Wittemberg de personnages doctes et pieux ; où l'on voyait Luther avec sa vieille Bible allemande, sa nouvelle version et le texte hébreu, son cher Philippe avec le texte grec, le docteur Creuziger avec la Bible hébraïque et la version chaldaïque, Bugenhagen avec un manuscrit latin, les professeurs avec les commentaires des rabbins, et où chacun exposait son avis après s'être préparé d'avance sur le texte, et après avoir consulté, outre les rabbins, les interprétations des anciens docteurs tant grecs que latins sur les idiotismes de la langue. Oui, c'est là qu'elle brillait et que vous la voyez à l'œuvre, telle qu'elle éclate encore dans ces paroles qu'écrivait Luther pour combattre Carlstadt et Münzer : « l'intérêt de Jésus-Christ et celui du monde entier exigent que la jeunesse soit bien instruite et bien élevée, et que les théologiens soient versés dans l'hébreu et le grec » ; ou bien dans cette lettre où il disait à Léon X : « il ne faut pas qu'on me prescrive comment je dois entendre la parole de Dieu ». — Et les travaux exégétiques immenses de nos réformateurs, de leur époque et des siècles suivants sont là aussi pour démontrer le principe par ses conséquences ! De Luther et de Calvin à Chemnitz, de Chemnitz à Franke, de Franke à Ernesti et à Semler, et de ceux-ci à nos jours, l'activité scientifique appliquée à la Bible a été toujours croissante. Faut-il rappeler |es noms de Mélanchton, d'Œcolampade, de Bugenhagen, de Brenz, de Bucer, de Flacius, de Gerhard, de Franz, de Glassius, de Danhauer, de Chemnitz, de Calixte, de Schmidt, de Franke, de Rambach, de Lange, de Baumgarten, de Lœscher, de Wolf, de Bengel, de Mosheim, de Schœttgen, de Elsner, de Kypke, d'Ernesti, de Semler, de Storr, de Morus, de Bauer, de Beck, de Keil, de Koppe, de Rosenmüller, de Kuinœl, de Paulus, de Lücke, de Winer, de Schott, d'Umbreit, de Tholuck, d'Olshausen, etc. ? Faut-il citer pour notre Église les travaux de Calvin, de Bèze, de Daniel Chamier professeur à Montauban, de Pellican, d'Amama, de Rivet, de Rusius, de Louis de Dieu, de Gomare, de Louis et de Jacques Capelle, de Cocceïus, de Grotius, de Jean le Clerc, de Turretin, de Wetstein, etc. ?
Ainsi appuyés sur la nature de la foi chrétienne, sur le caractère de la Bible, sur l'immense influence de l'exégèse et sur sa valeur ecclésiastique, ainsi que sur l'esprit et les antécédents de notre Église pour légitimer les prétentions de la science, notre plus grand désir serait de nous voir, sur les pas de nos voisins d'outre-Rhin et avec l'esprit croyant, savant et libre des Schleiermacher et des Néander, des Lücke et des Winer, des Ullmann, des Umbreit, des Tholuck et des Olshausen, renouer dans notre Église nationale, la chaîne de la piété et du savoir, de la foi éclairée et de la vie chrétienne, forte et indépendante. Car nous sommes profondément convaincus que les études bibliques concourent puissamment à la création des époques vivantes ; que c'est par elles qu'on se baptise d'eau et d'esprit, de lumière, de force et de vie, en se plongeant de cœur et d'intelligence, avec foi et savoir, dans la Parole de Dieu ; que ce sont elles qui, simplifiées et semées dans les masses, les rassasient de manne céleste, trempent leur foi de sève divine, leur volonté d'énergie sainte, et remplissent le cœur et la bouche de choses magnifiques et substantielles, de zèle, d'éloquence et d'amour ; que ce sont elles enfin qui feront la puissance et la gloire de nos temps comme à l'époque des premiers siècles chrétiens, et de la réformation. Déjà sur notre Église luisent des jours moins sombres ; une main providentielle commence à verser du baume sur les maux qu'enfantaient son éparpillement, sa position de minorité, son isolement agrandi par l'absence d'une constitution forte et de croyances vives, ses luttes, ses divisions, son enseignement incomplet, ses froissements de partis et ses entorses quelquefois profondes à l'esprit d'amour. Des efforts toujours plus prononcés d'association, une tendance à l'unité, un vif besoin de foi, de lumière, de progrès, un travail sourd de crise et de rénovation, sont autant de signes avant-coureurs qui versent quelque paix dans l'âme, quelque courage et des espérances dans le cœur. Mettez en effet la main sur le pasteur et le fidèle, sur l'école et le temple, sur la science et la piété, sur la constitution et l'enseignement, et partout vous sentirez les tressaillements et la sueur d'une conception et d'un enfantement, les agitations intimes d'une Église qui se réforme, les courants internes d'un nouvel esprit de vie qui se meut, ranime et déjà transfigure. Oh ! efforçons-nous doue de compléter cette œuvre en rendant à notre Église nationale française, si sainte par ses épreuves et ses longues infortunes, sa science et sa liberté ; et alors nous la verrons nourrir abondamment le cœur de l'enfance, la foi dés fidèles, le culte domestique, la vie de famille, la piété des consistoires, le zèle et le savoir des pasteurs, et rallumer sans cesse par la foi en Christ l'amour de Dieu dans les âmes, et par l'amour de Dieu, celui de tous pour chacun et de chacun pour tous. Retournons, à notre Bible, et nous surtout jeunes pasteurs et théologiens, avec l'ardeur d'un Origène qui, enfant, pouvait la réciter tout entière, et qui en fit le puissant levier de sa foi, de son génie, de sa science ; avec ce zèle brûlant d'un Jérôme dont l'âme y trouvait des torrents d'harmonie pour animer le silence de sa grotte, les sauvages solitudes de son cœur et les longues nuits de son désert ; avec cet amour du grand évêque d'Hippone qui la méditait et l'expliquait tous les jours de sa vie, depuis qu'il avait entendu dans un jardin et sous un figuier où il se roulait et se purifiait dans ses chaudes larmes, une voix qui lui criait : prends et lis. Retournons à notre Bible avec l'enthousiasme savant de Luther qui en avait fait son ange consolateur dans sa Patmos, la force de son bras et le bélier de sa sainte guerre ; avec ce feu dévorant qui faisait pâlir le jeune élève Chauvin à son cinquième étage du collège de Montaigu, lorsque aiguisant, armant son génie et embrasant son âme dans les profondeurs de l'Écriture, il y puisait l'institution chrétienne et la puissance sociale de sa sévère réformation. Et alors cette Parole divine qui de nos jours peuple des déserts, bâtit des villes, fixe des langues, civilise des sauvages, sauve des âmes et rapproche des mondes, deviendra dan l'ère sociale où le christianisme entre à grands pas, le foyer de tous les progrès réels, le génie et la garantie de toutes les libertés fécondes, de tous les légitimes intérêts, l'ancre ferme de l'ordre individuel, domestique, national, européen universel.
Tel est le point de vue sous lequel ce Commentaire a été entrepris. Quant à ses matériaux, il est facile de voir tout ce qu'il doit à l'Allemagne, et surtout aux ouvrages récents de Schott-Winzer, de Winer et de Néander ; suum cuiqueb. Encore une observation. L'exégèse nous semble devoir entrer dans la voie neuve d'une application sociale des vérités de l'Évangile ou d'une mise en relief de la puissance régénératrice, individuelle et sociale, des principes chrétiens. Ceci demanderait de longues explications, elles pourront trouver leur place plus tard, si l'accueil du public protestant nous encourage à continuer ces essais.
A une époque difficile à préciser les Galls furent ébranlés dans leur vie de clan par la double invasion druidique et guerrière des Kymry et des Bolg. Cet accroissement de population et l'esprit remuant de la race gaélique déterminèrent un puissant et vaste mouvement. Deux frères jumeaux, sous les inspirations de leur oncle Ambigat, chef de la Gaule centrale, sortirent du pays celtique, chacun à la tête d'une émigration nombreuse, vers l'an 594, avant J. C. Sigoyèse courut vers l'Italie, et Bellovèse poussant les Arécomiques et les Tectosages du Languedoc, vers le nord d'où ils étaient descendus, passa le Rhin vers Bâle, entraîna sans doute des hordes germaines, pénétra dans l'Hercynie, et se répandit dans la Luzace, la Silésie et la Bohême. C'est alors que s'établit une émigration périodique qui dura trois siècles, et que des hordes de Galls, de Kymry, de Bolg, de Germains, se ruèrent vers l'orient, leur primitive patrie, avec une constance séculaire que l'on serait tenté de regarder comme un élan prophétique, vers la lumière qui devait jaillir de ces régions, comme un prélude sanglant du fécond embrassement des mondes oriental et occidental par le sang du Golgotha.
Cette émission, si longtemps soutenue de flots humains, se heurtant, se poussant, se fortifiant, cette marée montante de barbares, alla frapper à travers les vallées du Danube, les portes de la Macédoine, lorsque le héros de cette province interrogeait lui-même à Babylone ce mystérieux Orient. Alexandre se fit des alliés de ces tribus. Mais à sa mort, ressaisies par leur instinct aventurier, elles se hâtent d'exploiter les embarras de ses successeurs et se jettent dans la Grèce et l'Asie, au milieu des discordes. Renforcées par l'arrivée de 300 000 émigrants, elles gravissent, sous les ordres d'un Brenn, le mont Hémus, le Rhodope, le mont Alban, se roulent comme des avalanches dans la Macédoine, l'Epire, la Thrace, rompent les phalanges de Ptolémée-la-Foudre, l'an 280 ; franchissent les Thermopyles, descendent dans la Phocide, et viennent se briser contre le temple de Delphes, où la Grèce entière les repousse, les saccage, les broie, et force les vaincus qui échappent à son glaive, de refluer en partie vers le Danube et le midi des Gaules.
Tandis que quelques divisions galliques épargnées par ce désastre s'étaient fixées dans la Thrace, trois hordes, les Tolistoboïe, les Trocmes et les Tectosages passant le Bosphore s'enfoncent dans l'Asie mineure, et troupes mercenaires, parviennent à s'établir et à se maintenir dans la contrée. Le roi de Bithynie, Nicomède Ier, voulant chasser son frère Zypoétas, achète leur secours, l'an 279, et leur donne des terres, noyau naissant de la contrée qui, de leur nom, fut appelée Galatie. Cette province était bornée au nord par la Paphlagonie et la Bithynie ; à l'est par le Pont et la Cappadoce ; au sud par la Cappadoce et la Phrygie ; à l'ouest par la Phrygie et la Bithyniec. Montueuse mais très fertile surtout le long du fleuve Halysd, elle avait pour villes principales Ancyre (Angora), métropole de la Galatie sous Auguste, Tavium, et Pessinonte fameuse par le culte de Cibèle. L'an 240, ces Gaulois furent défaits par Attale Ier, roi de Pergame ; plus tard, ayant fait une injure à Eumène II, roi de Pergame, et Rome voulant les abattre, avant de sortir de l'Asie, parce qu'ils auraient pu renouveler la guerre, le consul Manlius les attaqua, les vainquit et les confia à la garde d'Eumène, 189 ans av. J. C.e. Le dernier de leurs tétrarques, Amyntas, favori d'Antoine et de l'empereur Auguste, eut, outre la Galatie et la Pisidie, les districts de Lycaonie et de Pamphylie sous sa dominationf. L'an 26 av. J. C, de Rome 729, tout tomba sous la puissance immédiate des Romains, et la Galatie et la Lycaonie eurent un procurateur romaing. Lystre et Derbe avaient appartenu à l'empire du roi Amyntas, et Pline, le premier, les donne à la Galatie. Cependant Luc les sépare de la Gallogrèce (Actes 16.1-6), et les fait dépendre de la Lycaonie (14.6) qu'il distingue de la Galatie avec tous les écrivains de ce temps, au nombre desquels se trouve Pline lui-même (5, 25). Luc cite aussi la Pamphylie comme province particulière (Actes 14.24 ; 15.38).
La langue des Galates était celle des environs de Trèves, dit Jérôme, et Hug a longuement démontré cette descendance germaine, surtout pour les Tectosages qui étaient Bolg, Bolgos, selon Ausone ; Belgæ, selon Cicéron ; Volgæ, selon César. Ils apprirent néanmoins le grec, et c'est même cette langue qu'ils employaient pour les monuments et les inscriptions publiques ; ce qu'attestent des gestes que nous possédons. C'est de là, et de leur fusion par mariage avec les Grecs, qu'ils furent appelés Gallogrecs.
Les Gaulois, dit César, liv. 3, sont amoureux de nouveautés, légers lorsqu'ils courent aux armes, attachés à la liberté, extrêmement ennemis de l'esclavage. D'autres écrivains nous les représentent courageux, vaillants, amateurs de la liberté, tumultueux, presque toujours sous les armes pour leurs intérêts ou pour ceux des autresh. La fougue, selon M. Michelet, la promptitude, la mobilité de résolution, le génie guerrier, l'impuissance sociale caractérisent les Bolg. Race bruyante, sensuelle, légère, prompte à apprendre, prompte à dédaigner, avide de choses nouvelles, féconde, inclinée à la matière, au plaisir, coureuse, sympathique, amie du faste, de l'opulence, pleine de générosité, sa vie première était celle du clan, où le sang et la chair servent de base ; son génie était celui de l'individualité, de l'égalité, génie niveleur et matérialiste. Les Kymry avaient plus de sérieux et de suite dans les idées ; ils étaient disciplinables et gouvernés par une corporation sacerdotale, celle des druides.
Leur religion avait une tendance morale, et enseignait l'immortalité de l'âme. Toutefois leur esprit était encore matérialiste.
Il est naturel de penser que cette race gallique, de nature si impressionnable, si sympathique, si expansive, dut être modifiée dans ses mœurs et ses idées comme elle le fut dans sa langue. Elle ne pouvait pas être en contact social et quotidien avec des éléments plus civilisés qu'elle, sans subir l'action transformante de ce commerce si multiple et si incessant. Il paraît qu'elle avait appris à connaître, des Phrygiens, la grande mère des dieux ; en opposition avec les habitudes des peuples gallois et germaniques, elle avait bâti des temples, et le climat avait sans contredit adouci sa rudesse, car Cicéron nous dit de Déjotare, l'un de ses tétrarques, qu'il était diligentissimus agricola et pécuariusi.
Outre les indigènes et les Galates, il y avait beaucoup de Juifs attirés par la fécondité du pays, par sa situation favorable au commerce dont Tavium et Pessinonte étaient deux centres très actifs, par l'opulente hospitalité des Gaulois dont l'un des tétrarques, par exemple, publia que pendant une année entière il tiendrait table ouverte à tout venant. Ils étaient d'autant plus nombreux du temps du Christ, qu'on y avait conduit plusieurs colonies, et qu'Auguste, défendant aux Grecs et aux Romains toute molestation envers eux, avait promis une tutelle particulière à ceux qui se domicilieraient dans ces quartiers. D'après le rapport de Josephe, ils y possédaient des libertés considérables dont le document primitif fut placé à Ancyre, dans le temple d'Augustej.
Nous apprenons par 1 Corinthiens 16.1 ; 2 Timothée 4.10 ; 1 Pierre 1.1, et par notre épître qu'il y avait dans la Galatie, des chrétiens, dont Paul était le père (Galates 4.13,19 ; Actes 16.6).
Il y a deux opinions sur ce point. Fischer, Borger, Keil, Koppe, Mynster, Niemeyer, Van Heyst admettent trois voyages de Paul en Galatie ; le premier (Actes 14.6), pendant lequel il aurait converti les Galates ; le second (16.6) ; le troisième (18.23). Hug, Eichhorn, Bertholdt, Flatt, Schott, de Wette, Winer, Rückert, Néander ne croient qu'aux deux derniers, et fixent l'époque de la fondation dans le premier, qui est selon eux celui d'Actes 16.6. Voici les arguments et les réponses.
A.Galates 2.13. Paul cite Barnabas d'une manière qui fait supposer que les Galates le connaissaient ; or Barnabas s'était séparé de Paul (Actes 15.39), et n'était plus avec lui lors du voyage mentionné (Actes 16.6) ; donc Paul et Barnabas avaient déjà vu auparavant et ensemble les Galates ; d'où il suit que le voyage (Actes 16.6) n'est pas le premier. — R. Il n'était pas nécessaire que Barnabas fût personnellement connu en Galatie pour que Paul pût le citer. Cet évangéliste était déjà célèbre dans toute l'Asie, puisque les Grecs l'appellent le quatorzième apôtre. D'ailleurs, pourquoi les Galates n'auraient-ils pas pu avoir entendu parler de lui, ou le connaître déjà par les discours mêmes de Paul ? N'est-il pas parlé dans cette même épître (Galates 1.18 ; 2.9) de Jean, de Jacques, de Pierre ? Et qui prouvera qu'ils étaient alors connus de visage des églises galates ! Cependant ils sont tout, aussi bien supposés connus que Barnabas !
B. Les passages (Actes 15.36 ; 16.5) nous enseignent que le but de ce second voyage apostolique fut de visiter les frères et de les affermir dans la foi. — R. Cette assertion est inexacte, car nous voyons clairement que Paul aurait prêché en Asie et en Bithynie (16.6-7), s'il n'en eût été empêché. De fait, dans ce voyage n'annonça-t-il pas l'Évangile en Macédoine pour la première fois (Actes 16.10) ? Luc, du reste, distingue entre les Galates d'un côté, et de l'autre les églises que l'apôtre voulait raffermir ; il renferme entre 15.10-16.5, les frères à vivifier, et arrêtant là l'accomplissement de ce but particulier, il commence au v. 6 à parler de la Phrygie et de la Galatie, pour la première fois, et poursuit l'histoire, non du raffermissement et des visites, mais de l'évangélisation et des nouveaux succès.
C. Ces deux preuves, dit-on, sont en harmonie avec Actes 14.6, où se trouve cité le premier voyage de Paul en Galatie, car les villes Lystre et Derbe appartenaient à cette province. Dion Cassius nous dit qu'Amyntas, tétrarque de Galatie et roi de Pisidie, reçut du triumvir Antoine quelques marches limitrophes de la Lycaonie, de la Pamphylie et de l'Isaurie, et qu'après la mort d'Amyntas, la Galatie et la Lycaonie furent réduites en provinces romainesk. Pline déclare en outre que la Lystrie était habitée par les Galatesl ; Paul avait donc visité ce peuple dans son premier voyage apostolique. — R. Luc, au contraire, sépare avec beaucoup de soin de la Galatie (Actes 16.1,6 ; 18.23) Lystre et Derbe, qu'il donne à la Lycaonie (14.6). Il cite la Phrygie, la Galatie, et deux fois la Pamphylie comme provinces distinctes (Actes 14.24 ; 15.38, etc.). Les géographes peuvent bien embrasser d'un seul nom les terres sur lesquelles règne un prince, mais le peuple continue de les appeler de leurs noms propres, antiques et habituels ; or, d'après le récit de Luc, nous voyons qu'on en agissait alors ainsi ; voilà pourquoi, d'après les Actes, on ne pourra jamais prouver que Paul, dans ce premier voyage, ait visité la Galatie proprement dite. La question est toute ici : du temps de l'apôtre, était-il consacré par le langage, que par Galates simplement on entendît Néogalates ? Or, cette supposition, loin d'être démontrée, a contre elle le témoignage positif de Luc, et ce que nous ayons dit § 1. ; l'argument est donc nul.
D. On ajoute que les mots quartiers d'alentour (Actes 14.6) peuvent indiquer la Galatie. — R. Eichhorn a nié avec raison que ce mot grec puisse s'entendre d'une province entière, d'une vaste région. Prenons en outre une carte géographique ; l'apôtre, chassé d'Iconium dans les villes de Lystre et de Derbe, se dirigeait vers le midi, et comme la Galatie est située au nord, séparée de la Lycaonie par la Phrygie, ces deux mots ne peuvent absolument pas se rapporter à elle.
E. La Galatie prise dans ce sens large, on arrive à une autre preuve. Paul (Galates 4.14-15) parle de la joie avec laquelle il fut reçu lorsqu'il était tenté dans sa chair, affligé de maux extérieurs. On peut rattacher cette joie à ce que nous lisons des habitants d'Antioche, ville de Pisidie, qui avaient embrassé le christianisme avec bonheur (Actes 13.14,48), et à Actes 14.19 où nous voyons l'horrible traitement que les Juifs de Lystre firent subir à l'apôtre. — R. Qu'on voie dans cette infirmité de la chair une maladie ou des vexations juives, il n'en résulte pas qu'on ne puisse entendre les paroles de Galates 4.14-15, que du voyage cité Actes 13.14 ; car rien n'empêche d'admettre que dans le voyage Actes 16.6, Paul ait souffert des maux pareils quoique Luc les passe sous silence, puisque nous savons que quelquefois par brièveté l'historien sacré n'a pas exposé toutes les paroles et tous le faits de son héros. L'explication de ces mots dans le commentaire renfermera une nouvelle réponse ; et enfin nous dirons que cette raison, ne s'appuyant uniquement que sur les troisième et quatrième arguments, tombe avec la réfutation déjà donnée de ceux-ci.
Ainsi les preuves en faveur de trois voyages de Paul en Galatie (Actes 14.6 ; 16.6 ; 18.23), sont sans fondement. En nous en référant au récit simple et naturel de Luc, il n'y en a que deux ; le premier (Actes 16.6) ; le second (Actes 18.23), où il est dit que l'apôtre traversa la contrée de Galatie et de Phrygie, fortifiant les disciples. Les Galates avaient donc été convertis dans la première visite (16.6), et alors nécessairement, c'est-à-dire, dans la seconde grande course missionnaire qui commença vers la fin de l'an 52, au retour de la conférence apostolique de Jérusalem.
Revenu de la ville sainte à Antioche, Paul reprit son œuvre d'évangélisation (Actes 15.36). Il visita les églises déjà fondées et continua sa mission vers la Galatie (Actes 16.6), champ encore inexploré. Il y trouva une population mélangée de Grecs, de Galates et de Juifs. Il est probable que dans le petit nombre de Juifs qui se distinguaient de leurs concitoyens incrédules et matérialistes par un besoin de rédemption vivement senti et par une sympathie décidée pour l'Évangile, il recueillit quelques disciples ; la tournure, le genre des preuves, le fond des arguments et le but de l'épître, sa couleur juive, son explication d'une allégorie, la connaissance des institutions, des lois, des rites religieux du judaïsme, en un mot, de l'Ancien Testament qu'elle suppose, démontrent la vérité de cette assertion. Mais si selon son habitude il s'adressa d'abord à ceux de sa nation, il est très vraisemblable que leur indifférence, leur mépris ou leurs vexations accoutumées le firent aussi tourner vers les prosélytes des synagogues et vers les païens, conformément à la spécialité de sa mission. La classe des prosélytes qui représentait l'élément vivant, sympathique et saisissable du monde antique, répondit aussi à son appel, car la plupart des chrétiens galates étaient incirconcis avant leur conversion (Galates 5.2 ; 6.13) ; ne connaissaient pas Dieu, servaient ceux qui sont dieux, non par nature (Galates 4.8) ; étaient assujettis à d'impuissants et pauvres éléments, au joug de ]a servitude, observant jours, nouvelles lunes, saisons, années (Galates 4.10 ; 5.5). Ce mélange flottant de paganisme et de judaïsme que l'on aperçoit dans le tissu de l'épître nous démontre que la majorité se composait de païens instruits dans le judaïsme et hésitant entre la synagogue et l'Évangile, ce qui n'exclut pas la conversion de quelques païens purs, en dehors de tout contact juif (4.8), et aux mœurs desquels le passage 5.19-21, pourrait bien faire allusion.
Cette communauté chrétienne, composée de peu de Gentils et de Juifs, mais de beaucoup de prosélytes, était instruite des traits principaux de l'histoire et des progrès du règne de Dieu, puisqu'elle connaissait la biographie de Paul, des principaux apôtres, etc. (1.13-14). Elle avait reçu Celui qui l'avait appelée par sa grâce (1.6), et l'Évangile du salut (1.9), l'Évangile de Christ crucifié (3.1), de la liberté chrétienne qui affranchissait du paganisme et du mosaïsme (2.5 ; 5.1,13), l'Évangile de la foi. Par son adhésion à ces enseignements, elle avait senti la puissance du christianisme (3.1), reçu l'esprit et ses effets (3.2), connu Dieu (4.9). Elle était zélée pour le bien (4.18) ; elle courait à souhait (5.7), et quelques-uns de ses membres méritaient le titre de spirituels (6.1). Enfin elle était très heureuse (4.15) ; aussi avait-elle reçu Paul comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ même, tant elle l'aimait (4.13-15) !
Satisfait de cette œuvre de plantation, Paul passa dans la Troade ; s'arrêta à Philippe et se réfugia à Athènes (Actes 17.15), toujours persécuté à travers Thessalonique et Bérée (Actes 17.1,10). Il se rendit bientôt à Corinthe (Actes 18.1), d'où, après un séjour d'un an et demi (Actes 18.11 [an 54-55]), il retourna pour la quatrième fois à Jérusalem (Actes 18.18), passant rapidement par Éphèse où il promit de revenir. Il descendit en effet promptement de Jérusalem à Antioche (an 56), pour commencer son troisième grand voyage missionnaire, et c'est alors qu'eut lieu probablement cette fameuse entrevue qui annonçait que le parti judaïsant, battu à Jérusalem l'an 52, avait ranimé ses rancunes pharisaïques, et que la lutte des judaïstes contre les pagano-chrétiens venait de se rallumer (Galates 2.11). En effet, plus exaspérés que jamais à la vue des triomphes croissants de Paul, ces chrétiens pharisaïques se déterminent à suivre leur puissant adversaire, ou à répandre des émissaires pour ruiner ses travaux ; et à peine l'apôtre triomphant était arrivé à Éphèse à travers la Phrygie et la Galatie (Actes 18.23) dont il avait vu rapidement et avec satisfaction les églises que de fâcheuses nouvelles, sur les lieux qu'il vient de visiter, lui sont communiquées. Il apprend que les judaïsants troublent la Galatie ; qu'ils l'attaquent lui et son enseignement ; qu'ils répandent de faux récits, de méchantes interprétations de sa conduite (1.13 etc.) ; que, s'appuyant peut-être sur l'opinion de Pierre, qui semble exiger d'un véritable apôtre d'avoir toujours été avec le Seigneur durant son séjour terrestre (Actes 1.21), ils déprécient son autorité apostolique (Galates 1.1), en calomniant l'origine de son apostolat (1.12-22), en le comparant aux autres apôtres (2.6-10), en soutenant que l'Évangile devait être prêché par les apôtres ordonnés par le Christ (2.7), qui étaient, eux douze, les pères spirituels de la nouvelle Jérusalem, de l'Israël d'en haut (Matthieu 19.28 ; Apocalypse 4.10 ; 21.14) en l'accusant de versatilité pour complaire aux hommes (1.10 ; 5.11). Il apprend qu'ils nient la pureté de sa prédication, d'abord par toutes ces accusations, ensuite en s'efforçant de montrer une opposition entre ses doctrines et celles des autres apôtres, qui faisaient observer la loi (2.7-9,16) ; enfin, en proclamant au fond la nécessité de la loi, et de la circoncision en particulier pour être sauvé.
Ces efforts destructeurs n'étaient pas restés sans résultat. Ces hommes que Paul accuse de vouloir pervertir l'Évangile de Christ (1.6-7), de contraindre les Gentils à judaïser (2.14), de les faire finir par la chair, de les ramener à la servitude (3.3 ; 2.4 ; 5.1), de les faire circoncire (6.12), de les jalouser à mauvaise intention (4.17), de persécuter les chrétiens (4.29), de les empêcher d'obéir à la vérité (5.7), pour se glorifier d'eux en leur chair (6.12), parcequ'ils ne voulaient pas être persécutés pour la cause de Christ et qu'ils ne gardaient pas eux-mêmes la loi (6.12-13) ces faux frères, dis-je (Philippiens 3.2 ; 2 Corinthiens 11.13 ; Colossiens 2.18, etc. 1 Timothée 6.3-4) étaient en effet parvenus en partie à leurs fins. Ils avaient jeté de l'odieux sur Paul et de la confusion dans l'Église (4.16 ; 1.7 ; 5.9-12). Ils avaient séduit des Galates en faveur de la loi et de la circoncision (4.21 ; 5.2). De là, cet état d'infidélité à la vérité et d'abaissement moral dont se plaint l'apôtre (5.7 ; 3.1 ; 1.6 ; 5.13,15, etc.). Ici l'on optait pour la circoncision, et là pour la liberté, ce qui avait enfanté des froissements, des divisions, de la licence, des perturbations anti-chrétiennes. Les uns tombaient dans l'orgueil spirituel (6.3), abusaient de la liberté chrétienne (5.13), traitaient les faibles sans douceur (6.1) ; les autres se laissaient emporter par la vanité des bonnes œuvres, et la plupart semaient dans la chair, se mordant, se dévorant les uns les autres (5.13-15, 26), ne se donnant pas aide réciproque, se glorifiant des autres par d'orgueilleuses comparaisons (6.2,4,10).
A l'ouïe de ces tristes événements, Paul, plein d'inquiétude sur l'avenir de ces églises et craignant d'avoir travaillé en vain à leur égard (4.11), éprouve toutes les douleurs d'une nouvelle conception. Ce premier exemple d'amalgame chaotique tenté par le judaïsme entre la loi et la foi, et de désordre spirituel et social, l'impressionne fortement et met en jeu toutes les fibres de son âme, toute la la verve de son indignation, de sa foi et de son amour. Pressé de donner à ses chers enfants une nouvelle preuve de ses sollicitudes paternelles et de rasseoir ces consciences et ces intelligences bouleversées, il prend la plume contre son habitude et quelque peine qu'il pût lui en coûter, et laisse échapper de son cœur inspiré et de sa haute et divine raison, cette lave de foi, de lumière, de vérité et d'amour, tour à tour ardente et réglée, brûlante et calme, vive et logique que nous appelons épître aux Galates.
I. Adresse et salut (1.1-5). Dans l'adresse, Paul pose l'origine divine de son apostolat (1.2), et dans le salut, la justification de l'homme par Dieu au moyen de la foi en Christ (1.3-5). Double thème de son épître.
II. Introduction (1.6-10). Paul entre en matière d'une façon très vive. Il laisse échapper les émotions de son âme, en apostrophe aux Galates légers (1.6), et à leurs perturbateurs (1.7) ; en protestation solennelle sur l'immutabilité de sa prédication évangélique (1.8-9), et en apologétique interrogation sur lui-même et sur sa conduite (1.10).
III. Thèse de l'apôtre. Paul avant, pendant et immédiatement après sa conversion (1.11-17). A ce cri de son âme, à cette victorieuse apostrophe, forte déjà d'une preuve irrésistible, succède un énoncé clair et complet de sa thèse (1.11-12) et le développement calme de sa longue démonstration historique. Comme ses adversaires attaquaient la vérité de sa prédication par l'illégitimité prétendue de son apostolat, il fait à grand trait sa biographie. Tout le monde connaissait son zèle pour la loi juive et sa fureur contre les chrétiens(1.13-14), ce qui fait ressortir le caractère providentiel de sa conversion non volontaire ou recherchée, mais divinement opérée (1.15) ; immédiatement après et pendant trois ans, ce qui caractérise sa vie, c'est qu'elle fut privée de rapports avec les apôtres (1.16-17).
IV. Visite de Paul à Jérusalem et aux églises de Judée (1.18-24). Cette visite n'est pas moins favorable à sa cause que son absence, d'abord à cause de son but et de sa brièveté (1.18-20) ; ensuite en raison de l'ignorance des églises de Judée à l'égard de sa personne, ignorance qui rehausse le prix de leurs louanges et la sanction qu'elles imprimaient à la vérité de sa foi (1.21-24).
V. Nouvelle visite à Jérusalem. Rapports avec les judaïsants, avec les apôtres (2.1-10). A l'absence de rapports ou à leur nulle importance dogmatique, en succèdent de triomphants pour sa cause. C'est d'abord longtemps après une nouvelle visite à Jérusalem où il exposa sa prédication (2.1-2) et où il triompha de ses adversaires par la non-circoncision de Tite (2.3) et par sa glorieuse résistance (2.4-5) ; c'est ensuite ses relations fraternelles avec le apôtres (2.6), la légitimité de son apostolat, reconnue et proclamée par eux (2.7-8), leur association mutuelle et leur fraternité chrétienne (2.9-10).
VI. Entrevue de Paul et de Pierre à Antioche. Discours de Paul (2.11-21). Paul s'est montré l'égal des apôtres, missionnaire indépendant ; il y a plus, un instant il est supérieur. Pierre, étant digne de blâme, il le redresse (2.11-14). Il le convainc d'erreur dans sa conduite (2.14). Il lui montre que la justification découle non de la loi, mais de la foi, par son propre aveu de conscience ; par son passage du judaïsme au christianisme (2.15-16) ; parce qu'en revenant à la loi, on se reconstitue pécheur (2.17-18) ; par le but et l'effet de la loi (2.19) ; par la mort de Christ et la vie du chrétien en lui, vie de grâce et de foi (2.20-21). La gradation de ces paragraphes est remarquable. Paul est ennemi des chrétiens ; il est converti forcément ; il vit isolé des apôtres ; il est avec eux dans des rapports indifférents ; il est applaudi des églises de Judée ; il triomphe des judaïsants ; il est l'égal des apôtres ; un instant même il agit en supérieur. Donc, indépendance et vérité de sa dignité apostolique.
VII. La foi et non la loi, source du don de l'esprit (3.1-5). Paul, reprenant le développement de la fin du chapitre 2, entre en matière sur l'autorité de la loi et la vérité de son Évangile, en montrant aux Galates qu'ils n'ont pas obtenu l'esprit par leur obéissance à la loi, mais par la foi. Il leur donne un argument personnel, leur expérience (3.1-4) ; et une raison de fait, le moyen que Dieu a employé pour leur donner l'esprit (3.5).
VIII. Foi et justification d'Abraham (3.6-9). Vient alors un argument biblique, l'exemple d'Abraham (3.6-7), et le témoignage de l'Écriture (3.8-9).
IX. Malédiction de la loi. Son impuissance. Justification par la foi en Christ (3.10-14). Nouvel argument tiré de la nature et des dispositions de la loi. La loi fait peser la malédiction sur ceux qui lui sont infidèles (3.10) ; et tous ceux qui s'en tiennent à elle sont infidèles ou ne peuvent pas être justifiés, car la Bible dit qu'on ne vivra que par la foi (3.11), or, la loi n'a rien de commun avec la foi (3.12), donc tous les serviteurs de la loi sont maudits ; aussi de fait, Christ est venu briser cette malédiction pour justifier par la foi en lui (3.13-14).
X. Nature, inviolabilité de la promesse divine (3.15-18). Nouvel argument : Christ étant le but des promesses, la loi ne peut les annuler. Une volonté ou un fait postérieur n'abroge pas une disposition antérieure d'une autre nature, c'est la pratique humaine (3.15) ; or, tel est le cas de la disposition de Dieu envers Abraham, en vue de Christ donc la loi postérieure ne peut l'abolir (3.16-17 et comme la vie est attachée à cette promesse, elle ne peut l'être à ce qui lui est postérieur et opposé (3.18).
XI. Valeur temporaire, secondaire de la loi. Son harmonie avec les promesses (3.19-24). Les circonstances qui ont environné la promulgation de la loi indiquent son but temporaire, de réprimer et d'éclairer la conscience du péché (3.19-20). Ainsi elle était un instrument éducateur, et préparateur du Christ (3.21-24).
XII. Conclusion. Actualité de la foi ; sa puissance ; ses rapports (3.25-29). Par la présence réelle de la foi, Paul conclut à la nullité de la loi (3.25), et par l'assimilation personnelle de cette foi, à la possession de la filialité, une et universelle, de la bénédiction abrahamique (3.26-28). Dans le v. 29, il concentre, enchaîne et résume tous ses raisonnements, et revenant sur sa pensée, il la remonte par les degrés qu'il a déroulés. Il était parti de Dieu, donnant promesse à Abraham et par Abraham à toutes les nations, au moyen de Christ ; il arrondit ses arguments en concluant : si vous êtes à Christ, vous êtes les vrais descendants d'Abraham, et dès lors les héritiers des promesses et des bénédictions de Dieu.
XIII. Filialité par la foi (4.1-7). Nouvelle face de la dernière pensée du paragraphe précédent. La position domestique et sociale de l'héritier mineur est comme celle de l'esclave (4.1-2) ; tels étaient d'abord les Juifs et les païens (4.3) ; mais l'époque de la minorité étant écoulée, Dieu-Père a envoyé son Fils pour nous adopter en lui (4.4-5) ; de sorte que par le fait ayant reçu l'esprit de finalité (6), nous ne sommes plus serviteurs sous la loi, mais fils, libres et héritiers par la foi (4.7). Nouvelle et identique conclusion générale.
XIV. Inconséquence, folie, injustice des Galates. Mauvaise jalousie des judaïsants ; tendresse de Paul (4.8-20). L'apôtre suspend un moment la série de ses arguments bibliques dialectiques, pour se livrer à une émouvante effusion de cœur et à l'entraînement éloquent d'une sollicitude paternelle, à la fois tendre et sévère, touchante et alarmée, douce et jalouse. Son âme, pleine de son objet, passe rapidement en revue les Galates, lui-même et les judaïsants. Aux premiers, il demande comment il peut se faire qu'ayant expérimenté le joug de l'idolâtrie et puis la miséricorde divine, ils puissent se replacer sous le joug, et il déplore l'infécondité possible de ses labeurs, avec prière aux Galates de l'imiter dans sa liberté (4.8-12) ; quant à lui, il leur rappelle leurs sentiments de respect, de foi, d'amour pour sa personne, le bonheur dont il les avait rendus participants, leur verve de dévouement envers lui, pour leur faire sentir l'injustice des sentiments haineux qu'on leur a inspiré (4.13-16), ce qui l'amène à parler des intentions et de la conduite blâmables des judaïsants à son égard et envers eux, puisqu'ils les faisaient déchoir du bien (4.17-18) ; il termine par l'expression de ces indicibles douleurs spirituelles, mêlées d'amour, de tristesse, de larmes, sublime de la charité souffrante, que coûte l'enfantement spirituel à son âme de père et de mère (4.19-20).