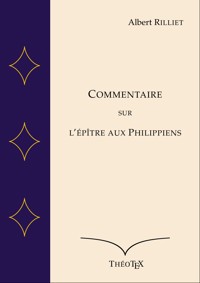
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Théologien et historien de la Réforme, Albert Rilliet (1809-1883) a compté parmi les figures les plus éminentes de la confédération helvétique. Son oeuvre s'est principalement concentrée sur l'histoire de Genève, mais il nous a laissé également ce commentaire sur l'Épître aux Philippiens, somme d'érudition et de finesse d'analyse, qu'il semble difficile de surpasser. Après une introduction historique de haute volée sur la ville de Philippes et sur l'état d'esprit de sa population à l'époque de l'apôtre Paul, l'auteur donne une traduction de l'épître, et procède à son exégèse verset par verset. Une connaissance minimale du grec biblique est requise pour pouvoir apprécier la valeur de cet ouvrage. Pour des raisons pratiques, dans notre édition numérique ThéoTeX nous avons remplacé le texte grec et l'appareil critique de Rilliet, par celui de Robinson & Pierpont ; sa traduction française donnée dans ce livre en 1841, a été remplacée par celle de son Nouveau Testament, basé sur le manuscrit Vaticanus et publié en 1859. La disposition a également été un peu modifiée de façon à permettre un accès hyperliens par versets. La plupart des citations latines de l'Introduction ont été traduites.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322482221
Auteur Albert Rilliet. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Parmi les divers écrits que renferme la collection du Nouveau Testament, l'Épître aux Philippiens est un de ceux dont le contenu et l'interprétation présentent sans contredit le moins de difficultés. C'est précisément cette circonstance qui m'a engagé à la choisir pour l'objet d'un travail exégétique, dans l'élaboration duquel j'avais à tenir compte tout à la fois de mes propres forces, et de l'état de la science dans les pays de langue française. Ce genre d'études, jadis si brillamment cultivé par nos premiers théologiens, paraît aujourd'hui comme délaissé dans nos Églises, et bien qu'il commence à reprendre dans quelques Facultés la place qui lui est due, son existence ne se trahit dans la littérature théologique que par de rares productions. Sans nous arrêter à rechercher les causes d'un fait qui forme, avec l'immense développement qu'a pris chez les protestants d'Allemagne la science exégétique, un singulier contraste, et qui offre une disparate non moins singulière avec la prétention de nos Églises de trouver dans l'autorité de la Bible le seul principe de leur existence, et dans son examen la cause efficace de leur développement, il suffit de constater l'état de souffrance où se trouve de nos jours dans les Églises françaises l'exégèse du Nouveau Testament, pour comprendre la nécessité de restreindre, au début de la carrière, l'étendue des difficultés qui attendent l'interprète et ses lecteurs.
J'ai cru satisfaire à cette nécessité, en choisissant pour mon travail une Épître qui, tout en offrant, soit pour le fond soit dans la forme, assez de sujets propres à exercer la sagacité exégétique, présente cependant, moins que d'autres écrits du Nouveau Testament, ces hautes questions de théologie, ces nombreux détails historiques, ces obscurités de style, à l'examen desquels on ne peut se livrer avec fruit qu'après avoir acquis dans des régions plus accessibles l'habitude de l'interprétation. C'est en partant du même point de vue, que j'ai cherché à élaguer tout ce qui n'était pas en rapport direct avec la tâche que je me proposais, et que, d'un autre côté, j'ai cru souvent mieux remplir celle-ci, en donnant des explications qui paraîtront peut-être superflues, qu'en risquant d'omettre celles qui pouvaient être nécessaires. C'est encore dans l'intention d'aller droit au but, que j'ai désiré faire de l'exégèse positive plutôt que de l'interprétation polémique, établir le sens clair du texte plutôt que discuter toutes ses significations possibles, expliquer enfin Paul par Paul lui-même, en ne sortant, soit pour la langue, soit pour les idées, soit pour les faits, des données que m'offraient ses écrits, que lorsque ces données ne suffisaient pas à éclaircir le fond ou la forme du texte dont j'avais à rendre compte.
Désirant concentrer l'attention de mes lecteurs sur les expressions et les pensées de l'apôtre, objet unique et immédiat du travail que j'ai entrepris, j'ai évité à dessein de reproduire et de débattre les opinions des commentateurs ; mais après les avoir étudiées pour mon propre compte, j'ai exposé aussi nettement et aussi complètement que possible les motifs de l'interprétation qu'un examen personnel et approfondi m'a fait adopter pour chaque passage, sans repousser toutefois les citations des interprètes ou des auteurs anciens propres à mieux exprimer ou à mieux éclaircir le sens de l'apôtre. J'ai évité de même, et pour la même raison, de faire intervenir dans mon travail la dogmatique ecclésiastique, et j'en ai écarté également les réflexions qui se seraient rapportées à ce qu'on a coutume d'appeler l'édification ces deux branches de la science religieuse peuvent et doivent profiter de l'exégèse, mais je ne pense pas qu'il convienne de les mêler avec elle.
Pour interpréter avec vérité et avec l'impartialité, non de l'indifférence mais de la foi, les écrivains sacrés, il faut savoir s'en tenir à eux-mêmes, les saisir dans la sphère vivante de leur activité personnelle, prendre pour ainsi dire sur le fait dans leurs écrits le développement intérieur de leur vie propre, et demander à ces incorruptibles témoins de leur existence, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, en nous abstenant d'apporter dans cette recherche des opinions préconçues, en en acceptant sans inquiétude les résultats quels qu'ils soient, en évitant en un mot de substituer aux faits que révèle l'étude sincère des saintes lettres, les idées que nous voudrions voir à leur place.
Tels sont, dans leur expression la plus générale, les principes qui m'ont guidé soit dans le Commentaire, soit dans l'Introduction destinée à mettre en lumière l'élément réel au milieu duquel Paul a vécu. Dans l'une et l'autre partie de l'ouvrage j'ai toujours cherché à m'établir directement sur le terrain de l'histoire, qui est celui de la vérité, en écartant, autant qu'il était en moi, toutes les fausses lueurs dont des préjugés respectables ou funestes ont trop souvent ébloui les regards de l'exégète.
J'ignore si j'ai réussi, ou plutôt je suis assuré, que dans ce travail, qui n'est qu'un essai, je n'ai pu fournir la carrière sans faire plus d'un faux pas. Mais ce dont je suis également convaincu, c'est que sans cette pleine indépendance que je réclame et que j'ai surtout recherchée, l'exégèse, privée de son plus beau caractère et de sa plus sûre garantie, n'entreverrait plus les auteurs sacrés qu'au travers d'un voile ; entre eux et l'interprète s'élèverait un mur de séparation qui détruirait pour celui-ci ce qui fait précisément l'excellence de son œuvre, je veux dire ce contact intime avec les dépositaires de la pensée divine, ce commerce spirituel où l'on ne peut vivre, quand on y vit réellement, sans en recueillir avec abondance les fruits de la sanctification et de la régénération.
Car je ne veux parler ici que de l'interprète chrétien et quand je repousse tout intermédiaire entre lui et les écrivains sacrés, j'excepte ce qui seul peut les lui faire comprendre, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui les inspira, et sans lequel, dans une mesure qui nous reste inconnue, il n'y a de progrès, de lumière et de vie, au sein du royaume du Seigneur, ni pour les Églises, ni pour les individus.
Puisse cet Esprit qui animait Paul, reposer sur un ouvrage destiné à mettre en lumière une portion de la vie de ce grand apôtre ! Puisse-t-il, par son moyen, éclairer utilement ceux qui viendront y chercher quelque instruction.
Après avoir consacré toute l'énergie d'un caractère exalté jusqu'au fanatisme, à défendre, au début de sa carrière les croyances de son peuple, le juif Paul de Tarse, abandonnant tout à coup la loi et les traditions de ses pères, avait embrassé la religion nouvelle, établie au sein de la Judée par Jésus de Nazareth, le Christ crucifiéa. Des conjonctures extraordinaires avaient déterminé sa conversion, une conviction parfaitement éclairée la sanctionna. Dévoué de toute la puissance de son âme au Maître qu'il n'avait pas connu, et à l'œuvre que Jésus ressuscité avait laissée à ses disciples, Paul s'était entièrement consacré à la prédication de l'Évangile du salut. Nouveau venu parmi les apôtres du Fils de Dieu, il paraissait vouloir racheter par une activité sans bornes le temps où dans sa haine contre les sectateurs du Christ, il dépensait ses forces à les persécuter ; il semblait qu'il désirât compenser par les conquêtes qu'il faisait pour l'Église, les ravages qu'il y avait causés. Déjà il a parcouru l'Arabie, la Syrie, tout le midi de l'Asie mineure, prêchant dans la synagogue des juifs et dans le forum des gentils, et il ne recherche qu'une occasion de porter plus au loin le trésor de la bonne nouvelle dont l'administration lui a été confiée.
C'est quelque temps après avoir assisté dans Jérusalem au concile apostolique (Act.15.4-30), que Paul entreprend un nouveau voyage de mission, et quitte Antioche (environ l'an 50 après J.-C.), pour visiter les Églises qu'il a déjà fondées, et les affermir dans leur attachement à la Parole de Dieu. Il est accompagné d'un chrétien appelé Silas, et sur sa route il s'attache un jeune homme qui, né d'un père grec et d'une mère juive, appartenait à la foi nouvelle, et se nommait Timothée (Act.16.1). Après avoir parcouru les provinces de l'Asie mineure déjà évangélisées, et avoir jeté les premières bases de l'édifice chrétien dans la Phrygie et dans la Galatie, Paul voulut se diriger, avec ses compagnons d'œuvre, vers la partie occidentale de l'Asie mineure, nommée à cette époque Asie proconsulaire, ou simplement Asieb). Mais, dit l'historien de l'Église apostolique, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la Parole en Asie. (Act.16.6). Défense singulière, par laquelle le même Esprit qui poussait les apôtres à prêcher l'Évangile s'opposait tout à coup à cette prédication, et retenait loin d'un sol qu'il fallait féconder les hommes auxquels était confiée la semence de la Parole. Défense positive, et sur laquelle les apôtres ne pouvaient se faire illusion, puisque la voix divine tenait ici un langage contraire aux impulsions de la volonté humaine, et qu'obéir à la première, c'était renoncer aux plans qu'avait formés la seconde. En se soumettant à l'injonction de l'Esprit saint Paul n'était donc pas exposé à prendre pour l'expression d'une volonté supérieure à la sienne, ce qui n'eût été que le résultat de ses désirs personnels.
Abandonnant la route qu'il avait eu l'intention de suivre, l'apôtre veut se diriger du côté de l'est vers la province de Bithynie ; mais à peine a-t-il formé ce projet que l'Esprit réitère son interdiction. Dans cette lutte nouvelle entre ses propres déterminations et les instigations divines, Paul, toujours docile à la voix qu'il reconnaît pour celle de son Dieu, se soumet encore, change de route, et se portant en avant dans la seule direction qui lui soit laissée, il poursuit sa course vers le nord-ouest jusqu'aux bords de la mer Egée ; parvenu de la sorte aux confins du continent Asiatique, il s'arrête à Troas (Act.16.8), colonie romaine située non loin des lieux où fut Troie. C'est là que les ouvriers apostoliques reçoivent l'explication des obstacles suscités par l'Esprit à leurs premiers projets ; c'est là qu'un champ nouveau, sur lequel ne s'étaient arrêtés ni leurs regards, ni leurs pensées, s'ouvre devant eux.
L'Orient seul avait jusqu'à cette époque reçu des apôtres de Christ l'enseignement chrétien, et les mers qui baignent l'Europe et l'Asie n'avaient pas encore été franchies par les ambassadeurs de Dieu. Les pays de l'Occident n'avaient pu entendre parler de l'œuvre du Christ que par l'intermédiaire de quelques rapports officiels venus de Palestine à Rome lorsque Jésus fut mis à mort, et par les récits tour à tour hostiles ou favorables, que les juifs d'Orient transmettaient de bouche ou par écrit à leurs coreligionaires d'Europec. Mais le moment était venu où l'Évangile devait être porté par ceux-là même qui en étaient plus particulièrement les dispensateurs, aux populations européennes ; il fallait qu'il prît enfin possession d'un continent où l'attendaient ses plus nobles conquêtes. La religion du Christ ne pouvait demeurer plus longtemps circonscrite dans l'Orient ; bien qu'elle y eût pris naissance, son avenir était ailleurs. Déjà l'Occident exerçait sur les destinées du monde cette influence qui dès lors a toujours grandi, en sorte que le christianisme devait se faire européen, pour devenir universel. Telle est la grande et providentielle pensée qui se cache sous les interdictions par lesquelles l'Esprit de Dieu repousse l'apôtre Paul des parages de l'Asie mineure. En ces lieux la Parole pouvait en quelque sorte faire son chemin d'elle-même, les jalons étaient posés, les ouvriers établis ; l'œuvre évangélique devait se propager dans les diverses provinces par le fait seul des relations qui les unissaient ; là, comme partout où il s'est implanté, le christianisme trouvait dans son existence la raison de son développement. Dès lors la prédication apostolique pouvait être temporairement éloignée des provinces d'Asie, pour venir inaugurer en Europe le royaume de Dieu.
Paul ne l'avait pas compris ; quelque vaste et pénétrant que fût le regard de son intelligence, et bien qu'il eût mieux que tous les autres apôtres conçu l'universalité de la foi qu'il prêchait, il n'a cependant pas su marcher de lui-même à la conquête religieuse de l'Europe ; il n'a pas compris la mission de cette portion du monde dans les destinées de l'humanité ; il n'a pas saisi les différences profondes qui la distinguent de l'Asie, et qui assignent à chacune d'elles des rôles si divers. C'est une volonté supérieure à la sienne qui lui inspire une résolution à laquelle il n'était point porté de lui-même, et dont il n'est pas probable qu'il entrevît les conséquences, lorsqu'il céda aux directions d'en haut. C'est ainsi que le narrateur des temps apostoliques nous a transmis un fait, dont mieux que lui peut-être nous saisissons la portée, en nous apprenant que le terrain nouveau sur lequel va descendre la religion du Christ a été désigné par la volonté spéciale de Dieu, et n'a pas été arbitrairement choisi par le caprice de l'homme.
Arrivé à Troas, Paul ne peut plus retourner en arrière ; toutes les provinces qui l'entourent lui sont interdites ; devant lui il n'a que la mer. Il sait bien où il ne doit pas aller, il ignore dans quel pays il doit se rendre. Au milieu de cette perplexité il est enfin tiré d'embarras par une vision nocturne, dans laquelle un homme qu'il reconnaît pour Macédonien se présente à lui, et le supplie de passer en Macédoine, afin de porter secours aux habitants de ces contrées. L'historien des Actes, qui venait alors de se réunir à Paul (Act.16.10), ne nous indique point quels furent pour l'apôtre les motifs d'ajouter foi à cette vision ; il nous apprend seulement qu'elle éclaircit les incertitudes des voyageurs, et qu'ils s'accordèrent à y voir une manifestation de la volonté de Dieu qui les appelait en Macédonie pour y annoncer l'Évangile. (Act.16.10). Alors ils n'hésitèrent plus ; montant sur un navire ils quittèrent Troas, et, après deux jours de navigation, ils débarquèrent à Néapolis, petite ville maritime sans importance, sur l'emplacement de laquelle existe aujourd'hui le bourg appelé la Cavalad. Ce fut en cet endroit que le sol européen fut touché pour la première fois par un apôtre de Jésus-Christ, porteur de cet Évangile, qui renfermait tout l'avenir de l'Europe et toute sa civilisation ; c'est du même lieu que sortit, dix-sept siècles plus tard, le sectateur d'une autre foi, appelé à devenir par des moyens bien différents de ceux de Paul le fondateur de l'un des empires de ce monde. Le prétendu civilisateur de l'Egypte, Méhémet-Ali, est né à la Cavala.
Les missionnaires apostoliques ne s'arrêtèrent point à Néapolis, et poursuivirent leur course vers la ville de Philippes, la première cité de Macédoine qu'ils rencontraient sur leur routee, et dans laquelle, par conséquent, ils devaient, d'après le but même de leur voyage, faire leur première station.
L'origine de cette ville remontait à des temps fort anciens ; elle avait été construite sur le territoire de la Thrace par des habitants de l'île de Thasos, et elle avait porté dans la première période de son existence, le nom de Crénidès, à cause des nombreuses sources d'eau vive (κρήναι) qui jaillissaient de la colline sur le sommet de laquelle elle était situéef. Plus tard (358 av. J.-C.) le roi Philippe de Macédoine, ayant réuni à son royaume une partie de la Thrace, forma le projet d'agrandir et de fortifier Crénidès, afin d'en faire un boulevard contre les incursions des peuples voisins, et pour protéger en même temps l'exploitation qu'il voulait entreprendre de riches mines d'or situées près de cette ville. La cité restaurée prit le nom de son nouveau fondateur et s'appela Philippes.
Située à environ deux milles de la mer Egée, elle était assise sur une hauteur escarpée dont les pentes, s'abaissant du côté de l'ouest, venaient mourir dans une vaste et fertile plaine qui s'étendait elle-même jusqu'au fleuve Strymon, à 350 stades (56 km) de Philippes. A l'orient s'élevait, non loin de la ville, une chaîne de montagnes qui formait la limite entre la Macédoine et la Thrace ; c'est là que se trouvait la gorge des Sapéens, défilé important dont Philippes commandait l'issue, et qui, selon l'expression d'Appien (auquel nous avons emprunté ces détails sur la situation de Philippes), était comme une porte placée entre l'Europe et l'Asieg. La côte au sud-ouest de Philippes était entrecoupée sur une assez grande étendue de marais qui la rendaient déserte. Plus près de la ville se trouvaient le mont Pangée et la colline de Bacchus, renommés pour leurs mines d'or et d'argenth. Philippe les exploita avec succès, et elles fournirent sans doute d'abondants revenus à ses successeurs, et aux particuliers qui en possédaient une partie, jusqu'au moment où la Macédoine tomba dans la dépendance des Romains (168 av. J.-C.).
Ces derniers, tout en rendant à cette contrée une liberté apparente, disposèrent cependant à leur gré de son territoire et de ses revenus ; l'exploitation des mines de métaux précieux fut entièrement supprimée, la sortie des bois de construction, et l'exportation du sel furent interdites. En même temps la Macédoine fut partagée en quatre districts, dont les habitants, parqués pour ainsi dire dans les limites que traça le vainqueur, reçurent l'injonction de s'abstenir de tout rapport avec les districts voisins en ce qui concernait les mariages et l'aliénation des propriétési. Philippes, qui se trouvait comprise dans le district de l'est (entre le Strymon et le Nessus), dont Amphipolis était la capitale, dut perdre par ces divers changements les principales ressources que lui avait jusque-là assurées sa position. Les années qui suivirent n'améliorèrent pas son sort ; la Macédoine, entraînée par un prétendu descendant de Persée, se révolta contre les Romains, et eut à souffrir tour à tour des maux de la guerre et de la tyrannie de son nouveau roij. Définitivement soumise par les légions romaines, elle fut réduite en province (148 av. J.-C), ou plutôt en servitudek, et l'on comprend que sous ce nouveau régime, Philippes ne retrouva pas des jours plus heureux. Elle eut le triste honneur de voir son nom prendre place dans l'histoire, à la suite des batailles mémorables que se livrèrent près de ses murs les triumvirs Antoine et Octave et les généraux Brutus et Cassius (42 av. J.-C.) :
La défaite des chefs du parti républicain, suivie plus tard de celle d'Antoine (31 av. J.-C), rendit Auguste maître de Rome et du monde. Alors il voulut récompenser les troupes auxquelles il devait l'empire, en leur donnant en Italie des villes et des terres ; dans ce but il déposséda les partisans de son rival, et les transportant loin de leur patrie, il établit un certain nombre d'entre eux à Philippesm (30 av. J.-C), à laquelle échut ainsi le titre de colonien. On peut conclure du choix qui fut fait de cette ville, que sa population avait diminué d'une manière assez notable pour permettre l'introduction dans ses murs de nouveaux habitants ; en effet l'étendue de son enceinte étant exactement limitée par les dimensions du plateau sur lequel la ville était bâtieo, celle-ci ne pouvait pas matériellement s'agrandir pour recevoir un accroissement de population. La réduction du nombre des anciens citoyens, que l'on est ainsi conduit à admettre, est une preuve positive de la déchéance qu'avait subie Philippes et dont nous avons indiqué les causes.
Une ère nouvelle s'ouvrit pour cette ville par l'arrivée des colons italiens ; dotée des privilèges que conférait le jus italicump, elle acquit avec ce droit la faculté d'opérer librement les transactions concernant l'aliénation et l'acquisition des propriétés, l'exemption de tout impôt direct, et l'autorisation de confier l'administration de la cité à des magistrats indépendants et investis d'une juridiction civile et criminelleq (duumviri juridicundo, στρατηγοίr). Ces avantages, qui étaient de droit commun pour les villes d'Italie, avaient été transférés à certaines cités de l'empire Romain pour des motifs divers ; ils furent probablement octroyés à la ville de Philippes en conséquence de l'incorporation des colons italiens. Outre ces droits généraux appartenant au corps entier de la cités, les nouveaux habitants de Philippes conservaient leurs droits personnelst, et entre autres la qualité de citoyens romainsu, propriété des peuples italiques depuis la guerre sociale. Profitant des circonstances plus favorables dans lesquelles elle se trouvait placée, la ville de Philippes se releva de la décadence que la domination romaine lui avait fait originairement subir, et reconquit une position florissante. Certains indices de commerce et de bien-être (voir section 4), semblent attester sa prospérité, au moment où l'apôtre Paul la visita pour la première fois (51 ap. J.-C).
Arrivés dans les murs de Philippes, les missionnaires chrétiens passèrent quelques jours à reconnaître l'état intérieur de cette villev, et à rechercher comment ils devaient s'y prendre pour commencer la tâche qui leur était confiée. En général Paul adressait ses premières prédications à la partie juive de la population des différentes villes qu'il visitait ; c'était dans la synagogue qu'il allait chercher d'abord des auditeurs et des adhérentsw. A Philippes le nombre des juifs était, à ce qu'il paraît, trop restreint pour qu'ils possédassent une synagogue dans la ville, soit que la construction de cet édifice religieux eût exigé des dépenses trop fortes pour les ressources de la petite communauté, soit que les habitants païens profitassent de leur immense supériorité numérique pour éloigner de leurs murs le sanctuaire d'une religion méprisée. Paul et ses compagnons privés de ce rendez-vous ordinaire, apprirent que les membres de la société juive se réunissaient le jour du sabbat hors des murs de la ville., près d'une rivièrex, dans un lieu consacré par l'usage aux prières et aux lustrations communes. C'était l'habitude des juifs, lorsqu'ils ne pouvaient ériger une synagogue, de la remplacer par un lieu de réunion nommé προσευχὴ, et de choisir celui-ci près des eauxy, afin de se livrer plus facilement à leurs ablutions. Ailleurs l'endroit de réunion était stablez, et alors le nom de προσευχὴ se donnait au bâtiment où les fidèles se rassemblaient ; à Philippes la localité n'est consacrée que par l'habitudea, et aucune construction permanente n'en a fait le théâtre nécessaire du culteb ; nouvelle preuve du peu d'importance de l'élément juif dans la population de Philippes.
Paul dut attendre le jour du sabbat pour se rendre avec ses compagnons à la Proseuchè, et lorsqu'il eut pris place dans son enceinte, il entra en conversation avec les personnes qui venaient accomplir en ce lieu leurs dévotions du dernier jour de la semaine. Il paraît que le plus grand nombre d'entre elles étaient des femmes, soit qu'elles formassent effectivement la majorité de la population juive de Philippes, soit que, selon l'usage, elles missent à l'accomplissement de leurs devoirs religieux plus de zèle que les hommes. Quoi qu'il en soit, ce fut elles qui attirèrent plus particulièrement l'attention des apôtres. Ils trouvèrent sans doute dans l'œuvre de dévotion à laquelle se livraient ces femmes, une occasion toute naturelle de s'entretenir avec elles des intérêts religieux, et de leur parler de la bonne nouvelle qu'ils étaient chargés d'annoncer.
Bien que l'auteur du livre des Actes, présent à cette scène, ne nous indique point comment Paul entra en matière, cependant, d'après ce que nous savons de la méthode généralement suivie par l'apôtre lorsque pour la première fois il prêchait l'Evangile à ses compatriotes, il est probable que ce fut du Messie qu'il parla, de cet être attendu par toute la nation, pour devenir, selon la volonté du Dieu de leurs pères, le sauveur et le roi d'Israëlc. Sur ce point Paul était d'accord avec les juifs ; mais ces derniers ne concevaient d'autre Messie qu'un Messie temporel, d'autre délivrance qu'une délivrance politique, et se croyaient sous le rapport religieux dans une complète sécurité, parce qu'ils voyaient dans leur loi un contrat inviolable conclu entre leur nation et l'Eternel, et d'où résultait pour eux l'assurance d'un bonheur sans fin dans le siècle à venir. Paul, en leur parlant du Messie, renversait toutes ces idées ; il montrait cet Être venu en Jésus, pour opérer le salut des âmes et leur délivrance des liens de l'erreur et du péché ; il présentait sous un jour tout différent les rapports des Juifs avec Dieu, et, en les plaçant à cet égard sur la même ligne que le reste de l'humanité, il blessait leur orgueil, et irritait leurs préjugés nationaux. En un mot, parti avec eux d'une conviction commune, il arrivait à des résultats entièrement opposés. Son langage devait révolter, et révolta bien des juifs, et le peu de succès qu'il rencontra auprès des femmes israélites de la Proseuchè de Philippes, suffit à prouver qu'en cette circonstance, comme dans d'autres occasions, il avait fait entendre des paroles que ne pouvaient supporter facilement des oreilles juives ; le mépris accueillit probablement un discours, qu'ailleurs aurait châtié la persécution. Une femme cependant écouta avec intérêt l'enseignement de Paul ; mais elle appartenait à une classe intéressante et nombreuse qui formait comme un chaînon entre le judaïsme et les croyances païennes : elle était prosélyte, ou, selon l'expression employée dans les Actes, elle révérait Dieud.
Les prosélytes juifs formaient, comme on sait, deux catégories différentes : les uns renonçant complètement à leurs opinions, et à leurs rapports avec la société païenne, devenaient tout à fait juifs ; ils faisaient une abjuration formelle de leurs anciennes croyances, adhéraient entièrement aux doctrines, aux rites et aux usages du judaïsme, se soumettaient même à la circoncision, et étaient ainsi placés sous le rapport religieux sur la même ligne que les véritables juifs. Ce n'est pas de ces convertis qu'il est question dans l'histoire apostolique, ils demeuraient confondus avec ceux dont ils avaient adopté la foi et les mœurse. D'autres sectateurs des religions païennes, animés de besoins spirituels que les mythologies ne pouvaient satisfaire, étaient attirés vers le judaïsme par la pureté de son monothéisme et par la sainteté de sa morale. De tout temps et au sein même de la Judée, les juifs avaient admis sous certains rapports et à certaines conditions, dans leur société religieuse des hommes étrangers à leur nationalité. Plus tard, lorsque le peuple juif dispersé s'était trouvé en contact avec les païens (et dans l'époque qui précéda l'apparition du christianisme, ces occasions de rapprochement s'étaient encore multipliées), ce peuple avait exercé assez généralement une attraction religieuse sur les sectateurs du polythéisme, qui, travaillés par une sorte de malaise moral et d'inquiétude spirituelle, se mettaient pour ainsi dire en quête de vérités plus consolantes pour l'âme, que les mythes et les symboles païens. De là l'existence dans presque tous les lieux où se trouvait une communauté juive, et à Philippes, entre autres, de cette catégorie de prosélytes qui ne voulant point se faire juifs, ne se soumettaient pas à la circoncision, s'abstenaient des cérémonies légales, et assistaient seulement dans les synagogues (Act.13.15-16), où on leur assignait une place particulière, à la lecture des livres sacrés et aux prières communesf. Ces prosélytes cherchaient dans la foi des Hébreux un aliment plus substantiel que les vaines fables du paganisme, mais ils se dispensaient de revêtir le costume obligé de l'observateur strict des ordonnances rituelles ; la forme leur importait moins que le fonds, et ils s'attachaient à la religion des juifs en attendant mieux.
De tels hommes, rendus plus nombreux encore à l'époque qui nous occupe par la fermentation religieuse qui se manifestait au sein même du paganisme, devaient accueillir avec empressement l'enseignement chrétien ; il allait droit à leur âme, il parlait un langage qui répondait à leurs besoins ; il leur montrait Dieu comme un père qui aime, qui pardonne, qui guérit, qui sauve ; il achevait ce que la doctrine juive avait commencé ; il la dépassait. Dégagé de l'exclusivisme national du judaïsme, il s'offrait à eux comme une religion universelle, où toutes les différences extérieures disparaissent, et qui ne s'établit que dans l'intérieur de l'homme. Tout ce qui les attirait dans la foi des juifs, l'Évangile le leur donnait à un degré plus excellent encore, et de plus il se présentait libre de tout cet appareil de cérémonies et de pratiques qui les avait empêchés de devenir complètement juifs. Enfin il ne rencontrait point en eux cette opposition jalouse, nourrie par les préjugés et l'orgueil national, qui éloignait tant d'Israélites du véritable Messie, et les retenait loin du royaume spirituel de Dieu, parce que pour eux, ce royaume était déjà complètement réalisé au sein du peuple d'Israël. Aussi, les ouvriers apostoliques trouvèrent-ils en général un facile accueil auprès de cette classe de prosélytes libres ; l'histoire de l'Église primitive nous les montre comme les adhérents naturels de l'Evangile, et son témoignage semble confirmé par les sentences de réprobation dont les rabbins juifs, postérieurs à Jésus-Christ, ont poursuivi les prosélytesg, ces faciles déserteurs d'une religion qu'ils n'avaient en quelque sorte prise qu'à l'essai.
C'est dans cette classe de personnes préparées pour le christianisme que Paul trouve à Philippes une femme qui prêta l'oreille à ses paroles. Elle fit attention aux choses que disait l'apôtre, et Dieu, qui toujours intervient dans l'œuvre religieuse, agissant sur elle (Act.16.14), elle saisit avec ardeur ce que Paul racontait du Christ Fils de Dieu, de l'amour du Père céleste pour les hommes, du salut procuré par Jésus, de la vie éternelle offerte à tous. Sa conscience réveillée par l'apôtre, sanctionnait tout ce qu'il déclarait touchant la sainteté et la grandeur de l'Éternel ; et en même temps son cœur accueillait avec joie l'annonce du pardon, de l'intimité rendue possible entre l'homme et son Dieu. Une sympathie inconnue unissait Paul à cette femme qu'il voyait pour la première fois ; ses paroles étaient pour elle comme autant de réponses à des questions qu'elle ne lui avait point faites, que peut-être elle ne s'était jamais formellement adressées à elle-même, et dont pourtant elle désirait la solution. Les intérêts les plus sérieux de l'humanité, les vérités les plus hautes, les relations les plus sublimes, les grandeurs les plus inouïes, les miséricordes les plus immenses, voilà ce qui occupe ces deux êtres étrangers jusque-là l'un à l'autre ; car il est impossible de parler de l'Évangile du salut, sans toucher à toutes ces sommités de la vie religieuse. Et ces deux êtres s'entendent et se comprennent, et ils s'entretiennent sans difficulté de sujets sur lesquels l'école dispute sans arriver à rien : c'est que pour eux il s'agit de faits, tandis que la philosophie, lorsqu'elle aborde ces hauteurs, n'y trouve que ses propres abstractions. Sur ce dernier terrain, l'homme simple s'égare, il se sent ferme sur le premier ; l'apôtre n'était compris de son interlocutrice que parce que, se tenant avec elle dans le domaine des réalités, il lui montrait entre l'histoire divine, dont il était le narrateur, et l'histoire intime de son propre cœur, dont elle-même connaissait bien les traits, une merveilleuse harmonie. Alors, comme toujours, la vraie grandeur de l'Évangile se montrait en ceci, que ce qu'il renferme de plus élevé est encore ce qu'il offre de plus simple, et que ses vérités les plus importantes sont précisément les plus universellement comprises.
L'historien des Actes nous apprend que cette femme, qui la première sur le sol européen accueillit avec bonheur la prédication de Paul, était étrangère à la ville de Philippes où des intérêts de commerce l'avaient conduite. Son nom était Lydie, sa ville natale Thyatire dans l'Asie proconsulaireh, son négoce, la vente de sa pourprei, soit que par ce dernier mot il faille entendre la matière première destinée à teindre les étoffes en rouge, ou plutôt les étoffes mêmes ainsi préparées. Ce genre de commerce semble prouver que la ville de Philippes possédait une population riche, et accoutumée au luxe et au bien-être. En effet l'usage de la pourpre est signalé par les auteurs anciens comme le propre de l'élégance et de la richessej, et il est probable que c'était l'espoir d'un avantageux débit qui avait occasionné le déplacement de Lydie et celui de toute sa maison ; d'autant plus que ce déplacement paraît n'avoir eu lieu qu'à une époque déjà avancée de la vie de Lydie, sans cela il n'eût probablement pas été relaté. Déjà dans Thyatire avaient pu prendre naissance les relations qui unissaient cette femme aux juifsk, et qui, fondées sur le désir de satisfaire ses besoins religieux, s'étaient poursuivies dans Philippes.
Une des preuves les plus manifestes de la sincérité de son sentiment pieux, et de son attachement pour tout ce qui pouvait le développer, c'est le désir qu'elle éprouve, après avoir entendu l'apôtre Paul, de le faire entendre également à tous ceux de sa maison, afin que comme elle et avec elle ils entrent dans l'économie nouvelle par le baptême (Act.16.15). On ne peut admettre en effet que cette cérémonie, à laquelle furent effectivement admis tous les gens de la famille de Lydie, ait été accomplie sans que ceux-ci eussent été auparavant instruits de sa signification et de son but. D'un autre côté le récit de l'auteur des Actes semble indiquer que cette instruction fut bien brève et bien imparfaite, et que l'adhésion des personnes qui composaient la maison de Lydie eut à peine le temps de devenir une volonté réfléchie. C'est que le baptême n'était autre chose pour les apôtres que le signe extérieur de dispositions présumées, qu'une sorte d'enrôlement de fait sous les bannières de Christ, un symbole accordé immédiatement sur le simple désir, ou même du consentement tacite d'un individu animé d'un premier mouvement de foi. De là ces baptêmes en masse, ces maisons entières baptisées à la fois, afin, sans doute, d'inspirer à ceux qui étaient l'objet de cet acte symbolique l'idée d'un engagement pris envers eux-mêmes et envers Dieu, et de sanctionner ainsi d'une manière visible l'obligation qu'ils contractaient de devenir chrétiens.
A peine Lydie a-t-elle reçu, ainsi que les siens, le baptême des apôtres, qu'elle insiste auprès de ces derniers, pour qu'abandonnant le logis mercenaire qu'ils occupent dans Philippes, ils viennent habiter l'intérieur de sa maison et y goûter les douceurs de l'hospitalité chrétienne. Elle s'autorise, pour presser Paul et ses compagnons d'œuvre, de la fraternité qui désormais l'unit à eux, et de la communauté de leur foi : Si vous m'avez cru fidèle au Seigneur, leur dit-elle, entrez dans ma maison et demeurez-y (Act.16.16). C'est au nom de cette harmonie de convictions qu'elle fait violence aux apôtres, et qu'elle cherche à vaincre la résistance de Paul qui désirait éviter d'être à charge aux fidèles, afin que la malveillance ne tournât pas contre lui et contre l'Évangile les avantages qu'il retirerait des nouveaux convertisl. Mais les instances de Lydie furent si fortes et si sincères, que les apôtres cédèrent à ses demandes, et s'établirent dans sa maison qui devint ainsi comme le premier sanctuaire de l'Église de Philippes, comme le centre où vinrent se grouper successivement tous ceux qui, dans cette ville, se donnèrent à Jésus-Christ. Rassemblée à son origine sous le toit hospitalier de Lydie, cette Église paraît y avoir puisé ce sentiment d'intime affection pour l'apôtre Paul dont elle fut animée plus que toute autre communauté chrétienne ; l'amour fraternel sous les auspices duquel Paul était entré dans la demeure de Lydie, se perpétua chez tous ceux qui vinrent grossir autour de cette première famille chrétienne, le faisceau de la foi, et ce que l'Église avait été dans son germe, elle le fut dans ses développements ; dès le début jusqu'à la fin, l'apôtre put en appeler les membres, ses chers et bien-aimés Philippiens.
On ignore quelle fut la durée du séjour de Paul et de ses compagnons d'œuvre dans la ville de Philippes ; il ne put se prolonger pendant plusieurs moism, mais on ne doit pas non plus le restreindre à un petit nombre de jours. Dans le récit des Actes il y a évidemment un temps d'arrêt et une lacune entre le passage qui concerne Lydie, et la narration qui suit immédiatement. Celle-ci renferme en effet un ensemble d'événements continus, survenus dans l'espace de deux ou trois jours et terminés par le départ de Paul. Mais en même temps elle contient diverses indications qui montrent que l'apôtre était déjà demeuré un certain temps dans Philippes, lorsque arriva la conjoncture qui l'en fit sortir. Ainsi il est question d'une femme qui, pendant plusieurs jours (ἐπὶ πολλὰς ἡμεράς), suivit les apôtres (Act.16.17-18) ; il est question des effets produits sur la population par les prédications de Paul et de l'opinion qu'on en avait conçue (Act.16.20-21) ; il est question enfin des frères, ce qui semble indiquer un certain nombre de convertis (Act.16.40). Tous ces faits supposent un espace de temps de quelque étendue, et qui ne peut s'être écoulé qu'après la conversion de Lydie et avant l'emprisonnement de Paul. Que se passa-t-il durant cet intervalle ?
Il est évident que l'apôtre, qui s'était rendu en Macédoine dans le but exprès d'y annoncer l'Évangile, ne demeura pas inactif, et ne perdit pas de vue le motif de son voyage, l'œuvre de sa vie. Il dut profiter d'abord des relations que la femme chez laquelle il demeurait soutenait avec les habitants de la ville, soit pour converser directement avec ceux qui fréquentaient sa demeure, soit pour agir par son entremise sur ceux avec lesquels son commerce la mettait en rapport, et que l'apôtre pouvait, comme à Éphèse, visiter dans leurs maisons (ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι καὶ κατ' οἴκουςAct.20.20). Peut-être l'intermédiaire de cette femme ne lui fut-il pas inutile pour faire pénétrer la Parole de Dieu jusque auprès des personnes de son sexen. Paul dut ensuite continuer, et il continua, en effet, ses courses à la Proseuchè (Act.16.16), où ses exhortations répétées trouvèrent probablement plus de faveur qu'au premier jour. Il dut enfin mettre en usage cette publicité, non de la lettre, mais de la parole, qui était un moyen prompt et facile de propager les opinions comme les nouvelles, et qui formait, on le sait, chez les populations gréco-romaines, un des éléments principaux de la vie publique. L'agora, dans laquelle se rencontraient par habitude ou par curiosité, par intérêt ou par désœuvrement, les habitants des villes helléniques, était pour eux, si l'on peut ainsi dire, le rendez-vous de toutes les pensées ou sérieuses ou frivoles, ou graves ou légères, et elle représentait en action ce que la presse périodique de nos jours stéréotype sur ses feuilles quotidiennes. Cette publicité orale fut souvent mise en usage par Paul pour propager la vérité évangélique (Act.13.7,11 ; 20.20), et il est très probable qu'à Philippes comme dans Athènes (Actes.17.17), il discourait chaque jour sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Par ces divers modes de rapprochement Paul se trouvait en présence des juifs et des païens.
Mais les premiers, comme nous l'avons vu, et comme l'absence de toute opposition de leur part le confirme, étaient peu nombreux dans Philippes ; la grande majorité des auditeurs de Paul fut nécessairement composée de païens, puisque l'Église de cette ville, ainsi qu'on doit le conclure d'après la lettre que Paul lui adressa, ne renfermait guère que des membres sortis de leur sein. Aussi, dans Philippes plus qu'ailleurs, Paul apparaît comme l'apôtre des gentils, et si l'on rapproche de ce fait le zèle tout particulier dont cette Église fit preuve entre toutes les autres, on se trouve naturellement conduit à rechercher à son sujet quels rapports devaient exister entre Paul, missionnaire chrétien, et les sectateurs du paganisme ; en d'autres termes, quelles dispositions favorables pouvait rencontrer chez les païens, lorsqu'il leur annonçait l'Évangile, l'apôtre de Jésus-Christ ?
Mais, de même que nous sommes naturellement conduits à cette recherche par la position qu'occupa parmi les communautés apostoliques l'Église de Philippes, de même nous voulons régler notre examen d'après le rôle que jouait dans l'Europe païenne une ville comme Philippes. Envisagée sous ce rapport, cette cité s'offre à nous comme étant du nombre de celles qui, mieux que d'autres, devaient reproduire la physionomie générale de cette civilisation d'Occident, en présence de laquelle se trouvait Paul depuis qu'il avait touché le sol européen. En effet, cette ville grecque repeuplée de Romains, est comme le symbole de l'état social de l'Occident à cette époque ; elle renferme dans son unité politique le double élément qui se retrouve plus ou moins distinct, plus ou moins confondu, dans la vie du monde romain sous les premiers empereurs. Nous sommes donc en droit de présumer chez sa population l'existence des dispositions morales et des idées religieuses que nous révèle l'examen de la société païenne en Europe, et nous pouvons conclure ici du général au particulier. Car il ne faut pas oublier que cette société est représentée dans Philippes d'une manière tout à fait générale, en ce sens que cette ville ne possède point une population qui se distingue par des qualités exceptionnelles ; elle n'a pas comme Corinthe, ou comme Athènes, un caractère propre ; elle forme au contraire un de ces nombreux centres sociaux sans couleur tranchée, qui se confondent dans l'ensemble de la civilisation à laquelle ils appartiennent, et en reproduisent les traits principaux. Des détails historiques qui nous ont été transmis sur la ville de Philippes, aucun ne montre qu'elle fût le théâtre d'un développement intellectuel relevé, et dans ses murs Paul dut se trouver en face d'une réunion d'hommes ordinaires enfermés dans la sphère peu étendue de la vie habituelle ; il y eut à faire à l'esprit des masses plus qu'à des intelligences particulièrement développées. Dès lors nous devons rechercher quelles étaient les prédispositions possibles du grand nombre en faveur de l'Évangile plutôt qu'étudier, sous ce rapport, les sommités intelligentes ; ce qui ne veut nullement dire qu'il faille exclure de cette classe, composée de ceux qu'on appelle tout le monde, la culture intellectuelle. Seulement, il faut, pour être fidèle aux données de l'histoire, nous en tenir dans notre examen, aux traits qui peuvent s'appliquer à tous, et ne consulter pour nos déductions que l'esprit général du paganisme populaire, dans le sens relevé de ce terme.
Du reste, nous ne prétendons à autre chose qu'à esquisser les traits principaux d'un sujet qui demanderait pour être complètement épuisé, beaucoup de conditions dont nous ne disposons pas. Nous désirons donc que l'on ne cherche ici qu'un aperçu général de la question telle que nous l'avons présentée, et l'on comprend d'ailleurs que dans cette Introduction on ne doit pas s'attendre à trouver davantage.
Parmi les ouvrages où les rapports entre le paganisme et la foi chrétienne sont envisagés au point de vue historique ou philosophique, nous citerons les plus remarquables d'entre ceux que nous avons lus ; en faisant observer qu'ils examinent la question d'une manière très diverse, et qui diffère également de l'étude spéciale et restreinte à laquelle nous nous sommes borné.
Ces ouvrages sont, sans parler de ce qui se rencontre d'analogue chez les Pères de l'Église, celui de Huet, Alnetanæ quæstiones (1690), riche en faits de détail, mais dépourvu de critique, ce qu'il faut dire aussi de Cudworth, The true intellectuel system (1678), qui a été rectifié par Mosheim son traducteur (1733), et de La Mennais, Essai sur l'indifférence, etc. (1823), qui a réuni pêle-mêle, dans le but de démontrer la perpétuité du consentement universel, les analogies vraies ou fausses du paganisme avec les principaux dogmes révélés. Parmi les auteurs allemands j'indiquerai Baur, Symbolik und Mythologie (1825) ; ce livre renferme l'exposition des religions païennes, ramenées à un ensemble harmonique par l'intermédiaire de la philosophie, et comparées sous ce rapport au christianisme ; Tholuck, dans Neander's Denkwürdigkeiten, I (1825), a exposé, du point de vue chrétien, l'état intérieur du paganisme classique ; Tzschirner, Der Fall der Heidenthums (1829), a donné deux chapitres pleins d'intérêt, relatifs à l'antithèse historique du paganisme et de la religion du Christ ; Ackermann, Das Christliche im Plato (1835), présente à propos de Platon une foule d'aperçus ingénieux ou profonds, sur les analogies réelles et apparentes qui existent, quant à la pensée religieuse, entre les anciens et l'Evangile ; Bötticher, Das Christliche im Tacitus (1840), envisage l'histoire dans ses rapports avec la manifestation du fait chrétien, et offre de nombreux rapprochements entre le monde païen et l'œuvre accomplie par Jésus-Christ.
Si, partant des principes historiques que nous avons posés, nous recherchons en fait quelles pouvaient être, sous le point de vue religieux, les relations qui s'établissaient au premier moment entre l'apôtre et ses auditeurs païens, nous avons à constater d'abord les éléments fondamentaux de la prédication de Paul, lorsqu'elle s'adressait et des hommes jusque-là sans rapports avec l'Évangile, et ensuite à reconnaître quel était l'état intérieur de ces âmes que l'apôtre venait convertir. A ce double égard, c'est Paul lui-même qui va, avant tout, nous servir de guide. En s'adressant aux membres de la société païenne, Paul ramenait, au début, tout son enseignement à deux idées générales, ou plutôt à deux faits universels : l'un, c'était l'existence d'un Dieu unique, tout-parfait, en rapport avec tous les hommes ; l'autre, c'était la réalisation du salut, c'est-à-dire l'établissement de relations nouvelles surnaturellement créées entre l'humanité déchue et son Créateur miséricordieux. Aux juifs, Paul parlait d'un Dieu qui était leur Dieu, et d'un Rédempteur qui était leur Messie ; aux païens, il parlait d'un Dieu qui pour eux était inconnu ou vaguement pressenti, et d'un Sauveur qui était le Fils de Dieu. Cette double base une fois posée, Paul construisait l'édifice chrétien s'il trouvait chez son auditeur le correspondant de ces deux principes : d'un côté, la foi en Dieu, que devait accompagner la repentance ; de l'autre, le sentiment de la nécessité du salut par le Fils de Dieu, Jésus-Christ ; en d'autres termes, la foi au Sauveuro. L'apôtre ne suivit pas à Philippes une méthode différente, et la manière dont il y annonça l'Evangile, confirme les observations que nous venons de présenter (Act.16.17,30,31,34).
Mais cette prédication de Paul, pour trouver quelque accès dans les âmes, devait rencontrer en elles des prédispositions favorables ; car l'Évangile ne s'impose pas, il est accepté. Il faut, ce nous semble, distinguer sous ce rapport chez les auditeurs païens de l'apôtre un double élément préparatoire : celui qui leur appartenait comme hommes, et celui qui résultait de leur nationalité. D'une part, le fond commun de la race ; de l'autre, les modifications accidentelles provenant des localités, des traditions, des croyances, des mœurs, des événements, en un mot, de la civilisation, soit particulière, soit générale, de leur pays et de leur époque.
Les dispositions favorables à l'acceptation de la religion chrétienne, telles qu'on peut en admettre l'existence chez les païens auxquels Paul portait la parole, doivent être d'abord recherchées dans la constitution morale et religieuse de l'humanité. C'est là que l'apôtre dut trouver, pour sa prédication et ses entretiens familiers, les divers points d'attache par lesquels le christianisme s'unit à l'âme, et comme les brèches au travers desquelles il pénètre dans l'intérieur de l'homme. Paul connaissait trop bien la race humaine pour ne pas discerner les traits qui font d'elle une race religieuse (Act.17.27), et pour ne pas porter immédiatement l'attaque sur les points par lesquels l'âme est accessible à l'influence de l'Évangile. On se représente en général les populations païennes, au milieu desquelles apparaissaient pour la première fois les prédicateurs apostoliques, comme tellement déshéritées de toute vie spirituelle, qu'elles étaient pour ainsi dire table rase, en fait de sentiments religieux, ou plutôt, comme tellement enveloppées par les absurdités de leurs cultes, qu'elles étaient en quelque sorte pétrifiées dans les habitudes d'un matérialisme aussi grossier, que leur mythologie était immorale.
Nous pensons, au contraire, que bien souvent les païens valaient mieux que leurs divinités, par la raison que celles-ci ils les avaient faites à leur image, tandis qu'eux-mêmes appartenaient à une race jadis formée à l'image de Dieu. Cette image divine, quelque effacée qu'elle fût en eux, n'était qu'oblitérée et non détruite ; les tendances du principe religieux étaient perverties, elles n'étaient pas disparues ; l'affinité divine, sans laquelle aucune religion ne peut ni se concevoir ni exister, s'était égarée, elle n'avait pas cessé d'être. Ils étaient toujours hommes, et à ce titre ils devaient comprendre l'apôtre qui leur parlait de Dieu, qui portait leurs regards vers l'avenir, qui les faisait réfléchir sur les mystères de l'existence, source intarissable et infinie des inquiétudes de l'âme, ou sur les appels non moins mystérieux de la conscience, source toujours féconde du malaise intérieur. Paul se mettait aux prises avec la vie réelle, journalière, avec la vie de tout le monde, et il profitait du trouble des uns, des souffrances, du mécontentement des autres, pour réveiller eu eux l'instinct de l'espérance, le désir du repos, le besoin de la certitude, et pour leur faire trouver la satisfaction de ces exigences de l'âme, ainsi ranimées dans la foi en Dieu, dispensateur des grâces, dans l'union avec Christ, principe de la vie éternelle, donateur du pardon et de la véritable paix.
Tantôt il rattachait ses instructions au spectacle des choses humaines ou de la nature, dans lequel il faisait voir les signes de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu ; il rétablissait ainsi les rapports entre la créature intelligente et son Créateur, puis il élevait sur cette base l'édifice religieux du christianisme (Act.14.15-17 ; 17.22-31 ; Rom.1.19-20). Ailleurs il évoquait le sentiment moral blessé par une conduite coupable ; il s'emparait du remords et du malaise de la conscience, et s'en servait comme d'auxiliaires pour convaincre le pécheur de la justice redoutable de Dieu (Act.24.25 ; Rom.1.32). S'il rencontrait des âmes désireuses des choses célestes sans les connaître, convoitant un monde meilleur sans le comprendre, et témoignant que la loi de Dieu était écrite dans leur cœur Rom.2.15), il avait pour elles un langage sympathique, il leur parlait de vie éternelle, d'Esprit saint répandu, de communion spirituelle avec Dieu, il répondait à leurs pressentiments, et il donnait, à ce qui n'était pour elles qu'un peut-être, la sanction de la vérité (Act.13.42,46-48). Se faisant tout à tous (1Cor.9.22), il appropriait ses exhortations et son langage aux dispositions particulières de chacun : Je me dois, disait-il, aux Grecs et aux Barbares, aux savants et aux ignorants (Rom.1.14).
Les chemins divers que prennent les destinées humaines, il savait s'y engager, parce que toujours il démêlait, sous des apparences souvent opposées, le principe divin que recèle l'âme humaine. Il discernait, au travers des voiles dont s'enveloppent les différentes existences, ce sentiment inhérent au cœur de l'homme, indestructible débris d'une origine céleste, qui se cache au fond des consciences, qui s'obscurcit, qui se trouble ; mais qui ne perd jamais la faculté de revivre et de se transformer. Ce fut par ce côté de la vie intérieure que Paul attaqua les âmes et les amena, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à la régénération chrétienne. Eveillant, par des moyens divers, le sentiment qui seul rend l'humanité susceptible d'être religieuse, celui de sa parenté avec Dieu (Act.17.28 ; Eph.3.15) ; s'adressant par un langage, varié selon les circonstances de chacun, à un principe qui est le même chez tous, l'apôtre poursuivait toujours un seul et unique but : le salut des âmes en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ crucifié (1Cor.9.22 ; 2.2 ; 15.3,23). C'est lui qui nous a raconté tout le secret de ses conquêtes. La méthode qu'il suivait pour amener les païens à l'Évangile, nous est dévoilée tout à la fois par ses propres déclarations et par sa propre histoire. Il n'a fait appel aux instincts de l'humanité que parce qu'il croyait qu'il existe en elle un élément naturellement accessible à la vérité divine ; il eût agi tout autrement s'il eût pensé que rien dans les païens ne s'émouvrait à sa voix ; il savait que ceux qui pouvaient comprendre le Dieu de la nature (Rom.1.19-20), pouvaient comprendre aussi le Dieu de la grâce, il savait que ceux qui pouvaient souffrir de la conscience de leurs péchés (Rom.2.9-16), pouvaient accueillir avec joie les assurances d'un grand salut.
Ainsi, à ne prendre pour guide de notre recherche sur les rapports entre Paul et ses auditeurs païens que Paul lui-même, auquel on ne refusera pas sans doute le droit de juger en pareille matière, nous devons, d'après sa conduite et ses déclarations, reconnaître qu'il trouvait les membres de la gentilité préparés à accueillir le christianisme. Croyons en l'apôtre, aussi bon observateur des faits moraux que tout autre scrutateur du cœur humain : l'homme n'a jamais perdu, comme espèce, ni la notion de Dieu, ni le sentiment du mal. Il a pu les étouffer comme individu ; et ce dernier fait explique pourquoi Paul a rencontré parmi les païens de son temps d'insurmontables oppositions contre l'Evangile. Mais nous faisons ici l'étude des auxiliaires et non des antagonistes que la prédication apostolique pouvait trouver dans les âmes ; c'est de ses triomphes, non de ses revers que nous voulons nous enquérir. Or il est impossible de ne pas voir une de ses causes de succès, (cause incomplète sans doute, mais indispensable,) dans les germes religieux naturellement plantés au fond des âmesp, et dans les dispositions intérieures qui préparaient le cœur, cette source de la vie, à accepter avec reconnaissance la bonne nouvelle du salut. Ce que l'apôtre nous a laissé entrevoir sur l'existence de ces prédispositions parmi ses auditeurs, se confirme par l'étude des témoignages que présente sur son propre compte le monde païen d'Occident.





























