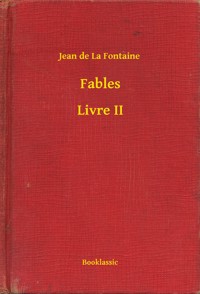Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
On connaît ses célèbres fables mais peu ont goûté aux contes érotiques de l'auteur.
Les portraits sont dignes de Saint Simon, avec en plus ce frivole humour qui conte avec finesse les déboires et aventures d'Amour, ce libertin lâché dans les jupes des filles.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean de La Fontaine était un écrivain français du XVIIe siècle. Il a écrit "les célèbres Fables", hérédité de la tradition orale et du fabuliste grec Ésope. Il a fait preuve d’une grande maîtrise de la langue française et de la poésie. Il fut aussi l’auteur de contes, de nouvelles, de poèmes, de comédies, d’épitres et de discours. Ces œuvres ne lui ont pas toujours valu admiration et amitiés.
Écrivain et poète légèrement libertin, il accèdera au fauteuil de l’Académie française, sa plus chère ambition, à la fin de sa vie. Mais il devra renier ses premiers contes et sera ainsi « en règle » avec Dieu !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean de la FONTAINE
contes (érotiques)
JOCONDE
Jadis régnait en Lombardie
Un prince aussi beau que le jour,
Et tel que des beautés qui régnaient à sa cour
La moitié lui portait envie,
L’autre moitié brûlait pour lui d’amour.
Un jour en se mirant : « Je fais, dit-il, gageure
Qu’il n’est mortel dans la nature
Qui me soit égal en appas,
Et gage, si l’on veut, la meilleure province
De mes Etats;
Et, s’il s’en rencontre un, je promets, foi de prince,
De le traiter si bien qu’il ne s’en plaindra pas. »
A ce propos s’avance un certain gentilhomme
D’auprès de Rome.
« Sire, dit-il, si Votre Majesté
Est curieuse de beauté,
Qu’elle fasse venir mon frère ; Aux plus charmants il n’en doit guère :
Je m’y connais un peu, soit dit sans vanité.
Toutefois, en cela pouvant m’être flatté,
Que je n’en sois pas cru, mais les cœurs de vos dames ;
Du soin de guérir leurs flammes
Il vous soulagera, si vous le trouvez bon :
Car de pourvoir vous seul au tourment de chacune,
Outre que tant d’amour vous serait importune,
Vous n’auriez jamais fait ; il vous faut un second. »
Là-dessus Astolphe répond
(C’est ainsi qu’on nommait ce roi de Lombardie)
« Votre discours me donne une terrible envie
De connaître ce frère : amenez-le-nous donc.
Voyons si nos beautés en seront amoureuses,
Si ses appas le mettront en crédit :
Nous en croirons les connaisseuses,
Comme très bien vous avez dit. »
Le gentilhomme part, et va quérir Joconde :
C’est le nom que ce frère avait.
A la campagne il vivait,
Loin du commerce et du monde
Marié depuis peu ; content, je n’en sais rien.
Sa femme avait de la jeunesse,
De la beauté, de la délicatesse ;
Il ne tenait qu’à lui qu’il ne s’en trouvât bien.
Son frère arrive, et lui fait l’ambassade ;
Enfin il le persuade.
Joconde d’une part regardait l’amitié
D’un roi puissant, et d’ailleurs fort aimable ;
Et d’autre part aussi sa charmante moitié
Triomphait d’être inconsolable,
Et de lui faire des adieux
A tirer les larmes des yeux.
« Quoi ! tu me quittes ! disait-elle.
As-tu bien l’âme assez cruelle
Pour préférer à ma constante amour
Les faveurs de la cour ?
Tu sais qu’à peine elles durent un jour,
Qu’on les conserve avec inquiétude,
Pour les perdre avec désespoir.
Si tu te lasses de me voir,
Songe au moins qu’en ta solitude
Le repos règne jour et nuit ;
Que les ruisseaux n’y font du bruit
Qu’afin de t’inviter à fermer la paupière.
Crois-moi, ne quitte point les hôtes de tes bois,
Ces fertiles vallons, ces ombrages si cois,
Enfin moi, qui devrais me nommer la première.
Mais ce n’est plus le temps, tu ris de mon amour.
Va, cruel, va montrer ta beauté singulière ;
Je mourrai, je l’espère, avant la fin du jour. »
L’histoire ne dit point ni de quelle manière
Joconde put partir, ni ce qu’il répondit,
Ni ce qu’il fit, ni ce qu’il dit ;
Je m’en tais donc aussi, de crainte de pis faire.
Disons que la douleur l’empêcha de parler :
C’est un fort bon moyen de se tirer d’affaire.
Sa femme le voyant tout prêt de s’en aller,
L’accable de baisers, et pour comble lui donne
Un bracelet de façon fort mignonne,
En lui disant : « Ne le perds pas,
Et qu’il soit toujours à ton bras,
Pour te ressouvenir de mon amour extrême
Il est de mes cheveux, je l’ai tissu moi-même ;
Et voilà de plus mon portrait
Que j’attache à ce bracelet. »
Vous autres bonnes gens eussiez cru que la dame
Une heure après eût rendu l’âme ;
Moi qui sais ce que c’est que l’esprit d’une femme,
Je m’en serais à bon droit défié.
Joconde partit donc ; mais, ayant oublié
Le bracelet et la peinture
Par je ne sais quelle aventure,
Le matin même il s’en souvient.
Au grand galop sur ses pas il revient,
Ne sachant quelle excuse il ferait à sa femme.
Sans rencontrer personne et sans être entendu,
Il monte dans sa chambre, et voit près de la dame
Un lourdaud de valet sur son sein étendu.
Tous deux dormaient.
Dans cet abord, Joconde
Voulut les envoyer dormir en l’autre monde ;
Mais cependant il n’en fit rien,
Et mon avis est qu’il fit bien.
Le moins de bruit que l’on peut faire,
En telle affaire,
Est le plus sûr de la moitié.
Soit par prudence, ou par pitié,
Le Romain ne tua personne.
D'éveiller les amants, il ne le fallait pas :
Car son honneur l’obligeait, en ce cas,
De leur donner le trépas.
« Vis, méchante, dit-il tout bas ;
A ton remords je t’abandonne. »
Joconde la-dessus, se remet en chemin,
Rêvant à son malheur tout le long du voyage.
Bien souvent il s’écrie au fort de son chagrin
« Encor si c’était un blondin !
Je me consolerais d’un si sensible outrage ;
Mais un gros lourdaud de valet !
C’est à quoi j’ai plus de regret ;
Plus j’y pense, et plus j’en enrage.
Ou l'amour est aveugle, ou bien il n’est pas sage
D’avoir assemblé ces amants.
Ce sont, hélas ! ses divertissements ;
Et possible est-ce par gageure
Qu’il a causé cette aventure. »
Le souvenir fâcheux d’un si perfide tour
Altérait fort la beauté de Joconde ;
Ce n’était plus ce miracle d’amour
Qui devait charmer tout le monde.
Les dames, le voyant arriver à la cour,
Dirent d’abord : « Est-ce là ce Narcisse
Qui prétendait tous nos cœurs enchaîner ?
Quoi ! le pauvre homme a la jaunisse !
Ce n’est pas pour nous la donner.
A quel propos nous amener
Un galant qui vient de jeûner
La quarantaine?
On se fût bien passé de prendre tant de peine. »
Astolphe était ravi ; le frère était confus,
Et ne savait que penser là-dessus,
Car Joconde cachait avec un soin extrême
La cause de son ennui.
On remarquait pourtant en lui,
Malgré ses yeux caves et son visage blême,
De fort beaux traits, mais qui ne plaisaient point,
Faute d’éclat et d’embonpoint.
Amour en eut pitié ; d’ailleurs cette tristesse
Faisait perdre à ce dieu trop d’encens et de vœux
L’un des plus grands suppôts de l’empire amoureux
Consumait en regrets la fleur de sa jeunesse.
Le Romain se vit donc à la fin soulagé
Par le même pouvoir qui l’avait affligé
Car un jour, étant seul en une galerie,
Lieu solitaire et tenu fort secret,
Il entendit en certain cabinet,
Dont la cloison n’était que de menuiserie
Le propre discours que voici :
« Mon cher Curtade, mon souci,
J’ai beau t’aimer, tu n’es pour moi que glace ;
Je ne vois pourtant, Dieu merci,
Pas une beauté qui m’efface :
Cent conquérants voudraient avoir ta place
Et tu sembles la mépriser,
Aimant beaucoup mieux t’amuser
A jouer avec quelque page
Au lansquenet
Que me venir trouver seule en ce cabinet.
Dorimène tantôt t’en a fait le message ;
Tu t’es mis contre elle à jurer,
A la maudire, à murmurer,
Et n'as quitté le jeu que ta main étant faite,
Sans te mettre en souci de ce que je souhaite. »
Qui fut bien étonné ? ce fut notre Romain.
Je donnerais jusqu’à demain
Pour deviner qui tenait ce langage,
Et quel était le personnage
Qui gardait tant son quant à moi
Ce bel Adon était le nain du roi,
Et son amante était la reine.
Le Romain, sans beaucoup de peine,
Les vit, en approchant les yeux
Des fentes que le bois laissait en divers lieux.
Ces amants se fiaient au soin de Dorimène ;
Seule elle avait toujours la clef de ce lieu-là ;
Mais, la laissant tomber, Joconde la trouva,
Puis s’en servit, puis en tira
Consolation non petite :
Car voici comme il raisonna
« Je ne suis pas le seul, et, puisque même on quitte
Un prince si charmant pour un nain contrefait,
Il ne faut pas que je m’irrite
D’être quitté pour un valet. »
Ce penser le console : il reprend tous ses charmes ;
Il devient plus beau que jamais.
Telle pour lui verse des larmes
Qui se moquait de ses attraits.
C'est à qui l’aimera : la plus prude s’en pique ;
Astolphe y perd mainte pratique.
Cela n’en fut que mieux : il en avait assez.
Retournons... aux amants que nous avons laissés.
Après avoir tout vu, le Romain se retire,
Bien empêché de ce secret :
Il ne faut à la cour ni trop voir, ni trop dire,
Et peu se sont vantés du don qu’on leur a fait
Pour une semblable nouvelle.
Mais quoi ! Joconde aimait avecque trop de zèle
Un prince libéral qui le favorisait
Pour ne pas l’avertir du tort qu’on lui faisait.
Or, comme avec les rois il faut plus de mystère
Qu’avecque d’autres gens sans doute il n’en faudrait,
Et que de but en blanc leur parler d’une affaire
Dont le discours leur doit déplaire,
Ce serait être adroit ;
Pour adoucir la chose, il fallut que Joconde,
Depuis l’origine du monde,
Fît un dénombrement des rois et des césars
Qui, sujets comme nous à ces communs hasards,
Malgré les soins dont leur grandeur se pique,
Avaient vu leurs femmes tomber
En telle ou semblable pratique,
Et l’avaient vu sans succomber
A la douleur, sans se mettre en colère,
Et sans en faire pire chère.
« Moi qui vous parle, Sire, ajouta le Romain,
Le jour que pour vous voir je me mis en chemin,
Je fus forcé par mon destin
De reconnaître cocuage
Pour un des dieux du mariage,
Et, comme tel, de lui sacrifier. »
Là-dessus il conta, sans en rien oublier,
Toute sa déconvenue.
Puis vint à celle du roi.
« Je vous tiens, dit Astolphe, homme digne de foi ;
Mais la chose, pour être crue,
Mérite bien d’être vue :
Menez-moi donc sur les lieux. »
Cela fut fait, et de ses propres yeux Astolphe vit des merveilles,
Comme il en entendit de ses propres oreilles.
L’énormité du fait le rendit si confus
Que d’abord tous ses sens demeurèrent perclus ;
Il fut comme accablé de ce cruel outrage.
Mais bientôt il le prit en homme de courage,
En galant homme, et, pour le faire court ;
En véritable homme de cour.
« Nos femmes, se dit-il, nous en ont donné d’une.
Nous voici lâchement trahis :
Vengeons-nous-en, et courons le pays,
Cherchons partout notre fortune.
Pour réussir en ce dessein,
Nous changerons nos noms, je laisserai mon train,
Je me dirai votre cousin
Et vous ne me rendrez aucune déférence :
Nous en ferons l’amour avec plus d’assurance,
Plus de plaisir, plus de commodité,
Que si j’étais suivi selon ma qualité. »
Joconde approuva fort le dessein du voyage.
« Il nous faut dans notre équipage,
Continua le prince, avoir un livre blanc,
Pour mettre les noms de celles
Qui ne seront pas rebelles,
Chacune selon son rang.
Je consens de perdre la vie,
Si, devant que sortir des confins d’Italie,
Tout notre livre ne s’emplit,
Et si la plus sévère à nos vœux ne se range :
Nous sommes beaux ; nous avons de l’esprit ;
Avec cela bonnes lettres de change ;
Il faudrait être bien étrange
Pour résister à tant d’appas,
Et ne pas tomber dans les lacs
De gens qui sèmeront l’argent et la fleurette,
Et dont la personne est bien faite. »
Leur bagage étant prêt, et le livre surtout,
Nos galants se mettent en voie. Je ne viendrais jamais à bout
De nombrer les faveurs que l’amour leur envole
Nouveaux objets, nouvelle proie,
Heureuses les beautés qui s’offrent à leurs yeux !
Et plus heureuse encor celle qui peut leur plaire !
Il n’est, en la plupart des lieux,
Femme d’échevin ni de maire,
De podestat, de gouverneur,
Qui ne tienne à fort grand honneur
D’avoir en leur registre place.
Les cœurs que l’on croyait de glace
Se fondent tous à leur abord.
J’entends déjà maint esprit fort
M’objecter que la vraisemblance
N'est pas en ceci tout à fait,
Car, dira-t-on, quelque parfait
Que puisse être un galant dedans cette science,
Encor faut-il du temps pour mettre un cœur à bien.
S’il en faut, je n’en sais rien ;
Ce n’est pas mon métier de cajoler personne
Je le rends comme on me le donne,
Et l’Arioste ne ment pas.
Si l’on voulait à chaque pas
Arrêter un conteur d’histoire,
Il n’aurait jamais fait ; suffit qu’en pareil cas
Je promets à ces gens quelque jour de les croire.
Quand nos aventuriers eurent goûté de tout
(De tout un peu, c’est comme il faut l’entendre)
« Nous mettrons, dit Astolphe, autant de cœurs à bout
Que nous voudrons en entreprendre ;
Mais je tiens qu’il vaut mieux attendre.
Arrêtons-nous pour un temps quelque part,
Et cela plus tôt que plus tard :
Car en amour, comme à la table,
Si l’on en croit la Faculté,
Diversité de mets peut nuire à la santé.
Le trop d’affaires nous accable ;
Ayons quelque objet en commun ; Pour tous les deux c’est assez d’un.
- J’y consens, dit Joconde, et je sais une dame
Près de qui nous aurons toute commodité.
Elle a beaucoup d’esprit, elle est belle, elle est femme
D’un des premiers de la cité.
Rien moins, reprit le roi, laissons la qualité
Sous les cotillons des grisettes
Peut loger autant de beauté
Que sous les jupes des coquettes.
D'ailleurs, il n’y faut point faire tant de façon ;
Etre en continuel soupçon,
Dépendre d’une humeur fière, brusque ou volage,
Chez les dames de haut parage
Ces choses sont à craindre et bien d’autres encor.
Une grisette est un trésor :
Car, sans se donner de la peine,
Et sans qu’aux bals on la promène,
On en vient aisément à bout ;
On lui dit ce qu’on veut, bien souvent rien du tout.