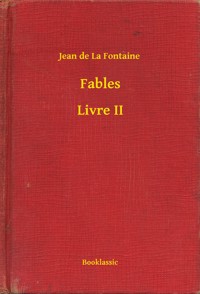Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Sire Guillaume, allant en marchandise, Laissa sa femme enceinte de six mois, Simple, jeunette et d'assez bonne guise, Nommée Alix, du pays champenois. Compère André l'allait voir quelquefois : A quel dessein, besoin n'est de le dire, Et Dieu le sait. C'était un maître sire : Il ne tendait guère en vain ses filets ; Ce n'était pas autrement sa coutume."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Voici les derniers ouvrages de cette nature qui partiront des mains de l’auteur, et par conséquent la dernière occasion de justifier ses hardiesses et les licences qu’il s’est données. Nous ne parlons point des mauvaises rimes, des vers qui enjambent, des deux voyelles sans élision, ni en général de ces sortes de négligences qu’il ne se pardonneroit pas lui-même en un autre genre de poésie, mais qui sont inseparables, pour ainsi dire, de celui-ci. Le trop grand soin de les éviter jetteroit un faiseur de contes en de longs détours, en des récits aussi froids que beaux, en des contraintes fort inutiles, et lui feroit négliger le plaisir du cœur pour travailler à la satisfaction de l’oreille. Il faut laisser les narrations étudiées pour les grands sujets, et ne pas faire un poème épique des aventures de Renaud d’Ast. Quand celui qui a rimé ces nouvelles y auroit apporte tout le soin et l’exactitude qu’on lui demande, outre que ce soin s’y remarqueroit d’autant plus qu’il y est moins nécessaire, et que cela contrevient aux préceptes de Quintilien, encore l’auteur n’auroit-il pas satisfait au principal point, qui est d’attacher le lecteur, de le réjouir, d’attirer malgré lui son attention, de lui plaire enfin : car, comme l’on sait, le secret de plaire ne consiste pas toujours en rajustement, ni même en la régularité ; il faut du piquant et de l’agréable, si l’on veut toucher. Combien voyons-nous de ces beautés régulières qui ne touchent point, et dont personne n’est amoureux ? Nous ne voulons pas ôter aux modernes la louange qu’ils ont méritée. Le beau tour de vers, le beau langage, la justesse, les bonnes rimes, sont des perfections en un poète : cependant, que l’on considère quelques-unes de nos épigrammes où tout cela se rencontre, peut-être y trouvera-t-on beaucoup moins de sel, j’oserois dire encore bien moins de grâces, qu’en celles de Marot et de Saint-Gelais ; quoique les ouvrages de ces derniers soient presque tout pleins de ces mêmes fautes qu’on nous impute. On dira que ce n’étoient pas des fautes en leur siècle et que c’en sont de très grandes au nôtre. À cela nous répondons par un même raisonnement, et disons, comme nous avons déjà dit, que c’en seroit en effet dans un autre genre de poésie, mais que ce n’en sont point dans celui-ci. Feu M. de Voitureen est le garant : il ne faut que lire ceux de ses ouvrages où il fait revivre le caractère de Marot. Car notre auteur ne prétend pas que la gloire lui en soit due, ni qu’il ait mérité non plus de grands applaudissements du public pour avoir rimé quelques contes. Il s’est véritablement engagé dans une carrière toute nouvelle, et l’a fournie le mieux qu’il a pu, prenant tantôt un chemin, tantôt l’autre et marchant toujours plus assurément quand il a suivi la manière de nos vieux poètes, quorum in hac re imitari neglegentiam exoptat potius quam istorum diligentiam. Mais, en disant que nous voulions passer ce point-là, nous nous sommes insensiblement engagés à l’examiner. Et possible n’a-ce pas été inutilement ; car il n’y a rien qui ressemble mieux à des fautes que ces licences.
Venons à la liberté que l’auteur se donne de tailler dans le bien d’autrui ainsi que dans le sien propre, sans qu’il en excepte les nouvelles même les plus connues, ne s’en trouvant point d’inviolable pour lui. Il retranche, il amplifie, il change les incidents et les circonstances, quelquefois le principal évènement et la suite ; enfin, ce n’est plus la même chose, c’est proprement une nouvelle nouvelle ; et celui qui l’a inventée auroit bien de la peine à reconnoître son propre ouvrage. Non sic decet contaminari fabulas, diront les critiques. Et comment ne le diroient-ils pas ? ils ont bien fait le même reproche à Térence ; mais Térence s’est moqué d’eux, et a prétendu avoir droit d’en user ainsi. Il a mêlé du sien parmi les sujets qu’il a tirés de Ménandre, comme Sophocle et Euripide out mêlé du leur parmi ceux qu’ils ont tirés des écrivains qui les précédoient, n’épargnant histoire ni fable où il s’agissoit de la bienséance et des règles du dramatique. Ce privilège cessera-t-il à l’égard des contes faits à plaisir ? et faudra-t-il avoir dorénavant plus de respect et plus de religion, s’il est permis d’ainsi dire, pour le mensonge, que les anciens n’en ont eu pour la vérité ? Jamais ce qu’on appelle un bon coute ne passe d’une main à l’autre sans recevoir quelque nouvel embellissement.
D’où vient donc, nous pourra-t-on dire, qu’en beaucoup d’endroits l’auteur retranche au lieu d’enchérir ? Nous en demeurons d’accord ; et il le fait pour éviter la longueur et l’obscurité, deux défauts intolérables dans ces matières, le dernier surtout : car, si la clarté est recommandable en tous les ouvrages de l’esprit, on peut dire qu’elle est nécessaire dans les récits où une chose, la plupart du temps, est la suite et la dépendance d’une autre, où le moindre fonde quelquefois le plus important ; en sorte que si le fil vient une fois à se rompre, il est impossible au lecteur de le renouer. D’ailleurs, comme les narrations en vers sont très malaisées, il se faut charger de circonstances le moins qu’on peut ; par ce moyen vous vous soulagez vous-même, et vous soulagez aussi le lecteur, à qui l’on ne sauroit manquer d’apprêter des plaisirs sans peine. Que si l’auteur a changé quelques incidents et même quelque catastrophe, ce qui préparoit cette catastrophe et la nécessité de la rendre heureuse l’y ont contraint. Il a cru que dans ces sortes de contes chacun devoit être content à la fin : cela plaît toujours au lecteur, à moins qu’on ne lui ait rendu les personnes trop odieuses. Mais il n’en faut point venir là, si l’on peut, ni faire rire et pleurer dans une même nouvelle. Cette bigarrure déplaît à Horace sur toutes choses ; il ne veut pas que nos compositions ressemblent aux crotesques, et que nous fassions un ouvrage moitié femme, moitié poisson. Ce sont les raisons générales que l’auteur a eues. On en pourroit encore alléguer de particulières, et défendre chaque endroit ; mais il faut laisser quelque chose à faire à l’habileté et à l’indulgence des lecteurs. Ils se contenteront donc de ces raisons-ci. Nous les aurions mises un peu plus en jour et fait valoir davantage, si l’étendue des préfaces l’avoit permis.
CONTE TIRÉ DES CENT NOUVELLES NOUVELLES ET D’UN CONTE DE BOCCACE.
C’est aux Cent Nouvelles nouvelles (nouvelle III) et au Décaméron de Boccace (journée VIII, nouvelle VIII) que la Fontaine, comme le dit le titre, a emprunté le sujet de ce conte.
Dans la IIIe des Cent Nouvelles nouvelles les détails différent quelque peu : là, point d’oreille à fabriquer, point de moule à raccommoder ; mais le seigneur se met en devoir de « recoigner et cheuiller le deuant de la musuiere », à laquelle il « baille à entendre qu’il luy cherroit s’il n’estoit recoigné, et ainsi par plusieurs fois le luy recoigna », et le meunier s’efforce, en revanche, de repêcher un diamant que la femme du seigneur a perdu au bain, c’est-à-dire qu’il a lui-même dérobé : il a fait croire à celle-ci que le diamant est entre dans son corps et qu’il sait comment l’en tirer : « Et le musnier pescha si bien et si auant qu’il le trouua, comme bien sceut depuis le cheualier ; si l’appela pescheur, et le musnier recoigneur le nomma. » Rapprochez la jolie farce du « Gentilhomme, Lison, Naudet, et la Damoyselle » dans l’Ancien Théâtre françois, tome I, p. 250.
Voici maintenant le sommaire de la VIIIe nouvelle de la VIIIe journée de Boccace ; on verra que, sauf pour le fond, ce récit diffère beaucoup de celui de la Fontaine : Due usano insieme. L’uno con la moglie dell’altro si giace. L’altro avedutosene fa con la sua moglie, che l’uno è serrato in una cassa, sopra laquale, standovi l’un dentro, l’altro con la moglie de l’un si giace.
« Deux hommes mariez frequentantz iournellement ensemble, l’ung coucha auecques la femme de l’aultre : lequel s’en estant aperceu feit si bien auec la femme de son compaignon qu’ilz l’enfermerent dedans img coffre, sur lequel il iouyt de sa femme. »
Citons également la fin du conte de Boccace : « Spinellosse, quand il fut sorty du coffre, sans user trop de parolles, deit : « Seppe, nous sommes l’ung comme l’aultre, et par ainsi ie treuue bon, comme tu disois tantost à ma femme, que nous soyons amys comme nous soulions, et n’estant autre chose à partir entre nous deux que noz femmes, ie suis d’aduis que nous les mections à butin » ; dont Seppe fut content : et disnerent tous quatre ensemble en la meilleure paix du monde, et de là en auant chacune de ces femmes eut deux mariz, et chascun d’eulx deux femmes, sans que iamais ilz en eussent pour cela autre question ne debat. »
Straparole, dans la première fable de sa sixième nuit, raconte cette même histoire, plus longuement, et sa conclusion est la même : « Deux comperes, dit le titre, s’aymans infiniment, se deçoiuent l’ung l’autre ; en fin font leurs femmes communes entre eux. » Mais dans son récit il n’est pas question de bain, comme dans le premier recueil cité, et ce n’est point un seul diamant, mais plusieurs bagues et anneaux qu’il s’agit de repêcher.
La Fontaine a emprunté aux Cent Nouvelles nouvelles et à Boccace l’idée des représailles, de la revanche du mari trompé. Mais la vraie source de son conte paraît être la IXe nouvelle de Bonaventure des Périers : « De celuy qui acheua l’oreille de l’enfant à la femme de son voisin », du moins pour la première partie. Non seulement le titre, le fond du récit, les incidents sont semblables, mais le nom même du rusé faiseur d’oreilles : André. Dans ce conte le mari ne se venge pas, mais il s’apaise « pour une couuerte de Cataloigne que luy donna le sire André ; à la charge toutesfois qu’il ne se mesleroit plus de faire les oreilles de ses enfants, et qu’il les feroit bien sans luy. »
Des Périers avait sans doute pris son sujet dans Poge : Nasi supplementum, ou dans la vieille traduction française de 1484 : « Du frere mineur (frère Frappart) qui fist le nez à ung enfant » ; peut-être aussi dans la facétie intitulée Talio.
D’autres narrateurs ont écrit cette histoire, avec quelques différences, particulièrement avec la Variante des Cent Nouvelles nouvelles et de Boccace. Citons, outre Straparole, dont il a déjà été fait mention, Masuccio, il Novellino (Naples, 1476, in-fol.), nouvelle XXXVI, dont voici l’argument : Dui cari compagni, per uno strano et travigliato caso, l’uno conosce carnalmente la moglie dell’altro et l’altro de l’uno, divolgalse et fatto tra loro per non guastare l’amicitia, abbutinano le moglie et l’altri beni et con quiete et pace insieme godono. – Malespini, nouvelle XLV.– Aloisio Cinthio, Libro della origine delli volgari proverbi (Venegia, 1526, in-fol.), proverbe XVI.– Gabriel Chappuys, traducteur d’il Pecorone, journée VII, nouvelle II des Facetieuses Iournées : « Valere, estant deuenu amoureux de Beatrix, la requiert de son amour. Le mary d’icelle, scachant cela, faict, en la presence de Valere, à la femme d’iceluy ce qu’il vouloit faire à la sienne. » Ce conte-là, plutôt tragique que plaisant, rappelle aussi, et mieux peut-être, le conte III de la IIIe partie, les Remois. – Guillaume Bouchet, les Serées (Paris et Lyon, 1608, in-12), serée XXXII, dont la conclusion est semblable à celle de Boccace. – Le Moyen de parvenir, p. 52 et 90, où sont deux historiettes qui ont quelque analogie avec la nôtre.
Comparons la Réponse imprévue de Grécourt, et l’anecdote racontée par lui sous ce titre : les Cheveux, dont voici la fin :
NOUVELLE TIRÉE DES CENT NOUVELLES NOUVELLES.
Ce conte n’est pas dans la première édition de la seconde partie, publiée en 1666, ni dans celle de 1667 Paris. Il fut imprimé d’abord, d’après une copie manuscrite, dans le Recueil contenant plusieurs discours libres et moraux, Cologne, 1667 ; puis dans l’édition d’Amsterdam, de Jean Verhoeven, 1668, in-16 ; et enfin inséré par l’auteur lui-même dans la deuxième édition de sa seconde partie, Paris, 1669, mais avec des atténuations, des adoucissements qui étaient destinés à lui permettre d’échapper à la censure et de paraître avec le privilège du Roi. Nous ne pouvons donc les adopter, tous du moins, puisque la pensée de l’auteur s’y trouve altérée et qu’il n’a fait que contraint les corrections dont nous parlons. Nous les reléguons au bas des pages comme variantes et, contrairement à notre règle, que, cette fois, nous sommes obligé d’enfreindre, donnons, sauf aux endroits où la Fontaine a fait des améliorations évidentes, le texte de 1668 (celui de 1667 est incorrect) qui a été suivi assez fidèlement par l’autre impression hollandaise de 1685. Ce serait dérouter le lecteur, habitué à la Version de 1668, et dénaturer l’œuvre du poète, que de reproduire trop exactement le texte adouci de l’édition de 1669.
Ce conte, comme l’indique le titre, avec plus de vérité que pour le conte précédent, est emprunté aux Cent Nouvelles nouvelles, nouvelle XXXII (les Dames dismées), qui est pleine de verve et d’esprit. Le point de départ, l’idée première est chez Poge, dans la facétie intitulée Decimæ (tome I, p. 163, de l’édition de 1798) ; voici la vengeance grossière que le mari tire du prêtre (un curé de paroisse de la ville de Bruges) : « Postquam, inquit, tibi rerum omnium uxoris meæ debetur decima, et hanc quoque accipies ! » Et simul vasstercore et urina uxoris plenum ori admotum in mensa bibere compulit. Comparez la XXIIIe nouvelle de Malespini.
On peut rapprocher du conte de la Fontaine, entre autres pièces satiriques où sont persiflés les gens d’Église, un fabliau de Rutebeuf : De frere Denize, ou ci enconmence li diz de frere Denize le Cordelier (Legrand d’Aussy, tome III, p. 380 ; Barbazan-Méon, tome III, p. 76 ; Jubinal, Œuvres complètes de Rutebeuf, 1874, tome II, p. 62 ; Montaiglon, tome III, p. 263), ainsi que la nouvelle IV de la IIIe journée du Décaméron de Boccace : Don Félix et frère Puccio ; rappelons aussi les divers récits, plus ou moins licencieux, relatifs à l’incontinence, à la paillardise des moines, et particulièrement des Cordeliers, qui se trouvent dans l’Histoire maccaronique de Merlin Coccaie, et chez Rabelais ; dans l’Apologie pour Hérodote d’Henri Estienne (tomes I, p. 422-416, II, p. 7-19, 25-31, 52-56 ; et passim) ; dans l’Heptaméron de la reine de Navarre (nouvelles V, XXXI, XLI, XLVIII, LVI ; etc.) ; dans l’Alcoran des Cordeliers, tant en latin qu’en françois (Genève, 1578, in-8°), tomes I, p. 155, 209, 239, 325-327, II, p. 230, 314-315, de la réimpression de 1734 ; dans le Sermon des frappe-culz nouueau et fort ioyeulx (Paris, 1530, in-8°) ; ou dans le Sermon du Cordelier aux Soldats, ensemble la Responce des Soldats au Cordelier (Paris, 1612, in-8°) ; dans le Journal de Henri III