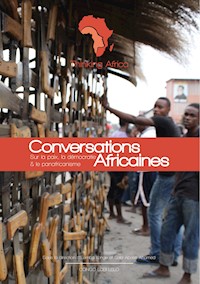
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Jean-François Akandji-Kombé, Francis Akindès, Mamadou Badji, Fadel Barro, Saïd Bouamama, Amzat Boukari-Yabara, Fabien Eboussi Boulaga, Souleymane Bachir Diagne, Assitan Diallo, José Do-Nascimento, El Hadj Guissé, Pascal Kambale, Séverin Yao Kouame, Patrick Mbeko, Achille Mbembe, Symphorien Ongolo, Albert Ouedraogo, Felwine Sarr, Mahamadé Savadogo, Ibrahima Thioub. Ils sont universitaires, écrivains, philosophes, activistes ou autres. Ils sont, avant tout, Africains. Chacun de leurs entretiens, réalisés par le think-tank Thinking Africa, associe expertises et perspectives africaines d'une part, et éclaire nos perceptions, compréhensions et actions sur les enjeux névralgiques de l'Afrique, d'autre part. Sociétés, culture et identités; conflits, droits et justice; jeunesse, mouvements citoyens et renouveau démocratique; géopolitique, stratégies et diplomaties économiques; prospectives, idées et panafricanisme: Plus qu'un livre d'entretiens, Conversations Africaines est un forum du savoir africain contemporain. Pour mieux agir sur notre devenir individuel et collectif. Sous la direction de Dr Saïd Abass Ahamed et Esimba Ifonge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tout le monde a besoin de croire ces temps-ci, et tout le monde oublie que des miracles se produisent au quotidien, lorsque nous reconnaissons l’humanité en autrui ou lorsque nous échangeons une conversation sincère avec quelqu’un.
ISHMAEL BEAH, Demain, le soleil
Notre génération n’a pas de chance, si l’on peut dire, en ce sens qu’elle ne pourra éviter la tempête intellectuelle ; qu’elle ne veuille ou non, elle sera amenée à prendre les taureaux par les cornes, à débarrasser son esprit des recettes intellectuelles et des bribes de pensée, pour s’engager résolument dans la seule voie vraiment dialectique de la solution des problèmes que l’histoire lui impose.
CHEIKH ANTA DIOP, Les fondements économiques et culturels d’un Etat fédéral d’Afrique noire
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS
Produire nous-mêmes des idées sur nous-mêmes
SOCIETES, CULTURES & IDENTITES
F
ABIEN
E
BOUSSI
B
OULAGA
“Ne nous dites pas : la philosophie est un luxe, on doit d’abord manger.”
I
BRAHIMA THIOUB
“Il faut nous émanciper de l’écriture de l’histoire faite sous la dictée du regard de l’autre.”
A
LBERT OUEDRAOGO
“Toutes les paix ne sont pas de bonnes paix… Il y a des paix qui sont pires que la guerre.”
S
AÏD BOUAMAMA
«Nous avons besoin de théoriser et de comprendre le réel, non pas pour remplacer l’action, mais pour éclairer l’action.”
CONFLITS, DROITS & JUSTICE
M
AMADOU
B
ADJI
“A beau vouloir nier l’importance de nos coutumes & de nos traditions, ces dernières nous rattrapent.”
P
ASCAL
K
AMBALE
“Ce n’est pas vraiment vers la CPI que les victimes se tournent mais vers une certaine idée de la justice.”
E
L
H
ADJ
G
UISSE
“Il faut d’abord établir la vérité, ensuite rendre justice. Et seulement après, le pardon.”
A
SSITAN
D
IALLO
“Il faut que nous fassions la paix avec notre propre justice avant vouloir faire la paix avec les armes.”
JEUNESSE, MOUVEMENTS CITOYENS & RENAISSANCE DEMOCRATIQUE
F
ADEL
B
ARRO
“Ce qui alimente notre réflexion de tous les jours, c’est le vécu quotidien des africains.”
F
RANCIS
A
KINDES
“Lorsqu’on n’arrive pas à éduquer sa jeunesse, elle devient une menace.”
M
AHAMADE
S
AVADOGO
“Pour qu’il y ait révolution, il faut qu’il y ait un accompagnement des mouvements sociaux, par un mouvement politique au sens clair.”
S
ÉVERIN
Y
AO
K
OUAME
“Au-delà d’une opportunité économique que peut représenter un emploi, il y a du lien social à générer.”
GEOPOLITIQUE, STRATEGIES & DIPLOMATIES ECONOMIQUES
S
YMPHORIEN
O
NGOLO
“Les dirigeants ont du mal à mettre en place des politiques publiques qui ne vont pas leur profiter directement.”
J
EAN
-F
RANÇOIS
A
KANDJI-
K
OMBÉ
“Nous avons des territoires maritimes sans maître, de fait. Chacun vient et se sert.”
P
ATRICK
M
BEKO
“Le droit international est une escroquerie intellectuelle. Il ne repose sur rien.”
F
ELWINE
S
ARR
“On ne peut pas avoir une réflexion sur l’économie, sans avoir une réflexion sur le reste et sur la place de l’économie dans le reste.”
PROSPECTIVES, IDEES & PANAFRICANISME
A
MZAT
B
OUKARI
-Y
ABARA
“Pour penser le panafricanisme, il faut penser la réconciliation.”
S
OULEYMANE
B
ACHIR
D
IAGNE
“C’est en fonction de la manière dont nous projetons nos sociétés demain, que l’on décide des actions à faire aujourd’hui.”
A
CHILLE
M
BEMBE
“La remise en cause du capitalisme peut venir de l’Afrique et plus précisément de cette expérience nègre.”
J
OSE
D
O
-N
ASCIMENTO
“Ce dont on a besoin, ce n’est ni la révolution ni le développement mais la reconquête de l’initiative historique.”
A PROPOS DE THINKING AFRICA
AVANT-PROPOS
Produire nous-mêmes des idées sur nous-mêmes
A la question, « pensez-vous que le continent africain pourra se sortir de sa marginalisation ? », l’historien burkinabè Joseph Ki-Zerbo, dans son livre, A quand l’Afrique ?, apporte la réponse suivante :
Il ne faut pas trop nous déterminer par rapport aux autres et concevoir la marginalisation en fonction du centre. Le centre est d’abord en nous-mêmes. Je dirai qu’il faudrait, comme alternative d’abord un projet d‘ensemble : Qui sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? Depuis que nous sommes indépendants, nous n’avons pas répondu à ces questions. Qu’est-ce que nous avons fait ? D’où venons-nous ? A partir de cette plate-forme d’ensemble, il faudrait mettre sur pied une force de frappe – consistant en idées, en ressources humaines et organisation – qui puisse se tailler une place dans le rapport de forces mondiales. [...] Il faut réaliser une opération mentale individuelle d’abord, collective ensuite, et se dire : Je suis le centre de moi-même.
Dans le film The Great Debaters (Les grands débatteurs) qui relate, dans les années 1930 aux USA, le parcours d’une équipe de débatteurs étudiants, sous fond de racisme, Denzel Washington, acteur principal et réalisateur du film attire notre attention sur la nécessité de disposer de son propre dictionnaire. En effet, au moment où il sélectionne son équipe de débatteurs qui va devoir affronter les différentes universités du pays, il leur dit qu’ils doivent créer leur propre dictionnaire. Parce que dans le combat qu’ils doivent mener, il faut être en mesure de contrôler et de maîtriser les mots et les idées.
Ces deux exemples relèvent l’importance de produire nous-mêmes des idées, pour et sur nous-mêmes.
Le think-tank Thinking Africa (TA), est né de ce constat. Initié en 2013 par une équipe de chercheurs et d’experts africains, Thinking Africa publie des analyses sur les enjeux politiques, géostratégiques, économiques et sociétaux en Afrique, forme des hauts fonctionnaires, officiers et décideurs africains au leadership, à la médiation et à la négociation, et organise des conférences scientifiques et débats sur les enjeux névralgiques africains, dans le but de réinventer le leadership africain et contribuer à l’émergence d’un continent pacifié et prospère. Parce que, si Thinking Africa estime que la production et la diffusion de savoirs prospectifs et idées africaines sont cruciales, sa raison d’être repose sur l’amélioration des politiques publiques, un meilleur leadership sur le continent et un impact positif sur les réalités quotidiennes des africains. Voilà l’enjeu qui nous préoccupe. A travers des entretiens filmés, le think tank s’attache à décrypter et valoriser les idées produites par les Africains sur les enjeux contemporains de l’Afrique et du monde à l’attention du grand public. Jean-François Akandji-Kombé, Francis Akindès, Mamadou Badji, Fadel Barro, Saïd Bouamama, Amzat Boukari-Yabara, Fabien Eboussi Boulaga, Souleymane Bachir Diagne, Assitan Diallo, José Do-Nascimento, El Hadj Guisse, Pascal Kambale, Séverin Yao Kouame, Patrick Mbeko, Achille Mbembe, Symphorien Ongolo, Albert Ouedraogo, Felwine Sarr, Mahamadé Savadogo, Ibrahima Thioub : Ils font partie des personnes que Thinking Africa a interviewées depuis 2013, pour sa web TV, Thinking Africa TV.
Ils sont universitaires, écrivains, philosophes, artistes, activistes, intellectuels ou autres. Et, avant tout, Africains. Chacun de leurs entretiens associe parcours de vie, expertises et perspectives africaines d‘une part, et éclaire nos perceptions, compréhensions et actions sur les enjeux névralgiques de l‘Afrique, d‘autre part.
L’ambition de ce livre, Conversations africaines, qui réunit donc une sélection éditorialisée des entretiens de Thinking Africa TV, est de partager, avec le plus grand nombre, les idées produites et exposées par des penseurs africains mais aussi de susciter et entretenir le débat sur le devenir du continent et de ses citoyens. Sociétés, cultures et identités; Conflits, droits et justice ; Jeunesse, mouvements citoyens & renouveau démocratique ; Géopolitique, stratégies & diplomaties économiques ; Prospectives, idées & panafricanisme : Plus qu‘un livre d‘entretiens, Conversations Africaines est un forum du savoir africain contemporain. Pour mieux agir sur notre devenir individuel et collectif.
Esimba Ifonge
SOCIÉTÉS CULTURES & IDENTITÉS
La paix est un effort quotidien qu’il faut renouveler à tous les niveaux. Ce vouloir vivre ensemble se négocie au quotidien, tous les jours. Et nous africains, nous l’avons ignoré pensant que c’était plus important de concentrer nos efforts sur le développement, sur la consolidation de l’Etat et sur la nation.
- Dr Saïd Abass Ahamed
FABIEN EBOUSSI BOULAGA :
Auteur de nombreux ouvrage dont La crise du Muntu (Présence africaine, 1977) et Les conférences nationales en Afrique noire. Une affaire à suivre (Karthala, 1993), Fabien Eboussi Boulaga n’a cessé de penser le devenir de l’Afrique.
L’humain, le Muntu, les droits humains, la religion, la démocratie : le philosophe camerounais estimait que la pensée critique n’est pas un luxe.
« Ne nous dites pas : la philosophie est un luxe, on doit d’abord manger. »
ENTRETIEN AVEC FABIEN EBousi Boulaga
TA: Vous donnez de l’humain une définition qui se caractérise par sa réalité affective, par l’ensemble des expériences de souffrances et de joies qui ponctuent son passage entre la naissance à cette vie et son trépas. Comment préserver son intégrité morale lorsque la socialisation s’opère sur un fond d’« organisation fonctionnaire », caractérisée par une « combinaison de la négation du principe du travail, du risque, de l’initiative, de la responsabilité de ses actes » ?
FABIEN EBOUSSI BOULAGA : Si tel est le contexte dans lequel vous pensez que se faire la socialisation, c’est un contexte historique donné où les objets ou les sujets de la socialisation sont des individus, sont des collectivités qui ne sont pas soumis à une sorte de fatalité ou de mécanisme naturel, physique qui les amène nécessairement à ne pas réaliser leur situation ou leur statut d’individu responsable. La socialisation s’adresse à quelqu’un qui est responsable, qui doit devenir libre. Alors on peut, sous ses mots, et c’est là tout notre problème, confondre les choses et créer de faux dilemmes : Dire socialisation contre liberté et contexte d’anomie sociale et difficulté à se réaliser comme individu libre. On peut le faire. La réflexion nous amène à comprendre que dire socialisation c’est se référer à certains des processus essentiels qui transforment l’homme primate en humain. On le socialise en lui donnant le statut d’une personne qui pourra ensuite prendre sa part à la gestion de la collectivité et au final à transmettre un héritage de l’humain. La socialisation va de concert avec la personnalisation, la sexualisation, et enfin la civilisation. La civilisation peut être définie comme des collectivités qui se reconnaissent comme des collectivités d’humains et dont les symbolismes, les rites sont respectés par les autres dans une alliance. Mais avant cela il y a la sexualisation. Nous naissons tous avec un certain degré d’indétermination et on doit nous sexualiser, c’est-à-dire nous rendre Homme, mâle ou femelle. Par conséquent, donc la socialisation ne peut pas se comprendre si elle n’est pas prise dans cela qui permet à l’homme de devenir humain ; c’est-à-dire en respectant les interdits, en respectant les symboles, en respectant la parole, en fonctionnant sur la parole donnée, et en respectant l’intelligence qui s’exprime par la parole, etc. La socialisation n’est donc qu’un moment par lequel toute société qui se veut humaine, c’est-à-dire capable de transmettre l’humanité de l’homme, l’homme n’est pas homme, comme l’arbre est un arbre, il faut constamment préserver l’avènement improbable de l’humain qu’on appelle l’émergence de l’humain, voilà en gros, mais c’est des raccourcis, qu’on peut développer indéfiniment.
TA: L’ensemble de votre œuvre est animé par l’appel que vous faites aux intellectuels du continent et à vous-même dans votre livre La Crise du Muntu : celui d’être par et pour soi-même, en surmontant ce qui conteste à l’homme noir son appartenance à l’humanité. Maintenant que les débats philosophiques ont globalement dépassé cette longue « affaire de la philosophie africaine », n’émergerait-il pas une ligne, voire un front de résistance, dans la pensée créatrice de certains intellectuels africains ?
FEB: La crise du Muntu, s’il est un ouvrage philosophique, devrait résister un peu au temps, et donc n’a pas à tendre comme une réalisation qui en marquerait le dépassement. Si c’est un bon livre il devrait encore être lu et réinterprété, et réapproprié par des individus pour se comprendre même dans des circonstances changées. Je crois que le livre a résisté au temps, et il est susceptible encore d’interpeler les gens pour leur dire sommes nous en train de nous prendre en main, d’exprimer notre liberté, de nous inscrire dans le monde, non pas simplement en subalterne, en subordonné, en mendiant mais en être humain qui participe au devenir de l’humanité ?
La crise du Muntu est un ouvrage qui est encore lu, me semble-t-il, la version anglaise vient d’être traduite, il y a des travaux là-dessus. Donc de ce point de vue, on peut dire que, à la fois, ce livre est, par bien des côtés, dépassé mais il est aussi d’une actualité pour ceux qui savent le reprendre à leur propre compte activement. S’il est peut-être dépassé, il peut être encore actif et utile à qui veut prendre conscience, une conscience critique, de sa situation dans le monde d’aujourd’hui.
Alors, là-dessus vous me demandez s’il n’y a pas d’autres personnes en supposant que je sois un intellectuel, qui fasse le même effort ou même davantage. Est-ce que je peux donner des noms, on veut des noms ? Je dirais que premièrement, quand un livre est bon, il s’est fait en discussion, dans un milieu de discussions. Même si on n’est pas allé discuter verbalement avec les individus, on a tenu compte de ce qui s’agitait dans la société pensante de l’époque. On a répondu à des objections, on en a inventé préventivement d’autres. C’est un travail qui est toujours en quelque sorte un travail collectif même s’il est fait par des individus. L’idéal philosophique, c’est d’être tout seul ensemble avec les autres. On est pas tout seul et on n’a pas la vérité tout seul contre tout le monde. Et cela ne serait pas la vérité. Ce n’est pas parce qu’on s’immerge dans la foule, dans la masse, qu’on a la vérité. C’est une dialectique que le philosophe français Maurice Merleau-Ponty a bien expliquée : On n’a pas la vérité tout seul parce que ce ne serait pas la vérité. Ce n’est pas la vérité individuelle, qui est quelque part, qu’il faut chercher pour son salut individuel. Mais en même temps, on ne le fait donc pas contre tout le monde.
On ne le fait pas non plus contre soi-même, en se dissolvant dans la masse, en étant le porte-voix ou le porte-parole de la foule.
C’est pourquoi je ne pense pas que je puisse m’imaginer faire des choses qu’aucun autre ne ferait dans notre contexte. Et je n’ai pas donné de noms parce que l’une des exigences d’un certain type de pensée, c’est à la fois d’être attentif aux autres mais d’être aussi un peu solitaire. C’est-à-dire de ne pas penser uniquement contre les autres, ou en commentaire des autres, sinon on risque d’être superficiel. Vous interviewez un vieillard, il faut vous attendre à ce qu’il radote et qu’il vous répète les mêmes choses. Ce que j’ai dit de mille manières et écrit, c’est que ce sont des œuvres qui vous reconnaissent comme intellectuel. Ils vous reconnaissent comme intellectuel non pas du fait d’un diplôme mais du fait de la stimulation que vous apportez à leur vie intellectuelle.
D’autre part, être intellectuel peut revêtir beaucoup d’aspect. Ma prédilection va pour l’intellectuel commun, celui qui vit pour vous et moi, qui prend en charge le problème du commun, et qui le fait avec les autres. Les intellectuels communs ? J’en vois un exemple, une figure, dans Alioune Diop. Alioune Diop a un itinéraire personnel mais en même temps il se met au service des aspirations communes des africains au passage de l’indépendance.
Il le fait, non pas, en concentrant les choses lui-même sur son œuvre, il renonce presque à écrire. Il écrit de très bons éditoriaux qui sont stimulants jusqu’à aujourd’hui pour nous, mais il fait éclore d’autres intelligences, d’autres individus. Il « permet » à Cheikh Anta Diop d’exister intellectuellement. Les livres de Cheikh Anta Diop sont refusés partout, c’est Alioune qui prend le risque de les publier, de les éditer, et ainsi de suite. Il est capable de fédérer des chrétiens, des marxistes, des athées, toutes sortes de gens dans une entreprise qui va de pair avec la rigueur intellectuelle personnelle, morale de l’individu et de ce qu’il propose comme sans tabou ni trompette à ceux qui veulent que les africains puissent conjoindre leurs efforts malgré leurs différences, sans dictature, sans orientation, sans pensée unique.
Les intellectuels africains, qu’ils s’expriment ! Que nous les reconnaissons chacun comme intellectuel. Un homme qui se dit « moi je suis intellectuel, vous voyez j’ai écrit, j’ai tel diplôme », non. Ce n’est pas cela qu’on attend de ce que j’appelle la figure de l’intellectuel aujourd’hui. Une des erreurs contre-productives éminemment serait de dire étant donné ma définition des intellectuels, bien-sûr moi-même je suis intellectuel, sont aussi intellectuels un tel, un tel, un tel. Non, c’est un jeu stérile dont les camerounais sont un peu des champions. Il faut combattre ceci non pas par des discours, mais en montrant que l’intelligence est une valeur et donc ça se choisit et ça se mérite. Ce n’est pas quelque chose qu’on vous confère de l’extérieur, c’est une valeur. Et il faut l’imposer comme valeur. Quand je dis que l’Afrique n’a pas d’intellectuels, c’est parce que l’Afrique ne considère pas l’intelligence comme valeur à égalité avec la richesse ou la puissance. Celui qui a la richesse dit je peux les acheter, je leur fais faire des travaux, je les paie ; celui qui a la puissance dit c’est moi qui mène tous les intellectuels, c’est la valeur suprême. Non, il n’y a pas une valeur unique suprême, c’est ça l’humanité. On est Homme si à la fois on conjoint l’intelligence, la richesse, la puissance, la force et la capacité de mener, de permettre à un groupe de vivre au niveau de son humanité.
TA: Dans le livre Christianisme sans fétiche, vous parlez de l’importance, pour la religion, du sens qu’une vie puisse donner à la mort. Pour sortir des passions fratricides, plus que la vie, est-ce la mort qu’il faudrait revaloriser ?
FEB: L’horreur est un objet de révulsion vitale, de fuite, de combat, de lutte, etc. La pensée vient soit trop tard soit trop tôt. Elle est venue trop tôt pour ceux qui ont négligé de considérer que l’homme n’était pas un acquis. Que ce qu’ils croyaient le fondement de leurs cultures, la religion ou leur culture dite traditionnelle, était comme des rentes d’humanité. Ils ont oublié que l’homme s’est réinventé constamment, souvent dans des conditions absolument inédites, quitte à continuer dans ces conditions inédites, à savoir qu’il n’est pas le premier humain, qu’il a quelque chose qu’il a reçu et qu’il doit transmettre, contre toute probabilité.
L’homme humain est une réalité improbable. Et donc, notre manière de ne pas être muet devant l’horreur, c’est d’accepter d’abord qu’il faut combattre l’horreur. C’est d’accepter qu’il faille la refuser de toute sa puissance ou de toute sa force. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que nous aurions pu faire autrement, que ce n’est pas tombé du ciel, que ce n’était pas une fatalité. Par exemple la sacralisation des frontières est quelque chose d’historique qui montre partiellement là ses limites qu’il faut dépasser maintenant, sans s’accrocher au fétiche de la souveraineté nationale, territoriale. Ça vient d’où cette souveraineté ? Elle est le produit d’une histoire donnée qui montre ses limites quand elle est transposée en absolu qui transcende l’histoire, qui dépasse l’histoire et les contextes géographiques, culturels, etc.
Nous disons que ce qui caractérise les africains ce sont la culture de l’homme, la patrie non pas des droits de l’homme mais de l’Homme, mais cela veut dire quoi réellement ? Cela veut dire quoi pour un intellectuel de reprendre ces discours en oubliant que cela peut alimenter l’inhumanité la plus atroce, que la volonté de créer l’homme nouveau socialiste, communiste, a donné le goulag, les camps de concentration ?
La liberté peut s’imposer à coups de bazooka, elle peut être le porte flambeau de ceux qui veulent vous anéantir. La pensée critique n’est pas un luxe et ne nous dites pas « la philosophie, on n’en veut pas, on veut d’abord manger ». Si vous voulez d’abord manger et penser ensuite, vous risquez de ne pas manger du tout, et de crever de famine, de maladie, etc. Voilà comment on pense l’impensable, en le sortant du champ du pensable qui se croyait absolu, en recadrant le problème autrement que ce que nous voulons adopter comme allant de soi. On a un exécutif, on a un parlement, on a tous les ornements d’un état rationnel mais qui ne l’est pas, et pas seulement au Cameroun.
Ce qui fait que le Nigéria est un grand pays, plein d’avenir mais pour le moment, la barbarie la plus atroce peut naitre de la gestion du Nigéria depuis une cinquantaine d’années, ainsi de suite. Boko Haram est parmi nous, pas seulement parce qu’il vient au Nord, mais en raison de la manière dont nous prenons la religion avec son fond d’intolérance absolue, qui est présent même dans les religions du livre en général, c’est-à-dire le christianisme, le judaïsme, etc. Dès lors que vous avez une croyance qui discrimine, qui dit « nous, on est supérieur ; nous, on a la vérité, les autres sont appelés à venir avec nous mais entre-temps ce n’est pas tout à fait ça ».
Vous avez le choix de devenir un saint, mais vous pouvez aussi devenir un croisé, vous pouvez devenir un djihadiste. Il y a tout un discours religieux qui est transposé en politique, qui est transposé dans la vie courante et qui incite à ces excès. Donc nous devons être constamment vigilants quand nous-mêmes parlons, quand nous prenons des idéaux pour, en soi, bons mais qui ne restent plus des idéaux dès que nous avons à les traduire dans le monde réel.
TA: Dans votre livre Les Conférences nationales en Afrique, une affaire à suivre, vous parlez de « témoin radical » pour désigner cet africain qui enfin parle, celui qui a été muselé, rançonné, abruti pendant des décennies noires que les conférences nationales souveraines ont pu documenter. En 2014, ce témoin radical s’est soulevé une fois de plus dans les villes du Burkina Faso. Peut-on espérer de la révolution burkinabé qu’elle augure une interruption, l’opportunité d’un travail de déconstruction d’institutions illégitimes, de re-conceptualisation de l’espace mental et politique africain ?
FEB: Il est bon d’encourager les signes qui annoncent l’aurore. C’est notre métier. On se réjouit toujours quand nous voyons poindre à l’horizon quelque chose qui nous donne espoir, que nous pouvons transformer notre propre condition, et la condition commune des africains et de l’humanité. Alors, il faut prendre les Burkinabè comme des humains. Il y a eu une étincelle, il y a eu un sursaut admirable qui a donné un résultat, mais tout reste à faire. Il y a des régressions, il y a un obscurcissement possible de cette lumière qui a duré quelque temps. C’est la manière dont ils essaient de consolider cet instant miraculeux et de le monnayer dans la vie quotidienne, ordinaire, banale de chacun de nous qu’il faut encourager et chercher à reproduire pour notre propre compte.
Alors, le Burkina a fait quelque chose qu’il faut réinterpréter. Ou il faut interpréter l’africain, le témoin radical. Le témoin radical est celui qui nous dit que toutes les belles institutions, tous les beaux discours, tous les idéaux peuvent échouer, si par je ne sais quel jeu du malin génie, peuvent converger vers l’écrasement de gens qui ne les connaissent plus que par leur souffrance. L’élément que les Burkinabè avec d’autres introduisent, c’est que la souffrance individuelle, humaine, est devenue la pierre de tous pour juger de la qualité des offres politiques, religieuses et autres, la souffrance. Est-ce que ma vie contribue au moins à ne pas faire souffrir l’autre.
TA: Vous dirigez et avez fondé la revue Terroirs, avec la mission, entres autres mandats, d’opposer une pensée réflexive sans complaisance aux discours africanistes et autres productions académiques ayant pour objet l’Afrique. Cette entreprise éditoriale de décolonisation épistémique est-elle un projet menacé par les nombreux obstacles à la publication et à la distribution sur le continent ?
FEB: Cette entreprise a été jusqu’à présent une entreprise éminemment précaire, dépendant j’allais dire de la richesse, ou mieux de la pauvreté de son promoteur. Je me suis débrouillé avec mes salaires, avec parfois mes honoraires pour la faire marcher. Mais c’est une entreprise qui s’est voulu toujours collective ; une entreprise qui a voulu échapper non pas aux obstacles d’une distribution, ou d’un management soumis aux impératifs de l’économie telle qu’elle est mais qui devait échapper à l’esprit de dépendance. Terroirs devait être le résultat de l’apport de ceux qui sont parties prenantes de cette aventure. C’est pourquoi, c’est toujours ouvert.
Des jeunes estiment que cette entreprise ne doit pas mourir, moi je n’ai plus la capacité de m’en occuper tout seul. On est donc en train de tout remettre à plat et j’attends des initiatives pour dire : « voilà ce que nous devons faire pour que cela continue dans le même esprit, et que nous ne finissions pas par être ceux qui cherchent des financements de façon indiscriminée à gauche, à droite, pour sortir un livre. C’est ce danger-là qui est le plus menaçant pour l’esprit, pour l’esprit de ce projet. L’esprit de ce projet veut être une illustration ou une réalisation même microscopique de la volonté et de payer de nous-mêmes pour ce qui est important pour nous. Par exemple si nous croyons que la liberté est quelque chose, j’ai toujours été étonné de voir que peu de pays peuvent financer leurs propres élections, ainsi de suite.
On tombe dans des situations paradoxales ou encore dans ce que les anglophones appellent « double bind », la double contrainte : Je vous dis : « Il faut être libre. Mais pour être libre, je vais vous aider à être libre ». Vous ne pourrez pas être libre si je vous aide à être libre. C’est cette contradiction dans laquelle nous sommes en permanence. Nous voulons une initiative, nous voulons une liberté de pensée, et nous savons que nous la perdons quand nous devons nous ajuster aux forces, aux puissances qui vont nous aider et nous financer.
Vous ne pouvez pas écrire certains travaux dans le cadre du fonctionnariat qu’est l’enseignement public. Vous pouvez les écrire marginalement. Mais si vous dites, si j’écris ça, je vais perdre tel promotion, je vais même perdre mon poste… Pour résumer, la revue Terroirs n’est que comme vous diriez la métonymie de l’Afrique, qui ne peut vivre que si elle se prend en charge mais si elle ne se prend pas en charge efficacement, elle va virevolter et disparaitre.
IBRAHIMA THIOUB :
Directeur du Département d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste des systèmes de domination en Afrique, le professeur Ibrahima Thioub pose un regard critique sur les lectures africaines de l’esclavage et de la traite atlantique.
« Il faut nous émanciper de l’écriture de l’histoire faite sous la dictée du regard de l’autre. »
ENTRETIEN AVEC IBRAHIMA THIOUB
TA: Quelles sont les spécificités que présentent l’histoire africaine et son historiographie ?
Ibrahima Thioub: L’Afrique est un continent composé de plusieurs sociétés, de plusieurs pays, de plusieurs nationalités, elle est d’une extrême diversité. On a tendance à avoir une approche réductionniste et à considérer globalement le continent comme ayant une histoire unique. Des processus historiques multiples et variés s’y déroulent avec des formes d’organisations sociales politiques qui sont en cours d’étude et qui sont loin d’être épuisées, donc on ne peut pas dire qu’il y a UNE histoire de l’Afrique. C’est commode de le dire mais il faut reprendre la pluralité des processus historiques, leur diversité, comme dans tous les autres continents du monde. Au regard de l’histoire en tant que processus de transformation des sociétés, à ne pas confondre avec l’histoire en tant que discipline, chaque société a ses spécificités et en la matière l’Afrique n’a rien de particulier.
L’historien français Lucien Febvre souligne que « l’histoire est fille de son temps », c’est sous ce rapport qu’on peut dire qu’il y a une écriture spécifique de l’histoire en Afrique. Si je prends l’exemple de l’histoire qui s’écrit dans les universités, on peut dire que l’Afrique y entre pratiquement dans un contexte particulier qui est la fin de la deuxième guerre mondiale, pour ce qui est, en tout cas, de l’historiographie de l’Afrique de l’Ouest francophone. Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, on est dans un contexte de montée en puissance des mouvements de contestation de l’ordre colonial, avec la création de partis politiques, de mouvements de jeunesse, de femmes, de syndicalistes, de travailleurs, qui contestent l’oppression coloniale, sa domination économique et son idéologique culturelle. Tout cela est contesté sous des formes multiples et variées, des mouvements qui réclament l’indépendance à des mouvements qui demandent la réforme du système colonial ou une meilleure assimilation, ou des formes d’associations. En tout cas, il y a plusieurs expressions de plusieurs acteurs qui chacun à partir de ses positions, de sa culture, de la perception qu’il a de ses intérêts participe à une remise en cause de l’ordre colonial. Les combattants qui sont revenus de la guerre posent de nouvelles questions ; la restructuration de l’ordre économique ; les demandes de transformations sociales : c’est dans ce contexte que les africains participent à l’écriture de l’histoire. Et ce contexte va influer sur la façon dont s’écrit l’histoire.
L’Europe avait fondé sa domination sur le déni de l’historicité des sociétés africaines. Les premières générations africaines qui vont s’intéresser à l’écriture de l’histoire vont se battre pour la réaffirmation de l’historicité des sociétés africaines, en contestant les fondements idéologiques de la colonisation pour montrer que l’Afrique a une histoire. Dans ce processus, on va écrire une histoire plutôt belle, une histoire qui ne sera pas critique sur les sociétés africaines. Mais on va produire un récit, une narration qui valorise tout ce qui est réalisation sociale, culturelle de l’Afrique pour pouvoir supporter le mouvement de contestation de l’ordre colonial, en donnant ainsi au mouvement des racines historiques qui lui indiquent le futur à construire. C’est dans ce contexte que naît l’historiographie du côté de l’Afrique de l’ouest francophone. Dans le processus, on a ceux qui vont s’intéresser à la connexion avec l’Egypte, les grands empires au Mali, au Zimbabwe, etc. et les recherches archéologiques vont être très développées, mais aussi, dans le même sillage, ceux qui vont marquer un intérêt particulier pour l’Atlantique. Si, je prends l’école de Dakar que je connais le mieux, la première thèse qui a été soutenue à Dakar - par l’un de ceux qu’on peut appeler les pères de l’école de Dakar, c’est-à-dire, Abdoulaye Ly - a porté sur la compagnie du Sénégal, qui était une compagnie de traite. Ce faisant, Ly ouvre un axe très important, celui de l’explication des positions subalternes de l’Afrique dans l’organisation du monde. Les années qui vont suivre, on va voir se développer davantage cette historiographie qui interroge les rapports de l’Afrique à l’Atlantique et qui va être beaucoup plus dans les milieux universitaires, contrairement à la thèse défendue par Cheikh Anta Diop qui nous connecte à l’Egypte. Pour ce qui est de l’école de Dakar, c’est la thèse d’Abdoulaye Ly qui va être beaucoup plus influente.
Si on va en Afrique orientale ou en Afrique australe, ce sont d’autres historiographies qui vont s’y développer. Pour ce qui est de la génération postérieure, de nouvelles questions vont surgir puisque les programmes d’ajustement structurels vont passer par là, avec aussi l’apparition, dans les années 1970, de nouveaux acteurs dans l’espace public comme les jeunes, les femmes, les marginaux, les urbains, les sportifs, les groupes de musique. Ces nouveaux acteurs qui entrent en scène, n’avaient pas été pris en compte par cette première période de notre historiographie. C’est pendant la période où ils s’affirment dans l’espace public qu’ils vont chercher aussi, interpeller l’écriture de l’histoire.
Cette interpellation de la dynamique des sociétés africaines va avoir un répondant dans l’historiographie qui s’ouvre de plus en plus avec l’histoire des marginalités urbaines comme rurales, l’histoire de la criminalité, l’histoire du sexe, l’histoire de l’alcool, de la délinquance, l’histoire du banditisme, l’histoire des jeunes, l’histoire des villes, l’histoire de l’alimentation, l’histoire de la santé. Parce que nous ne devons pas oublier que c’est la période aussi où se développent des épidémies comme le VIH/SIDA, et tout plus récemment Ebola. Bref, tout cela interpelle les historiens, pour pouvoir voir quelles sont les continuités historiques en rapport avec ces événements qui occupent l’actualité. Cela modifie considérablement aussi bien l’écriture, le récit, la narration que les méthodes avec des connexions beaucoup plus fortes avec d’autres disciplines comme l’anthropologie, la sociologie, la linguistique. Ces disciplines vont être de plus en plus en conversation avec les historiens. Il s’agit là d’un aspect majeur de transformation de l’historiographie plus récemment.
TA: Les grandes périodes historiographiques occidentales sont-elles pertinentes dans l’analyse de l’histoire des sociétés africaines ?
IT: Oui, bien sûr. La question est tout à fait légitime et pertinente. Quelle périodisation, pour quelle histoire africaine ? L’écriture de l’histoire - que j’ai quelque part appelé nationaliste - qui démarre au lendemain de la deuxième guerre mondiale, produit une histoire comparable à l’histoire de l’Europe. Les historiens africains vont reprendre ce modèle européen avec la perspective de vouloir démontrer que tout ce qui a existé comme de positif et qui a servi à construire l’idéologie de la domination coloniale dans le champ historique, a une antériorité. Cheikh Anta Diop utilise ce terme en parlant de l’antériorité des civilisations nègres. L’antériorité, c’est-à-dire, le lieu de l’apprentissage des sociétés européennes en Afrique, de ce qui est même la civilisation. Donc, cette comparaison, cette permanente définition de soi-même en référence à l’autre, l’autre étant celui qui a dominé et qui a colonisé, va amener très souvent à l’adoption de la même périodisation qu’on trouve en Europe : Préhistoire, antiquité, histoire médiévale, histoire moderne et contemporaine, et parfois même avec les mêmes coupures périodiques. Mais réinterroger les processus sociaux politiques, culturels, économiques des sociétés africaines, bien sûr, nous amènerait nécessairement, en prenant en compte d’autre facteurs, les facteurs climatiques par exemple, les facteurs environnementaux, les facteurs démographiques, à trouver d’autre coupures.
Si je prends, par exemple, la période dite médiévale, ou moyen-âge en Europe, toujours mise en opposition avec la période moderne des Lumières, du règne de la raison et autre, et bien elle est décrite comme une période à la limite de la stagnation et de la régression, ce qui est largement aujourd’hui d’une remise en cause, y compris par l’historiographie européenne, on va voir qu’en Afrique, c’est une autre perspective peut-être. Il y a là une période où fleurissent des civilisations brillantes autour de la boucle du Niger ; les empires du Ghana, Songhaï, Mali qui sont en connexions à travers le Sahara avec l’Orient et qui commercent avec cet Orient. Si on prend du côté de l’océan indien, ce sont d’autres logiques, au cœur de l’Afrique également. Ce sont d’autres éléments qu’il faudrait mettre en œuvre et cette réflexion n’est pas encore, à mon sens, suffisamment conduite pour qu’on retrouve une dynamique propre à l’Afrique, avec des facteurs qui permettent d’opérer un autre découpage, propre à l’Afrique même s’il y a une connexion à faire avec le reste du monde. Parce que justement l’Afrique n’a jamais été coupé du reste du monde. D’ailleurs, le peuplement du reste du monde s’opère à partir de l’Afrique, qui est le berceau de l’humanité. Il n’y a jamais eu de coupures, il y a eu des échanges avec l’extérieur et cette connexion à l’extérieur est, bien-sûr, à prendre en compte dans le découpage de la périodisation à faire. Mais les dynamiques internes doivent être privilégiées pour qu’on ait une écriture qui prend le souffle de l’Afrique comme repère.
TA: Quels défis doivent relever les universitaires africains en vue de peser davantage dans les prises de décisions ? Et comment parvenir à allier analyse intellectuelle et applications pratiques ?
IT: Les universitaires ont pour mission de produire du savoir et de transmettre ce savoir. La question qui se pose est : Quel savoir doivent-ils produire ? Produire tous les savoirs. Et tous les savoirs ont leur place à l’université. Mais il y a là quelque chose qui est spécifique, peut-être, à l’Afrique, c’est que les derniers siècles ont mis les sociétés africaines sur une position subalterne dans les affaires du monde. Cela interpelle les universitaires, de toutes les disciplines. Pour ce qui est de la discipline que je connais le mieux, qui est l’histoire, il faut nous émanciper de l’écriture de l’histoire faite sous la dictée du regard de l’autre, surtout quand l’autre est le colonisateur ou ancien colonisateur.
Puisque, pour moi, il est évident que l’histoire qui a été écrite au moment du combat pour la libération était appelée à écrire ce type d’histoire. Puisque dans la lutte pour la libération, l’Afrique fait face à l’autre, l’autre en tant que dominateur. Nécessairement, les historiens doivent donc produire un discours, en tout cas mener des recherches, qui ont eu pour objectif conscient ou inconscient d’accompagner, d’appuyer ou d’être même à l’avant-garde de ces mouvements de lutte pour la libération. C’est une mission des universitaires et je pense qu’ils l’ont très bien accompli. Mais pour moi, cette séquence - des luttes de libération de l’Afrique - s’achève en 1994, avec l’élection de Nelson Mandela comme président de l’Afrique du Sud. Dans cette période de luttes, l’Afrique a fait face à l’autre comme colonisateur, comme dominateur et parfois même sa mise en dépendance après cette accession à la souveraineté internationale.
Au moment où cette période s’achève a eu lieu le génocide rwandais en 1994. Certes, il y a eu dans ce génocide des interventions extérieures, c’est vrai, qui ont une certaine connexion avec les dominations coloniales, qui ont une certaine connexion avec la période antérieure. Mais mon point de vue est que, à partir de la défaite et de la fin de l’apartheid, à partir de la fin des empires coloniaux dont le dernier, l’empire portugais a été vaincu par des guerres de libération en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert et en Guinée Bissau, à partir de ces moments, s’engage la lutte pour la liberté. Mais les deux, lutte pour la libération et lutte pour la liberté, sont fortement imbriquées, il n’y a pas une césure catégorique mais en tout cas sur les tendances lourdes, il me semble que là il y a une rupture.
Et dans la lutte pour la liberté, on ne fait pas face à l’autre mais on fait face à soi-même. En fait ce qui distingue le libéré du libre, c’est que le libéré a toujours le maitre dans sa tête. Le libre ne pense plus au maître, il affronte les problèmes dans le contexte où il est, en tant que sujet autonome qui ne se définit plus en référence à l’autre. Donc le temps est venu de ne plus écrire en pensant à : en quoi sommes-nous comparables à qui que ce soit, en quoi sommes-nous meilleurs, en quoi avons-nous été premiers… Cette mission a été accomplie et très bien accomplie par les générations antérieures. Les générations actuelles doivent écrire une histoire qui se connecte au regard de soi à soi. Et cette histoire demande une autre approche de l’histoire qui est plus critique et orientée sur les sociétés africaines.
Nous avons, par exemple, beaucoup travaillé sur la traite des esclaves, en l’écrivant d’une certaine façon, en interrogeant son impact géographique, politique, économique, pendant la période où on travaillait sur les terroirs en Sénégambie. C’était un travail important à faire, et cela a été fait et bien fait. Aujourd’hui, si j’ai à aborder la même question et la même période, si je dois l’étudier, je peux l’approcher autrement, comment l’approcher autrement, et cela est en cours quand je regarde les travaux de quelqu’un comme Mamadou Fall. Je peux l’approcher autrement en nous posant la question suivante : Jusqu’aujourd’hui des jeunes africains continuent de prendre des pirogues, de traverser le Sahara, cette fois-ci non pas dans des bateaux négriers, ou dans des caravanes négrières traversant le Sahara, mais par leur propre fait, en tout
cas, en tant que sujet jeune. Ils embarquent dans une aventure qui fait mourir, dans l’Atlantique ou dans la méditerranée, des milliers d’Africains, et des jeunes particulièrement qui sont les forces vives des sociétés africaines.
Quelle est la configuration des forces socio-politiques, économiques, culturelles qui expliquent ces mouvements ? je vais réinterroger la période de la traite transatlantique à la lumière des questions qui sont posées à ces jeunes-là, et à ce niveau la question qui m’interpelle, c’est ce que j’ai entendu dire par un jeune ivoirien, « si le poisson sort de l’eau pour mourir sur la berge, c’est qu’il fait très chaud sous l’eau » et ça c’est tout un programme pour les historiens, pour les sociologues, pour les psychologues et pour toutes les disciplines universitaires. Il me semble qu’on est dans un temps où on peut écrire une autre histoire sur la même période avec de nouvelles questions, qui nous sont posées par l’actualité et par nos sociétés.
TA: En réponse au discours de Dakar de Sarkozy du 26 juillet 2007, vous avez écrit « L’histoire vue d’Afrique, enjeux et perspectives ». Pouvez-vous revenir sur cet incident diplomatique et quelles en furent selon vous les conséquences ?
Le discours de Sarkozy à Dakar ne m’a pas surpris. Pourquoi ? Mon point de départ a été celui-ci : C’est avec la France ou bien sur initiative française qui se décline après la traite des esclaves et après les agissements structurels du 19ème siècle, que l’on somme les africains de s’adapter au nouveau contexte économique, né de l’abolition de la traite des esclaves - et pas de l’abolition de l’esclavage encore une fois, il faut les distinguer, l’une se met en 1815, l’autre en 1848 pour la France. La crise qui nait de cette période permet à l’Occident de construire les légitimités de la colonisation, et de la fonder idéologiquement.
Ce sont davantage les intérêts géopolitiques et économiques qui ont été plus prégnant pour décider de la colonisation que les justificatifs qui ont été donnés par ses initiateurs. Cela a continué de mettre l’Afrique en dépendance par rapport à l’Europe sous la forme d’empires coloniaux concurrents ou en tout cas coexistant, britannique, portugais, français. A partir de ce moment, la production de ce discours a produit une image de l’Afrique dans l’opinion française qui a été nourrie pour des générations, des générations par des ouvrages scolaires enseignés dans les écoles. Nous formions qu’un avec la métropole. Nous étions dans le même empire et au sein de l’empire circulent des hommes, des idées, des objets.
Et le regard que les uns et les autres portent sur ces idées, ces objets et ces personnes en circulation avec tous les échanges, tous les processus, toute la dynamique historique que charrie ce processus au sein de l’empire, se sont formées des consciences, dans les écoles, dans les armées, dans les expériences historiques de l’administration coloniale ; des médias qui formatent une opinion européenne à qui on donne une image de l’Afrique avec des expositions coloniales ; tout cela a permis de formater une opinion très largement partagée par l’Europe pendant la période coloniale.
Dans les années 1960, se pose la question de la décolonisation. Mais l’Europe, en particulier les puissances coloniales, considère que c’est l’Afrique qu’il faut décoloniser, en oubliant que les métropoles étaient dans l’empire colonial, et qu’il fallait également décoloniser les métropoles. Donc la décolonisation a plus porté sur un acte politique qui était même de l’intérêt des puissances coloniales parce qu’il fallait désormais éviter la guerre. Elle a éclaté au Cameroun, l’Indochine était passé par là, l’Algérie éclate en 1954. Et de plus en plus, les colonisés demandent à être traités sur un pied d’égalité avec les métropolitains : droit de vote, syndicat, niveau de vie. L’empire ne pouvant pas satisfaire cette demande a eu une politique de retrait qui était tout à son avantage parce que la métropole conservait tous ses avantages géostratégiques et économiques, sans avoir à prendre en charge la satisfaction des revendications du mouvement social dans les colonies. C’est ça qui est à l’origine des indépendances des années 1960, qui a été disons la lutte des colonisés : imposer la satisfaction de cette demande, ou de trouver une stratégie de retraite tout en gardant les avantages de la métropole.
C’est cela qu’on a appelé la décolonisation. Elle a plus porté sur les colonies. Une fois l’indépendance acquise, la mise en œuvre progressivement des nouvelles politiques scolaires, la construction d’une nouvelle conscience dans les anciennes colonies devenues des Etats indépendants a pu être possible. En revanche, en métropole, l’image et l’opinion qu’on avait de l’africain se sont pour ainsi dire sclérosées. La métropole a gardé la même opinion, la même conscience généralement partagée. On n’a pas décolonisé les livres, on n’a pas décolonisé les manuels scolaires, on n’a pas décolonisé les médias métropolitains, on n’a pas décolonisé les consciences métropolitaines. Et la plupart des électeurs de Sarkozy ont été formatés dans cette opinion, et c’est ce qu’ils pensent de l’Afrique.
Donc Sarkozy, dans son discours de Dakar, ne s’adressait pas aux africains, il s’adressait à son électorat. Mais nous africains, nous sommes capables de nous adresser à nous-mêmes. Certes, son discours était choquant, dans le contexte dans lequel il a été prononcé, mais on aurait pu beaucoup plus l’ignorer. Et je crois que c’est un mois après, à la même place où s’est tenu Sarkozy pour tenir son discours, qu’un historien américain, spécialiste de l’Afrique, en conversation avec les historiens africains depuis très longtemps, à la même tribune, recevait le titre de Doctorat honoris causa de l’université de Dakar. Ce dernier a déclaré à cette cérémonie, quelque chose qui était, à mon sens, la meilleure des réponses au discours de Sarkozy. Il a dit, en substance ceci : le discours de Sarkozy date du 19ème siècle, c’est le discours d’un ignorant au 21ème siècle. Laissons les hommes, les universitaires, les intellectuels, de la Sénégambie du 19ème siècle lui répondre. La France a plus intérêt à sortir de cette conscience du 19ème siècle que les africains ont à réagir à ce genre de discours. Parce que la maladie est du côté de la France, elle n’est pas du côté de l’Afrique.
TA: Vous avez travaillé à l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes, en France, sur un projet de recherche intitulé « Identités chromatiques en Afrique : histoires, héritages et actualité ». Qu’est-ce que recouvre la notion d’identités chromatiques ?





























