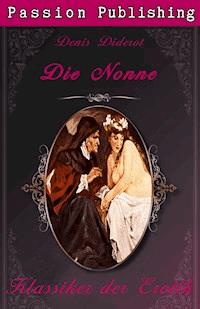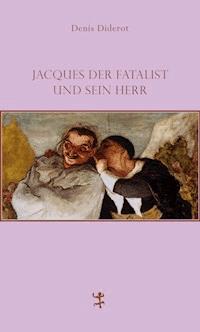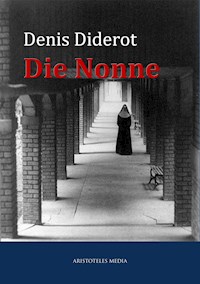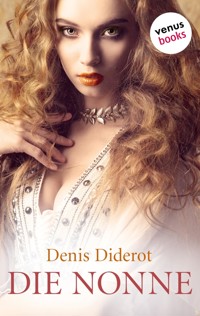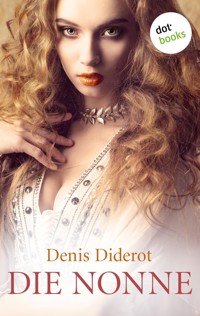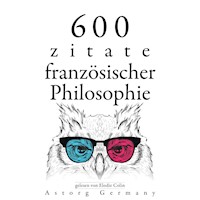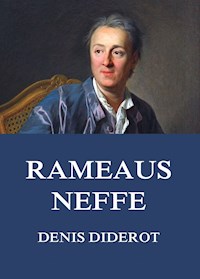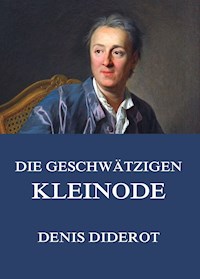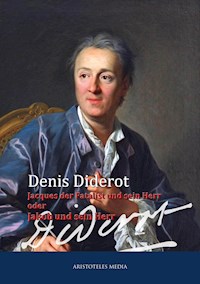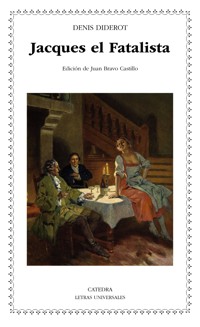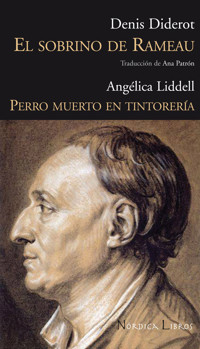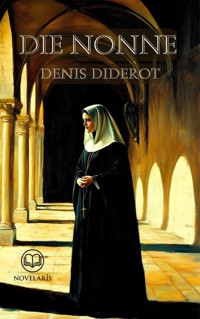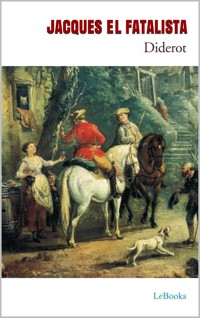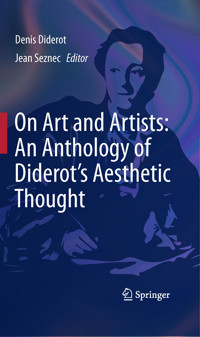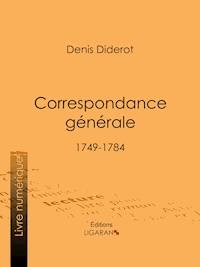
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Lettres de Diderot à Voltaire, Bernard du Châtelet, Jaucourt...
Das E-Book Correspondance Générale wird angeboten von Ligaran und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335017069
©Ligaran 2015
Naigeon, à qui la tâche eût été plus facile qu’à tout autre, n’a point pris la peine de réunir les lettres de Diderot ; l’édition Belin en avait rassemblé dix-neuf auxquelles l’édition Brière joignit, outre les correspondances avec Le Monnier et Mlle Jodin, douze lettres inédites, ainsi que divers billets ou réponses de Voltaire, Rousseau, Galiani, Mme Riccoboni. Nous en offrons près du triple ; dans ce nombre trente environ sont inédites, et le reste était dispersé dans des recueils peu consultés ou dans des publications plus récentes.
Ce résultat n’est pas tel, certes, que nous l’eussions souhaité ; mais nous sommes bien forcé d’arrêter là des investigations poursuivies pendant plus de trois années, et, sans vouloir fatiguer le lecteur du récit de nos déceptions ou des péripéties de nos recherches, nous citerons les noms de ceux qui se sont faits nos collaborateurs bénévoles.
Tout d’abord, nous ne ferons aucune difficulté de reconnaître que nous devons un avantage ainsi marqué sur nos prédécesseurs au goût des autographes, qui, à peine soupçonné il y a cinquante ans, a, de nos jours, presque renouvelé l’érudition historique et littéraire. Aussi les premiers noms que nous devons inscrire ici sont ceux des dignes représentants de la science créée par Jacques Charavay et Auguste Laverdet. Le successeur de celui-ci, M. Gabriel Charavay, a mis à notre disposition les exemplaires annotés des ventes qu’ils ont dirigées ; quant à M. Étienne Charavay, non content de nous prodiguer les indications les plus utiles, il a usé de la légitime considération dont l’honorent les amateurs pour nous procurer l’accès de collections que nous n’espérions pas toujours voir s’ouvrir.
C’est ainsi que le doyen des amateurs parisiens, M. Boutron-Charlard, nous a permis de copier une épître très flatteuse au président de Brosses et un bulletin de victoire, tout brûlant d’enthousiasme, adressé à Voltaire, lors de la première représentation, à Paris, du Père de Famille ; c’est ainsi que M. Alfred Sensier nous a communiqué, outre la lettre à Le Monnier qui figure plus haut, quelques piquants billets à Suard ; c’est ainsi encore que le regretté M. Rathery a, par le prêt de lettres à Langeac et à Sartine, comblé deux des lacunes trop nombreuses que nous révélaient les catalogues de ventes.
M. Moulin, à qui nous devons une autre lettre à Sartine, nous engageait à aller frapper à la porte de M. le marquis de Fiers, et, tout aussitôt, celui-ci mettait sous nos yeux trois lettres à l’abbé Gayet de Sansale, qui forment un véritable petit drame judiciaire. Sur la recommandation de M. Ch. -L. Livet, M. le baron de Boyer de Sainte-Suzanne autorisait, dans les termes les plus gracieux, la reproduction de quatre longues lettres relatives au séjour et au retour de Russie.
C’est de Saint-Pétersbourg même que M. Howyn de Tranchère nous faisait connaître en quels termes Diderot posait sa candidature à l’Académie impériale des arts. M. Dubrunfaut, à qui M. Assézat devait de pouvoir collationner le texte de Jacques sur une copie ancienne, lui remettait en même temps diverses lettres inédites à Grimm et à Suard.
M. le duc de Broglie empruntait à ses archives de famille un intéressant remerciement du philosophe à Mme Necker.
Au moment de se séparer de sa magnifique collection, M. Benjamin Fillon nous permettait de prendre copie d’une curieuse lettre de recommandation adressée aussi à cette femme célèbre dont le salon fut un des derniers qu’il fréquenta dans sa vieillesse.
Une requête conservée à la Bibliothèque nationale (Département des manuscrits, réserve) nous révélait que Diderot prenait, à Vincennes même, sur l’Histoire naturelle, des notes qu’il demandait la permission d’offrir à Buffon ; la bibliothèque Victor Cousin nous fournissait deux réponses, fort différentes par la date et le contenu, à Jaucourt et à Mercer, et nous permettait de rétablir, dans une lettre à Voltaire, tout un passage où Diderot osait le combattre sur sa haine pour Shakespeare.
On trouvera, d’ailleurs, au bas de chaque pièce nouvelle, le nom de son possesseur ou l’indication de sa provenance, renseignement qui nous a parfois manqué pour les lettres contenues dans les éditions Belin et Brière.
Nous avons suivi, pour le classement, l’ordre chronologique même lorsque, malgré l’absence fréquente des dates, le contenu de la lettre ou le nom du destinataire nous éclairait sur l’époque où elle avait dû être écrite, et nous avons rejeté aux dernières pages quelques billets que nous aurions été contraint de placer arbitrairement, si nous les eussions supposé écrits à-tel moment ou adressés à tel personnage.
Quant aux desiderata dont, plus que personne, nous connaissons le nombre et l’importance, l’un des appendices du vingtième volume renfermera tout au moins, sur ceux qui nous auront définitivement échappé, des renseignements que nos successeurs mettront peut-être un jour à profit. Jusque-là, nous voulons espérer que nos derniers appels aux détenteurs de certains autographes seront entendus.
11 juin 1749
Le moment où j’ai reçu votre lettre, monsieur et cher maître, a été un des moments les plus doux de ma vie ; je vous suis infiniment obligé du présent que vous y avez joint. Vous ne pouviez envoyer votre ouvrage à quelqu’un qui fût plus admirateur que moi. On conserve précieusement les marques de la bienveillance des grands ; pour moi, qui ne connais guère de distinction réelle entre les hommes que celles que les qualités personnelles y mettent, je place ce témoignage de votre estime autant au-dessus des marques de la faveur des grands que les grands sont au-dessous de vous. Que ce peuple pense à présent de ma Lettre sur les Aveugles tout ce qu’il voudra ; elle ne vous a pas déplu ; mes amis la trouvent bonne : cela me suffit.
Le sentiment de Saunderson n’est pas plus mon sentiment que le vôtre ; mais ce pourrait bien être parce que je vois. Ces rapports qui nous frappent si vivement n’ont pas le même éclat pour un aveugle : il vit dans une obscurité perpétuelle ; et cette obscurité doit ajouter beaucoup de force pour lui à ses raisons métaphysiques. C’est ordinairement pendant la nuit que s’élèvent les vapeurs qui obscurcissent en moi l’existence de Dieu ; le lever du soleil les dissipe toujours ; mais les ténèbres durent pour un aveugle, et le soleil ne se lève que pour ceux qui voient. Il ne faut pas que vous imaginiez que Saunderson dût apercevoir ce que vous eussiez aperçu à sa place : vous ne pouvez vous substituer à personne sans changer totalement l’état de la question.
Voici quelques raisonnements que je n’aurais pas manqué de prêter à Saunderson, sans la crainte que j’ai de ceux que vous m’avez si bien peints.
S’il n’y avait jamais eu d’êtres, lui aurais-je fait dire, il n’y en aurait jamais eu ; car pour se donner l’existence il faut agir, et pour agir il faut être : s’il n’y avait jamais eu que des êtres matériels, il n’y aurait jamais eu d’êtres spirituels ; car les êtres spirituels se seraient donné l’existence ou l’auraient reçue des êtres matériels, ils en seraient des modes ou du moins des effets, ce qui n’est point du tout votre compte. Mais s’il n’y avait jamais eu que des êtres spirituels, vous allez voir qu’il n’y aurait jamais eu d’êtres matériels. La bonne philosophie ne me permet de supposer dans les choses que ce que j’y aperçois distinctement ; mais je n’aperçois distinctement d’autres facultés dans l’esprit que celles de vouloir et de penser, et je ne conçois non plus que la pensée et la volonté puissent agir sur les êtres matériels ou sur le néant, que le néant et les êtres matériels sur les êtres spirituels. Prétendre qu’il ne peut y avoir d’action du néant et des êtres matériels sur les êtres purement spirituels, parce qu’on n’a nulle perception de la possibilité de cette action, c’est convenir qu’il ne peut y avoir d’action des êtres purement spirituels sur les êtres corporels ; car la possibilité de cette action ne se conçoit pas davantage. Il s’ensuit donc de cet aveu et de mon raisonnement, continuerait Saunderson, que l’être corporel n’est pas moins indépendant de l’être spirituel que l’être spirituel de l’être corporel, qu’ils composent ensemble l’univers, et que l’univers est Dieu. Quelle force n’ajouterait point à ce raisonnement l’opinion qui vous est commune avec Locke : que la pensée pourrait bien être une modification de la matière !
Mais, lui répliquerez-vous, et ces rapports infinis que je découvre dans les choses, et cet ordre merveilleux qui se montre de tous côtés ; qu’en penserai-je ? – Que ce sont des êtres métaphysiques qui n’existent que dans votre esprit, vous répondrait-il. On remplit un vaste terrain de décombres jetés au hasard, mais entre lesquels le ver et la fourmi trouvent des habitations fort commodes ; que diriez-vous de ces insectes, si, prenant pour des êtres réels les rapports des lieux qu’ils habitent avec leur organisation, ils s’extasiaient sur la beauté de cette architecture souterraine, et sur l’intelligence supérieure du jardinier qui a disposé les choses pour eux ?
Ah ! monsieur, qu’il est facile à un aveugle de se perdre dans un labyrinthe de raisonnements semblables, et de mourir athée, ce qui toutefois n’arriva point à Saunderson ! Il se recommanda, en mourant, au dieu de Clarke, de Leibnitz et de Newton, comme les Israélites se recommandaient au dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, parce qu’il est à peu près dans une position semblable ; je lui laisse ce qui reste aux sceptiques les plus déterminés, toujours quelque espérance qu’ils se trompent ; mais que cela soit ou non, je ne suis point de leur avis. Je crois en Dieu, quoique je vive très bien avec les athées. Je me suis aperçu que les charmes de l’ordre les captivaient malgré qu’ils en eussent ; qu’ils étaient enthousiastes du beau et du bon, et qu’ils ne pouvaient, quand ils avaient du goût, ni supporter un mauvais livre, ni entendre patiemment un mauvais concert, ni souffrir dans leur cabinet un mauvais tableau, ni faire une mauvaise action : en voilà tout autant qu’il m’en faut ! Ils disent que tout est nécessité. Selon eux, un homme qui les offense ne les offense pas plus librement que ne les blesse la tuile qui se détache et qui leur tombe sur la tête : mais ils ne confondent point ces causes, et jamais ils ne s’indignent contre la tuile, autre conséquence qui me rassure. Il est donc très important de ne pas prendre de la ciguë pour du persil, mais nullement de croire ou de ne pas croire en Dieu : « Le monde, disait Montaigne, est un esteuf qu’il a abandonné à peloter aux philosophes », et j’en dis presque autant de Dieu même. Adieu, mon cher maître.
À Vincennes, ce 30 septembre 1749
Monsieur,
Lorsque vous me fîtes sortir du Donjon, vous eûtes la bonté de me promettre que les cahiers que j’y avais écrits me seraient rendus. Si vous les avez parcourus, vous vous serez aperçu que des observations, bonnes ou mauvaises, sur l’Histoire naturelle composent la plus grande partie de ce qu’ils contiennent. On travaille actuellement à une seconde édition de cet ouvrage, et je serais bien aise de communiquer mes remarques à M. de Buffon pour qu’il en fît l’usage qu’il jugerait à propos. Voilà, monsieur, la seule raison que j’aie de vous redemander des matériaux informes, dont je ne fais pas grand cas dans l’état où ils sont, mais qui peuvent devenir meilleurs. e vous supplie de me continuer les marques de votre bienveillance auprès de M. d’Argenson, car j’en ai plus besoin que jamais.
J’ai l’honneur d’être, monsieur, etc.
Je vous dois, monsieur, en mon particulier, un remerciement pour l’article Anatomie. J’emploierai votre article Bysse, ceux que M. David m’a fait passer de votre part et les autres que vous voudrez bien nous communiquer ; et je n’ignore pas ce que notre Dictionnaire y gagnera. Je serai bien charmé d’avoir l’honneur de vous voir chez moi, mais permettez que je vous fasse une visite. Nous causerons chez vous plus à notre aise, et je veux mettre à profit cette conversation même pour la perfection de notre ouvrage. Je serai chez vous, dimanche matin prochain, entre neuf et dix. En attendant, je suis, avec toute l’estime et le respect que l’on doit aux hommes de votre mérite, monsieur, etc.
Si le jour et l’heure que je prends ne vous conviennent pas, vous pouvez m’en marquer d’autres.
Paris, 5 mars 1751
Monsieur,
On ne peut être plus sensible que je le suis à l’honneur que vous m’annoncez.
Pour savoir à quel titre je dois l’accepter, je n’ai qu’à me juger en parcourant les noms célèbres auxquels l’Académie n’a pas dédaigné de joindre le mien. Il est heureux que pour la seule fois qu’elle eut à se relâcher de ses maximes, ce fut en ma faveur ; et qu’elle ait accordé à l’espérance d’encourager en moi quelque talent ce qu’on n’avait obtenu d’elle, jusqu’à ce jour, que sur des preuves d’un mérite supérieur.
Tels sont, monsieur, les sentiments avec lesquels j’ai reçu son diplôme et que je vous supplie de lui rendre dans les expressions les plus fortes. Moins j’avais lieu de m’attendre à une grâce de sa part, plus j’en dois être pénétré.
Mous nous sommes promis, mon illustre collègue M. d’Alembert et moi, de lui présenter les volumes de l’Encyclopédie à mesure qu’ils seront publiés. L’avantage que j’ai d’appartenir à un corps aussi illustre m’est une forte raison pour souhaiter qu’entre les articles que j’ai faits dans cet ouvrage il s’en rencontre quelques-uns qui ne soient pas indignes de paraître à côté des vôtres.
Je suis avec dévouement et respect, monsieur, etc.
(Sans date)
Monsieur,
Il me faudrait un an et un gros livre pour y mettre autant d’esprit que vous en avez mis dans la lettre obligeante que vous avez la bonté de m’écrire, mais il ne faut qu’un moment et l’amour de la vérité pour vous assurer combien je suis sensible à cette marque de bonté. La personne par laquelle vous m’avez fait tenir cette lettre vous en dira là-dessus bien plus que je ne peux vous en exprimer. Il y a des choses qu’il faut voir, monsieur et révérend Père, et les signes de joie que j’ai ressentis quand on m’a annoncé quelque chose de votre part sont de ce nombre.
Je puis donc compter deux moments doux dans ma vie. L’un me fut procuré quand mon aveugle clairvoyant parut ; cette lettre m’en valut une autre de Mme la marquise du Châtelet et mon sourd-muet m’en vaut une autre de vous. Mais, au nom de Dieu, mon révérend Père, à quoi pense le P. Berthier de persécuter un honnête homme qui n’a d’ennemis dans la société que ceux qu’il s’est fait par son attachement pour la compagnie de Jésus et qui, tout mécontent qu’il en doit être, vient de repousser avec le dernier mépris les armes qu’on lui offrait contre elle ? Vous le dirai-je, mon révérend Père ? Sans doute, je vous le dirai, car vous êtes un homme vrai, et par conséquent disposé à prendre les autres pour tels. À peine mes deux lettres eurent-elles paru, que je reçus un billet conçu en ces termes : « Si M. Diderot veut se venger des Jésuites, on a de l’argent et des mémoires à son service ; il est honnête homme, on le sait ; il n’a qu’à dire : on attend sa réponse. » Cette réponse attendue, la voici : « Je saurai bien me tirer de ma querelle avec le P. Berthier sans le secours de personne ; je n’ai point d’argent, mais je n’en ai que faire. Quant aux mémoires que l’on m’offre, je n’en pourrai faire usage qu’après les avoir très sérieusement examinés et je n’en ai pas le temps. »
Jugez-nous actuellement le P. Berthier et moi, vous, mon révérend Père, qui joignez tant d’équité à tant de discernement.
Je suis, monsieur et révérend Père, avec le respect le plus profond et toute la vénération qu’on doit aux hommes supérieurs, etc.
2 juillet 1751
Monsieur,
Je ne connais rien de si fin et de si délié et qui marque tant de goût et tant de précision que vos observations ; vous avez raison partout. Les deux Ajax sont mal dessinés, mais c’est leur faute et non la mienne. Quant à la nuit de Vernet, je conviens que, tout admirable qu’elle soit dans son tableau, elle n’avait pas la majesté ni le pathétique de la nature, ce qui signifie tout au plus que mon exemple est mal choisi, mais ce qui n’empêche pas mon principe d’être vrai. Il est certain, je crois, que toutes les fois que le plaisir réfléchi se joindra au plaisir de la sensation, je dois être plus vivement affecté que si je n’éprouvais que l’un ou l’autre. Je viens de recevoir de bien loin une autre lettre sur la même matière, et l’on me propose à cette occasion cinq ou six questions bien délicates à discuter ; mais comment faire au milieu des énormes occupations dont je suis accablé ? Si cependant je pouvais dérober un moment à l’Encyclopédie, je ne dis pas qu’il ne m’échappât une troisième lettre qui, grâce à vous, monsieur, et à votre esprit (car c’est le caractère de ceux qui en ont vraiment d’en donner aux autres) ne fût bien supérieure aux précédentes. En tout cas, je devrais à la part que vous auriez à cette lettre tout au moins l’attention de vous la communiquer manuscrite et je n’y manquerai pas.
Mais revenons aux deux autres ; je suis bien fâché que vous n’ayez pas été chargé de les faire connaître au public ; il y aurait gagné et je n’aurais pas perdu ; vous avez si bien saisi ce qu’il peut y avoir de bon dans ces petits écrits, que, tout en marquant ce qu’il y a de faible et de mauvais, il se fût fait dans votre examen une moyenne de critique et d’éloge dont j’aurais été bien content ; car j’aime surtout la vérité et la vertu, et quand ces deux qualités se réunissent dans un même homme, il va dans mon esprit de pair avec les dieux. Jugez donc, monsieur, des sentiments de dévouement et de respect que je dois avoir pour vous. Pardonnez-moi ce laconisme, mais d’ici à trois ans et demi, si je goûte quelque plaisir, ce ne sera guère qu’à la dérobée. J’ai l’honneur d’être, etc.
16 décembre 1752
Notre ami M. d’Alembert me renvoie à vous, monsieur, pour avoir l’Apologie de milord Bolingbroke et le Tombeau de la Sorbonne. Si vous me procurez la lecture de ces deux brochures, je vous en serai très obligé. Je sais qu’elles sont rares.
1754
Madame,
Je crains toute épithète et ne mérite point celle de philosophe ; je ne suis ni d’âge ni d’étoffe à faire un Caton, et il est cent occasions où je serais bien fâché qu’une femme aimable n’eût à louer que ma sagesse.
Pour poète, je ne me souviens pas d’avoir sommeillé sur le Parnasse assez longtemps pour être à mon réveil salué de ce nom.
Le titre de musicien ne me va pas plus. Il y a cinq ou six ans que j’ai perdu le peu de voix que j’avais, pour la raison que nous ne pratiquons pas en France la méthode de la faire durer autant qu’en Italie.
La stérilité du menton est donc la seule qualité qui soit commune entre Phébus et moi. Aussi ses malheurs ne me touchent-ils guère, et je vous jure que si j’avais vécu comme lui avec neuf pucelles et qu’elles eussent la même bonne volonté pour moi, mortel chétif, j’aurais mieux employé mon temps que ce dieu.
Quant à Daphné, vous conviendrez que cette fille était de mauvais goût, et qu’avec toutes les raisons qu’elle avait de se défier d’un chanteur qui allait jusqu’au la, il valait mieux risquer d’être déesse que de s’exposer à devenir laurier et faire la récompense de l’amant que la couronne du poète.
Enfin, madame, je n’ai ni les vices ni les vertus d’Apollon, seul de ses frères à qui leur père ait accordé un équipage et même assez brillant. Il tranchait du petit-maître et personne ne l’est moins que je ne le suis. Né jaloux jusqu’à la fureur, il fit à Vénus une tracasserie dont je suis incapable, car si je ne parviens pas à me procurer le bonheur de Mars, je ne suis pas homme à donner à Vulcain avis de son malheur.
À Paris, ce (sic) janvier 1755
Monsieur,
C’est dans l’état où était votre manuscrit sur la matière étymologique et non dans celui où vous vous proposez de le porter que j’en ai été enchanté. Je serais trop difficile si je ne demandais un mieux que je ne conçois pas. Je l’accepte donc comme je l’ai vu et comme il est, et je l’accepte avec toutes les conditions que vous y mettez. Les unes sont trop justes, les autres, nous faisant un devoir de reconnaître devant le public l’obligation que nous aurons, nous sont trop agréables. Ayez donc la bonté de recueillir en notre faveur les fragments dispersés de votre manuscrit et de les adresser à Le Breton, libraire et imprimeur, rue de la Harpe, vis-à-vis de la rue Saint-Séverin. C’est un des associés de l’Encyclopédie.
M. de Buffon m’avait déjà parlé de votre Histoire des terres australes. Je voudrais bien que vous eussiez été à portée d’entendre ce qu’il m’en disait. Le suffrage et les éloges d’un homme tel que lui font la récompense la plus réelle des travaux d’un homme de lettres. Lorsque vos occupations vous permettront de mettre la dernière main à votre morceau sur l’étymologie, je serais très flatté d’en être l’éditeur, si vous m’estimez toujours assez pour me conserver ce titre ; mais en attendant que vous puissiez le publier séparément, c’est un service dont je sens tout le prix que la liberté que vous nous accordez de le faire connaître. Je vous réponds au nom de tous ceux qui veulent bien coopérer à la perfection de notre Dictionnaire. Il n’y en a aucun qui ne doive craindre de voir votre travail à côté du sien, mais il n’y en a aucun qui ne doive s’en tenir honoré. Je suis avec un profond respect, monsieur, etc.
Paris, 1756
Comme je suis très sensible aux belles choses, depuis, monsieur, que j’ai vu votre Mort, votre Hercule, votre France, et vos Animaux, j’en suis obsédé. J’ai beaucoup pensé aux critiques qu’on vous a faites, et je me crois obligé en conscience de vous avertir que celles qui tombent sur votre Amour ne marquent pas une véritable idée du sublime dans les personnes à qui elles se sont présentées ; que ces critiques passeront, et que ce casque dont vous aurez couvert la tête de votre enfant restera et détruira en partie ce contraste du doux et du terrible que quelques artistes anciens ont si bien connu, et qui produit toujours le frémissement dans ceux qui sont faits pour admirer leurs ouvrages… Celui qui saura voir sera frappé dans le vôtre d’un enfant et d’une femme en pleurs, mis en opposition ici avec votre Hercule, là avec un spectre effrayant ; d’un autre côté, avec ces animaux que vous avez si bien renversés les uns sur les autres. Supprimez cette figure, plus d’harmonie dans la composition ; les autres figures seront désunies ; la France, adossée à de grands drapeaux nus, n’aura plus d’effet, et l’œil sera choqué de rencontrer presque dans une ligne droite, dont rien ne rompra la direction, trois têtes de suite, celles du Maréchal, de la France et de la Mort. Transformez cet Amour en un génie de la guerre, et vous n’aurez plus qu’une seule figure douce et pathétique contre un grand nombre de natures fortes et de figures terribles. J’en appelle à vos yeux et à ceux du premier homme de goût que vous placerez devant votre ouvrage, et qui voudra bien se transporter au-delà du moment présent. J’ajouterai que le symbole de la guerre sera double, et que ce second symbole, déjà superflu par lui-même, sera encore équivoque ; car, pourquoi ne prendrait-on pas sous un casque un enfant avec son flambeau pour ce qu’il est en effet, pour un Amour déguisé ? Pour Dieu, monsieur, laissez cet enfant ce que votre génie l’a fait.
Je suis sûr que ce que je vous dis, la postérité le verra, le sentira, le dira ; et n’allez pas croire qu’elle examine jamais avec nos caillettes de Paris et nos aristarques modernes, si décents et si petits, en quel lieu le Maréchal allait prendre les femmes qu’il destinait à ses plaisirs. L’Amour entre dans les compositions les plus nobles, antiques et modernes : il n’eût point été déplacé sur le tombeau d’Hercule ; cet Hercule fut sa plus grande victime. L’Amour eût marqué dans un pareil monument, comme dans le vôtre, que ce héros, de même que votre Maréchal, avait eu la passion des femmes, et que cette passion lui avait ôté la vie au milieu de ses triomphes. Adieu, monsieur. Quand on sait produire de belles choses, il ne faut pas les abandonner avec faiblesse. Un grand artiste comme vous doit s’en rapporter à lui-même plus qu’à personne. Et croyez-vous, monsieur, que s’il s’agissait d’avoir son avis et de le préférer à celui du maître dont on juge la composition, je n’aurais pas eu le mien comme un autre ? Selon mon goût à moi, par exemple, la Mort, courbée sur le tombeau, la main gauche appuyée sur le devant et relevant la pierre de la main droite, aurait été tout entière à cette action ; elle n’eût ni regardé le héros, ni entendu la France : la mort est aveugle et sourde. Son moment vient, et la tombe se trouve ouverte. J’aurais laissé tomber mollement les bras du Maréchal, et il serait descendu en tournant la tête avec quelque regret sur les symboles d’une gloire qu’il laissait après lui : il en eût été plus pathétique et plus vrai ; car, quelque héros qu’on soit, on a toujours du regret à mourir. Le reste du monument serait demeuré comme il est, excepté peut-être que j’aurais couvert les os du squelette d’une peau sèche qui en aurait laissé voir les nodus, et qu’on n’en aurait aperçu que les pieds, les mains et le bas du visage. C’eût été un être vivant ; cet être en fût devenu plus terrible encore ; et l’on eût sauvé l’absurdité de faire voir, entendre et parler un fantôme qui n’a ni langue, ni yeux, ni oreilles. Voilà, monsieur, ce que j’aurais voulu ; mais j’ai pensé que quand un grand ouvrage était porté à un haut point de perfection, et que l’effet en était grand, il valait mieux se taire que de jeter de l’incertitude dans les idées de l’artiste, que de l’exposer à gâter un chef-d’œuvre. Je vous conseille donc de ne faire aucune attention à ce que je viens d’avoir la témérité de vous dire, et de laisser votre monument tel qu’il est. Ce sera toujours un des plus beaux morceaux de sculpture qu’il y ait en Europe. Je suis, etc.
29 juin 1756
Il y a, mon cher, tant de griefs dans votre lettre, qu’un gros volume, tel que je suis condamné d’en faire, m’acquitterait à peine, si je donnais à chaque chose plus de quatre mots de réponse que vous me demandez. Si vous êtes toujours aussi pressé de secours que vous le dites, pourquoi attendez-vous à la dernière extrémité pour les appeler ? Vos amis ont assez d’honnêteté et de délicatesse pour vous prévenir ; mais, errant comme vous êtes, ils ne savent jamais où vous prendre. On n’obtint pas la première rescription qui vous fut envoyée aussi promptement qu’on l’aurait désiré, parce qu’on n’en accorde point pour des sommes aussi modiques ; elle était datée du 17, elle ne fut remise à D… que le 18, et à moi que le 19 ; le 20 les lettres ne partaient pas : ajoutez à ces délais sept à huit jours de poste, et vous retrouverez ces douze jours de retard que vous me reprochez… Que je me suppose le patient si je peux. Et depuis trois ou quatre ans que je ne reçois que des injures en retour de mon attachement pour vous, ne le suis-je pas ? Et ne faut-il pas que je me mette à tout moment à votre place pour les oublier, ou n’y voir que les effets naturels d’un tempérament aigri par les disgrâces et devenu féroce ?… Je ne vous répondis point, je n’envoyai point le mot de recommandation pour M. de V… ; c’est que j’avais résolu de vous servir et de ne plus vous écrire. Je ne connais point V… ; je l’aurais connu, que je ne vous aurais point adressé à lui. Cet homme est dangereux, et vous eussiez fait à frais communs des imprudences dont vous eussiez porté toute la peine. Voilà les raisons de mon silence. Je me soucie peu, dites-vous, de la manière dont vous voyez mes procédés ; il est vrai que je me soucie beaucoup plus qu’ils soient bons. Tant que je n’aurai point de reproches à me faire, je serai peu touché des vôtres. Le point important, mon ami, c’est que l’injustice ne soit pas de mon côté. Je passe par-dessus les cinq ou six lignes qui suivent, parce qu’elles n’ont point le sens commun. Si un homme a cent bonnes raisons, il peut en avoir une mauvaise ; c’est toujours à celle-ci que vous vous en tenez.
Mais, venons à l’affaire de votre manuscrit ; c’est un ouvrage capable de me perdre ; c’est après m’avoir chargé à deux reprises des outrages les plus atroces et les plus réfléchis que vous m’en proposez la révision et l’impression. Vous n’ignoriez pas que j’avais femme et enfant, que j’étais noté, que vous me mettiez dans le cas des récidives : n’importe, vous ne faites aucune de ces considérations, ou vous les négligez ; vous me prenez pour un imbécile, ou vous en êtes un ; mais vous n’êtes point un imbécile. L’on doit n’exiger jamais d’un autre ce que vous ne feriez pas pour lui, ou soumettez-vous à des soupçons de finesse ou d’injustice. Je vois les projets des hommes, et je m’y prête souvent, sans daigner les désabuser sur la stupidité qu’ils me supposent. Il suffit que j’aperçoive dans leur objet une grande utilité pour eux, assez peu d’inconvénient pour moi. Ce n’est pas moi qui suis une bête, toutes les fois qu’on me prend pour tel.
Aux yeux du peuple, votre morale est détestable ; c’est de la petite morale, moitié vraie, moitié fausse, moitié étroite aux yeux du philosophe. Si j’étais un homme à sermons et à messes, je vous dirais : ma vertu ne détruit point mes passions ; elle les tempère seulement, et les empêche de franchir les lois de la droite raison. Je connais tous les avantages prétendus d’un sophisme et d’un mauvais procédé, d’un sophisme bien délicat, d’un procédé bien obscur, bien ténébreux ; mais je trouve en moi une égale répugnance à mal raisonner et à mal faire. Je suis entre deux puissances dont l’une me montre le bien et l’autre m’incline vers le mal. Il faut prendre parti. Dans les commencements le moment du combat est cruel, mais la peine s’affaiblit avec le temps ; il en vient un où le sacrifice de la passion ne coûte plus rien ; je puis même assurer par expérience qu’il est doux : on en prend à ses propres yeux tant de grandeur et de dignité ! La vertu est une maîtresse à laquelle on s’attache autant par ce qu’on fait pour elle que par les charmes qu’on lui croit. Malheur à vous si la pratique du bien ne vous est pas assez familière, et si vous n’êtes pas assez en fonds de bonnes actions pour en être vain, pour vous en complimenter sans cesse, pour vous enivrer de cette vapeur et pour en être fanatique.
Nous recevons, dites-vous, la vertu comme le malade reçoit un remède, auquel il préférerait, s’il en était cru, toute autre chose qui flatterait son appétit. Cela est vrai d’un malade insensé : malgré cela, si ce malade avait eu le mérite de découvrir lui-même sa maladie ; celui d’en avoir trouvé, préparé le remède, croyez-vous qu’il balançât à le prendre, quelque amer qu’il fût, et qu’il ne se fît pas un honneur de sa pénétration et de son courage ? Qu’est-ce qu’un homme vertueux ? C’est un homme vain de cette espèce de vanité, et rien de plus. Tout ce que nous faisons, c’est pour nous : nous avons l’air de nous sacrifier, lorsque nous ne faisons que nous satisfaire. Reste à savoir si nous donnerons le nom de sages ou d’insensés à ceux qui se sont fait une manière d’être heureux aussi bizarre en apparence que celle de s’immoler. Pourquoi les appellerions-nous insensés, puisqu’ils sont heureux, et que leur bonheur est si conforme au bonheur des autres ? Certainement ils sont heureux ; car, quoiqu’il leur en coûte, ils sont toujours ce qui leur coûte le moins. Mais si vous voulez bien peser les avantages qu’ils se procurent, et surtout les inconvénients qu’ils évitent, vous aurez bien de la peine à prouver qu’ils sont déraisonnables. Si jamais vous l’entreprenez, n’oubliez pas d’apprécier la considération des autres et celle de soi-même tout ce qu’elles valent : n’oubliez pas non plus qu’une mauvaise action n’est jamais impunie : je dis jamais, parce que la première que l’on commet dispose à une seconde, celle-ci à une troisième, et que c’est ainsi qu’on s’avance peu à peu vers le mépris de ses semblables, le plus grand de tous les maux. Déshonoré dans une société, dira-t-on, je passerai dans une autre où je saurai bien me procurer les honneurs de la vertu : erreur. Est-ce qu’on cesse d’être méchant à volonté ? Après s’être rendu tel, ne s’agit-il que d’aller à cent lieues pour être bon, ou que de s’être dit : je veux l’être ? Le pli est pris, il faut que l’étoffe le garde.