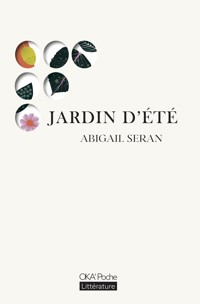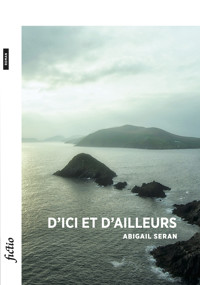
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BSN Press
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« D’autorité, ma mère vint s’asseoir au fond de mon lit. Posture ancienne. Je repliai instinctivement mes jambes, me redressai et calai mon dos contre le mur. Réaction adolescente. Ma gestuelle suffit à ce qu’elle poursuive.
– J’espère que tout se passera bien… »
Léanne devenue Léa se retrouve, trois semaines durant, coincée dans l’appartement de son enfance. Sa mission: rendre des visites quotidiennes à un vieil oncle qui divague, pose des questions étranges. Mise au défi de remonter le fil des mots, Léa s’élancera dans un voyage improbable sur les traces de son passé et de celui de son protégé.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Abigail Seran, écrivaine valaisanne, a reçu le prix de la SEV pour son recueil de nouvelles
Un autre jour, demain (2018). Elle est l’initiatrice du projet "D’écrire ma ville". Avec
D’ici et d’ailleurs, son quatrième roman, intimiste mais ouvert sur l’Irlande, elle traite en premier lieu de la transmission et du rapport à nos aînés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D’ICI ET D’AILLEURS
D’ICI ET D’AILLEURS
Abigail Seran
roman
De la même auteure
Le Big Challenge,BSN Press, 2022 Le Journal d’Antigone,BSN Press, 2022 Un autre jour, demain,Luce Wilquin, 2018 Jardin d’été,Luce Wilquin, 2017 Chroniques d’une maman ordinaire,Favre, 2015Une maison jaune,Plaisir de Lire, 2015Marine et Lila,Plaisir de Lire, 2013
www.abigailseran.com
À ma grand-maman Marie, pour ta main si douce qui a tant tenu la mienne.
Première partie
1
Parfois, je retournais voir ma mère. Obligation filiale qui me ramenait à des rues tristes et pâles. J’évitais soigneusement les gens et les lieux, souvenirs trop lointains, embarrassants. Je garais ma voiture en bas de chez elle, montais les deux étages à pas rapides afin de minimiser le risque de croiser les voisins qui ne manqueraient pas de prendre de mes nouvelles et de déclarer sur un ton mi-dépité, mi-admiratif qu’ils se souvenaient de moi, la petite, que ces souvenirs n’étaient pas si vieux. Et pourtant. Quasi un quart de siècle s’était écoulé. Tout cela était avant. Avant les nuits blanches à m’acharner sur des bouquins aux sujets compliqués, pavés indigestes avalés-digérés-recrachés, avant les jobs mal payés dans des entreprises prestigieuses, avant les échelons hiérarchiques franchis un à un avec hargne. Avant la plaque à mon nom sur la porte de mon bureau, avant l’opéra que je savourais autant que les restaurants gastronomiques dans cette cité qui dormait si peu, si loin de mon enfance. Avant que je ne me sente trop habillée dans cette cage d’escalier qui, en quelques décennies, n’avait su que vieillir, lorsque j’ignorais encore le montant indécent que pouvait coûter un sac de luxe ou une paire de chaussures réputées introuvables et dont seules les initiées enviaient la propriété. Depuis, il y avait eu ce labeur obstiné et cette carrière en pleine ascension qui me permettaient de goûter à ce que je ne savais même pas exister lorsque j’habitais ce bourg que j’avais mis tant d’efforts à quitter. Cet avant presque effacé, qui, par contraste, révélait mes victoires d’aujourd’hui.
Et pourtant, j’allais bien devoir y séjourner à nouveau. Sous contrainte. Je revis la mine réjouie de ma mère, appelant « son » Armand pour le prévenir qu’elle était libérée de ses obligations durant trois longues semaines. Jeu de dupes d’une réponse mal réveillée à ses palabres qu’elle me servait les matins où j’avais exceptionnellement passé une nuit chez elle. Quand elle s’était plainte de devoir refuser le voyage que son amoureux lui faisait miroiter pour cause de devoir auto-imposé, je m’étais écriée que s’il n’y avait que cela, je pouvais bien aller le voir, moi, son frère. Elle avait saisi la fenêtre de tir au vol, dégainé son téléphone pour valider la proposition en officialisant mon accord par communication à témoin. C’est à ce moment-là que je réalisai que je venais de m’infliger vingt jours de pénitence dans ce trois-pièces étriqué en ayant comme unique but de rendre une visite quotidienne à son demi-frère installé en maison de retraite. Ma mère accomplissait cette tâche scrupuleusement tous les jours, expiant ainsi, plus de soixante ans plus tard, le fait que leur père avait abandonné son fils encore adolescent pour épouser ma grand-mère. Depuis un mois je cherchais une excuse pour contrer mon exil. Depuis un mois je savais qu’il me faudrait assumer mon erreur. Même si mon esprit avait tenté de croire à un miracle, s’inventant un mandat de dernière minute, une obligation incompressible. J’étais entre deux jobs, ma mère le savait. Je lui avais distraitement expliqué quelques jours avant cette scène que mon nouvel emploi me laissait deux mois de liberté dont je ne savais encore la destination, moi qui manquais si souvent de temps.
Je respirai un grand coup, attrapai mon thé vert et allai savourer quelques gorgées sur mon petit balcon dominant ma métropole. Il me restait quarante-huit heures pour me préparer à ces trois semaines… Parenthèse ? Expérience sociologique ? Ou mauvais retour en enfance ? Pas encore partie, j’avais déjà hâte de redevenir adulte.
2
Jour-J.
Cette dernière semaine, ma mère m’avait appelée tous les jours. Pour m’indiquer la météo prévue, me donner quelques instructions, me faire part de ses préparatifs, me dire qu’elle avait imprimé son itinéraire, qu’elle avait préparé ma chambre (j’avais absolument refusé de prendre la sienne, l’idée de dormir dans le lit qui l’avait certainement vu forniquer avec Armand me répulsait). Messages, whatsapps, mails, les informations tombaient par tous les canaux possibles. Si ce bombardement devait avoir des vertus apaisantes pour leur émettrice, il provoquait sur moi l’effet drastiquement inverse. J’avais au final annoncé mon arrivée pour la veille de son départ afin qu’elle puisse me transmettre tout élément utile de la main à la main, espérant ainsi faire cesser ce flux de recommandations quasi ininterrompu. En vain. Quand j’étais ressortie de ma matinée spa la veille, j’avais trouvé autant de notes digitales que si j’avais disparu dans une zone de catastrophe naturelle.
Plombée par tous ces renseignements cruciaux et lestée de trois sacs bien lourds, j’allais, à regret, attaquer la montée des escaliers qui menaient au domicile maternel.
– Attendez ! Je vais vous aider !
Je n’eus pas le temps de répondre, une main avait déjà saisi deux de mes bagages.
– Vous allez au deuxième chez Marie-Solange, c’est ça ?
Tout le quartier était donc au courant. Je fus tentée par une réponse acide.
– Nathan. J’habite juste au-dessus. Elle est passée hier soir pour nous annoncer que vous arriviez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas. Maman et moi, on vous donnera un coup de main. Je dépose les sacs sur le palier ?
Je n’eus pas eu le temps de répondre, l’ado leste, dont j’avais souvent entendu parler, mais que vaguement entraperçu par le passé, avait déjà gravi l’étage suivant. Je ne pus que crier un « merci ! » parvenue devant la porte maternelle qui s’ouvrit au même instant. Ma mère avait dû être alertée par notre conversation. Depuis toujours, on entendait tout ce qui se passait dans l’escalier.
– Bonjour ma Léanne !
Je l’embrassai, déposai dans sa petite entrée mes bagages, vis les siens. La connaissant, ils devaient être là depuis des jours. Son grand sac à dos coloré aux côtés de mes sacs en cuir noir et fauve. Nos vies s’entrelaçaient en nouant mon estomac.
3
Tourner, se retourner dans ce lit trop petit. Ce qui d’habitude passait comme une brève bulle, se transformait en punition. Chez moi, le lit était si grand que je pouvais dormir à l’équerre sans qu’aucun pied ne dépasse. Il avait été un de mes premiers investissements, il était mon havre de paix, celui dans lequel je plongeais avec délectation, qui me protégeait du monde, me ressourçait lorsque les tempêtes professionnelles ou privées étaient trop intenses. Ici, dans ce lit de mon enfance, alternativement, je rencontrais le mur ou la table de nuit si par mégarde l’un de mes bras devait choisir de ne pas rester sagement le long du corps. À force de m’agiter, j’eus trop chaud, j’ouvris la fenêtre. Au bout de quelques minutes de courant froid me chatouillant le nez, j’estimai cela trop désagréable et me relevai pour refermer. J’eus soif, décidai d’aller chercher un verre d’eau, me pris les pieds dans l’un de mes sacs dont j’avais décidé de vider le contenu le lendemain. Retarder mon installation…
Je suivis les bruits de la ville, de la rue, des chasses d’eau. Tout ce frétillement sonore qui faisait office d’aide-mémoire enfantin, cette fois, m’insupporta au plus haut point. Dix-neuf nuits de ce traitement. Quelle perspective ! Il y eut deux petits coups secs et ma porte s’entrouvrit. Dérangement bienvenu.
– Tu n’arrives pas à dormir non plus ?
– …
– Je t’entends t’agiter…
D’autorité, ma mère vint s’asseoir au fond de mon lit. Posture ancienne. Je repliai instinctivement mes jambes, me redressai et calai mon dos contre le mur. Réaction adolescente. Ma gestuelle suffit à ce qu’elle poursuive.
– J’espère que tout se passera bien…
Enfin, elle se souciait de ce qu’elle m’avait imposé. Ces dernières semaines, il n’y en avait eu que pour son voyage, son Armand, ses to do lists et ses instructions.
– Presque trois semaines… Je ne me rappelle pas de la dernière fois où je suis partie aussi longtemps…
Elle marqua une pause pour se souvenir.
– Ce devait être à l’été de tes treize ans. Quand avec papa on était allés camper en Toscane.
Je ne répondis pas, attendant qu’elle verbalise la reconnaissance de mon investissement, peut-être des excuses. J’avais bien besoin de sa bienveillance. Elle poursuivit.
– Armand a dit que ça passerait vite, que comme on se déplaçait beaucoup, on n’aurait pas du tout l’impression de longueur. J’espère, parce que j’avoue avoir un peu peur du mal du pays…
Elle poursuivit sur ses inquiétudes, ses soucis. Elle ne parla que d’elle. Elle était venue à moi pour partager ses angoisses. Pas une seconde, elle ne considéra mon emploi du temps transformé, mon sacrifice d’un temps libre pourtant rare, mes ressentis. J’aurais voulu l’interrompre, elle ne m’aurait pas même entendue. Ma mère qui, d’ordinaire, se pliait en quatre pour mon confort, attendant mon réveil pour partager café chaud et croissants, était, là, uniquement centrée sur elle-même. Elle ne me demanda pas pourquoi je ne dormais pas. J’aurais voulu qu’elle m’interroge, j’aurais eu envie, pour une fois, de parler de papa, de partager quelques mots tendres dans cette dernière nuit ensemble. Elle cessa le flot de paroles tout en tapotant ma jambe, signant la fin de l’interlude.
– Il faut dormir ma chérie. Demain, j’ai un grand voyage.
Baiser machinal dans mes cheveux, elle ressortit en toute hâte de ma chambre, me laissant groggy par le monologue auquel je venais malgré moi d’assister. Je me retrouvai dans le noir. Le retour dans l’appartement de mon enfance était normalement synonyme de complicité surannée. Cette nuit, il avait l’amer goût de l’abandon.
4
Le taxi avait démarré. J’avais fait un signe de la main. Au bout de la route, il avait tourné à droite et disparu. J’étais restée bien plus longtemps que de raison sur ce bord de trottoir. La dernière fois que je m’étais trouvée plantée ainsi – je devais avoir dix-sept ans – mes parents partaient pour un week-end en amoureux fêter leurs vingt ans de mariage. La liste des avertissements avait été gigantesque. Ma mère n’avait fini par me lâcher qu’au prix d’une insistance paternelle intense. Elle avait gesticulé par la fenêtre de la portière bien au-delà du virage du bout de la rue, m’avait, plus tard, raconté mon père mi-amusé, mi-excédé.
Aujourd’hui, rien de tel. J’étais adulte, et l’impatience, et l’excitation de ce voyage semblaient lui avoir fait oublier que je restais à quai. Elle embrassait son Armand de baisers picorés. Elle était déjà loin. Ma main à moi suspendue dans l’air pour un adieu sans réponse. Mon père me manqua. Encore plus que toutes les fois où ma mère refusait de parler de lui, son souvenir la rendant trop triste.
Je regardai cette rue si familière. Quelques feuilles encore flamboyantes accrochées aux arbres dans un soleil de fin d’automne. Je ne parvins pas à me rappeler s’ils étaient déjà si grands, il y a plus de vingt ans. Cette fameuse fois, j’avais couru à l’intérieur, rameuté les copines, j’avais passé une heure au téléphone pour planifier ce week-end d’absolue liberté. Aujourd’hui, la situation s’était inversée, ma liberté était ailleurs. J’ai remonté lentement l’escalier, animal allant à l’abattoir. J’ai refermé la porte, levé le nez, vu la tapisserie fatiguée, le couloir aux meubles inchangés, ce tableau de nature morte que, déjà enfant, je détestais. Pour une fois, ses teintes brunes et sombres s’accordaient à mon humeur. J’allai à la cuisine et ouvris le frigo. Cela faisait bien longtemps que j’avais arrêté de grignoter, mais cet appartement trop vide et mon statut de naufragée nécessitaient un remplissage stomacal.
Sur les étagères, des Tupperware bien empilés. Sur chacun, un billet soigneusement déposé où je retrouvais l’écriture impossible de ma mère, un amas de petits hiéroglyphes indomptés. J’y déchiffrai un « poulet basquaise », une « soupe aux champignons » et un « gâteau au chocolat ». En m’asseyant, je trouvai sur la table un papier avec une fleur mal dessinée qui mentionnait ce qui devait être un « Bon appétit, ma puce ». J’eus un sourire morne. Elle avait quand même un peu pensé à moi. Je plongeai ma cuillère dans la pâtisserie. Le goût me renvoya illico en adolescence : calumet de la paix après nos disputes. Elle en déposait un morceau devant ma chambre, frappait deux petits coups pour annoncer l’offrande. L’orage passait, noyé sous le chocolat. J’appréciai le geste en fermant les yeux. Les bouchées avaient gardé leur effet magique. Je léchai soigneusement la cuillère.
Je regrettai tout à coup de n’avoir gardé, dans cette ville, aucun contact qui eût pu venir profiter avec moi de cet appartement qui m’était confié. Surtout que maintenant, j’avais accès au bar en toute légalité.
5
Un mal de tête persistant. Contre ma règle de base, j’avais bu seule et probablement trop, au vu de la manière dont mes tempes tapaient. Je me sentis courbaturée. Logique, étant donné que je n’avais pas quitté le canapé. Sur la table basse du salon deux Tupperware ouverts. Des bouteilles d’alcools qu’après quelques allées et venues dans le meuble-bar, j’avais finalement décidé de garder à portée de main. Je cherchai mon téléphone, le trouvai à moitié sous le tapis. Il y avait trois messages de ma mère. Un du premier aéroport pour dire qu’ils allaient embarquer, un de leur escale où ils passaient une nuit courte et un disant qu’ils étaient bien arrivés et qu’elle espérait que je m’amuse bien. Si boire en regardant des films dont je n’étais pas capable de me souvenir tout en mangeant froid à même la boîte en plastique pouvait être considéré comme de l’amusement, on pouvait reconnaître que j’avais atteint le paroxysme du festif. Je trouvai au pied du canapé mon soutien-gorge que j’avais fini par retirer et la couette que j’étais allée chercher vers vingt-trois heures, heure à laquelle la chaudière s’éteignait : ça non plus n’avait pas changé. Bien qu’ayant mal au crâne, le désordre qui régnait et l’idée de m’être saoulée au frais de la princesse m’amusèrent. Victoire de sale gamine. Je déchantai en voyant ma tête dans le miroir, mais bon, je ne connaissais plus personne ici, et pour aller en visite en maison de retraite, finalement, ce n’était pas si grave. La douche agit sur mon éveil, je ne me maquillai pas, ce qui était une exception absolue à mes habitudes et sortis lunettes de soleil sur le nez pour aller, en bonne fille, m’acquitter de ma tâche que bizarrement je redoutais quelque peu. En franchissant la porte de l’appartement, je redressai les épaules. Si l’on me confiait la gestion d’une équipe de deux cent cinquante personnes et que l’on me jugeait apte à leur faire atteindre leurs objectifs tout en respectant budgets et timings, je devais bien être capable de faire la conversation à un vieux monsieur ! Méthode Coué. En refermant la porte, je jetai un coup d’œil à l’intérieur. J’avais décidé de ne rien ranger. Petite vengeance inutile et puérile, mais pleinement satisfaisante à ce soin maniaque que ma mère prenait toujours à tout bien ordonner. « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ! » Si elle avait pu voir le foutoir que j’avais laissé, elle en aurait fait une crise cardiaque ! Pour un peu, j’hésitai à lui envoyer une photo de l’appartement moins de vingt-quatre heures après son départ. Réaction évidemment totalement idiote, quoique, cela aurait peut-être pu la faire rentrer…
Je n’en fis bien entendu rien, concentrée sur ma mission, je descendis les escaliers avec autant de conviction que possible. Jeans, cheveux sales mais attachés, j’allais rencontrer ce fameux Luc que je n’avais pas revu depuis fort longtemps et dont la vie et mon emploi du temps surchargé avaient limité les souvenirs à quelques brèves entrevues lors d’événements familiaux, occasions expirées du fait de son entrée en maison de soins trois ans plus tôt.
6
En vue de ces retrouvailles qui ne me disaient rien de bon, j’avais décidé de marcher. L’air frais de cette journée ensoleillée aérait mes poumons et mon estomac. Derrière mes lunettes, les couleurs étaient vives. Un déluge d’orange, de jaunes, de rouges envahissait les rues de la tête aux pieds. Je pris le sentier de la rivière. Cela rallongeait le trajet, mais, pour une fois, j’avais le temps et la curiosité d’aller voir si les choses avaient changé. L’appréhension me faisait prendre les chemins de traverse. Je retrouvais le sentier des promeneurs du dimanche, des ados amoureux, des chiens et des enfants en liberté. Il cheminait entre le cours d’eau et les maisons de maître. Cela avait longtemps été le beau quartier, celui où j’avais rêvé de m’installer, à voir les maisons vieillies, ce ne devait plus être tout à fait d’actualité. J’y croisai peu de monde. Un monsieur assis sur un banc, perdu dans ses pensées, un jeune qui, à l’odeur, avait dû se réfugier là pour fumer son pétard tranquillement. Par-delà le parfum âcre dégagé par le fumeur, je respirai l’automne. Là où j’habitais désormais, il fallait aller chercher ces sensations bien loin de la ville. Trop de bitume et de béton, les arbres n’arrivaient pas à prendre le dessus même dans les squares de quartiers, ils perdaient la bataille olfactive. J’avais presque oublié ces odeurs. J’eus envie de m’arrêter, de rester là. J’avais pris un engagement, et même si je jouais la gamine depuis mon arrivée, je ne me défilerais pas, ce n’était pas mon genre. D’autant que ma mère m’avait dit avoir annoncé mon passage à l’Oncle Luc et à tout le personnel. Il me restait un peu de dignité, je quittai donc le sentier du ruisseau et filai sur la voie menant à la maison de retraite.
Je ne reconnus que peu le coin. En lieu et place d’une allée bordée d’arbres figurait un long tapis de bitume noir encadré par deux bandes rouges. Les pistes cyclables avaient mangé la verdure. Certainement plus pratique pour accéder à l’école proche en toute sécurité, nettement moins bucolique que dans mes souvenirs. J’avais marché vite jusqu’à longer le parc qui abritait ma destination. Lui n’avait pas ou si peu évolué. Toujours planté de deux bâtiments qui se faisaient face, d’un parking et d’un grand panneau « réception » bien caché derrière un énorme marronnier.
Je n’y étais que rarement allée depuis mon enfance. Encore petite, nous venions, mes parents et moi, rendre visite à mon arrière-grand-mère, une femme joviale et menue à la bouche édentée peu rassurante. Je ne me sentais pas tellement plus à l’aise aujourd’hui. Je fus saisie d’un regret d’avoir refusé d’y revenir une fois avec ma mère. Prise à mon propre piège de n’avoir écouté que d’une oreille ses rapports détaillés sur le lieu et son pensionnaire. Misérablement intimidée, je demandai des indications à l’entrée. La réceptionniste qui me répondit me dévisagea. J’enlevai à la hâte mes lunettes de soleil, prise en faute de snobisme. Elle m’indiqua l’ascenseur au fond du couloir, troisième étage à gauche. Son visage me dit vaguement quelque chose. Je saluai. J’accélérai.
Tout avait changé ou ma mémoire faisait défaut. Je m’attendais à des odeurs d’hôpital, il flottait une senteur de thé à la cannelle. Dans l’ascenseur, une citrouille en papier était collée sur le miroir, je me devinai à travers son rire sarcastique. Légère honte du peu d’efforts fournis. Si l’on ne pouvait pas voir mes cheveux gras car noués bien serrés, j’avais les traits tirés d’une nuit hachée et trop arrosée. Je n’eus pas le temps de le regretter plus longtemps, l’étage demandé était atteint. Je me mis en chasse du numéro de chambre d’Oncle Luc. J’aurais voulu avoir le temps de prendre une grande inspiration, mais la porte s’ouvrit et je me trouvai face à une infirmière qui se retourna pour lancer un « et vous avez même de la visite ! » qui devait finir une conversation et m’obligea à entrer.
Un vieux monsieur un peu ramassé sur lui-même leva le nez et me regarda avancer. Mains moites, pas ralenti. Je ne voulus pas nous effrayer.
– Bonjour Oncle Luc.
Aucune réponse. Je m’approchai d’un peu plus près.
– C’est Léa, Oncle Luc. Léanne pardon. La fille de Marie-Solange.
À ce nom, il réagit. Je compris pourquoi ma mère avait tant souhaité que nous y venions d’abord ensemble. Regret de plus. Stérile.
– Elle est en voyage, Marie-Solange. Je la remplace.
– C’est bien. C’est bien.
Je ne sus si c’était le voyage ou mon remplacement qui était bien. Il avait l’air satisfait, je m’en contentai.
– Prends une chaise. Ne reste pas debout. Prends une chaise.
Je suivis l’instruction, enlevant au passage mon manteau, découvrant le décor que je n’avais pas regardé en arrivant, trop concentrée sur mon oncle.
Assise face à lui, le silence reprit. Il sembla parti dans ses pensées. Que dire, que faire ? Embarrassée de moi-même, de cette situation, je fus sauvée par l’infirmière qui passa la tête par l’embrasure de la porte.
– Si vous voulez aller vous promener… On en parlait justement avant votre arrivée… Il y a une veste dans l’armoire, vous pouvez prendre la chaise et aller profiter du beau temps…
Je n’avais jamais poussé une chaise roulante de ma vie, il me sembla pourtant que tout serait mieux qu’un huis clos avec ce monsieur que je ne connaissais plus. L’infirmière m’avait aidée à l’y installer. Je devais avoir l’air bien gauche, mais j’entrepris toutefois l’aventure avec soulagement.
Ce ne fut pas une mince affaire, la manœuvre était nouvelle et dans ma crainte de le faire chuter, j’allais trop lentement, créant à notre insu un bouchon devant l’ascenseur. Pourtant, je sus que cette virée en extérieur était une aubaine quand d’un même geste nous tournâmes nos visages silencieux vers le soleil. Ses traits se détendirent. Les miens aussi.
Je ne sais combien de temps nous sommes restés dehors, ainsi suspendus à ces derniers rayons d’automne. Le froid de l’ombre nous chassa finalement et quand nous réintégrâmes la chambre de Luc, je n’eus pas le temps de lui ôter sa veste, qu’une autre aide-soignante vint nous indiquer qu’il était bientôt l’heure du repas qui se prenait au dernier étage. Je regardai ma montre, dix-sept heures trente, je notai mentalement pour la prochaine fois, calant, sans y prendre garde, déjà mon rythme sur ses contraintes horaires. L’infirmière me demanda si je l’emmenais, j’acquiesçai, toujours sans adresser la parole à mon oncle qui semblait s’accommoder de ces déplacements imposés. Je lui ôtai donc sa veste et entrepris d’atteindre la salle à manger. Si j’avais pu aller jusqu’à l’extérieur, je devais pouvoir remplir cette dernière tâche. J’avais cependant omis la foule pressante. Des déambulateurs, des chaises roulantes, des cannes, tous agglutinés devant une porte close. Je ne savais si je devais laisser là mon oncle, quand une voix me harponna :
– Vous restez dîner ?
– Heu, non…
– Si vous le souhaitiez, il suffirait de vous inscrire un peu à l’avance et vous pourriez vous joindre aux pensionnaires.
Je faillis répondre à la femme d’une cinquantaine d’années, chemisier bleu, foulard savamment noué et sac à main de marque à l’épaule qui m’avait interpellée, qu’il ne fallait quand même pas trop m’en demander. Regrettant d’un coup d’être si mal attifée, je marmonnai une espèce de « ah, c’est bon à savoir » qui avait pour but de me faire disparaître au plus vite.
Elle n’en avait pas fini avec moi.
– On y mange très bien, au cas où…
Remerciements polis, rapides, les portes s’ouvrirent, déclenchant une course filmée au ralenti, mouvement dans lequel je fus embarquée et Oncle Luc avec moi. Il s’agissait d’avoir les meilleures places. Je le compris lorsqu’une dame me donna un coup d’épaule pour piquer le dernier espace disponible à la table où je comptais installer Oncle Luc. Son air triomphant me laissa pantoise. Avais-je bien vu un regard un peu vicieux quand elle m’avait dit « désolée » entre ses fines lèvres maquillées ?
Je dénichai une table dans le fond, surfai à travers le mobilier de la salle à manger et y installai mon oncle en m’assurant d’avoir verrouillé les freins du fauteuil. En signe d’au revoir, je me penchai vers lui pour lui tendre la main. Il l’attrapa, m’attira à lui et au moment où je pensais qu’il allait me coller une bise qui me dégoutait déjà, me glissa à l’oreille ce qui me sembla être un « Dis à Niv de ne pas aller se baigner ! » impérieux. Je n’eus pas le temps d’y réfléchir, les plats arrivaient déjà, me chassant de facto, troublée.
De retour chez ma mère, après avoir marché à grands pas dans le froid apporté par la nuit. Je détestais les premières fois qui impliquaient trop d’impondérables. Celle-ci s’était avérée déroutante. Mais elle avait le mérite d’être derrière moi. Pour fêter la fin de ma première mission, je m’offris un thé au milieu du désordre que j’avais laissé dans le logis maternel. Le thé étant un des dadas de ma mère, j’eus le choix. Je souris à ceux dans leurs pots colorés que je lui avais ramenés de mes voyages d’affaires. Petit rituel qu’elle appréciait. Les plus jolis figuraient bien en vue. Pincement au coin du cœur. Je laissai la boule flotter à la surface de la théière, celle à pois rouges, celle que je connaissais depuis toujours. Une des rares habitudes que j’avais gardée d’elle. Dans les odeurs d’oranges d’hiver, je repensais à ses manies que je regardais souvent avec condescendance. Comme celle de son bain quotidien qui me décida à profiter de la baignoire. Chez moi, j’avais fait le choix d’une douche à l’italienne, plus pratique, plus efficace. Ici j’avais du temps à perdre. Dans l’armoire à pharmacie, quelques sels de lavande s’accordant parfaitement à la salle de bains rose vif où une plante avait pris possession du bidet. Glisser dans l’eau trop chaude, flotter, laisser filer l’absurdité de la situation, oublier les devoirs, les contraintes, appuyer la tête contre le bord de la baignoire, fermer les yeux, mettre ses pieds au-dessus des robinets, entendre la mousse crépiter. Dans cette langueur bienfaisante, un flash. Les mots de mon oncle, injonction insensée. Mais qui était donc Niv et pourquoi donc fallait-il l’empêcher de se baigner ?
7
Étrangement dormi. Pas mal ni bien. Une nuit habitée de songes intenses. Je n’avais pas le souvenir d’avoir rêvé autant. Un mélange de ma mère en Asie, de mon enfance, de l’Oncle Luc, de ma présence ici. Ce sentiment de décalage, de retour en arrière. Il fallut trois cafés, une aération transversale de l’appartement et une crise de rangement pour que je retrouve mon époque et que je sorte de cet anachronisme désagréable dans lequel ce lieu me mettait. Il était dix heures trente quand je pus considérer les mises à jour de mon cerveau comme effectuées. Je regardais l’appartement nickel, mon lit fait et la vaisselle proprement entassée sur l’égouttoir. Je détestais faire la vaisselle seule, mais je dus avouer que ce matin, cette tâche, les mains dans l’eau sale, avait eu un effet apaisant. Je ne la séchai tout de même pas, contrairement aux manies maternelles. Je limitais ma transformation en fée du logis au minimum. Et puis, la vaisselle était, en principe, un moment de complicité avec maman. On papotait, elle me racontait des ragots que je n’écoutais pas vraiment, je lui faisais part des anecdotes du bureau en astiquant les plats, assiettes qu’elle dorlotait dans l’eau savonneuse. À la vue de la pile mouillée en attente de torchon, pointe de nostalgie, elle me manquait. Ma mère, qui m’avait fichue dans ce pétrin, coincée dans ce bled pour trois semaines, qui s’éclatait avec son mec en road trip asiatique, me manquait. Nos rôles étaient inversés. Normalement, j’étais celle qui vadrouillait de par le monde, lui envoyait une carte postale ou un selfie dans un décor de rêve. J’étais l’aventurière, celle qui était partie, qui avait osé, pendant qu’elle m’attendait dans sa cuisine. Sentiment d’injustice. Bien entendu déplacé. Mais j’avais envie de faire la moue.
Or donc, au milieu de cette matinée anodine, l’appartement ayant récupéré sa forme originelle et hormis une visite à mon oncle prévue pour plus tard, le programme confinait au néant. Je contrôlais mes emails et mes messages, réflexe professionnel si habituel. Rien de bien passionnant : quelques copines s’enquérant de mon exil, une invitation à une vente privée, la voisine m’indiquant avoir relevé mon courrier, bref, aucune information qui pût occuper une journée. J’avais bien emmené quelque littérature professionnelle, l’idée de m’y plonger me fatiguait d’avance. Météo grise, sans pluie. Ce n’était vraiment pas dans mes habitudes d’être désarmée face au temps qui me semblait toujours trop court. Moi qui rêvais d’un moment de libre, qui jonglais dans un agenda déchaîné, je me retrouvais dépitée face à la perspective de vivre encore plus de deux semaines d’une telle vacuité. C’était inique. Je n’avais ici aucun rituel, aucune envie. Que faisait ma mère de ses journées ? Je réalisais que j’en ignorais tout. Parce qu’elle n’avait rien dit ou que je n’avais jamais rien demandé. J’aurais voulu au moins être « jour de marché », ce qui aurait pu provoquer un retour en enfance. Flâner de stand en stand, attraper quelques potins inutiles, prendre le temps de choisir ses légumes. J’aurais pu donner à ce séjour un air de vacances. Peine perdue. Et puis cette idée farfelue qui me redonna le sourire : aller courir. Courir en pleine journée de semaine. Je pourrais ainsi poursuivre mes comparaisons des changements apportés à cette ville, évolutions que ma mère ne cessait de vanter. Et courir avait cette vertu de me vider la tête, même si dans ces circonstances, du vide, j’en avais en suffisance…
J’avais parcouru les rues, constaté les enseignes disparues, les nouvelles, les intangibles. Le boucher, la mercerie, le café du Pont. Les panneaux d’annonces de travaux accrochés au mur d’un immeuble vétuste. J’étais montée jusqu’à la forêt, celle-là même où, en bande, nous allions jouer, ramasser des châtaignes pour les faire griller, hurlant quand on croquait dans une véreuse. J’avais longé la petite chapelle et son cimetière. J’avais enlevé mes écouteurs et les bruits comme les souvenirs étaient revenus. J’avais cessé de courir, marché. Vite puis de plus en plus lentement. Depuis le promontoire au sortir de la forêt, la ville s’était étalée. Elle avait bien grandi. Au nord, la zone industrielle, jadis isolée, désormais entourée de commerces. Les petites maisons d’ouvriers avaient presque toutes laissé place à de grands bâtiments modernes. Se pouvait-il qu’en vingt ans tout ait tellement changé ? Que je ne m’en sois pas aperçue ? J’avais repris ma course, m’étais souvenue des visages, avais réalisé que la réceptionniste de la maison de retraite devait être la petite sœur d’une de mes amies du judo. J’avais fait du judo, c’est vrai. Je nous revoyais en kimono. Sandra, elle s’appelait Sandra, voulait toujours se joindre à nous au grand dam de ma copine qui se serait bien passée de sa petite sœur collante. Arrêt, laisser remonter les souvenirs.
Le dojo existait-il toujours ? Pourquoi avais-je abandonné le judo ? Les études sans doute. Un couple de promeneurs, chien à bout de laisse, me salua. Fin des réminiscences. Je frissonnai. Je décidai de reprendre ma course. Sous mes pas surgirent d’autres images, des sons, des promesses. « On restera amies pour la vie. » « On s’appellera ! » « Tu me raconteras la fac… » « De toute façon, je ne t’oublierai jamais. » Je ne voyais plus les arbres, les bâtiments, les passants. S’affichaient les souvenirs, les liens perdus, les sensations d’antan.