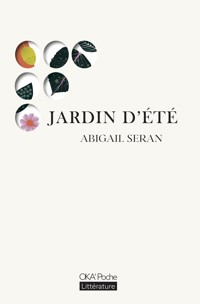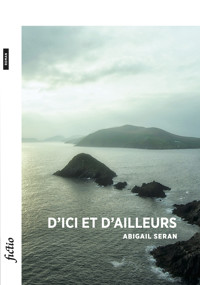Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Plaisir de Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sous le toit d'une maison jaune, trois destins féminins s'entremêlent...
Un jour, Charlotte découvre dans la maison de maître où elle a récemment emménagé avec sa mère des petits papiers écrits bien des années auparavant. Curieuse, elle décide de remonter la trace de ces mots. Il s’avère qu’entre ces murs, deux autres adolescentes ont vécu avant elle : Léonie, issue d’une famille de notables de l’entre-deux-guerres et Pia, émigrée italienne dans les années cinquante. Chacune d’entre elles fera un bout de chemin dans cette maison qui aurait dû être jaune avec des destins bien différents. Pia, Charlotte et Léonie, trois univers entrelacés à ce moment de la vie si particulier qu’est le passage à l’âge adulte. D’une écriture pleine de justesse et de retenue, l’auteure nous fait traverser le vingtième siècle, au gré des doutes, des espoirs et des certitudes de ses héroïnes. Une histoire au suspense savamment tissé qui pourrait bien dévoiler que cette demeure n’est pas le seul point commun de ces jeunes filles.
Le portrait de trois jeunes femmes du XXe siècle, si différentes et si semblables.
EXTRAIT
– Jaune. En voilà une idée ridicule. Vous me peindrez cette maison en blanc.
Je tournai, incrédule, mon visage vers ma mère. Je voulus rappeler à mon père que, contrairement à ce qu’il venait d’asséner, il lui avait promis qu’elle pourrait en choisir la couleur. Elle dut pressentir ma réaction, attrapa ma main, la serra au point que mes phalanges furent douloureuses. Ses yeux baissés m’imposèrent le silence. Il remonta dans la Pic-Pic et démarra sans même un regard. Cette futilité réglée, il pouvait retourner à des affaires sérieuses. Nous rentrerions donc à pied, malgré le vent, malgré le froid.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
[L'] écriture [d'Abigail Seran], douce et décidée, comme ses héroïnes, nous facilite la lecture et permet de se consacrer pleinement à laisser vaguer notre esprit au fil d'époques que l'on aurait aimé connaître. -
Desiddhartaabaudelaire, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
D’origine valaisanne,
Abigail Seran a passé son enfance à Monthey. Elle habite depuis quinze ans dans le Canton de Vaud, en Lavaux. Après des études de droit, elle a travaillé dans le monde bancaire. Poursuivant ses activités de conseils, elle assume également une charge d’enseignement. Elle est l’auteure de
Marine et Lila et
Une Maison Jaune aux Éditions Plaisir de Lire et des
Chroniques d’une maman ordinaire, aux Éditions Favre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage paraît avec les précieux soutiens
du Canton du Valais, de l’État de Vaud et
de la Commune de Bourg-en-Lavaux.
ISBN : 978-2-940486-54-0
© Éditions Plaisir de Lire. Tous droits réservés.
CH – 1006 Lausanne
www.plaisirdelire.ch
Photographie de couverture : Matthieu Spohn
Couverture : Chris Gautschi
Version numérique : NexLibris – www.nexlibris.net
DE LA MÊME AUTEURE
Marine et Lila,
éd. Plaisir de Lire, coll. Aujourd’hui, 2013.
Chroniques d'une maman ordinaire,
éd. Favre, 2015
Site de l’auteure : www.abigailseran.com
Aux femmes de ma vie,
tout particulièrement à celle qui me l’a donnée.
ABIGAIL SERAN
UNE MAISON JAUNE
ROMAN
1924-1957-1992
Mars 1924
– Jaune. En voilà une idée ridicule. Vous me peindrez cette maison en blanc.
Je tournai, incrédule, mon visage vers ma mère. Je voulus rappeler à mon père que, contrairement à ce qu’il venait d’asséner, il lui avait promis qu’elle pourrait en choisir la couleur. Elle dut pressentir ma réaction, attrapa ma main, la serra au point que mes phalanges furent douloureuses. Ses yeux baissés m’imposèrent le silence. Il remonta dans la Pic-Pic et démarra sans même un regard. Cette futilité réglée, il pouvait retourner à des affaires sérieuses. Nous rentrerions donc à pied, malgré le vent, malgré le froid.
Les deux kilomètres qui séparaient la nouvelle demeure de l’ancienne furent parcourus sans un mot. Léopold, mon jeune frère, sautillait de flaque en flaque. Ma mère n’avait pas relevé les yeux et ne lui en fit même pas le reproche. La remarque qui me brûlait les lèvres depuis la sentence paternelle fut balayée par une bourrasque, comme toutes ces questions que j’aurais tant voulu poser.
« Léonie Grandvieille, ce n’est pas le rôle d’une jeune fille de s’interroger. » Dans le silence gelé, cette phrase si souvent répétée claqua une fois encore.
Avril 1957
La voiture s’arrêta. Il faisait noir. Seules quelques lumières, au dernier étage d’une demeure imposante, distribuaient des rectangles jaunes sur le gravier. Je voulus parler. Ma mère mit un doigt sur ses lèvres en signe de silence. Nous sortîmes de la voiture et montâmes rapidement les marches de l’entrée. Je ne savais pas, à ce moment-là, comme il serait long le temps avant que je n’en revoie l’extérieur.
Au moment de m’engouffrer dans la bâtisse, j’eus juste le temps d’attraper quelques odeurs. Fraîches, piquantes, inconnues. Je frissonnai. Ma mère saisit mon poignet pour me presser de gravir le grand escalier. Arrivées au deuxième étage et la porte derrière nous fermement close, ma mère me prit dans ses bras et chuchota dans un italien mâtiné d’une pointe d’accent français :
– Bienvenue dans ton nouveau chez toi, Pia.
Elle avait tort. Mon foyer à moi était à plus de mille kilomètres de là, dans un village escarpé aux odeurs de pins, avec une Nonna qui m’attendait. Ce n’était pas ma nouvelle maison, ce ne serait jamais ma nouvelle maison.
Tout à son bonheur de voir sa famille enfin réunie, ma mère ne remarqua rien. Depuis cinq ans qu’elle espérait ce moment.
Je me souvins alors que j’avais promis à ma grand-mère d’essayer d’être heureuse. Dans un effort, je souris.
Fin Mai 1992
– Charlotte ! Charlotte ! Où es-tu ?
Je maugréai que j’étais en train de découvrir cette vieille baraque dans laquelle ma charmante mère avait décidé de me faire vivre.
– N’est-ce pas qu’elle est jolie ? C’est tellement dommage qu’ils la détruisent. Mais dans l’intervalle nous allons bien en profiter, continua-t-elle, virevoltante, en me rejoignant dans une grande pièce du premier étage.
Elle tortilla entre ses doigts une mèche de mes cheveux.
– Tu as choisi ta chambre ? Tu pourras la peindre de la couleur qui te plaira, je t’aiderai si tu veux. Nous allons être heureuses ici toutes les deux. Tu as vu le jardin ? Il est immense, il y a même une balançoire accrochée au noyer. Quoique tu sois un peu grande pour ça maintenant, monologuait-elle en passant ses doigts dans ma tignasse tandis que je fixais la trace blanche autour de son annulaire gauche.
Quinze ans la semaine prochaine ! Tiens, si tu veux on fera une grande fête sur la pelouse, poursuivit-elle en lâchant la boucle qui rebondit le long de mon cou.
Je jetai un coup d’œil par la fenêtre. Pelouse était un mot plutôt excessif pour caractériser le champ qui s’étalait derrière la maison.
– A priori on a déjà un premier locataire pour les chambres du bas, je crois qu’il est peintre. Il projette d’emménager dans quelques mois, à ce qu’il m’a dit.
Sa voix futile résonnait dans les grandes pièces vides qu’elle arpentait. Je tentai d’appréhender l’univers que je m’étais attribué : un vaste espace haut de plafond, des murs défraîchis, un parquet craquant. Il y avait de la place, c’était déjà ça.
Juin 1992
Ma mère avait toujours eu la folie des grands mots. Une maison de maître était une vieille bâtisse promise à la destruction qu’on habitait pour tenir éloignés les squatters ; une grande fête : un rassemblement de voisins, de soi-disant amis et de collègues qui mangeaient dans des assiettes en plastique, mais buvaient dans de vrais verres dont aucun ne ressemblait à l’autre : un apéritif dînatoire ; des morceaux de pommes, des gâteaux secs et des marshmallows perdus au fond de bols nappés de serviettes multicolores.
Elle était radieuse. Elle avait une fleur dans ses cheveux encore courts, une robe à volants qui aurait mérité d’en avoir quelques-uns de plus en longueur et de moins en épaisseur, les sandales qu’elle m’avait achetées. Je l’observai depuis un renfoncement de mur. Combien de temps allait-elle mettre à se rendre compte que l’héroïne théorique de la fête jouait les déserteurs ? Elle allait et venait avec les cocktails, un mélange de jus de fruits, d’alcools qu’on lui avait donnés et de sirop, le tout aux couleurs curieuses. Aux mouvements de ses lèvres, je vis qu’elle babillait. Comme toujours. Je pensais à mon père. Il avait dit qu’on ferait « quelque chose » pour mon anniversaire. Je ne savais pas de quoi il s’agissait, mais cela n’aurait, sans aucun doute, rien à voir avec ça.
Je remis mes pieds nus dans mes Doc Martens. J’avais cédé sur la robe, mais exclu toute négociation concernant les chaussures. C’était mon anniversaire après tout. Même si, à bien y regarder, cela ressemblait plus à une cérémonie introductive envers nos voisins. Bien qu’il fût certain que nous ne serions jamais des leurs. Quoi qu’en espérât l’hôtesse. Un brin de politesse bourgeoise et une curiosité pour une propriété de maître encore récemment impénétrable les avaient obligés à venir, mais n’empêchaient ni les sourires de façade ni les œillades appuyées. Le promoteur avait certainement levé quelques oppositions à son projet ce soir. Somme toute valait-il peut-être mieux un bâtiment immonde, mais avec des habitants dignes de leur monde.
– Te voilà, je t’ai cherchée partout ! Il est tellement grand ce parc. On va faire le gâteau et…
Je devais avoir l’air bien misérable pour qu’elle suspende sa phrase.
– Je vous l’enlève un instant, Madame.
– Mais…
Thibault prit mon bras et me glissa à l’oreille que je lui en devais une. J’eus juste le temps d’entendre ma mère qui, dans un rire forcé, lança :
– Je t’ai déjà dit de m’appeler Céline ! Et je t’accorde cinq minutes. Ramène-la-moi vite !
Mon sauveur accroché à mon bras, je contournai l’habitation.
– Merci !
– Pas de quoi.
– Et je te dois quoi ?
– La visite du palais !?
Nous montâmes les marches du perron.
– L’entrée royââle… déclamai-je, magistrale.
– Après vous, gente Dââme.
Après une rapide inspection des lieux, affalée aux côtés de mon visiteur sur mon matelas posé à même le sol, je scrutai les lumières du jardin sautillant au plafond.
– Dis donc, elle n’y est pas allée de main morte la châtelaine !
– Tu parles de la maison ou de la soirée ?
– La maison elle donne, même si elle est pas de première jeunesse.
Il marqua une pause.
– La soirée…
– Elle craint.
– J’ai pas dit ça.
– Eh bien moi, je le dis.
– C’est sympa d’avoir fait une fête pour ton anniversaire, quand même.
– T’appelles ça un anniversaire toi ? Moi je dirais un essai d’embourgeoisement bas de gamme.
– T’es rude !
– Mon anniversaire, ce sera avec mon père…
– Sympa pour moi.
– Excuse-moi Thib’, je ne voulais pas dire ça. C’est cool que tu sois passé.
– Bon on y retourne, j’ai pris l’engagement de ramener la damoiselle, moi…
Je tentai de lui donner un coup qu’il esquiva, toréador agile.
Il se cala contre le chambranle de la porte. À défaut de flèches, je lui décochai un oreiller.
Juillet 1924
Dans quelques jours, les vacances. Le soleil déjà haut de cette fin de matinée me faisait transpirer dans mes chaussures noires. Lisbeth chantait. Lisbeth chantait toujours et m’enjoignait à la suivre. Alors, je glissais ma voix dans la sienne, d’abord timidement, puis encouragée par sa main et ses grands yeux bleus, je m’enhardissais jusqu’à ce qu’aucun occupant dont l’habitat se fut trouvé sur notre passage ne puisse ignorer notre présence. Et le Blanc et le Noir, comme on nous appelait au village, déroulaient leurs gambettes en fredonnant sur le chemin de l’école.
Lisbeth et moi étions amies depuis que l’alphabet de nos prénoms avait décidé de nos places sur les bancs de l’école communale. Nous accommodant de ce destin nominal, nous nous étions liées d’amitié malgré nos dissemblances. Toutes deux brunes et pourtant opposées aussi bien dans les traits physiques que de caractère. Lisbeth avait ce rayonnement que les enfants très aimés transmettent.
Sur les sentiers que nous prenions, si de prime abord on pouvait voir deux mêmes fillettes en goguette, au second regard on percevait de Lisbeth le blanc de son col et son visage malicieux, tandis que de moi seuls ressortaient le noir de mon tablier et l’angulosité de mon corps. Mais qu’importait, Lisbeth m’avait choisie. Je ne pouvais qu’être reconnaissante que le choix de cet être solaire se fût porté sur moi.
– Je suis si contente que tu aies déménagé. Nous sommes bien plus proches maintenant.
Elle serra ma main plus fort et entreprit la descente de la pente en laissant ses jambes encore pleines des rondeurs de l’enfance s’emballer sous son corps souple. Je suivis dans un mouvement saccadé.
– Je suis contente aussi.
Mon plaisir n’était pas feint. Finis les longs trajets quatre fois par jour. Désormais, l’école n’était plus qu’à quelques encablures de mon nouveau domicile et s’y rendre avec Lisbeth était un ravissement qui avait raccourci mes journées.
– Et tu pourras venir chez moi prendre le goûter. Et nous pourrons réviser ensemble.
Jusqu’ici la distance m’avait servi d’excuse, je craignais que l’autorité paternelle ne voie pas ces quatre-heures d’un bon œil. Je n’en dis rien, laissant Lisbeth savourer ses plans d’avenir et me prenant à rêver aux gâteaux de Nanette, leur bonne, dont elle me parlait si souvent et qu’elle m’apportait parfois. Je lui souris et Lisbeth prit cela pour un acquiescement, comme elle prenait d’ailleurs tout signe ou mutisme de ma part.
Nous arrivâmes devant sa maison. Une résidence entourée d’un vaste parc. De grands arbres gardaient aussi bien les jardins que l’habitation elle-même. Nous fîmes halte à hauteur de l’entrée. Lâchant ma main, elle me fit un petit signe vif et doux en passant le portail.
– Nous nous verrons peut-être demain à la messe, et sinon à lundi.
Elle n’attendit pas ma réponse et disparut derrière les cyprès.
Je poursuivis ma route dans le silence qu’avait laissé Lisbeth. Je me sentis soudain moins légère. J’allais passer mon premier samedi après-midi dans la nouvelle maison.
Le samedi était particulier. Mon père, qui les autres jours ne faisait que de brèves apparitions à l’heure des repas, hantait le foyer de sa présence. Le son du gramophone qui s’accrochait aux murs jusqu’aux dernières poutres du toit en attestait. Personne d’autre que lui n’avait le droit d’approcher cet engin magique, le seul objet qu’il avait déménagé lui-même. La boîte à musique, comme l’appelait notre bonne, était si vénérée que, lorsque nous étions petits, Léopold et moi n’avions pas le droit de pénétrer dans la pièce qui l’abritait. Je ne savais pas où le phonographe avait désormais pris ses quartiers, et il me tardait de le découvrir, tant cela allait avoir de l’influence sur la géographie de mes samedis.
Durant ses heures d’écoute attentive, la transparence des gens et des bruits était de mise. Aucune porte claquante, pas de jeux bruyants, point de rires. Quoique les rires ne fussent pas vraiment tolérés non plus hors des heures musicales. Le calme devait être tel que j’en étais venue à redouter cette musique que pourtant je trouvais belle. Je saisissais alors un livre ou un cahier et essayais de me terrer dans un endroit où j’étais certaine de ne pas le troubler. À la bonne saison, il s’agissait du jardin, en hiver, c’était plus aléatoire et je devais alors faire le choix de la sécurité ou de la chaleur.
Ma nouvelle résidence annonçait de nouveaux défis. D’une part, on ne pouvait, pour l’instant, pas vraiment parler de jardin, les arbres n’étant que verdure accrochée à des tuteurs et, d’autre part, je ne maîtrisais pas encore suffisamment les lieux pour connaître les voies qui me permettraient de fuir si nécessaire. J’approchais et entendis au loin des notes. Aucune trace de vie. Ce qui allait de pair. En revanche, l’heure était nouvelle. Habituellement, la musique suivait le repas et ne le devançait pas. Ce changement de programme me laissa perplexe.
J’étais maintenant plantée entre le portail et le perron, ne sachant si j’osais encore avancer ou s’il valait mieux patienter. Tout retard entraînait une punition sévère, mais briser le moment sacré pouvait conduire à un châtiment dont mon corps se souviendrait longtemps. Sur le côté de la bâtisse, la porte de la cuisine s’entrouvrit et Louison me fit signe. Je glissai, autant que faire se peut, sur le gravier et me faufilai dans l’antre dont l’odeur fit grimacer d’envie mon estomac.
Ne sachant pas où était mon père et quels bruits il pouvait percevoir, j’allais chuchoter afin de glaner quelques informations, mais la cuisinière fut plus rapide.
– Il est dans le grand salon du bas, de l’autre côté du corridor. Il y a un Monsieur avec lui. Il faut que vous alliez vous présenter en rentrant de l’école, qu’il a dit. Enlève-moi ce tablier et pour une fois, tu te débarbouilleras ici.
J’embrassai Louison sur sa joue tendre et lui souris. Elle m’avait presque élevée et n’arrivait pas à se faire à l’idée de me vouvoyer, même si maintenant j’étais une jeune fille comme lui avait dit le maître. Reconnaissante qu’elle continue à me traiter comme une enfant, je suivis les instructions à la lettre. J’allais sortir de la cuisine pour me rendre au salon, quand Louison me retint et détacha ma natte.
– Une vraie demoiselle, comme ça, dit-elle en m’inspectant une dernière fois.
Juillet 1957
Trois mois. Déjà trois mois. Là-bas, Pietro devait faire les foins. Il devait faire chaud, comme ici, mais l’odeur des oliviers en plus. Ma mère avait pensé qu’on me donnerait une place à la manufacture : elle m’avait été refusée. Trop jeune. On attendrait qu’elle ait seize ans. Dans neuf mois. Je les avais entendus discuter de mon sort un soir dans la cuisine autour de la table en formica rouge. Fallait-il qu’elle reparte ? Ma mère ne pouvait s’y résoudre. La séparation avait été trop longue. On me trouverait bien du travail, des enfants à garder, la cueillette des pommes. Si à l’automne les choses n’avaient pas évolué, on verrait. Pendant ce temps, la famiglia était réunie. Et ça ferait de l’aide pour le ménage, le repassage, la cuisine.
Les faibles mots prononcés par mon père marquaient ses hésitations.
Là-bas, elle pourrait aider la Nonna. Et puis rester enfermée, tout le temps...
Juste pour l’été, avait-elle quémandé. Quelques semaines. Le temps de retrouver sa fille.
Je savais qu’elle avait gagné. Il n’avait plus rien dit.
Je me couchais sur les lattes du parquet. Il était frais. En me mettant tête-bêche au lit, je pouvais voir le ciel par la petite fenêtre et à partir du milieu de l’après-midi, j’étais au soleil. C’était le même que a casa. J’y étais pour un instant. J’essayais de ressentir les odeurs, je fermais les yeux et j’entendais au loin pétarader le vélosolex de Pietro. J’étais au sommet du village, couchée sur la grosse pierre. On pouvait tout entendre sans être vu. Je restais de longues heures, perchée, à me laisser chauffer par les rayons. Pietro disait que j’étais un peu folle de rester comme ça. Quand on me cherchait, il répondait que j’étais sûrement encore sur le caillou au soleil. C’était là que je m’étais réfugiée quand Maman et Papa étaient partis pour aller travailler de l’autre côté des Alpes. J’avais grimpé jusque tout en haut pour voir la voiture le plus longtemps possible. Puis, j’y étais revenue. Au début, dans l’espoir de les voir rentrer. Puis juste pour m’allonger sur le roc chaud, sentir l’air, écouter les vieilles, observer le ciel.
Ici, j’avais pris l’habitude de m’étendre sur le sol. Et soudain, je les entendais, les mamans appelant les enfants, les femmes se parlant de fenêtre à fenêtre, les gaillards, la nuit tombée, chantant, le gosier rassasié de chianti. J’entendais les couples qui se disputaient. Les chuchotis sur le passage de la veuve Paola. Il suffisait de se concentrer. Le soleil était mon relais. Il m’emmenait là-bas, chez moi. À maman qui me demandait si ce n’était pas trop long, seule, dans le petit appartement, je répondais que je lisais. Elle, qui lisait si mal, ne me questionnait jamais sur ce sujet. Alors j’étais libre de retourner sur le caillou, mon caillou, dans mon village à moi. Il faisait suffisamment chaud pour que je m’y sente en une seconde.
Une fois, j’étais si absorbée par mon Italie natale, que je n’entendis pas mon père rentrer. Il fut stupéfait de me trouver ainsi allongée. J’expliquai que j’essayais de voir les montagnes sans trop m’approcher de la fenêtre, comme il me l’avait recommandé. Il n’avait rien demandé de plus. Depuis ce jour-là, j’étais sur mes gardes dès que le soleil déclinait afin de sortir de ma rêverie avant leur retour. Je ne voulais pas les inquiéter. Ils avaient déjà bien assez de soucis sans cela. Dès mes tâches terminées, je m’envolais vers le sud.
Les jours de lessive étaient mes préférés, car je m’allongeais sous le linge mouillé étendu en travers de ma chambre. J’avais l’impression d’être dans la ruelle de ma Nonna. Un jour prochain j’y retournerais, parce que ma vie était là-bas et pas dans ce pays qui ne voulait que des bras et pas de leurs propriétaires.
Août 1992
Demain, la rentrée. On était allés au bord du lac avec Papa. Lac, c’était son nom sur les cartes de géographie, parce qu’il était si petit qu’on pouvait en faire le tour en une demi-heure à peine. D’ailleurs, entre nous on disait aller à la flaque. Déjà toute petite, il me demandait si je voulais aller y jeter des cailloux. Sur la microplage cachée par les roseaux, on s’amusait pendant des heures à faire des ricochets.
Dans son sac à dos, il avait emmené le pique-nique, des sodas trop gazeux et trop sucrés. On avait posé le campement un peu plus haut sous les sapins. Je détestais la route sinueuse qu’il fallait prendre pour y aller. Depuis toujours elle me rendait malade, mais j’adorais tellement le coin, que j’en subissais chaque virage sans broncher. On avait mangé du saucisson, du pain, et même des bonbons. Je savais qu’il avait acheté tout ça à la station-service où il travaillait. Probablement à la dernière minute, ce qui aurait rendu folle maman. Moi, je m’en fichais, on était tous les deux à la flaque comme quand j’avais dix ans. Comme quand on était encore une famille. La brume avait de la peine à décoller des arbres. Août en automne. Comme une menace d’hiver sans les feuilles mortes.
– On aurait dû venir hier.
J’ai haussé les épaules.
– J’aime bien comme ça. Il n’y a personne au moins.
Il a retenu une phrase. C’est ce que j’aimais bien avec lui. Il ne prononçait que les mots nécessaires. Même maintenant qu’elle n’était plus là pour prendre toute la place verbale, il avait la parole économe.
Il a pris une inspiration.
– Et, … là-bas, ça va ?
J’ai plongé du regard au fond de l’eau. J’ai suivi les truites qui filaient le long des cailloux. Peut-être même étaient-ce ceux qu’on avait jetés. Si je haussais les épaules, on n’en parlerait plus. Comme il n’avait rien demandé depuis le déménagement, je me suis dit qu’il avait droit à quelques informations.
– La maison est grande. Il fait frais parce que les murs font au moins trente centimètres d’épaisseur. Ma chambre est au premier. Et il y a pas mal de terrain tout autour. Ça tombe un peu en ruine. Mais bon, j’imagine que c’est assez logique puisqu’ils vont la détruire.
J’ai senti qu’il notait ces éléments architecturaux.
En s’extrayant du silence, il a ajouté :
– Et, … vous… ?
Je me suis retournée pour le voir. Il a détourné la tête. J’ai compris qu’il voulait de ses nouvelles. Je ne savais pas trop ce qu’il fallait lui dire pour ne pas le blesser. J’ai attrapé un bâton et j’ai commencé à tracer des formes sur le sol.
– On s’est mises aux confitures. On a découvert que tout au fond du jardin, il y a des arbres fruitiers. On a déjà fait de la confiture de pruneaux et d’abricots. Maman était si contente qu’elle en a amenées à son travail. Il paraît que ses collègues étaient É-PA-TÉS.
J’avais dit ça sur son ton à elle, en rejetant ma tête en arrière. Papa et moi, on s’est regardés et on a ri. On s’était toujours moqués du « épaté » de maman. C’était bien de pouvoir encore le faire. Même si elle n’était pas là pour l’entendre.
C’était comme si nos rires avaient levé le voile. La bruine s’est couchée dans l’eau et on s’est retrouvés d’un coup au soleil.
Il m’a tendu mon cadeau. Je n’en revenais pas. Un discman et avec des écouteurs high tech que l’on peut glisser dans les oreilles. Il avait même déjà mis les piles. Avant, il n’aurait jamais pensé à mettre les piles. Il y avait un CD dedans. J’ai voulu ouvrir pour voir ce que c’était. Il a fait les gros yeux. Alors on a pris chacun une oreillette et j’ai appuyé sur « play ». Au bord de cet étang, un goût de saucisson dans la bouche, les Carmina Burana ont envahi ma tête.
On est restés longtemps comme ça. Jamais je n’aurais pensé qu’il puisse apprécier ce genre de musique. J’ai mis ma tête sur son épaule. Il m’a prise dans ses bras. La flaque était à nous. Le monde aussi.
Septembre 1924
C’était le troisième samedi. Il avait repris ses habitudes. Quoique l’on pût se poser la question de savoir si quelques samedis à la fin de l’année scolaire et repris à la rentrée pouvaient constituer une habitude. Pourtant, c’était comme s’il en avait toujours été ainsi. Il était assis avec mon père dans le grand salon. Celui du bas. La fenêtre était ouverte. Maman était en retrait. Elle brodait et acquiesçait quand il fallait. Ils discouraient sur les compositeurs, les morceaux, les orchestres. Mon père était ravi. Enfin quelqu’un à sa mesure. Je devais les rejoindre dès la classe terminée. Quand j’entrais, il y avait ce quelque chose qui me mettait mal à l’aise. Mais je n’avais pas l’usage du monde, alors c’était bien normal. Maman plongeait encore plus profondément dans sa broderie tandis que mon père se satisfaisait de l’arrivée de sa fille.
– La voilà ! il souriait très largement.
Monsieur Chembignac se frottait les mains et reprenait les termes de mon père :
– Oui, la voilà. Joignez-vous donc à nous, Mademoiselle Grandvieille. Nous écoutions Mozart. Vous aimez Mozart, n’est-ce pas ?
J’acquiesçais d’un signe et restais là, muette, assise sur le bord de la causeuse. Je baissais la tête et examinais les pieds de M. Chembignac qu’il avait petits. Ses élégantes chaussures de cuir noir bougeaient au rythme de sa voix. Il avait l’audace de parler sur la musique et mon père ne s’en offusquait pas. Je trouvais cela tout à fait fascinant.
Tétanisée à l’idée de faire un faux pas, je me remémorais les conseils de Lisbeth. Après la première fois, je m’étais renseignée sur l’attitude à avoir en de telles circonstances. Les parents de Lisbeth recevaient beaucoup et présentaient toujours leur fille à leurs invités. Elle m’avait dit d’être polie, silencieuse, d’avoir un regard droit et de sourire. Je parvenais sans difficulté à appliquer les deux premières consignes, mais j’étais incapable de relever les yeux sans sentir mes joues brûler. Je décidais donc de maintenir mon visage vers le sol pour éviter d’avoir à appliquer les deux dernières recommandations. Je n’avais pas osé le dire à Lisbeth, elle aurait certainement haussé les épaules de déception et je n’aimais vraiment pas la voir ainsi. Surtout si c’était mon comportement qui provoquait cette réaction. J’essayais, dans cette posture un peu tordue, d’écouter attentivement la conversation tout en enregistrant les informations sur les pièces dont devisaient les deux messieurs. Ces concertos, sonates, symphonies qui auparavant me rendaient invisible prenaient peu à peu sens. C’était une seconde fascination.
Ce troisième samedi, le premier de l’automne à proprement parler, j’appris au détour de la conversation que le rituel nouveau s’interrompait pour un mois, car Monsieur Chembignac devait se rendre à Lyon pour quelques négoces. Mon père coupa court à ses explications en apostrophant de sa voix ferme l’invité, déclina ses nom et prénom pour appuyer son propos et indiquer que, dans cette maison, les affaires ne concernaient pas les femmes. Je vis les chaussures s’agiter un instant. J’appris ainsi que ces quatre prochains samedis me seraient rendus et que le monsieur dont je connaissais mieux les pieds que la figure se prénommait Auguste.
Octobre 1957
Il faisait froid. Pas ce petit courant frais qu’on apprécie tant à la fin de l’été, après que les touristes éventuels sont repartis. Pas cet automne léger qui fait que l’on s’assied dans la cuisine pour bavarder plutôt que sous les pins. Non. Un froid glaçant, la bise qui transperçait dès que l’on ouvrait la fenêtre et même si on ne l’ouvrait pas. Maman avait dit que ça allait s’arranger, que c’était parce que le chauffage n’était pas enclenché. La propriétaire ne l’allumait jamais avant le début novembre. Après ça allait. Mais jusqu’à cette date-là, il fallait tenir si le temps n’était pas clément. Et là, c’était terrible. J’entendais la pluie se déverser sur les tuiles, je sentais le vent qui se faufilait dans les interstices, sous les fenêtres de cette maison mal chauffée. Enfin, pas encore chauffée.
J’avais d’abord mis plusieurs couches, mais je n’avais pas emmené de vêtements chauds, parce que chez moi, un chandail suffisait pour passer l’hiver. J’ai ajouté ceux de ma mère et même une des vestes de mon père. Je ne m’habituais pas à tout ça. C’était triste, glacé. Je voulais rentrer chez moi. J’ai essayé de leur dire. Papa m’avait suppliée du regard d’arrêter et Maman avait les larmes aux yeux. Alors je n’avais pas fini ma phrase. J’avais juste dit que la Nonna me manquait. Elle n’écrivait pas la Nonna. De temps en temps, Pietro lui demandait si elle avait quelque chose à me dire et elle m’envoyait des baci. Je n’aimais pas les baci en papier. J’en aurais voulu des vrais, de ceux qui sentent la polenta, la pasta. Puis, j’avais étudié ma mère. Elle travaillait dur. Quand elle rentrait le soir, elle avait mal au dos, aux mains à force de déposer les feuilles de tabac sur les planches à clous. Mais quand elle me voyait, on aurait dit qu’elle s’illuminait. Alors, j’ai continué à ne pas finir mes phrases. J’ai même arrêté de les commencer. Et quand le soir, nous nous mettions à cuisiner, les recettes qu’on se passe de générations en générations, j’essayais d’imaginer qu’on était dans la grande cuisine de chez nous et que la Nonna était derrière, prête à faire un commentaire, à rajouter des épices, à corriger les dosages. Des fois, j’y pensais tellement fort que je pouvais la sentir dans mon dos. Alors je me remplissais de ça, pour les longues journées à rien. Les journées à dormir, et à éviter de voir le ciel gris. Les journées à attendre. De grandir, d’avoir seize ans et le droit d’aller me trouer les mains comme ma mère.
Octobre 1924
Il a fallu recommencer à se cacher le samedi. Avec le voyage d’Auguste-aux-petits-pieds (c’était le surnom que lui avait donné Lisbeth depuis que je lui avais raconté sa dernière visite), les colères avaient repris. Après avoir essayé le grenier (trop pénible et froid avec le vent transperçant les fenêtres), déserté le jardin aux arbrisseaux inutiles, j’avais découvert, par hasard, que la laverie était une pièce absolument parfaite. J’y avais suivi Louison pour l’aider à porter la corbeille et y avais découvert, derrière le bac à laver, un espace avec un petit muret juste assez large pour me permettre de m’y installer sans avoir à me recroqueviller.
Lorsque le linge était étendu, une barrière visuelle flottante venait s’interposer entre la porte et mon coin, me rendant invisible aux visiteurs potentiels. Pour couronner cette fameuse trouvaille, un soupirail débouchant juste au-dessous du salon se situait deux mètres au-dessus du muret. Oreille à mi-chemin entre la musique et mon repaire. L’acoustique n’était pas celle du salon, mais j’entendais suffisamment le gramophone pour pouvoir reconnaître les morceaux. Louison étant intraitable sur la propreté, je ne risquais même pas de me tacher. Elle devait se douter que c’était l’endroit où j’avais pris mes quartiers. Un samedi, elle s’était raclé la gorge en entrant, un autre, elle s’était soudain mise à se parler à elle-même. Cela m’avait juste laissé le temps de cacher mes papiers. Elle n’aurait pas voulu découvrir mes secrets, Louison. Les protéger peut-être, mais les découvrir, jamais. Comme elle le disait si bien : « ce qu’on ne sait pas, on ne peut pas le dénoncer ».
Octobre 1957
J’avais laissé la porte de l’appartement ouverte. C’était interdit, les parents l’avaient répété à plusieurs reprises, on aurait pu m’entendre ou, pire, me voir. Et alors on me renverrait en Italie. Mais de l’escalier montait un courant chaud. Elle devait faire du feu, parce qu’avec la température venait l’odeur du bois qui brûle. J’avais entrouvert la porte, juste un peu. Et je m’étais mise dans l’entrebâillement. On ne pouvait pas me repérer, j’en étais certaine. C’est là que cela a commencé.
Au début je n’étais pas sûre que cela vienne d’en bas. C’était doux, c’était léger. Je n’avais rien entendu de tel avant. Jamais. Des notes. On aurait dit qu’elles flottaient, qu’elles grimpaient l’escalier en sautillant, portées par la chaleur. Une danse ? Une ritournelle ? Une comptine ? J’avais arrêté de respirer. J’aurais bien voulu les attraper. Alors j’ai recommencé. Le lendemain, j’ai ouvert la porte. J’ai senti la chaleur, j’ai espéré. Les notes sont venues. J’ai résisté à la tentation de m’approcher un peu plus. Mon silence quotidien s’était habillé. En tenue de soirée.
J’ai eu hâte des après-midis. J’ai oublié qu’il faisait froid. J’ai oublié les jours qui passent. Un mardi je me suis enhardie. J’ai ouvert la porte et me suis mise sur la première marche de l’escalier. Il faut dire que c’était une musique si discrète, qu’il était difficile de l’entendre sans s’approcher. La joueuse devait travailler le morceau parce qu’après quelques notes, elle s’arrêtait, pestait et recommençait. J’aurais aimé savoir à quoi ressemblait celle qui égayait mes journées. J’avais bien tenté de lorgner l’entrée en contrebas quand j’entendais la voiture arriver, rien d’autre à saisir hormis quelques cheveux noirs et une silhouette sombre. Le contraste entre la sévérité entrevue et la douceur des notes était tel que j’avais bien de la peine à croire que cet austère profil ensorcelait mes murs.
Le rituel fut pris. Je glissais sur le palier, repoussais la porte, me laissais une marge de retraite et m’installais sur la première marche. Je fermais les yeux, partais en voyage.
Novembre 1992
L’automne était bel et bien fini. La baraque montrait son ouverture au monde par des courants d’air intempestifs qui rendaient son habitation pénible. Et l’hiver n’avait pas même commencé. J’enfonçai les écouteurs dans mes oreilles, choisis un CD au hasard, et essayai de travailler un peu.
J’avais déplacé les tréteaux et la planche qui me faisaient office de bureau une demi-douzaine de fois pour trouver un emplacement sans frisson. Cela ne suffit pas. Je me relevai, pris ma couette, m’y enroulai et repris mon problème de maths. Elle ouvrit la porte. Je levai les yeux au ciel. Elle me parla. Je n’entendis rien. Elle allait s’agacer et faire sa mine boudeuse. J’ai tergiversé avant d’enlever la musique de ma tête. Elle se pencha vers l’avant et je perçus un « Mais tu m’entends au moins ?? » Je libérai une oreille. J’avais Springsteen à droite et ma mère à gauche. On devrait penser à en faire un mix, tiens… « Born in tu viens mangeeeeer !!! ».
J’enlevai la deuxième oreillette.
– J’ai pas faim et j’ai pas fini.
– Mais il faut bien que tu manges…
– Plus tard.
– Ça veut dire quoi plus tard ? Tu manges tout le temps en décalé. D’ailleurs, j’en ai assez de venir chercher les bols sales dans ta chambre. Tu pourrais quand même manger en même temps que moi et cesser de te nourrir de céréales industrielles.
Elle entreprit la cueillette de la vaisselle abandonnée. Je lui tendis nonchalamment un cinquième bol qui était hors de sa vue puisque à mes pieds. Elle soupira. Pas un de ces soupirs d’exaspération. Celui-ci était teinté de lassitude. C’était assez récent ces soupirs-là. Je ne les aimais pas trop, ils me faisaient, très légèrement, culpabiliser. Elle tourna les talons, et passa la porte. Je portai la main à mes oreilles pour voir si le boss était toujours là, mais elle fit volte-face.
Elle n’avait plus la tête au soupir las, mais son regard de vainqueur. Ça, ce n’était pas bon du tout. Pour moi tout au moins. J’ai laissé tomber mes écouteurs. J’ai attendu. Les conséquences de sa détermination allaient se faire connaître et je savais déjà que je ne serais pas épargnée.
– Tu as presque quinze ans et demi maintenant.
(Il eût visiblement mieux fallu pour moi ne pas avoir cet âge vénérable.)
– Tu es en pleine forme.
(Peut-être pourrais-je me trouver un handicap ou une maladie fulgurante me permettant de nuancer cette constatation ?)
– Et tu dois apprendre à être autonome parce que je ne serai pas toujours derrière toi.
(Ce doit bien être là un élément intrinsèque à la maternité que de systématiquement imaginer ses enfants livrés à eux-mêmes et errant sans même savoir se nourrir et s’abriter. Aux dernières nouvelles, à l’ère des supermarchés et de l’État social, il y avait assez peu d’enfants des rues sous nos latitudes occidentales.)
– Alors,
(La sentence, je posai mon stylo pour l’entendre.)
– Tu vas apprendre les tâches ménagères et l’on commencera par la lessive qui sera dorénavant de ta responsabilité.
J’allais tenter un plaidoyer. Je n’en eus pas le temps. Elle était déjà partie. Je mordillai machinalement mon stylo. Je râlerai pour la forme à notre prochaine rencontre. Mais pas trop parce qu’elle pourrait bien me trouver d’autres activités encore bien plus désagréables à accomplir.
Novembre 1924
Il était revenu. Avec, pour moi, un présent. Un chapeau très rond. Toutes les Lyonnaises en portaient. Je n’ai pas osé guigner. Enfin juste un peu. Pour rougir et remercier. Ma mère n’a pas bougé. Mon père a tapoté sa pipe, signe en principe de satisfaction. Léopold ne s’y est pas même intéressé, trop occupé qu’il était à passer ses mains sur le ballon en cuir neuf. Il n’y eut pas de session musicale. J’ai été libérée assez rapidement, les hommes avaient à parler. En quittant le grand salon, ma mère a refermé bien vite la porte derrière nous. Elle a envoyé Léopold jouer dehors avec son nouveau trésor.
Nous nous sommes retrouvées toutes les deux dans le grand hall d’entrée qui résonne au son des voix fortes. Je tenais bien droit le chapeau dans son carton. Elle s’est figée un instant. A passé sa main sur ma joue. A saisi mes épaules. Je sentis ses doigts frêles qui s’agrippaient à moi. Je croyais qu’elle allait me parler, mais Louison a surgi de la porte de la cuisine. Elle a relâché son étreinte. Dans ses yeux détournés à la hâte, il m’a semblé discerner un voile. Elle a laissé là le corridor et, à pas mesurés, s’est mise à gravir le grand escalier.
J’ai montré le contenu de la boîte à Louison. Elle m’a dit qu’avec un chapeau pareil, j’allais pouvoir intégrer le grand monde et peut-être même les soirées des Montverdil, si leur fille Lisbeth m’y invitait.