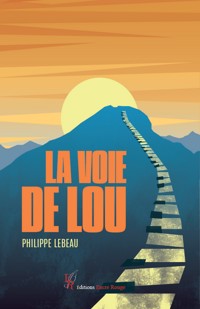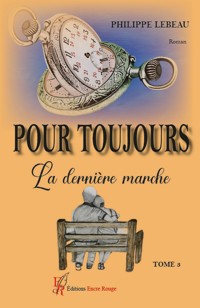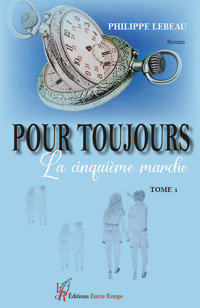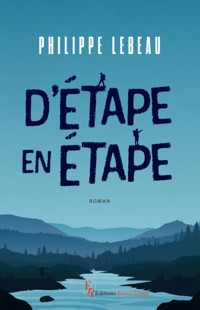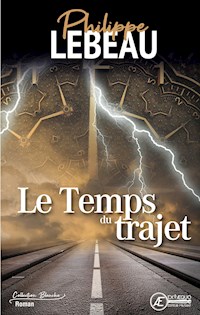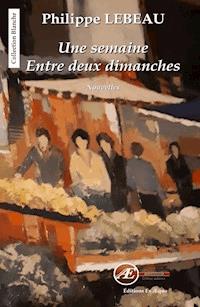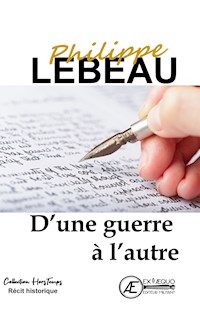
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un retour dans le passé nous permettra de comprendre les origines de notre héros préféré, François Jacpierre.
Quand il reçoit la lettre à en-tête de la mairie d’Elbeuf, François Jacpierre reste dubitatif. Il aurait un grand-oncle mort durant la guerre 14-18 ? Il se souvient de ce vieux coffre déposé dans son garage suite au décès de sa mère. Dix ans après l’avoir oublié, il l’ouvre et y découvre trois petits carnets. L’un d’eux renferme une lettre à son intention. Commence un long voyage de l’Alsace à la Normandie, du Poitou à Paris, de la France au Canada. S’ensuit un périple à travers le temps qui va « D’une guerre à l’autre », de 1870 à 1954. Quatre familles, les Viel et les Müller, immigrés d’Alsace, les Jacpierre, originaires du Poitou, les Garbo, « textains » d’Elbeuf en Normandie, se rencontrent, se frôlent, se côtoient, écrivent et inscrivent leur destinée commune. Une saga familiale enchevêtrée dans l’Histoire avec sa majuscule. Avec ce roman, l’auteur nous livre les origines de la famille de François Jacpierre, héros de ses deux précédents romans, Une semaine entre deux dimanches et Le temps du trajet.
Découvrez les nouvelles aventures de François Jacpierre dans cette saga familiale attachante et passionnante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe LEBEAU
D’une guerre à l’autre
Roman
ISBN : 979-10-388-011-3-4
Collection : Hors Temps
ISSN : 2111-6512
Dépôt légal : avril 2021
© couverture Ex Æquo © 2021 Tous droits de reproduction, d’adaptation et detraduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Éditions Ex
« …Mais quand les homm’s vivront d’amour
Qu’il n’y aura plus de misère,
Peut-être song’ront-ils un jour
À nous qui serons morts, mon frère
Nous qui aurons, aux mauvais jours
Dans la haine et puis dans la guerre
Cherché la paix, cherché l’amour
Qu’ils connaîtront, alors, mon frère… »
Quand les hommes vivront d’amour
Préface
Ce n’est pas tous les jours que je peux accueillir un romancier d’une autre collection dans la mienne ! Je remercie Philippe de passer ainsi chez Hors-Temps après avoir séjourné en Blanche avec ses deux premiers romans ! Dans l’ouvrage que vous tenez entre les mains, nous découvrons l’histoire des ancêtres de François Jacpierre, héros de ses deux précédents romans, Une semaine entre deux dimanches et Le temps du trajet.
D’une guerre à l’autre est avant tout un périple temporel entre la guerre de 1870 et celle d’Algérie jusqu’en 1954 ! Le roman nous entraîne dans les méandres de la grande Histoire à travers trois familles dont les destins sont intimement mêlés. Philippe nous livre un roman choral, passionnant et passionné ! Il nous fait voyager virtuellement entre l’Alsace et la Normandie, le Poitou et Paris, nous balade entre la France et le Canada. Je vous invite à suivre l’auteur et ses personnages dans cette saga au rythme soutenu ! Tous les ingrédients qui font passer un bon moment de lecture y sont réunis : rires, pleurs, secrets, drames, silences, engagements et rencontres !
Catherine Moisand
Directrice de la Collection Hors-Temps
Prologue
Monsieur Jacpierre,
À l’occasion de la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons procédé au recensement des soldats elbeuviens morts pour la France pendant ce conflit. Nous avons constaté que certains de ces valeureux combattants ne figuraient pas sur le monument aux morts de notre commune. C’est le cas de votre grand-oncle, André-Lucien Jacpierre, mort au champ d’honneur en novembre 1914.
La municipalité souhaite réparer cet oubli. Elle a décidé de faire graver le nom de ces hommes tués durant ce conflit et de leur rendre un hommage solennel lors des cérémonies commémoratives du prochain anniversaire de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918.
Un éloge funèbre sera prononcé pour chacun d’eux et pour ce faire, nous souhaiterions avoir quelques éléments sur la vie et la famille d’André-Lucien Jacpierre.
À cette fin, vous serait-il possible de nous communiquer les informations en votre possession ou des documents en rapport avec votre parent ?
Vous remerciant d’avance pour votre collaboration.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Jacpierre, l’expression de notre considération distinguée.
Djibril Mératem
Maire d’Elbeuf
Debout devant sa boîte aux lettres, François tourne et retourne le courrier à en-tête de la mairie d’Elbeuf. Il aurait un grand-oncle mort à la guerre ? Première nouvelle. Il n’en a jamais entendu parler ni par ses frères ou sa sœur, ni par ses parents ou par qui que ce soit d’autre.
Il se souvient de la tournée des cimetières à la Toussaint, dans son enfance. Les parents avec chacun leur chrysanthème enveloppé dans du papier journal. Parfois, ils rencontraient un oncle, une tante, accompagnés d’un cousin ou d’une cousine de l’âge de ses frères et du coup sacrément plus vieux que lui. Ça racontait les histoires de famille, celle d’un grand-père ou d’une grand-mère, celle de l’oncle Constant ou de l’oncle Arthur.
— T’as des nouvelles d’Arthur ? Paraît qu’il va venir bientôt ?
— Paraît, mais tous les ans il nous dit ça et il n’est revenu qu’une fois depuis qu’il a été amnistié.
François revoit le paysage du haut de ces deux cimetières. Les cheminées d’Elbeuf qui se sont éteintes sournoisement, silencieusement les unes après les autres tout au long de son enfance. Les immeubles qui se sont élevés fièrement, bruyamment les uns après les autres tout au long de son enfance. Avec ses frères, Denis et Xavier, une fois le simulacre de recueillement terminé, ils s’accoudaient au muret qui surplombe la ligne de chemin de fer et ils se perdaient dans l’horizon sauf que, fréquemment à la Toussaint, le brouillard limite la vision au bout du cache-nez. Les plus vieux des frangins, le plus souvent Bertrand, faisaient la tournée la semaine précédant la cohorte familiale, afin de nettoyer les tombes. Quelquefois, il n’avait rien à faire, car un cousin ou un oncle ou une tante était passé avant lui et n’oubliait pas de faire remarquer avec force et vigueur qu’il avait astiqué les lieux.
Au cimetière de la côte Saint-Étienne, il y avait, et il y a toujours, la tombe des grands-parents maternels de François, la famille Viel avec le grand-père Eugène, immigré alsacien et la grand-mère Angèle, sa deuxième épouse. Y reposent aussi le petit Xavier, son frère décédé quelques heures après sa naissance, la tante Marcelle et une autre tante, Germaine, demi-sœur de sa mère. L’oncle Augustin, le curé, les a rejoints en 1992. Dans sa grande largesse, il a laissé suffisamment d’argent pour payer une concession éternelle et une pierre tombale neuve. Le reste de son héritage, il l’a laissé à un copain curé plutôt qu’à sa sœur. C’est ça l’esprit de famille. Heureusement qu’il n’avait pas légué ses livres au dit curé. En faisant le déménagement du presbytère, le frère de François, Jean, a fait tomber une caisse de bouquins. Quelle ne fut pas sa surprise d’en voir s’échapper des billets de banque. L’oncle les avait cachés dans ses livres. Son copain curé n’en a pas hérité. Il n’avait qu’à venir vider la maison !
Au cimetière Saint Jean, sur l’autre colline qui surplombe Elbeuf, il y a les tombes de la famille Jacpierre. Celle du grand-père Pierre, de sa femme Édith et d’une de leur fille Geneviève. Il y a celle des arrière-grands-parents, Pierre-Joseph lui aussi immigré, mais du Poitou, et Marie sa deuxième épouse. Dans les souvenirs de François, il n’y a pas d’inscription ni de plaque au nom d’André-Lucien. Il se souvient d’être allé le 11 novembre avec l’école, chaque année du primaire, pour chanter la Marseillaise dans le carré des morts pour la patrie, en haut de ce cimetière. Il ne se rappelle pas d’une tombe avec Jacpierre inscrit. Il s’en serait vanté auprès des copains. Il glisse la lettre dans sa poche et en sort son téléphone pour appeler son frère de treize ans son aîné.
— Allo Frangin, c’est moi. Dis, je viens de recevoir un courrier de la mairie d’Elbeuf, il paraît qu’un frère du grand-père Jacpierre serait mort à la guerre en 1914. Tu le savais ?
— Non, répond Bertrand, jamais entendu parler de ça. J’ai reçu la même lettre ce matin. Ils ont fait la tournée ! Je sais que le grand-père n’a pas fait la guerre à cause de son œil en moins, que l’oncle Arthur s’est barré au Canada pour y échapper, mais là c’est une nouvelle. Ils ne se sont pas trompés de Jacpierre ?
— Faut croire que non. Il n’est pas inhumé au cimetière Saint Jean.
En guise de réplique, un silence bourré de points d’interrogation, d’exclamation et de suspension. Le suspens de la réponse s’achève sur le traditionnel« Tout le monde t’embrasse ! » dont seul François est au courant. L’un et l’autre appuient sur le bouton rouge de fin d’appel d’une conversation qui n’a pas coûté un rond à l’opérateur tant elle était courte.
Arrivé à la porte de son garage, François se souvient qu’il y a entreposé un vieux coffre en bois récupéré chez ses parents au décès de sa mère. S’y entassent des paperasses de famille sans utilité, que personne n’a consultées et dont personne ne voulait, mais qu’aucun des frangins ne pouvait jeter. Pour soulager la conscience familiale et libérer la maison, François a mis le coffre dans celui de sa voiture et, sans un regard de plus, l’a abandonné dans un coin d’où il n’est jamais sorti. Depuis bientôt dix ans, celui-ci s’enfonce dans l’oubli. Il n’a jamais eu l’idée ni l’envie de l’ouvrir, jusqu’aujourd’hui, jusqu’à cette lettre qui fait ressurgir du passé des souvenirs d’antan, d’un temps très éloigné, de vies oubliées. François déplace des planches, des cartons et tout un fatras de choses inutiles qu’il entrepose et garde dans ce lieu au cas où... De qui, de quoi, nul ne le sait encore moins lui, mais il garde, « On ne sait jamais, ça peut servir ! ».
Il ramène à la vie ces histoires de famille, ce passé assoupi, cette Belle au bois dormant dans ce coffre-château-fort enseveli sous une couche grise de toiles d’araignées et de poussière mêlées.
Dans la vieille malle, il y a deux cartons distincts. Sur celui de droite, une large inscription : Famille Jacpierre. Le second est lui aussi porteur de cette même écriture toute en liées et en déliées de sa mère : Famille Viel.
Trait d’union entre les deux cartons, une enveloppe bleue semblant n’appartenir à personne. Aucun nom ni prénom. Elle attire le regard, les mains. Enfin libérée, elle se faufile sournoisement, délicieusement au soleil printanier. À l’intérieur des photographies ; celles d’une jeune femme tout en sourire. Elle a ses cheveux tressés qui courent jusqu’au milieu du dos. Au revers, un prénom, Anna. Une autre semble l’accompagner, celle d’une enfant qui lui ressemble si ce n’étaient ses cheveux plus noirs, moins frisés, moins longs. Un prénom presque illisible au dos de ce carton jauni : Madeleine. Comme une larme, une tache étoile la robe de l’enfant. Sur un autre cliché en noir et jaune, une jeune fille. Elle ressemble à l’enfant. Certainement elle en plus âgée, toujours aussi belle malgré son visage sans sourire, ses yeux sans éclat sauf celui d’une perle de larme. Elle tient par la main un jeune militaire à la moustache guerrière. Lui étale un large sourire de futur vainqueur, mais dans ses yeux la peur. Une date en haut à gauche, perdue dans le ciel, perdue dans le temps, juillet 1914 et ces initiales M. AL.
Une autre photographie glisse de l’enveloppe bleue, celle d’un jeune homme qui ressemble au militaire précédent. Une femme se tient à ses côtés, suffisamment éloignée de lui pour ne laisser aucune ambiguïté, ne rien laisser supposer. Elle porte une fillette de deux ans tout au plus dans les bras. Elle ressemble à la jeune fille du cliché avec le soldat, mais ce n’est pas lui qui est là. Ils sont tous les trois sur le pont d’un bateau. Une date semble s’envoler avec le vent vers des confins inconnus, juillet 1916. Aucun nom, aucun prénom.
Deux autres images dorment dans le fond de l’enveloppe bleue. L’une présente un homme dans son cercueil. Il est entouré d’une multitude de couronnes et de bouquets de fleurs. Il prend la pause pour l’éternité sans autre pudeur que celle de la mort. Attaché à son dos par un papier collant noirci, le portrait en couleur d’une femme encore jeune, au regard en amande et aux cheveux blonds tressés qui courent jusqu’au milieu du dos. Une jeune fille à sa droite, sa fille à n’en pas douter. Elle a le regard de sa mère, un petit sourire en coin à faire craquer toute la terre. Au dos des deux clichés, une date identique écrite à l’encre bleue, 1963. Et toujours aucun nom, toujours aucun prénom. Qui sont ces portraits inconnus, petits soldats sans nom d’une histoire qui va et qui vient d’une guerre à l’autre ? Trois carnets identiques en moleskine noire, attachés par un gros élastique, se sont terrés dans les plis de l’enveloppe bleue. Sur leur couverture une étiquette d’écolier revêtue chacune d’une inscription dont François reconnaît l’écriture, celle de sa mère. Des dates y sont inscrites. L’une à la plume Sergent-Major est à l’encre violette, 1871 – 1914. L’autre a pris le noir, mais conservé la plume, 1918 - 1939. Sur le dernier carnet, une seule date est notée au stylo plume, mais toujours avec cette écriture significative des écoliers de ce début du vingtième siècle, 1940. Une lettre est glissée dans le dernier carnet. Elle est datée du 22 février 2010. Elle est adressée à François, signée de sa mère. L’écriture est tremblante, comme fatiguée. La lettre a été rédigée la veille de sa mort.
Mon Chéri,
Ta gentille petite femme m’a demandé hier pourquoi je n’avais jamais pris le temps d’écrire l’histoire de la famille. Elle a ajouté que tu avais commencé à le faire et tu m’as dit que tu me montrerais ce que tu as écrit.
Je crains de n’avoir le temps de te lire. Mon corps se vide, mon cœur ne se contrôle plus, je suis si fatiguée.
Je suis sur le départ pour ce grand voyage qui me conduira auprès de ceux qui ont fait ce que je suis devenue, avec mes bons points et mes mauvais. Je vais rejoindre le souvenir, vos souvenirs. Je vais être auprès de ceux qui ont remonté le balancier de ma vie. Ce balancier qui mène les heures, parfois les heurts, parfois bonheur, parfois malheur, sa course va bientôt, très bientôt s’arrêter. Elle finira son chemin au milieu, ni d’un côté ni de l’autre. La mort n’est ni un bonheur ni un malheur. Elle est !
Je glisse cette lettre dans mes petits carnets où j’ai retranscrit quand le temps me le permettait, les histoires de la famille. Je n’ai eu que le temps et le courage de les poser sur les pages de ces carnets. Je te les confie. Tu y découvriras des secrets parfois bien gardés, parfois de polichinelle. Fais-en ce qu’il te plaira d’en faire. Je te les confie. À toi de les mettre en lumière ou de les taire. Tu sauras faire.
Je t’aime mon chéri, mon François. Tu portes le prénom de mon grand-père resté à Bischwiller. J’ai voulu que sa mémoire et celle de ma famille traversent les ans, portées par un de mes enfants.
Traverse les ans et rejoins la mémoire, leur mémoire, leurs souvenirs, les miens. Je te fais confiance.
Je t’aime et je vous embrasse, toi, tes enfants et ta gentille Camille.
Maman
Sous un arc de triomphe de toiles d’araignées, une flamme s’est ranimée dans les souvenirs d’hier et d’avant, bien avant.
Famille Jacpierre,an 0 d’après-guerre
Leignes – Paris – Vernon - Elbeuf, juillet 1871
Installé au soleil printanier de ce début d’après-midi, François sort le carton « Famille Jacpierre ». Avec des gestes précautionneux, il en ouvre les rabats poussiéreux. Sur le dessus, une pochette grise avec écrit dessus « Donation Garbo ». Semblant s’être attaché à elle, un vieux livret militaire au nom de Pierre-Joseph Jacpierre, natif de Leignes dans le Poitou.
Pierre-Joseph ! Ce double prénom résonne en François comme une ancienne chanson, une vieille ritournelle pleine de sourires complices, d’anecdotes familiales qu’on se transmet d’une génération à l’autre.
« Le fameux Pierre-Joseph » disait de lui sa mère. « Il s’est ruiné aux jeux » ajoutait son père.
L’ancêtre de la famille, celui dont on a tous parlé, jasé et fini par oublier. La référence et la honte !
« Ton père a toujours eu en horreur les jeux d’argent à cause ou grâce à ce Pierre-Joseph » lui a dit sa mère.
Cette dernière aimait à raconter le passé, comme pour mieux atténuer les rigueurs de sa vie. Raconter l’hier consolait son présent trop souvent sans saveur et bourré de déboires, d’espoirs disparus. Elle racontait sa vie, la sienne, celle des autres, enfin pas toutes, certaines d’entre elles sont restées dans l’ombre, envahies de silences, d’inconnus, de poussière et de toiles d’araignées.
François prend le premier carnet noir de sa mère. Le temps s’en va à la recherche du temps, celui d’il y a longtemps, celui d’il était une fois, deux fois, tant de fois.
Juillet 1871
L’histoire de Pierre-Joseph Jacpierre commence vraiment en octobre 1871. Il a tout juste la vingtaine. La fin de la guerre contre la Prusse est signée depuis le 12 mai. Les troupes, venues des quatre coins de France, sont laissées à elles-mêmes et s’éparpillent à vau-l’eau. Celles basées à Paris ont vécu l’enfer de la Commune et sa répression contre un peuple révolté par la capitulation des riches et des nantis pour préserver leurs privilèges. Elles ont donné main-forte à un certain Adolphe Thiers qui en quelques semaines a fait massacrer dix fois plus d’ouvriers que Robespierre n’exécuta de nobles pendant la terreur.
Sur les routes vers la province, cheminent de concert, ex-communards venus des villes ouvrières pour soutenir leurs frères de Paris et ex-soldats, « dé-soldés », désolés d’avoir plongé leurs armes dans la grande lessiveuse de la vie. Beaucoup sont des paysans sans terre, des ouvriers sans ferme, des journaliers sans attache et sans bien. Ils ont quitté leur village, leur masure depuis si longtemps que plus personne ne les attend. Ils sont las et ils sont là aux frontières de Paris, leur ballot sur l’épaule avec la faim en guise de compagne et l’avenir en ligne d’horizon. Mais quel avenir ?
En chemin ils s’arrêtent, celui-ci à Fontainebleau, celui-là à Saint-Germain. D’autres allongent leurs pas, vers les terrils du Nord, la Beauce ventrue ou la Normandie joufflue. C’est la saison des moissons. On manque d’hommes dans les champs et dans les bras des femmes. La même histoire soixante ans plus tôt pour les rescapés de la Bérézina.
Chacun pose ses hardes où il veut, où il peut. On ne connaît de lui que ce qu’il veut et ce qu’il peut encore en dire.
La France migre et disperse aux quatre coins de ses conquêtes ou de ses défaites tantôt ses cadavres que personne ne réclame, que tout le monde oublie, tantôt ses survivants que plus personne n’attend, qu’aucun amour n’espère.
Les morts sont entassés dans un caveau commun ou sous un monument dont aucun ne se souvient qu’ici gît le héros d’une folie guerrière, d’une ambition meurtrière d’un pouvoir scélérat. Demain ils se mélangeront les malchanceux de France, les enrôlés de force d’ici et d’ailleurs. Après on les triera, d’un côté les vaincus, de l’autre les vainqueurs. Et sous un arc de triomphe de la folie humaine, on glissera les os d’un illustre inconnu pour donner bonne conscience aux puissants de la terre, qui, chaque anniversaire de leur jeu de massacre, viendront alimenter le feu d’une flamme assassine.
Lui, chemine depuis la barrière de Saint-Cloud aux côtés d’un de ceux qui, quelques jours avant, étaient face à lui, contre lui, à abattre. Ils ont sympathisé dans le creux d’un fossé, lui pour s’y soulager du dégoût du charnier, lui pour s’y réfugier de la peur du charnier. Ils se sont rencontrés, Pierre-Joseph Jacpierre l’ex-soldat, et Albert-Hippolyte Garbo ex-communard.
Avant de fondre sur Meaux, ils traversent les vestiges des potagers et des fruitiers de Chambourcy et d’Orgeval. La route longe la Seine et grimpe la colline de Mantes-la-Jolie qui n’a plus rien de son nom tant la guerre, la famine l’ont ravagée. Un petit village du nom de Giverny, les accueille une nuit. Ils arrivent à Vernon, la ville des Mobiles de l’Ardèche.
Les Allemands se sont arrêtés là, la faute à ces héros venus de Privas, d’Annonay ou d’un lointain village du sud de la France. Ces enrôlés de force et ces volontaires d’une garde mobile ou nationale, parfumés d’un patriotisme sauvage, ont arrêté les uhlans, leurs fantassins et leurs cavaleries en forêt de Bizy. Embusqués dans les chemins creux qui relient Vernon à Évreux, à Louviers ou à Rouen et ouvrent grandes les portes de la Normandie, ils les ont décimés avec leurs vieux fusils des guerres napoléoniennes. Un jeune Capitaine, Marius Régis Rouveure, d’à peine vingt-trois ans, y a laissé sa vie. Une vie bien trop courte comme celle d’autres bougres, sans nom et sans grade qui, fauchés comme lui dans les forêts de l’Eure, n’ont pas eu les moyens eux, d’être rapatriés près des leurs. Il faut rendre gloire, honneur, reconnaissance au capitaine Rouveure. On décide d’un monument sur le lieu de sa mort. Il faut donner exemple aux jeunesses à venir, aux morts en devenir. On donne le nom d’Ardèche à une rue de Vernon, l’avenue de la Maisonnette. Pour inhumer les sans nom de la guerre, venus de ce département, la ville fait bâtir un autre monument en forme de pyramide, pour recevoir leur corps.
Mais avant de bâtir, il faut tout nettoyer. Redonner sens et vie aux rues éventrées, aux forêts maltraitées. Il faut aller chercher les obus ennemis qui n’ont pas explosé dans cette terre humide. Il faut des bras. Albert et Pierre-Joseph louent les leurs, ils restent à Vernon jusqu’à la saison des pommes à cidre.
Trois nouvelles étapes les mènent chez Albert, au hameau du Buquet commune de La Londe, Seine-Inférieure, à quatre kilomètres d’Elbeuf.
Pierre-Joseph Jacpierre n’hésite pas. Il ne va pas plus loin. La ferme des Garbo, parents d’Albert, a besoin de ses mains. Le père Garbo est au bout du chemin. Il a le dos en demi-cercle et le cerveau qui tourne en rond. La mère a toute sa tête. Elle voit en Pierre-Joseph le moyen de caser sa dernière, Angéline qui fait tourner le chef à tout ce que comptent Le Buquet et La Londe en garçons. Faut dire que du haut de ses seize ans, la coquine a de quoi. Fine et fière, un sourire enjôleur éclaire son visage auréolé de boucles blondes et garni de deux émeraudes qui transperçant le cœur, incitent à la débauche. C’est une cadronnette comme on dit ici, mais pour la dissiper, faudra attendre encore qu’elle fasse la vingtaine.
Les Garbo ont quatre enfants, deux filles et deux garçons. Blanche, l’aînée, a marié celui des Hue, Léonard. Pas bien beau ni très malin, mais beau parti. À la mort de ses parents, il héritera des champs du plateau entre le hameau du Buquet et l’église de La Londe. La terre y est grasse et donne en abondance pour qui sait la travailler. Et Léonard sait la besogner sa terre. Bien mieux que sa femme qui depuis cinq ans qu’ils sont assortis ne lui a toujours pas donné d’héritier. Même une héritière ferait l’affaire. Pourtant il fait ce qu’il faut, mais rien n’y fait. La Blanche ne prend pas. Les années passent et passe l’envie. La Blanche se ternit et s’étiole.
« Elle devient toute décatie », dit d’elle Léonard qui n’a plus d’yeux pour elle et renverse dans la paille les journalières qui souvent ne veulent pas, mais se taisent. Et la Blanche se grise des potions du rebouteux de Bourgtheroulde, des décoctions de la folle du petit bois. Mais rien à faire, rien n’y fait, la Blanche ne prend pas. Les regards s’insistent sur sa ligne sans ventre. Sûr et certain, c’est de sa faute. Personne ne le sait, mais elle n’a pas été sage avant le mariage. Elle a même eu bien peur quand pendant trois longs mois, elle n’a pas saigné. Elle n’avait pas seize ans. Elle n’a pu se défendre du bel Adrien, le fils des voisins avec qui elle avait dansé toute la soirée au bal du quinze août à la Londe. Elle l’aimait bien l’Adrien. Elle l’espérait en silence, sans rien dire à personne. Souvent, la nuit, dans le secret de son lit partagé avec sa petite sœur Angéline de cinq ans sa cadette, elle rêvait de lui, si beau, si gentil. Enfant, le dimanche, elle guettait son passage pour faire avec lui le chemin de l’église. Ils étaient promis l’un à l’autre et c’est sans crainte qu’elle avait accepté qu’il la raccompagne, passé minuit. Ils avaient ri de voir le Père Hébert endormi dans sa carriole, saoul comme pas possible. Serrés l’un contre l’autre, ils ont ramené la charrette, le cheval et le père Hébert jusque chez lui. Ils l’ont laissé cuver son cidre et son calva dans le fond du tombereau bien à l’abri dans l’étable.
« Sûr que demain il ne se souviendra de rien et bénira le cheval de l’avoir déposé à bon port » a dit Adrien en riant. Et ils sont repartis en se tenant par la main. La fraîcheur de la nuit les invite à se serrer plus fort. À l’approche de chez elle, Adrien l’a embrassée. Elle s’est laissé faire. Elle en avait rêvé. Mais, abandonnée contre un arbre, elle s’est inquiétée quand elle a senti ses mains se glisser sous sa robe. Elle s’est effrayée quand il l’a plaquée sur le sol. Elle a eu beau crier ce soir-là, elle a eu beau le supplier, taper, griffer, mordre et pleurer, la fête des moissons et de la sainte Vierge a vu partir en larmes de sang son innocence entre les jambes d’Adrien. Elle n’a rien dit, n’a rien pu, rien osé dire. Le lendemain, tout le monde moquait Adrien pour sa chute dans les ronces du chemin qui lui avaient lacéré le visage et les mains. Le cidre, certainement ! Elle n’avait pas su se défendre. Elle avait certainement été trop aguichante envers lui. Quelques jours après le quinze août, Adrien a disparu. Il est parti et nul n’a plus entendu parler de lui. Personne n’a compris. Sauf Blanche. Tout le monde a pleuré. Sauf Blanche. Trois longs mois plus tard, elle a eu ses règles. Plus fortes que d’habitude, mais elles étaient là et la peur est partie et la honte est restée, sournoisement fichée dans un coin de son cœur, dans un coin de son corps. Elle n’a pas oublié cette nuit, cette peur. Elle s’est mariée et Léonard n’a rien remarqué. Elle pense que Dieu, la sainte Vierge et tous les saints du ciel lui font payer de n’avoir su résister au retour de ce bal. C’est à cause d’elle la disparition d’Adrien. C’est son péché et faute d’absolution du curé à qui elle n’a rien confessé, elle ne peut avoir d’enfant. Alors, Blanche traîne sa tristesse et sa honte secrète du puits à l’étable, de la Noël à la Saint Jean et chaque quinze août son cœur et son corps saignent. C’est un seize août au matin, seize ans plus tard qu’on retrouve la Blanche flottant à la surface glauque de la mare de la ferme. Deux jours auparavant, les Hébert ont appris la mort d’Adrien à la guerre. Il s’était fait soldat et a été tué à la bataille de Reichshoffen. Aucune des journalières, aucune des ouvrières renversées dans les granges de Léonard n’a jamais eu d’enfant de lui. C’est une chance. Mais Léonard n’a pas de chance ; il s’est remarié et sa seconde épouse, elle non plus, ne lui a pas donné d’héritier. Même une héritière aurait fait l’affaire. Le sort s’acharne sur ce pauvre Léonard.
Albert est le second des enfants Garbo. Il a l’âge de Pierre-Joseph. Comme lui, il est né en 1851, mais lui a eu la chance au tirage au sort. Il ne fait pas l’armée et réussit à se faire oublier lors du rétablissement par l’impératrice de la Garde nationale mobile en août 1870. Il part à Paris pour s’y faire oublier, mais la commune le rattrape au mois de mars 1871. Il a loupé la guerre, mais a failli mourir au mur des fédérés, par hasard, par erreur. Pas plus communard que versaillais, il est là pour se cacher, échapper à la tuerie. Le siège de Paris l’enferme dans sa nasse de faim, de massacre et de mort. Lui n’est pas là pour ça. Et le hasard dévie la balle versaillaise dans le cœur d’un autre pauvre bougre debout à ses côtés. Pas le temps d’achever les mourants d’un dernier coup de grâce. Ils mourront lentement, se vidant de leur sang. Les balles sont comptées et Monsieur Thiers en manque. Coup de chance pour Albert qui, à la nuit venue, rampe jusqu’au sortir du cimetière du Père-Lachaise. Il ne se vantera pas du hasard, de la chance, ni de ses intestins.
Albert est tisseur à Elbeuf et promis à la fille Hébert, Marie, la sœur d’Adrien. Elle aussi c’est une belle fille. C’est l’amie d’Angéline et comme elle, les garçons ne se privent pas de jouer les essaims à son passage. Mais pas touche, chasse gardée et héritage des forêts de la Londe avec. On peut déserter la tuerie sans pour autant cracher sur la vingtaine d’hectares de bois et de chasses des futurs beaux-parents. Mais faut attendre un peu que la Marie passe sa vingtaine elle aussi. Comme Angéline, elle n’en a que seize et elle peut encore rapporter à la ferme tout en travaillant à rentrayer dans la dernière des maisons du hameau. Avec leurs mains fines et habiles, elles rentrent les fils cassés des pièces de drap et en font disparaître les coutures. Elles travaillent à façon pour Canthelou ou Petou sous l’œil expert et la vigilance brailleuse du maître d’atelier. Deux grandes salles, une pour les pièces de laine, l’autre pour celles de lin, vitrées d’un bout à l’autre de leurs quinze mètres chacune pour éclairer au mieux les tissus à travailler. L’été c’est la fournaise, l’hiver une glacière. Elles sont une vingtaine à se tuer les yeux et les doigts. Moyenne d’âge vingt ans, la plus jeune en a douze, la plus vieille vient de fêter Sainte Catherine. Les larmes se figent et le souffle fume pour réchauffer les doigts gourds en hiver. L’été, les fenêtres ouvertes laissent entendre les chants et les rires des ouvrières, mais également les rémouquages de la contredame, la Mère Joséphine. Marie et Angéline travaillent depuis leurs douze ans. Douze heures par jour, six jours par semaine, douze mois par an, après la traite du matin et avant celle du soir. Le métier n’est pas facile, mais bien plus agréable que de curer l’étable ou de battre le beurre. Et elles sont entre filles. Les Hébert habitent la ferme au bout du passage de la Mare-plate qui conduit à la route de l’église de La Londe. C’est le chemin creux des malheurs de Blanche. Il part face à l’atelier de rentrayage et communique avec celui qui aboutit à la bâtisse des Garbo. Cernés de haies et de talus, les deux passages se conjuguent, débordent et s’engluent d’une terre argileuse collante les jours de pluie. Ils se déversent à la jonction du chemin qui descend à Elbeuf, devant l’allée qui mène à la maison Garbo. À force, excédé de ne pouvoir rentrer chez lui sans s’inonder les pieds, le vieux Garbo a creusé une mare qui sert de récepteur aux écoulements et d’abreuvoir à ses vaches. Il en a profité pour y mettre un couple de canards qui donne bon an mal an, quatre canetons revendus au marché d’Elbeuf le samedi matin. Comme quoi un malheur n’a pas que du mauvais.
Le dernier, le p’tit ravisé de la famille Garbo, c’est Edmond. Quand Pierre-Joseph arrive, il vient tout juste d’entrer comme apprenti chez le père Cordier, un menuisier d’Elbeuf. Il n’est plus à la ferme. Il a le gîte et le couvert chez son patron. C’est un taiseux, un lunas. On ne l’entendait pas à la ferme et valait mieux pas. Il a été placé chez la mère Cordier jusqu’à ses six ans comme son frère et ses sœurs, mais lui à onze il y est retourné, comme arpète de son mari. Ce n’est pas le bonheur ni le luxe, mais les Cordiers l’ont pris en affection après la mort de leurs deux fils écrasés par un arbre un soir de tempête en revenant d’un chantier dans le Roumois. Il n’y a eu que le cheval pour s’en sortir. C’est lui qui a donné l’alerte quand il est arrivé seul, les deux brancards brisés de chaque côté. Le père Cordier n’a fabriqué qu’un cercueil pour y déposer ce qui restait de ses enfants réduits en bouillie par un chêne deux fois centenaire. Il a récupéré le chêne et l’a mis à sécher dans sa cour. On le remarque à la tache brunâtre sur son flanc. Une fois sec, il en fera deux cercueils, un pour sa femme et un pour lui.
Après la Toussaint 1871, après le ramassage des pommes à cidre, Pierre-Joseph s’installe à La Londe, dans une dépendance du « Chartrier » le château qui se dresse auprès de l’église. Le dimanche précédent, alors qu’il attend au café d’en face la sortie de la messe et celle d’Angéline, il entend le débourreur du domaine dire qu’il part à la ville pour s’occuper des écuries de Monsieur Grandin, le député, un patron d’Elbeuf. Pierre-Joseph, dont c’était le métier dans le Poitou, se propose aussitôt pour le remplacer ; il se voit attribuer et le poste et le logement qui va avec. En fait ce logement se réduit à une pièce située face au château et accolée aux écuries, mais c’est mieux que la mansarde de journalier qu’il occupe depuis son arrivée au-dessus de la grange chez son ami Albert. Il y est chez lui. Il passe l’hiver à soigner les six juments qui devraient bientôt mettre bas. Il finit le débourrage des poulains nés au printemps dernier, avant leur vente au marché du Neubourg à l’arrivée des hirondelles. Cela lui laisse assez de loisirs pour fabriquer dans sa cahute, des pièces tissées sur le métier qu’il loue chez un maître tisserand d’Elbeuf et qu’il descend à chaque fin de mois. Le loyer du métier décompté lui laisse suffisamment de monnaies sonnantes et trébuchantes qu’il change quand c’est assez en un Napoléon d’or bien frappé. Souvent le soir, il retrouve Albert au café d’en face. Autour d’une bouteille de cidre et de celle de calva quand la soirée s’attarde en rincettes et surrincettes, ils jouent aux dominos. Pierre-Joseph est fin joueur, sa renommée s’installe. Les parties se perdent et se gagnent, mais se monnayent aussi. Sa dextérité lui rapporte. Son bas de laine, muché derrière une brique descellée au bas du mur derrière sa paillasse, se garnit et s’arrondit au fil des soirées et des années.
Il n’y a pas que son magot qui se garnit, sa réputation aussi. Pas seulement débourreur de poulains le Pierre-Joseph, il passe pour l’étalon du château et du plateau de La Londe. Les étables, les écuries, les granges et les sous-pentes connaissent ses chevauchées fantastiques et lubriques. Sa renommée a passé les années.
« Faut que jeunesse se passe » dit la Mère Garbo pendant les cinq années qui précèdent le mariage de Pierre-Joseph et d’Angéline. Celui-ci a lieu en novembre 1876, après le ramassage des pommes à cidre, un an après celui d’Albert et de Marie. Impossible d’envisager deux fêtes la même année pour la Garbo, d’autant plus que le vieux s’effiloche de plus en plus.
« Il tourne jacquot. Ce n’est pas le moment de dépenser sans compter. »
Quand Pierre-Joseph et Angéline se marient, Albert et Marie ont déjà Marguerite. Contre toute attente, Marie n’accepte pas que sa fille lui soit retirée au lendemain de la naissance pour être confiée à une nourrice. Elle quitte son travail au rentrayage et elle aussi, prend en location un métier. Albert, chaque semaine, descend les travaux de Marie qui ainsi peut garder Marguerite auprès d’elle non sans subir sarcasmes et remontrances de sa belle-mère et l’étonnement de sa belle-sœur Angéline.
Trois ans plus tard, à la Pâques 1879, le vieux Garbo devenu sourd comme une boise et qui ne pouvait plus arquer depuis plusieurs années, tire sa révérence.
« Il est mort comme il a vécu. Prier Dieu pour lui s’rait du temps perdu » a dit sa femme Joséphine. Elle non plus n’a pas perdu de temps. Sitôt la donation à ses enfants signée, elle a fermé son parapluie aux premières gelées. Elle s’en est allée rejoindre son vieux et sa Blanche après la saison des pommes à cidre.
Albert récupère la maison de ses parents qu’il loue à Pierre-Joseph et Angéline. Lui a déjà celle des Hébert, les parents de Marie, juste en face. Angéline hérite des bois et des pâturages qui vont de la côte du Buquet à celle de Bourgtheroulde. Une bonne dizaine d’hectares qui ne demandent qu’à rapporter à qui sait les faire fructifier.
Pierre-Joseph Jacpierre l’enrôlé du Poitou a déposé ses hardes à la saison des pommes dans un coin de mansarde de la campagne normande. L’immigré de Leignes dans le Poitou n’est pas allé plus loin. Il ouvre son chemin vers un nouveau destin.
Famille Viel,an 3 d’après-guerre
Bischwiller – Paris – Vernon – Elbeuf, juillet 1874
— T’as fait quoi dans le garage ? demande un brin énervée Camille, l’épouse de François. On ne peut même plus prendre les vélos. Déjà qu’avant c’était la caverne d’Ali Baba, là c’est après le passage des quarante voleurs !
Le temps est au gris ce matin et il déteint sur l’humeur de la maison. Bonjour l’ambiance ! Camille râle sur le rangement du garage, Juliette, leur fille, sur ses baskets qu’elle ne retrouve pas dans ce lieu de carnage et Antoine, le dernier de la famille, sur la pluie qui les surprend lui et son vélo au sortir du souk normand. Fichu garage !
— Papa tu pourrais me conduire au collège ? affirme plus que ne le demande Antoine.
— Qui a mis tout ce bazar devant les chaussures ? maudit Juliette empanachée dans les restes d’une vieille toile d’araignée bien poussiéreuse juste avant de hurler encore plus fort, mais d’effroi cette fois, en découvrant l’araignée accrochée au revers de son manteau.
Il est huit heures trente. Le calme est revenu après la tempête du départ des uns et des autres, toujours à la bourre, à la recherche de la veste du jour, de la paire de chaussures indispensable pour compléter l’harmonie de la tenue du jour qui finalement ne conviendra pas à cause de la pluie ou du brouillard ou du soleil ou de rien d’autre que de ne pas convenir. Et ce sera le nouveau départ d’une course effrénée, à la recherche d’un autre pull, d’une autre tenue qui ne conviendra pas plus, car, ne l’oublions pas, Juliette et Antoine sont des ados. Alors …
Alors François se dit qu’afin d’éviter le pire demain, il ferait mieux de ranger le garage ou tout du moins de libérer l’accès aux chaussures et aux vélos. Sortir la vieille malle de son enclos d’inutilités ne lui prend qu’un instant, mais qu’est-ce qui lui prend d’en ouvrir à nouveau le couvercle, sitôt déposée auprès de la table de la salle ?
À l’intérieur du carton marqué « Famille Viel », plusieurs enveloppes et boîtes sont soigneusement disposées. François y découvre des photos jaunies en noir et blanc. Il y retrouve ses grands-parents qu’il n’a jamais connus. Il y a aussi son oncle Augustin, le curé, et Raymond le demi-frère de sa mère.
Dans une large pochette grise, il y a des lettres, des officielles, des familiales, à l’encre bleue délavée ou noire usée. Entre elles, gisent des faire-part de décès, de naissance, de baptême, de communion et de mariage.
Il trouve dans une boîte en fer rouillée, un vieux chapelet aux grains à l’ivoire jauni et usé, une médaille de Saint Christophe, une autre de la Sainte Vierge, deux de Sainte Thérèse et deux aussi de Sainte Bernadette, les deux Bienheureuses à égalité, championnes toutes catégories dans l’estime et les prières de Thérèse sa mère. Dans leur petit écrin en velours rouge ou noir ou bleu, trônent des décorations avec leur ruban tricolore. Il y a celles du travail au nom d’Eugène Viel, de Constant Viel et de Marcelle Delaruelle, l’arrière-tante de François. Il y a celle de l’église pour les bons et loyaux services d’Eugène en qualité de sacristain et celle de la CGT avec son ruban rouge au nom de Constant pour ses vingt-cinq années d’adhérent. Aucune décoration d’une quelconque guerre.
Une troisième boîte, plus imposante, laisse s’échapper six livres élimés, un Nouveau Testament annoté, Francinet, Le tour de France par deux enfants,Le Petit Lavisse, une version française de l’encyclique de Léon XIII Rerum novarum et Le droit à la paresse d’un certain Lafarge. Des journaux y dorment, certains depuis plus d’un siècle et demi. Le Révolté, Le droit social et L’Humanité font bon ménage avec des vieux exemplaires de L’Univers, de La Croix, Le Pèlerin et d’autres feuillets catholiques que François devine destinés aux enfants, Bayard et Bernadette.
En contemplant ces souvenirs jaunis, François entend sa mère quand, installée à l’ombre du sapin dans la cour de la maison au Buquet, elle se laissait aller à raconter son enfance, sa jeunesse et la vie d’avant, celle de son père Eugène, de son oncle Constant et de tous ceux qui comme eux sont arrivés d’autre part, d’autres lieux, d’autres pays, par choix ou contraints par la vie, la misère. Il entend les mots. Il voit s’animer ses mains et son visage à l’évocation de ce passé parfois gai, parfois triste, parfois sourire, parfois larmes, toujours présent, toujours vivant. Elle avait une faconde qui vous emportait dans les méandres du passé comme si vous y étiez. La machine à remonter le temps défilait ses images tant elle savait vivre ses mots, ses histoires. François se souvient de cet après-midi, peu de temps après la mort de son oncle, le curé. Il était revenu des Alpes pour passer quelques jours de vacances auprès d’elle. Entre deux souvenirs à rire sur l’oncle, sa chute dans la piscine ou sa conduite le nez rivé sur le volant à trente à l’heure, elle était partie dans l’avant, bien avant quand son père, Eugène, encore enfant, était venu d’Alsace sous la bonne garde de son frère Constant.
Juillet 1874
Le train s’arrête en gare de Deutsch-Avricourt. Une série d’aiguillages transfère le convoi de la voie de droite à celle de gauche. La gare est toute neuve. Elle vient d’être terminée aux frais de la France en guise de dommages de guerre. L’Alsace et la Moselle sont sous domination allemande et ses gouvernants ont imposé leurs normes avec, notamment, la circulation à droite sur le tronçon devenu germanique de cette ligne reliant Strasbourg à Paris. La manœuvre est longue et fastidieuse, car les contraintes techniques imposées par les Allemands nécessitent un remplacement de locomotive. Tout cela dure plus d’une heure que les voyageurs usent en se réconfortant, si leurs moyens le leur permettent, au restaurant de la gare ou plus simplement en s’installant quand il fait beau, sur les talus qui bordent les voies.
Eugène, le père de Thérèse, et son frère Constant sont de ceux-là. Ils viennent de Bischwiller. Constant a vingt-deux ans. C’est un des rares rescapés de la bataille opposant Prussiens et Français à Reichshoffen le 6 août 1870. Eugène en a douze et quitte tout juste les bancs de l’école où depuis trois ans il est interdit de parler le français ou l’alsacien. De ne pas parler l’alsacien ne contrarie personne dans la famille Viel. Le père, François, et le Grand-père, Louis, sont intraitables sur le sujet. On est Français, on parle français. Et hors de question de sombrer dans la religion des hérétiques protestants. Catholiques fervents pratiquants et acteurs des cérémonies, d’enfants de chœur à sacristain, de père en fils. Alors quand, à la suite de la défaite des troupes françaises trois ans plus tôt, il a fallu choisir, le père l’a fait pour ses quatre fils, ils resteront Français quoi qu’il en coûte. Les deux aînés sont partis dès la fin de la guerre. Ce sont des « optants », ceux qui ont choisi entre 1870 et 1872 de partir. L’un serait au fin fond des Alpes à Guillestre où il serait ramoneur, son métier d’ici. Ils ne savent pas trop, le courrier n’arrive que difficilement de France. C’est un ami de leur fils qui tient cette information d’un ami d’un ami… Un autre serait à Paris où il officierait comme serveur dans une taverne alsacienne. Mais là aussi, rien n’est certain. Pour Constant, blessé lors de la fameuse bataille de Reichshoffen, il a été décidé qu’il attendrait les douze ans d’Eugène. C’est aujourd’hui chose faite. Tous deux font partie de la cohorte des natifs de Bischwiller qui fuient leur ville et leur terre d’origine pour émigrer en France. Deux mille, ils sont deux mille à quitter cette commune de dix mille âmes en 1870. Le refus d’être Allemand, la désertion des usines et des fabriques, la disparition des métiers qui de deux mille passent à six cent cinquante en ces quelques années, confèrent aux habitants le choix de l’exode. Direction la Normandie où ils retrouvent leurs congénères installés dans le petit Bischwiller à Elbeuf. Ils y travaillent chez Blin ou Herzog, des industriels de confession juive qui eux aussi ont fait le choix de la France, mais plus pour des raisons financières que patriotiques, les frais de douanes sont passés de 0 à 10%.
Avec eux dans ce train, il y a d’autres jeunes, d’autres familles originaires de Bischwiller. Il y a leurs voisins, les Müller, Oscar et Gertrude. Oscar, de l’âge de Constant, est fileur de métier. Gertrude, son épouse, tient dans ses bras la petite Anna qui est née au printemps. Eux ne vont pas à Elbeuf, mais à Vire où sont déjà installés et les attendent les deux frères d’Oscar.
Eugène, assis dans son coin, remâche sa tristesse. Hier, au moment du coucher, son père l’a pris dans ses bras. Ce n’est pas fréquent, mais Eugène est le dernier de la fratrie. Ils savent tous deux qu’ils ne se reverront plus, passé cet instant. Demain au moment du départ, son père sera à la fabrique ou plutôt dans ce que les Allemands en ont laissé. C’est lui qui a poussé Constant à prendre avec lui son frère, contre l’avis de Catherine son épouse. À Bischwiller ne restera que Marthe. Elle est âgée de quatorze ans. Elle manque déjà à Eugène. Avec ses longs cheveux blonds et sa bouche boudeuse comme leur mère, mais aussi avec son rire et ses réparties, elle formait avec Eugène un duo retournant terre et ciel à l’affût de nouvelles bêtises à tournebouler les parents et les voisins. Ils se sont serrés fort ce matin. Marthe a pleuré. Eugène a pleuré. Elle lui a pincé le nez. Il lui a pincé le nez. Ils se sont regardés, nez pincés, leur mimique entre eux deux. Une dernière fois. Une toute dernière fois. Ils se sont obligés à sourire. Dans le bissac d’Eugène, Marthe a glissé une grosse part de kouglof qu’il vient de découvrir. Une larme se cache dans son mouchoir. Il se force à sourire. Il a promis à Marthe. Penser à sa sœur et sourire. Il goûte la part de gâteau dont il dissimule le reste au fond de son bagage. À sa mort, soixante-dix ans plus tard, on retrouvera, précieusement emballée dans un vieux mouchoir, dans le fond du tiroir de sa table de chevet, une part de kouglof, dure et desséchée. Elle sera glissée dans la main d’Eugène, avec son chapelet.
Un long cri, venu des entrailles de fer de la locomotive, embarque les passagers. Eugène et son frère prennent place sur d’inconfortables sièges en bois de la troisième classe. Il est cinq heures du soir heure française. Ceux qui ont une montre, l’ont retardée d’une heure. Demain en milieu de journée, ils seront à Paris d’où un autre train les conduira à la gare de Tourville près d’Elbeuf. Ils ne traîneront pas à la capitale. Pour y faire quoi ? Chercher le frère aîné ? Ils ne savent pas où le trouver. Alors mieux vaut aller rapidement au but du voyage et commencer à travailler au plus vite.
Eugène n’est pas bien grand. Il est fin comme une anguille et agile comme un singe dit de lui son frère. Sa petite taille lui vaudra certainement de se glisser sous les métiers pour rattacher les fils cassés. Il fera un bon rattaqueux. C’est dangereux et nombre d’enfants ont un bout ou un doigt complet en moins, arraché par une navette trop rapidement chassée par le cacheu, pressé de tirer la corde pour la déclencher après une rafle qui a arraché la chaîne. Il connaît tous les termes Eugène. Constant et leur père les lui ont enseignés comme les prières en latin à l’église et la Marseillaise en cachette dans le fond de la cuisine. Il sait qu’à Elbeuf, les fabriques embauchent à tour de bras sans se soucier de l’âge. D’être Alsacien et de Bischwiller est un avantage pour entrer chez Blin ou Herzog. Reste à voir si les textains du cru seront bien accueillants ? Pas certain, mais cela ne préoccupe guère Eugène en cet instant, tout absorbé qu’il est par ce paysage à peine vallonné qui le change des contreforts vosgiens qu’ils viennent de quitter. Il paraît qu’Elbeuf n’est pas loin de la mer. Il se met à rêver. Il songe à cette illustration de son livre religieusement protégé dans ses quelques habits. Celui que ses parents lui ont offert pour sa communion, Francinet. Dans ce manuel, acheté en sous-main, on raconte la France, celle d’avant 1870, celle avec l’Alsace, mais aussi celle des bords de mer. On y découvre cette vaste étendue sans limites qui emmène les bateaux vers ce lointain pays qu’on appelle l’Amérique. Un jour, il en est persuadé, il ira voir la mer. D’Elbeuf on n’est pas loin, cent kilomètres qu’est-ce que c’est comparé aux sept cents qui le séparent de Marthe et de ses parents ? Marthe, sa sœur. Le balancement et le tic y tac de la ligne du chemin de fer l’entraîne dans un sommeil peuplé de vagues sur le rivage et de vague à l’âme.
— Eugène ! On arrive à Paris !