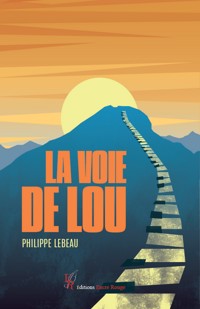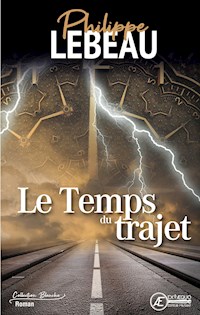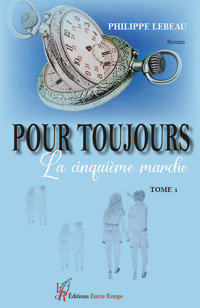
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Encre Rouge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pour toujours
- Sprache: Französisch
Été 1963 : Arthur et Morgane ont douze ans, presque… Elle vit au Pradet, plage de la Garonne. Lui, vient de Paris le temps des vacances. Ils se rencontrent.
Été 1964 : Arthur et Morgane se retrouvent. Ils ont treize ans, bientôt… Leurs jeux se transforment. Leurs vacances se poursuivent à Contes, dans l’arrière-pays niçois. Nouvelles aventures, nouveaux copains, le village, la montagne, ses torrents, cet amour « Pour toujours » ?
Été 1965 : Presque quatorze ans. Morgane et Arthur sont à Contes, chez le Papé et la Mamé de Morgane, dans le village perché. La nuit, la fontaine du village offre un lieu de baignade idéal. « Attention, la cinquième marche grince ! » Avant le retour d’Arthur à Paris, ils partagent un serment.
13 novembre 1968 : Ils ont seize ans ! C’est leur anniversaire commun, ils se racontent l’un à l’autre ce grand saut, de l’enfance à la fin de l’adolescence, dans les années 60 !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philippe Lebeau est né à Elbeuf en 1954. Il a travaillé dans l’industrie avant de s’engager dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Aujourd’hui, retraité, il demeure dans les Alpes du Sud où se situe son roman
Pour toujours - La Cinquième Marche.
Il est auteur de quatre romans,
Une semaine entre deux dimanches paru en 2018,
Le Temps du trajet en 2019,
D’une guerre à l’autre en 2021 et
D’étape en étape en 2022, ainsi que d’un recueil de nouvelles
Histoires d’Eux en 2021.
Pour toujours - La Cinquième Marche est le premier opus d’une trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éditions Encre Rouge
®
174 avenue de la libération – 20600 BASTIA
Mail : [email protected]
ISBN papier : 978-2-37789-749-0
Dépôt légal : Juin 2023
PHILIPPE LEBEAU
POUR TOUJOURS
TOME 1
LA CINQUIÈME MARCHE
ROMAN
On se caresse, on se dévore
On s’aimait trop, on s’aime encore
Plus de vingt ans et des alarmes
T’as toujours pas baissé les armes
Toi et moi
Jorge Mario Da Silva / Bernard Lavilliers
À Stéphane,
À Gabriel.
Dix ans et six cents mois
Plus rien ne presse.
Le calme inonde la place, se dévoile et s’installe autour d’une table ronde.
Deux tasses à moitié pleines ;
Deux mains qui se rejoignent ;
Deux souvenirs qui traînent ;
Deux sourires qui s’étreignent ;
Arthur, Morgane, la soixantaine.
Plus rien ne presse.
Avez-vous remarqué ? Nous disons la dizaine, la vingtaine et ainsi jusqu’à la soixantaine. Au-delà, le néant.
Avez-vous constaté ? Nous affichons nos unités jusqu’à la quarantaine, ensuite, nous en restons à la dizaine. Par modestie ou par pudeur ? Et si c’était la peur ? Peur de vieillir, peur de mourir ?
Morgane, Arthur, la soixantaine.
Affectés, bouleversés, ils le sont sans nul doute. Ils le sont, nul n’en doute. Mais ces deux-là, toujours ensemble, toujours unis, ont tant de force, de résilience, de résistance pour toujours, qu’il est impossible de les écrire attablés, accablés.
Il y a quelques jours, les cendres mélangées de Zélie et de Pierre s’en sont allées, dispersées par le vent du Crotoy, vers des pays lointains, unis à jamais, pour toujours !
Ce matin, ce sont celles de Dominique et Marie qui ont pris leur envol entre les bras d’Éole, depuis la cime du Diable vers d’autres sommets du Mercantour, unis à jamais, pour toujours !
Morgane, Arthur… Arthur, Morgane…
Entre leurs doigts qui se frôlent, se touchent, se perdent l’un à l’autre, l’un et l’autre, passe la vie, celle qui rit, celle qui court, celle qui vit.
— Tu te souviens ? C’était…
— Il y a longtemps…
— Attends, c’était…
— Au temps de notre dizaine…
— Aux moments de notre quinzaine.
— Et cela à jamais, pour toujours !
Arthur
Nuit du 13 au 14 juillet 1963
Je m’appelle Arthur et j’ai douze ans. Enfin, pas encore tout à fait. Je les prendrai au mois de novembre, mais c’est comme si je les avais. Il n’y a que maman pour dire que j’ai onze ans.
Elle ne me voit pas grandir.
Je ne sais pas l’heure qu’il est. Il fait nuit maintenant. Nous sommes partis de Paris après avoir dîné, mon père préfère rouler de nuit.
Déjà cinq arrêts depuis le départ, cinq bas-côtés qui ont accueilli avec résignation les restes de mon repas de ce soir et ceux de ce midi, voire ceux d’hier. L’odeur des Gitanes maïs qu’enchaîne mon père les unes après les autres entretient mon mal au cœur. Je sens la sixième halte pointer dans mon bas-ventre, même si là, il n’y a plus rien à vomir. J’essaie de dormir, mais ça manque un peu de confort. Je suis allongé entre les sièges avant et arrière de la DS. Sur la banquette se tiennent mon frère aîné Jean et, tête-bêche, les jumeaux Line et Jérémie. Ce dernier a la tête sur les jambes de Jean et les pieds de Line contre son nez. Coup de chance, elle s’est lavée avant de partir. Un peu plus de six années me séparent de Jean, trois me rapprochent des jumeaux. Avec Jean, nous n’avons rien en commun, aucun jeu, aucune bêtise, aucun secret. Lui a la tête sous les jupes des filles, moi je tente de m’éloigner de celle de maman. Avec les jumeaux, nous avons nos parties de billes, de cache-cache. Je suis assez grand pour attraper le bocal de bonbons ou la boîte de biscuits dont je partage le contenu avec eux, persuadé que maman n’a rien vu.
Dans la voiture, maman ne parvient pas à somnoler auprès de mon père. Avec ses cheveux bruns mi-longs qui caressent ses épaules, retenus par un bandeau blanc ; avec ses yeux noisette encadrés de cils qui n’en finissent pas ; avec ses sourcils discrètement rehaussés de bleu ; maman est magnifique. Chaque voiture qui nous croise l’illumine telle une artiste en scène. Elle a un beau prénom, Zélie, ça rime avec joli et elle l’est, jolie.
Elle et mon père ne parlent pas. Ça fait longtemps qu’ils ne se parlent plus. Faut dire que mon père est souvent parti. Il est représentant en machine à écrire, les Hermès. Toute la semaine, il sillonne les routes du nord et de l’ouest de la France et ne rentre que le vendredi soir quand ce n’est pas le samedi matin pour repartir le lundi à l’aube. Du coup, il ne s’occupe de nous que pour râler, hurler et nous mettre des raclées quand on fait trop de bruit en jouant. Franchement, avec Line et Jérémie, on préfère les jours d’école aux week-ends. Jean, lui, il s’en fout ! Il n’est jamais à la maison les fins de semaine, mais il a pris des sacrées trempes avant de pouvoir partir chez ses copains et copines. D’ailleurs, il est plus souvent chez les copains qui ont des frangines. Mon père est grand, carré, avec un ventre qui s’arrondit au fil des années, la faute aux restaurants midi et soir. C’est une armoire qui renferme des claques prononcées, des fessées cul nu, voire des coups de martinet ou des douches glacées laissant des traces et des souvenirs cuisants. Maman tente d’intervenir quand il nous frappe. Elle se met entre lui et nous. Ça l’arrête. Une fois, un de ses coups a touché maman. Elle l’a mis à la porte. C’était un samedi matin. Il n’est revenu qu’un mois plus tard avec encore plus de ventre la faute aux restaurants même le week-end. Hier soir, il est rentré, a chargé la DS et après avoir dîné, nous sommes partis direction le sud.
Le sixième arrêt a eu lieu. Mon père n’est pas content, car ça fait tomber sa moyenne. Au fait, je dis mon père et pas notre père, car, s’il est bien le mien et celui des jumeaux, ce n’est pas celui de Jean. Jean en est bien content ! Lui, son père, il ne le connaît pas. C’est un Américain d’après ce qu’il se vante. Maman n’en cause jamais, mais elle le lui aurait dit. D’après mon frangin, maman et son père se seraient rencontrés à la Libération de Paris. Ils se sont revus et vlan, une bombe dans le ventre de maman. Il est reparti sur le front et vlan une balle dans la tête de son chéri dans les derniers jours de la guerre en Allemagne. Pas de chance pour lui, ni pour maman, ni pour Jean. Quatre ans après elle rencontrait mon père et j’arrivais, moins auréolé de la réputation de héros de mon géniteur que Jean. Mais tout ça, il ne faut pas le dire. Maman n’en parle jamais surtout devant mon père.
Il fait jour. L’horloge de la voiture marque six heures du matin. Je suis à l’avant sur les genoux de maman, calé dans ses bras, la tête nichée dans le creux de son cou qui sent bon l’eau de Cologne et la tendresse. Cette nuit après la sixième pause « vomi », mon père, excédé, a bien voulu que je m’installe à l’avant avec maman. Je me suis endormi illico et je ne bouge pas de peur qu’il ne me renvoie à l’arrière. Les yeux mi-clos, je vois le paysage défiler. De part et d’autre, de grandes taches violettes apparaissent. Des champs immenses envahissent le paysage et diffusent leur senteur de lavande par les fenêtres ouvertes de la voiture. Ça change de la Gitane maïs. Au loin, j’aperçois des collines, et sur les bas-côtés des arbres noueux avec de toutes petites feuilles d’un vert délicat. Je ne connais pas. Je ne résiste pas.
— C’est quoi ces arbres ?
— Des oliviers, me répond maman.
— T’es réveillé toi, dit mon père, tu retournes à l’arrière !
Le regard de maman me fait comprendre qu’il vaut mieux m’exécuter. J’enjambe le siège avant et me retrouve de nouveau coincé entre les deux banquettes. Attention septième arrêt en vue !
Celui-ci a bien lieu, mais pas à cause de moi. Mon père a décidé de s’arrêter pour déjeuner et faire le plein. C’est dans un village, perdu au milieu des champs de lavande qu’il stoppe la DS devant une station essence face à un « routier ». Celui-ci nous accueille avec ses odeurs de pain grillé, de café et d’eau de javel mélangées. Pour soigner le mal au cœur, il y a mieux !
Le ventre lesté, mais l’envie de vomir toujours en embuscade, le réservoir plein et un paquet de cigarettes neuf sur le tableau de bord, la voiture reprend la nationale 7 pour une dernière étape de deux cents kilomètres. Les jumeaux ont quitté la position allongée. Du coup, je suis assis derrière maman, Line et Jérémie entre Jean et moi. La fenêtre ouverte me permet d’échapper aux vapeurs de tabac et à leurs conséquences.
— Le premier qui voit une voiture rouge gagne une glace à deux boules, dit maman.
Huit billes rondes et gourmandes scrutent la route avec impatience ; même Jean joue le jeu.
— Là en face ! crie Jérémie.
— T’as pas fini de crier ! hurle le chauffeur.
Le silence s’installe illico, entrecoupé des reniflements de Jérémie et des « Tu t’arrêtes de pleurer ! » de notre père.
Les deux boules sont plutôt coincées dans la gorge des passagers que disposées dans un cornet.
— On arrive bientôt, tente de rassurer maman. Regardez comme c’est beau !
Rien n’y fait.
L’ambiance est lestée de plomb et le bouchon flotteur « maman » coule inexorablement.
Les rires se sont éteints.
Restent deux cents longs kilomètres ! La trouille au ventre ! Le ventre en vrac ! Et patatras, huitième escale ! Et le chauffeur qui hurle encore !
Les rires sont en bernes.
Reste trois heures de route, trois longues heures d’un silence abyssal !
Morgane
14 juillet 1963
— Morgane ! Ça, c’est ma mère. Tu te secoues un peu ! Je dois venir te chercher pour que tu descendes ? Tu me réponds ou tu préfères que je monte ?
— J’arrive ! J’arrive ; je descends tout de suite ! Je finis la vaisselle du petit déjeuner de la maison.
— Tu te dépêches, il y a celles du restaurant à faire et tu referas les assiettes d’hier soir, c’est du ni fait ni à faire ! Tu as de la chance que ton père soit là, sinon…
— Mais tu ne peux pas la laisser un peu la pitchoune ?
Ça, c’est mon papa, heureusement qu’il est là lui, sinon…
— Bien entendu il faut que tu la défendes !
C’est parti pour une nouvelle dispute entre eux.
Chaque matin, c’est la même chose. Depuis que j’ai dix ans, ma mère a décrété que les jeudis et les dimanches quand il y a de l’école et pendant les vacances, je dois aider au restaurant. Aider c’est vite dit ! En fait, ma mère a renvoyé Louise, la jeune fille qui faisait la vaisselle et elle m’a mise à la place pour le service du petit déjeuner, du midi et celui du soir. Papa est au piano. Pas très musical ce piano, en fait c’est la gazinière.
Papa est cuisinier. Il s’appelle Dominique et il a trente-trois ans. Il est gentil et il est beau. Je crois que quand je serai plus grande, je serai amoureuse d’un garçon comme lui. Il a repris le restaurant de mon Papé et de ma Mamé. Eux, ils sont repartis dans leur village au-dessus de Nice. Je crois qu’ils ne supportaient plus du tout ma mère. Elle, elle est serveuse… Elle sourit aux clients, elle est aimable, gentille devant, mais dès qu’elle leur tourne le dos, elle râle après papa et moi. Elle ne fait pas que nous crier dessus, elle tape fort, pas sur papa, elle n’oserait pas, mais sur moi. Ce ne sont pas que des baffes. Souvent, c’est le martinet ou le torchon. Ce n’est plus la laisse du chien, on n’a plus de chien, papa l’a donné pour qu’il n’y ait plus de laisse à la maison. Papa se met entre ma mère et moi pour m’éviter les coups. Sitôt le dos tourné, elle rattrape les coups perdus en coups tordus. Je crois qu’elle ne m’aime pas. Elle dit qu’elle ne voulait pas d’enfants, que je suis un accident, qu’elle aurait bien voulu avorter, mais que c’est interdit. Papa et ma mère dorment chacun dans une chambre. Je ne les ai jamais vu dormir dans le même lit. Je crois que ma mère n’aime pas papa non plus. Je ne sais pas si elle aime quelqu’un ?
Dès que je peux, je pars de la maison. Je n’ai le droit de disparaître qu’entre dix heures et midi le matin et quand j’ai terminé la vaisselle du service du midi et du soir. Tu parles de vacances !
Parfois, quand il n’y a pas trop de clients, je peux retrouver les copines et les copains à la plage plus rapidement, mais le plus souvent, ils sont déjà partis à la pêche, se promener ou se baigner. Alors je me retrouve toute seule. J’ai un secret, je connais un endroit dans les rochers où personne ne va. C’est une grotte, l’entrée est étroite et bien cachée entre deux aplombs. C’est mon château. Personne ne le connaît. Pas plus la petite crique entre les falaises. Là aussi le passage est si étroit qu’il n’y a que des enfants qui peuvent s’y faufiler. C’est là que je me baigne. Je n’ai pas de maillot de bain, ma mère refuse de m’en acheter. « Tu n’as pas de seins, ça ne sert à rien ! » Ce n’est pas vrai, j’ai le bout qui a beaucoup grossi depuis quelque temps. Mais ma mère, elle ne me voit pas grandir, elle ne me voit pas du tout, sauf pour travailler au restaurant et me mettre des baffes.
Il est neuf heures. Il n’y aura plus grand monde au petit déjeuner, maintenant. Il me reste à relaver et essuyer les assiettes d’hier soir. Je ne vois vraiment pas en quoi elles sont sales. Sûr, c’est pour m’embêter. En me débrouillant bien, avant dix heures j’aurai terminé. Il ne faut pas que je me fasse remarquer, sinon la patronne va encore me trouver une corvée à faire… Je devrais m’appeler Cendrillon !
De la fenêtre de la cuisine, j’ai vue sur l’autre côté, vers le port et la place du café-épicerie-quincaillerie-souvenirs-cartes postales-jeux de plage qui donne dessus. Tout à l’heure, il y a une voiture qui est arrivée, une DS. Ils ont dû rouler toute la nuit. À l’intérieur, les passagers avaient l’air d’être là pour un enterrement. Waouh la tête qu’ils avaient ! Le conducteur était le pire de tous. Il est venu au restaurant boire un café. Les passagers ont sorti les valises et sont montés à l’appartement au-dessus du café. Il y a un garçon qui doit avoir mon âge. De loin, je le trouve mignon… Il y a un autre garçon qui est plus vieux et un autre plus jeune et aussi une fille qui lui ressemble. Ces deux-là ont bien deux ou trois ans de moins que le garçon qui est mignon ; on dirait des jumeaux.
Ce soir, il y a le feu d’artifice du 14 juillet. Hier, papa m’a dit que je pourrai aller sur la plage pour le voir avec les copines et les copains. Il l’a dit à ma mère qui n’était pas d’accord, mais papa a répondu que ça ne se discutait pas ! La patronne n’était pas du tout contente et je crois que c’est pour ça qu’elle me fait refaire la vaisselle d’hier.
Arthur
14 juillet 1963
La route emprunte une descente abrupte et étroite qui nous conduit devant un café-épicerie-quincaillerie-souvenirs-cartes postales-jeux de plage… face à la mer.
Les valises sont sorties du coffre et déposées sur le trottoir devant le café au-dessus duquel nous attend notre location. Mon père est reparti ! Le sourire retrouve le chemin de nos visages.
— Bon, vous faites quoi ? dit maman, on ne va pas passer nos quatre semaines de vacances sur ce trottoir ! Allez hop, chacun sa valise et que ça saute !
En un instant, les bagages montent le petit raidillon derrière le café.
Les deux fenêtres grandes ouvertes de la salle-cuisine-séjour nous offrent le spectacle de la mer. De part et d’autre du couloir y conduisant, deux chambres, une pour les enfants et l’autre pour les parents.
Dans la nôtre, un lit double pour les jumeaux et deux simples pour Jean et moi sont alignés. Dehors, les cigales s’en donnent à cœur joie.
— Ce soir, il y a le feu d’artifice du 14 Juillet ! s’exclame Line en voyant une affiche posée sur un poteau de l’autre côté de la route.
— Si vous voulez y aller, tout le monde à la sieste après manger ce midi, décide maman.
— On peut aller à la plage maintenant ? demande Jérémie.
— Jean, tu surveilles les jumeaux et toi, Arthur, tu ne les embarques pas n’importe où !
J’ai douze ans quand même. Je ne fais pas n’importe quoi ! Il faudrait que maman se rende compte un jour que je suis un grand.
Elle ne me voit pas grandir.
— Vous revenez pour midi ! nous crie maman depuis la fenêtre.
Jean n’a pas l’air très content de se traîner les jumeaux. De moi il s’en fiche, j’me débrouille tout seul.
Les vacances commencent.
Jérémie a pris ses voitures et ses billes ; Line son seau, sa pelle et deux poupées ; Jean ses lunettes de soleil pour reluquer les filles. Moi je n’ai rien pris sauf mon envie d’aller me promener sur les rochers.
J’y vais.
Je grimpe, je glisse, j’escalade, je saute, je suis alpiniste, aventurier, explorateur de terres inconnues. Entre les roches rouges presque marron, je me faufile, je me joue de mes poursuivants imaginaires, je suis le roi de ces lieux, je suis le roi Arthur. Ne manque plus que mon épée « Excalibur ». La prochaine fois je prendrai mon épuisette, ça fera l’affaire ! Mes frères et ma sœur sont loin, au moins cinq cents mètres. Ils sont minuscules sur la plage où, à cette heure, il n’y a presque personne. Je saute d’un rocher à l’autre. Je pense, Roi Arthur, attention, derrière vous un ennemi ! me crie Ivanhoé. Je me retourne et d’un seul coup, un creux dans le rocher attire mon regard. J’empreinte une série de pierres rouges qui forment un escalier. Je gravis les marches et me hisse sur une plate-forme au bout de laquelle une cavité plonge sous une avancée étroite. Je me glisse dessous en rampant et je parviens à l’intérieur d’une grotte invisible de l’extérieur. Dedans, le plafond s’élève à deux, voire trois mètres par endroit. La caverne s’enfonce sur cinq bons pas vers l’intérieur et présente facilement six à huit mètres de largeur. Une lampe de poche est posée sur un petit rebord à l’entrée. J’appuie sur le bouton pour l’allumer : incroyable, elle fonctionne ! Je promène son faisceau lumineux vers le fond. Je distingue une roche arrondie entourée de trois pierres plates en guise de fauteuil. Dans la paroi, des renfoncements abritent des verres, deux assiettes, une autre lampe électrique, une bougie, des allumettes et même un vase avec des algues séchées dedans. Un short, un polo et une serviette gisent, roulés en boule sur une des pierres plates. J’ose m’avancer et découvre, rangés à l’intérieur d’une caissette à oranges en bois, des biscuits, du chocolat, une banane et une gourde en peau pleine. Stupéfait, j’écarquille les yeux ! Mais je ne touche à rien. Du dehors me parvient, atténué, le bruit du ressac qui vient mourir sur les rochers. J’ai un peu la trouille d’être surpris, mais j’aimerais bien savoir à qui appartiennent les habits et la serviette. À première vue, leur propriétaire n’est pas beaucoup plus grand que moi.
Un bruit à l’extérieur ! J’éteins la lampe et me précipite vers la sortie. Je me glisse entre deux rochers. Merde, j’ai oublié de remettre la lampe ! Trop tard. J’entrevois une forme qui, à son tour, entre dans la grotte et en ressort rapidement.
Je reste sur mon surplomb sans remuer. J’attends. Un, deux, trois… Je compte jusqu’à cinquante avant de me relever doucement. Personne à droite, personne à gauche, ni devant, ni derrière, ni au-dessus, ni en dessous ? Le plus silencieusement possible, je rejoins l’entrée de la grotte et dépose la lampe avant de ressortir et… de tomber nez à nez avec une tête aux cheveux longs, ondulés et blonds qui encadrent deux yeux d’un bleu intense.
Morgane et Arthur
14 juillet 1963
— Salut. Tu fais quoi ? demande la tête parsemée de taches de rousseur.
À l’intérieur de la grotte, l’autre tête sursaute et se cogne le haut du crâne sur une arrête rocheuse en se redressant.
— Aïe ! Ça fait mal !
— Tu n’avais qu’à pas être curieux, se moque une voix chantante.
Arthur se passe la main dans les cheveux. Ouf, ça ne saigne pas, mais il y a un œuf prêt à virer à l’omelette.
— Fais voir. Waouh, un peu plus et tu peignais l’entrée en rouge ! Tu es qui ?
Devant Arthur, une fille avec des yeux en amande, et une masse de cheveux ébouriffés autour d’un sourire moqueur.
— Je m’appelle Arthur.
— Comme le Roi ? Moi, c’est Morgane.
— Comme la Fée ?
— Oui ! Tu n’es pas d’ici ? Tu viens d’arriver, je vous ai vu tout à l’heure !
— On vient d’arriver pour nos vacances. Toi aussi, t’es ici en vacances ?
— Bah oui, idiot, comme tout le monde, mais je suis d’ici.
La tête fait partie d’un ensemble, pas plus grand qu’Arthur qui se glisse dans la grotte.
— Je ne sais pas comment tu as trouvé l’entrée, mais en tout cas tu n’as pas intérêt à en parler ! Tu ne dis rien à personne, lance Morgane, des éclairs plein les yeux. De toute façon, avant que tu ne retrouves l’endroit tout seul, va falloir quelques jours. J’aurai le temps de savoir si tu es un cafteur ! Assieds-toi, Roi Arthur.
Morgane tend la gourde en peau.
— Bois, c’est l’élixir de vie éternelle.
Ça a un goût bizarre et inconnu. C’est pétillant, sucré, et noir comme du café.
— C’est quoi ?
— Ça vient d’un royaume d’au-delà des mers. Les barbares nomment ça du Coca-Cola. Tu n’en as jamais bu ?
— Non, ce n’est pas mauvais ton breuvage Fée Morgane. J’en reprends une rasade !
— Tu veux un gâteau ? Tu as quel âge ?
— Douze ans et toi ?
— Aussi ! Enfin bientôt, au mois de novembre.
— Comme moi, le combien ?
— Le 13 et toi ?
— Pareil ! C’est marrant !
Un silence de surprise se glisse entre eux. Au loin on entend le clocher de l’église qui sonne douze coups.
— Malheur il est midi ! Il faut que je rentre. Tu vas à la fête du 14 juillet ce soir ? On se retrouve sur la plage d’ac ? crie Morgane en sortant précipitamment de la grotte. Tu vas retrouver la plage ?
Mince il est midi ! Sûr que Jean va commencer à trépigner. En effet, quand il aperçoit Arthur au bout de la plage, force est de constater qu’il n’est pas du tout, mais vraiment pas du tout content ! C’est sous ses invectives et ses « J’vais l’dire à maman ! » que se fait le retour à la location. Une odeur de frites et de poisson grillé les y accueille et laisse à la porte la contrariété de Jean.
— Vous vous êtes baignés ? demande Zélie, l’eau est comment ?
Morgane
14 juillet 1963
— Tu as vu l’heure ? Ma mère… Tu ne perds rien pour attendre ! Ton feu d’artifice c’est au lit ce soir !
— Mais il est à peine midi dix… et il n’y a pas encore de vaisselle.
— Et tu réponds en plus ! Je vais t’en retourner une dont tu vas te souvenir…
— Assez ! Ouf, papa. Morgane, tu viens en cuisine et toi tu lui fiches la paix ! Et elle pourra aller au feu d’artifice ce soir ! Re ouf.
Je n’ai pas le temps de m’éclipser ; le torchon me cingle la jambe.
Ça fait vraiment mal. Papa, j’en ai marre…
Mes larmes ont trouvé la sortie. Elles coulent, coulent… impossible de les retenir. J’ai beau presser mes yeux, j’ai beau renifler pour les renvoyer au fond du nez, de la gorge ! Rien n’y fait. Elles coulent, coulent… Elles sont si nombreuses qu’elles forment un rideau devant mes yeux. Deux bras me soulèvent et me serrent très fort. J’enfouis mes larmes dans le cou de mon père. Il y règne une douceur aux odeurs d’huile d’olive, d’épices et de cannelle, celles qu’il a dû utiliser pour le dessert du jour. Avec son torchon, lui, il m’essuie le visage. J’aimerais bien rencontrer un garçon comme mon papa plus tard. Papa me dépose à terre et retourne au piano.
Je m’installe devant l’évier où il n’y a rien à laver.
— Viens, je t’ai fait des frites avec une cuisse de poulet et une part de tarte aux pommes…
— Avec de la cannelle !
— Oui avec de la cannelle, je sais que tu aimes ça.
— Papa, c’est quand qu’elle va partir ?
— …
— Moi je pourrais partir, je pourrais aller chez Papé et Mamé… Dis papa, tu veux bien que j’aille chez eux ?
— Et moi, tu me laisses tomber ?
— On part ensemble ; tu fermes le restaurant ; on s’en va ! On la laisse !
— Et comment fait-on pour manger, s’habiller…
— Papé et Mamé nous donneront tout…
— Ce n’est pas aussi simple, tu sais.
— …
Papa, j’en ai marre…
Je sens les larmes qui s’agglutinent de nouveau à la porte de secours. À l’aide ! J’ai beau fermer à double tour la serrure, elles s’échappent ! Je les rattrape du bout des doigts avant qu’elles ne s’écrasent dans l’évier. Je relève la tête… De l’autre côté de la place du port, je vois Arthur qui rentre avec ses frères et sa sœur. Il a le sourire lui. On dirait qu’il a croisé une Fée alors qu’il n’a rencontré que Cendrillon… Il est mignon avec sa tignasse tout ébouriffée de cheveux bruns et bouclés. Tiens, je n’ai pas fait attention à la couleur de ses yeux. Je suis certaine qu’ils sont noisette. En tout cas il a un beau sourire et aussi une belle bosse sur la tête ! Ce serait bien qu’on devienne amis. Mais il va sûrement se faire des copains à la plage.
Moi je ne vais pas pouvoir y être comme les autres, comme d’habitude. Dommage. Je ne sais pas si ce soir on se retrouvera au feu d’artifice. Ça y est, j’ai de nouveau les larmes qui demandent une permission de sortie.
— Tu rêvasses encore ? Tu veux que je te réveille ?
Le torchon de ma mère se lève ! C’est la main de papa qui l’attrape !
— Assez !
Papa j’en ai marre ! Je voudrais partir !
Dominique
14 juillet 1963
Je suis assis à la terrasse du restaurant.
Ma tasse de café refroidit doucement à l’ombre des tilleuls.
Je l’oublie.
Je suis fatigué.
J’en ai marre !
Annie s’en est encore prise à Morgane ce matin. Avec son fichu torchon et ses mots… pour une fois ce n’était pas les coups de savates ! Je suis intervenu trop tard pour le premier coup, à temps pour arrêter le deuxième. Elle n’aime pas Morgane ; l’a-t-elle aimée un jour ? Elle ne m’aime pas. Depuis combien d’années ne m’aime-t-elle plus ? Depuis la naissance de notre fille et même avant, depuis qu’elle a constaté sa grossesse. Cela fait plus de onze ans que je n’ai pas eu le droit de la toucher. Cela fait plus de onze ans que nous dormons chacun de notre côté. Depuis combien de temps a-t-elle son amant ?
Pourtant au début c’était bien… en 1949. J’avais 19 ans et elle 17. Elle venait de Toulon pour aider sa grand-mère au café-épicerie du port. Elle m’a tout de suite tapé dans l’œil avec ses longs cheveux blonds et bouclés, tout comme ceux de Morgane aujourd’hui. Moi, je travaillais en cuisine au restaurant de mes parents, le même qu’aujourd’hui en moins moderne. Par la fenêtre de la cuisine, je l’apercevais quand elle sortait du magasin pour prendre des légumes ou des fruits sur l’étal extérieur. Au bal du 14 juillet, j’ai osé l’inviter à danser et elle n’a pas dit non quand je l’ai embrassée. Les jours d’après, une fois mon service terminé, on se retrouvait sur la plage, et bien sûr, je l’ai emmenée dans ma caverne secrète dans les rochers. On était épais comme des limandes à l’époque, on pouvait encore passer entre les rochers. Maintenant… C’est là qu’on a fait l’amour la première fois. La première pour tous les deux… J’avais récupéré des préservatifs auprès de militaires américains stationnés dans le coin. On ne savait pas comment s’en servir, et puis on apprend vite ces choses-là.
Elle est repartie à Toulon et moi j’allais la retrouver dès que je pouvais.
Et puis l’armée comme cuisinier en Algérie. Je n’ai pas eu de chance, la durée du service militaire est passée de douze à dix-huit mois peu de temps avant mon incorporation. C’était calme à l’époque là-bas. Pas comme il y a peu. Je partageais ma chambrée avec un instituteur, Serge. C’était et c’est toujours un copain, plus même, un ami. Avec lui, j’ai découvert les livres, la musique, les chanteurs qu’on n’entendait pas à la radio, Ferré, Brassens, Vian. J’ai aimé écouter du jazz, pas seulement les Armstrong et Bechet, mais aussi les Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis. Il m’a appris à danser le rock et le charleston. Et surtout, il m’a fait découvrir les Francs-maçons. Il ne valait mieux pas dire qu’on en faisait partie quand on était à l’armée. Pas seulement à l’armée d’ailleurs. Ça ne se proclamait pas sur les toits. Nous restions discrets. Serge m’a initié. À Alger, où nous étions, il y avait une loge et Serge m’y a emmené. J’ai appris à écouter, à étudier, à réfléchir et à écrire ce que je pensais des sujets abordés. J’ai appris, au bout d’un an, à m’exprimer devant les autres, à donner mon avis, à avancer des idées sur des sujets qu’on n’abordait nulle part ailleurs qu’à la loge. La contraception, la peine de mort, le colonialisme, la fraternité, tout ça, je l’ai découvert grâce à Serge, mon frangin maçon et pas seulement.
J’ai eu des permissions. Certaines, les plus longues, je revenais en métropole et je retrouvais Annie. Je ne lui parlais pas de Serge ni des Francs-maçons, à peine de l’armée. On n’avait pas le temps, on passait notre temps à faire l’amour et celui qui me restait, je le passais auprès de mes parents. Avec Serge on est allé se balader en Algérie pendant les perms les plus courtes. On a rencontré les Algériens, on les a entendus nous dire que ça devait changer, que les choses ne pouvaient plus durer comme avant, que le temps des colons était fini. On les a entendus nous dire qu’il fallait que les Français partent et laissent l’Algérie aux Algériens et que la violence allait s’accroître. À part nous et quelques autres, personne n’a écouté ces hommes et ces femmes. Le résultat… des milliers de blessés, de morts, la torture, les massacres et la haine pour des décennies entre la France et l’Algérie, les Français et les Algériens ! Quel gâchis !
Ni Serge ni moi n’avons participé aux combats. Nous avons été libérés avant, à temps.
Jacky, mon petit frère, n’a pas eu cette chance. Il est parti quand je suis revenu. Il y est allé pour dix-huit mois, mais ils ont changé la donne. C’est passé à trente mois. Jacky ne les a pas faits, il a été tué d’une balle en pleine tête au bout de dix-huit mois et un jour.
Du coup, j’ai repris sa place au restaurant, celle qui lui était réservée, celle de cuisinier. J’ai tiré un trait sur mes rêves de devenir maître d’école, d’aller vivre à la ville, à Toulon. Elle en rêvait Annie. Notre rêve a été emporté avec la vie de Jacky. Il s’est affalé sur un morceau de sable dans un coin d’Algérie, au service d’une cause qui n’était ni la sienne ni la mienne. Le sable en a rougi de honte, d’être le réceptacle d’une jeunesse sacrifiée.
Annie et moi on s’est mariés. Nous n’aurions pas dû…
Mon café est froid.
Arthur
14 juillet 1963
On a fait la sieste, enfin surtout les jumeaux. Jean et moi on a lu. Lui, plongé dans La Peste d’Albert Camus, et moi dans Vaillant, le journal que maman nous prend avec le sien le samedi sur le marché au vendeur de L’Humanité Dimanche. J’espère qu’ici on trouvera Vaillant. J’aime bien les aventures de Pif le chien et puis il y a plein d’articles sur le monde qui m’intéressent. Jean voulait que maman nous prenne aussi Tintin, mais elle n’a pas voulu prétextant que c’était un journal de réacs. Moi, j’trouve pas que c’est réac comme elle dit. Et d’abord, c’est quoi réac ? J’ai demandé à Jean. Il m’a dit que les réacs, ce sont les gens qui sont pour le général de Gaulle. J’comprends mieux. Maman n’aime pas du tout de Gaulle. Elle préfère Maurice Thorez et Jacques Duclos. C’est pour ça qu’elle achète L’Huma, Vaillant, mais pas Tintin. Dommage, car je le lis parfois chez mon copain Patrice. J’aime bien les aventures de Michel Vaillant et celles de Ric Hochet ou d’Alix, et aussi Tintin et Milou. Je ne le ramène jamais à la maison, maman ne serait pas contente !
— On y va. On va louper le feu d’artifice, si ça continue !
— Mais non, Arthur. Il est 21 heures et il n’est tiré qu’à 22 h 30. On a le temps ! me répond maman.
Vous oui, mais moi j’voudrais bien être sur la plage pour y retrouver Morgane avant la nuit.
— Maman, j’peux aller sur la plage maintenant ?
— On t’a dit non ! hurle mon père en argumentant son propos d’une baffe sans retour. T’as compris ?
Tu parles que j’ai compris. Je dois avoir les cinq doigts imprimés sur la joue. J’ai l’œil qui me fait mal et l’oreille en feu ! Tu parles que j’ai compris… Je m’enfuis dans la chambre en compagnie de mes larmes. Elles se bousculent, elles se piétinent. Elles envahissent mes yeux, ma gorge, mon nez ; ça s’échappe de partout en un torrent de morve et de pleurs silencieux. Ne pas lui montrer ! Maman n’a rien dit. Maman, j’en ai marre! Elle me rejoint un instant plus tard, munie d’un gant de toilette mouillé avec lequel elle me tamponne la joue tout en me berçant.
— Maman, pourquoi il tape ? Pourquoi il crie ? Il ne nous aime pas ?
— File sur la plage. Tu nous retrouves à la cabane du vendeur de glaces dans une demi-heure. Je vous dois une double boule.