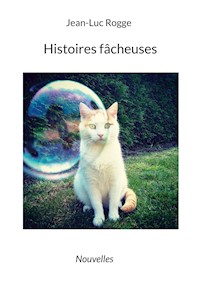Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Carine, 34 ans, vient d'enterrer son frère lorsque la France est secouée par les attentats du treize novembre... Arsène voit son univers exploser quand son frère Marc lui montre une vidéo le concernant sur un site peu recommandable... Jean a décidé d'offrir le plus beau des cadeaux à son épouse pour son soixantième anniversaire : il la quitte et part s'installer seul dans le sud de la France... Xavier roule de nuit sur une route bordée de hauts sapins lorsqu'il aperçoit une vieille femme nue dans la lueur de ses phares... Le pays pullule de vermine et Manon, qui ne le supporte plus, a décidé d'agir... Romain, Élodie, Philippe, Thierry, Pascal englués dans d'autres intrigues de la même veine, tentent, eux aussi, d'échapper au sort, malheureusement souvent funeste, qui leur est destiné... "De bien curieuses histoires", un livre à l'univers particulier qui vous mènera, au travers de dix nouvelles tantôt choquantes, tantôt émouvantes, tantôt drôles, tantôt féroces, à la rencontre de vies bouleversées, de destins à la dérive. Décidément, nul n'est épargné par les vicissitudes de la vie !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Solène pour sa précieuse collaboration
Du même auteur :
Histoires singulières
Histoires à vivre avec ou sans vous
Histoires fâcheuses
Dérapages inattendus
Fractures familiales
Rien de grave, je t’assure
Table
Ce foutu vendredi treize
Une rencontre fortuite
Dingue des Bleus
Vengeance tardive
Un époux à l’esprit tordu
Sauvé malgré lui
Un contretemps sinistre
Un week-end tumultueux
Jamais sans mon ours
Le jour où tout a déraillé
Ce foutu vendredi treize
C’était un vendredi.
Un vendredi treize.
Celui dont tout le monde se souvient.
J’étais désespérée !
Le matin même, j’avais accompagné mon frère, ou ce qu’il en restait, au cimetière. Fatigué de vivre, il s’était jeté trois jours plus tôt sous le direct de six heures cinquante. Celui qu’il avait tant et tant de fois emprunté depuis plus de dix ans pour se rendre au boulot.
Pierre était cadre dans une boîte de téléphonie. Son job y était stressant mais bien payé et ses patrons appréciaient son ardeur à la tâche.
Avec Laurence, sa femme, tout se passait pourtant merveilleusement. Enfin, je crois. Ils étaient mariés depuis cinq ans, s’entendaient parfaitement et s’ils n’avaient pas d’enfant, c’était par choix. Pierre aimait d’ailleurs répéter à l’envi qu’il ne souhaitait pas condamner un innocent à vivre.
En fait, tout le monde en ville admirait Pierre et Laurence, ce couple heureux, bien nanti, en harmonie parfaite avec son époque.
Alors pourquoi ce geste fatal ?
Mon frère rêvait d’autres horizons. Il voulait tout arrêter, quitter pour toujours cette ville, cette région, ce pays. « Changer de vie », son obsession. Il en avait souvent discuté avec Laurence mais elle hésitait. Malgré son amour pour lui, laisser famille et amis pour partir à l’aventure dans un pays inconnu lui paraissait un obstacle impossible à surmonter.
Maintenant, Laurence est dévastée. Dans son mot d’adieu, Pierre l’assure qu’elle n’y est pour rien. Mais, bien sûr, elle culpabilise. Je crois qu’elle aura du mal à s’en remettre. Pauvre Laurence.
Moi non plus, je n’ai rien vu venir. Moi aussi, je me sens coupable.
Lors de nos rencontres, très fréquentes, Pierre m’avait pourtant souvent parlé de sa lassitude, de son désarroi. Il se sentait englué dans une vie merdique de bureaucrate. Il étouffait. Il me rappelait que, tout petit déjà, il rêvait de grand air, d’espaces infinis, d’animaux à élever, à soigner, de… que sais-je encore ?
— Toi, tu dois comprendre, il me disait. T’es ma grande sœur, quand même.
Hélas, jamais je ne l’ai pris au sérieux. Je lui répondais des banalités.
— Tu veux ma place ? je lui disais toujours. Mais Pierrot, tu ne te rends pas compte de ton bonheur. Un bon job, un bel appartement, des économies, pas de dettes, une femme qui t’aime, mais il y en a plein qui donneraient n’importe quoi pour pouvoir être à ta place. T’as plus vingt ans, Pierrot. Abandonne tes rêves de petit garçon. Redescends sur terre.
— Ouais, t’as sûrement raison grande sœur, il répondait alors fort marri avant de laisser tomber.
Et on passait à autre chose.
Je n’ai pas compris sa désespérance. Je n’ai pas entendu sa souffrance. J’ai réagi comme la reine des connes.
Et maintenant, mon frère, mon petit frère, mon petit Pierrot qui allait fêter ses trente ans dans dix-huit jours, est mort. Mort et enterré.
Pierre repose dans le même caveau que papa. Il y est depuis deux ans. Papa était pensionné depuis six mois lorsque sa tumeur au cerveau a été détectée.
— Inopérable, lui avait dit froidement le spécialiste. Profitez au mieux des jours qui vous restent et, le moment venu, nous ferons tout pour que vous ne souffriez pas trop, il avait ajouté.
Papa lui avait alors demandé ce qu’il entendait par « jours qui vous restent ».
— Environ un an, lui avait répondu sans frémir le spécialiste.
Papa, bonne éducation oblige, l’avait alors remercié — comble de la politesse, remercier quelqu’un qui vient de signifier votre arrêt de mort — et il l’avait salué.
Puis, dès son retour à la maison, alors que je l’interrogeais sur les résultats des examens effectués à la clinique, papa m’avait simplement dit :
— Je suis cuit.
J’étais dévastée.
J’eus beau alors tenter d’en savoir plus, le supplier de m’expliquer, papa se referma comme une huître.
Et ce fut tout !
C’était tout papa, çà.
Deux semaines plus tard, en rentrant du boulot, je le retrouvais pendu dans sa chambre.
Sur la table de chevet, une lettre pour Pierre et pour moi. Il s’y excusait pour son geste et nous assurait de son amour pour nous.
Comment notre père a-t-il pu nous jouer ce tour ? Il n’avait pas le droit.
J’ai noyé mon chagrin dans l’alcool. Sans succès.
Le temps a passé mais il me manque toujours autant.
Et Pierre maintenant !
La tendance suicidaire serait-elle inscrite dans les gènes de la famille ?
Décidément, à un moment ou un autre, tout le monde laisse une lettre et fout le camp dans cette famille.
Maman fut la première.
Le jour du dix-huitième anniversaire de Pierre, elle a quitté papa et est partie s’installer en Tunisie. Avec son amant. Comme à son habitude, maman fut franche et directe avec nous. Dans la première partie de cette lettre, elle s’adressait d’abord longuement à papa le remerciant pour toutes ces belles années et l’assurant de sa tendresse éternelle. Puis, la suite nous était réservée : « Voilà, nous écrivait-elle, après tout ce temps passé à vous éduquer, il est temps de repenser à moi. Sachez que vous avez été pendant toutes ces années des enfants parfaits que j’ai aimés, chéris, adorés. Je suis fière de vous et je ne regrette absolument rien mais il me faut, maintenant que vous êtes adultes, passer à autre chose et retrouver ma liberté. J’espère que vous me comprendrez et me pardonnerez car je ne veux pas mourir avant d’avoir vécu. » Elle terminait en nous embrassant tous les trois.
Ni Pierre, ni papa ne l’ont comprise. Ils n’ont pu lui pardonner. Ils n’ont jamais voulu la revoir.
Pour ma part, bien que choquée et affreusement triste, j’ai admiré son cran et j’ai compris son besoin de vivre.
Depuis, j’ai pris pour habitude de passer une semaine chaque année à Sousse auprès d’elle et de son nouveau mari. L’y voir heureuse me rend heureuse.
Seize heures, j’ai mal au crâne et j’ai les entrailles retournées.
J’ai chaud. Je me déshabille presque entièrement. Je suis en slip. Je débouche la bouteille de bordeaux que je conservais en réserve au cas où… Je m’installe dans le sofa et je me sers un verre, deux verres… Je vide la bouteille.
Je me recroqueville.
Les vapeurs d’alcool aidant, ma douleur intérieure s’estompe quelque peu.
Je ne suis pas dupe, je ne connais que trop bien le processus, elles réapparaîtront plus violentes encore dans quelques heures.
Et il me faudra boire, boire encore, boire toujours.
Je suis désespérée.
Je sombre dans un sommeil comateux.
Les cauchemars se succèdent.
Je suis au bord du gouffre. Il serait si facile de s’y laisser engloutir.
Vingt-trois heures, j’ouvre les yeux. J’ai la nausée.
Merde, j’ai rechuté.
Onze mois et huit jours.
J’ai tenu le coup onze mois et huit jours.
Je ne veux plus y retourner, plus me faire enfermer, tout recommencer à zéro.
Je me croyais guérie mais je ne suis pas capable de résister. Je suis faible.
Après ma troisième cure, j’avais pourtant juré au toubib et aux infirmiers qu’ils ne me reverraient jamais, que j’avais compris, que j’étais vaccinée pour toujours.
Et puis paf, la disparition de Pierrot !
Comment pourrais-je, une nouvelle fois, trouver suffisamment de force en moi pour m’en aller débiter mon triste laïus devant un parterre de pauvres types tous aussi paumés que moi :
« Bonjour. Je m’appelle Carine. J’ai trente-quatre ans et je suis alcoolique. J’ai connu une enfance heureuse dans une famille bourgeoise. Mon frère Pierre et moi n’avons jamais manqué de rien. On peut même dire que nous avons été particulièrement choyés durant toute notre jeunesse. J’ai enseigné le français dans un lycée pendant une dizaine d’années mais, suite à mes problèmes avec l’alcool, j’ai été licenciée pour faute grave il y a trois ans. Depuis lors, je n’ai plus travaillé. J’ai d’abord vécu un an aux crochets de mon père et, depuis sa disparition, je dilapide peu à peu ma part d’héritage.
J’ai bu mon premier verre le jour de mon baptême estudiantin. Je ne pouvais faire autrement. Cela m’a plu. Cela m’a désinhibé. Moi habituellement si timide, si renfermée, j’osais soudainement aborder quiconque sans crainte. Je me sentais soudain forte. J’ai donc continué, je me suis enfoncée gaiement, insidieusement, dans l’alcoolisme. Durant quatre belles années, j’ai collectionné bitures et amours sans lendemain. Puis, mon diplôme en poche, j’ai quitté l’université et sa vie nocturne et je suis rentrée à la maison. Je croyais pouvoir m’arrêter de boire quand bon me semblerait mais aujourd’hui, près de douze ans plus tard et malgré plusieurs remises en question, plusieurs cures de désintoxication, je suis toujours embourbée dans les mêmes problèmes. Tout m’est prétexte à boire. Je suis laide, bouffie. Les hommes me fuient. Je suis seule. Trop seule. Trop seule et trop faible. »
Je me sens irrécupérable. Irrécupérable à trente-quatre ans !
Un mal profond me dévore : le mal de vivre !
Machinalement, j’allume la télé.
Les terroristes ont frappé !
Nous sommes en guerre !
Tétanisée, je me colle à l’écran.
Les informations sont incomplètes, les images rares. Je passe d’une chaîne d’infos à l’autre dans l’espoir d’en savoir un peu plus. Il y a des morts, beaucoup de morts.
Chaque jour, nous sommes bombardés d’images d’attentats mais jusqu’à présent tout restait si abstrait, si lointain. Cette fois, nous sommes directement concernés.
La vie est injuste. Des hommes, des femmes partis faire la fête sont morts ce soir, abattus comme des lapins. Mon mal de vivre me fait honte. Je gémis, je tremble.
Une anxiété sourde me saisit. J’ai peur. Je me lève et je ferme soigneusement à clé toutes les portes de la maison qui donnent sur l’extérieur.
Je descends à la cave, j’y remonte avec une nouvelle bouteille. Je la débouche, je me sers un verre et je bois. Je bois très vite et, enfin, je sombre.
Un mal de tête violent m’éveille. De l’aspirine, il me faut de l’aspirine !
Je jette un œil vers le réveil. Huit heures trente. La télé est toujours allumée. On en sait un peu plus à présent. On parle d’une centaine de morts, sinon plus.
J’ai honte.
Je sors une feuille de papier du bloc de l’imprimante. Je prends un stylo, je m’assieds à la table du secrétaire de papa et je me mets à écrire :
« Samedi 14 novembre.
Chère maman,
J’espère que tu me pardonneras… »
On sonne.
Zut !
Je ne bouge pas. J’attends.
On insiste : un coup, deux coups, trois coups…
— Putain, on ne peut même pas mourir tranquille dans cette maison, je me dis tout en me dirigeant vers la porte.
J’entrouvre.
L’homme qui me fait face a l’air surpris.
Mon Dieu, je dois ressembler à un zombie.
Bon, qu’est-ce qu’il attend ?
— Carine ?
Je ne rêve pas, il vient de m’appeler par mon prénom. J’ai beau le dévisager à mon tour, j’ai vraiment l’impression de ne l’avoir jamais rencontré.
— Euh, oui. On se connaît ?
— Philippe.
— …
— Philippe Desoleil, tu me reconnais quand même ? Allez, on a passé trois ans dans la même classe. De douze à quinze ans. Philippe ! Tout le monde me surnommait Filou. Rappelle-toi ! Ah ça, quel hasard ! Ah, ça me fait vraiment plaisir de te revoir !
Philippe Desoleil, Philippe Desoleil… oui, oui, ça me revient. Doucement, mais ça me revient. Desoleil : un garçon très timide au physique assez ingrat avec lequel je ne crois d’ailleurs pas avoir eu beaucoup de contacts. Quelqu’un de très effacé, en fait. Ni sympa, ni déplaisant. Ni séduisant, ni repoussant. Le prototype parfait du mec qui passe inaperçu. La preuve, je l’avais complètement zappé de ma mémoire.
— Philippe, mais bien sûr ! Et dis-moi, cela fait combien de temps qu’on ne s’est plus revus ? Dix ans ? Quinze ans ?
— Attends, trente-quatre moins quinze égale dix-neuf, si je ne m’abuse. Dix-neuf ans, Carine, tu te rends compte ?
Et de rire de toutes ses dents.
Non, je ne me rends compte de rien sinon qu’il a fameusement changé et qu’aujourd’hui, devant moi, il est particulièrement beau. Beau et sexy ! Je lui trouve même un petit air de Brad Pitt. Pour se l’approprier, les nanas doivent se bousculer au portillon. C’est curieux à dire, mais grâce à ces pensées frivoles qui me viennent à l’esprit, les nuages s’éloignent. Je me sens remonter à la surface, revivre. Mais lui, que peut-il penser de moi, sinon le contraire ? Il doit se demander comment une adolescente si séduisante peut s’être transformée en gourde mal fagotée qui pue l’alcool.
— Heu, tu voudras bien excuser ma tête et ma tenue Philippe mais je viens de vivre des jours particulièrement sombres et, avec ce qui s’est passé cette nuit, je n’ai pas beaucoup dormi.
— T’inquiète Carine, je comprends et puis, tu sais, ça ne me gêne pas que tu me reçoives sur le pas de ta porte en petite culotte de coton et les nibards à l’air.
Mais il a raison, l’apollon. Je n’ai même pas pris la peine de me couvrir quelque peu avant d’aller ouvrir. La honte !
Je suis mal, très mal. Je lui demande de patienter deux secondes. Je claque la porte, je fonce dans la chambre, j’enfile un pull et un jean à toute vitesse et, hors d’haleine, je retourne lui ouvrir.
Et là, il faut que j’assure :
— C’est fou comme j’ai toujours été distraite, je lui dis.
Il me regarde d’un air amusé. Il doit me croire folle. Il me répond :
— Ouais, même que t’as jamais remarqué les regards amoureux que je te lançais à longueur de journée au bahut. Allez, il y a prescription maintenant, alors je peux bien te l’avouer : j’étais raide dingue de toi. J’en ai passé des nuits à fantasmer sur toi seul dans ma chambre. Ah, comme j’ai pu t’aimer Carine ! Mais toi, rien, t’étais sur ton île, inaccessible pour le commun des mortels. T’étais réservée aux caïds. Mais t’avais raison Carine, t’étais vraiment trop top pour nous. Mais tu sais, t’es toujours aussi belle, Carine.
Je sens que je pique un fard. Je suis émue à crever.
Je me sens mal, j’ai la tête qui tourne.
Je suis conne. J’ai trente-quatre balais, j’ai enterré mon frère chéri hier, je suis alcoolique, je suis dans les emmerdes jusqu’au cou, j’allais me suicider il n’y a pas un quart d’heure et, maintenant, alors que j’ai pourtant déjà connu pas mal des mecs dans ma vie, je rougis bêtement parce qu’un ancien camarade de classe me balance un compliment à deux sous à la figure.
— Mais ne reste donc pas collé sur le pas de la porte, je lui dis. Entre, je t’en prie.
— Merci. On sera en effet plus à l’aise pour parler.
Je m’écarte. Il entre tout en me frôlant. Un frisson me parcourt l’échine. Je suis toute chose. C’est dingue, je ne connais même pas le motif pour lequel il a sonné. Mais après tout, peu m’importe.
Il pénètre dans mon capharnaüm. Il observe attentivement. Le désordre ne semble pas le perturber. Je pousse nonchalamment du pied sous le sofa les deux bouteilles de vin qui traînent sur le sol. Il s’approche de la télévision toujours allumée : les images des attentats y passent en boucle… Les experts s’y succèdent… Les journalistes annoncent que le nombre de morts a été revu à la hausse… La France est en état de choc, assommée !
Philippe hoche la tête lentement et soupire.
— Quel gâchis, me dit-il ensuite en se retournant. Un sourire triste assombrit son regard.
Il me regarde droit dans les yeux. Un sentiment équivoque me taraude soudain l’esprit. Parlait-il seulement des événements horribles de la nuit ou ces quelques mots s’adressaient-ils aussi à moi ?
« Carine, ta vie, quel gâchis… »
— Et si tu allais prendre une douche, il me dit d’un ton amical.
Sa remarque me déconcerte.
Euh, oui, t'as raison, je m’entends lui répondre. Prépare-toi un petit café pendant ce temps-là. Je n’en ai que pour quelques minutes.
Il accepte.
Je me dirige avec lui vers la cuisine, je lui montre la machine à expresso, je lui sors les capsules et je m’éclipse.
— En veux-tu aussi une tasse ? il me demande.
— Oui, oui, bien sûr, je lui dis.
Je m’enferme dans la salle de bains.
Je suis une épave, rien qu’une épave.
Le contact de l’eau chaude qui gicle sur ma peau me revigore peu à peu.
Je me sens mal, très mal, mais tellement bien aussi.
Quelques minutes plus tard, je le rejoins, un peu plus présentable.
— Cela retape, non ? me dit-il.
— Oui, t’as raison, j’en avais besoin.
Il s’approche de moi, une tasse de café à la main.
— Un sucre ou deux ? me demande-t-il.
— Noir, toujours noir.
Tout en le regardant, je porte la tasse à mes lèvres.