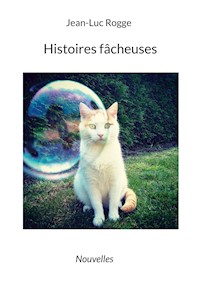Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dix histoires, dix horizons, dix mondes différents. Rencontres d'une heure, d'un jour, d'une vie. Amour et passsion ; amour et haine ; amour ... toujours. Des couples se forment, se détruisent, se déchirent. Des êtres s'adorent et se perdent pourtant. Dans notre monde imparfait, la quête de l'âme soeur ne serait-elle qu'illusoire ? "Histoires à vivre sans vous" : dix nouvelles tantôt surprenantes, percutantes, audacieuses ou touchantes réunies dans un recueil fascinant, à la liberté de ton originale et au franc-parler certain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Décidément, le monde ne va pas bien
La curieuse amie de maman
La lettre égarée
On ne meurt pas le 1er jour de l’été
Un charmant petit village
Ma femme est un tyran
Surtout ne rien oublier
Une lune de miel agitée
Promenade au cimetière
Te souviens-tu
Merci à Solène pour sa précieuse collaboration
Du même auteur :
Histoires singulières
Histoires fâcheuses
De bien curieuses histoires
Dérapages inattendus
Fractures familiales
Rien de grave, je t’assure
Décidément, le monde ne va pas bien.
Je me suis levé tôt ce matin-là.
Encore à moitié endormi, j’ai allumé machinalement la télévision avant de prendre mon petit-déjeuner. Je suis tombé sur William Leymergie, plus raide que jamais. Six heures trente : il lançait le premier journal de Télématin.
Après un premier sujet sur les résultats des élections municipales et la percée du Front National — six maires élus directement au premier tour, bonjour le fascisme —, la présentatrice nous balança sans broncher que, selon un rapport de l’OMS, la pollution atmosphérique avait tué sept millions de personnes en 2012. Sept millions, rien que ça ! Mais, comme pour nous rassurer, elle ajouta que les régions les plus touchées dans le monde sont l’Asie et le Pacifique avec cinq millions cent mille décès. Oui, bien sûr, cela change tout !
Je n’ai pas supporté : j’ai éteint la télé et je suis allé chercher le journal qui m’attendait dans la boîte. Je l’ai ouvert au hasard et je suis tombé sur la page des faits divers. Tout en terminant mon expresso, j’ai ainsi pris connaissance de la condamnation d’un père et de son fils pour s’être filmés en train de torturer des animaux, de la découverte de trois enfants affamés en Californie et de la condamnation d’un prêtre de quatre-vingt-cinq ans à quinze années de prison pour plus de vingt actes de pédophilie.
Je n’ai plus continué. J’ai balancé cette feuille de chou dans la poubelle.
Décidément, me suis-je dit, le monde ne va pas bien, et je ne vais pas bien.
J’ai cinquante-cinq balais, je vis seul dans un deux-pièces cossu du centre d’Hénin-Beaumont, l’une de ces villes dont les habitants viennent d’élire au premier tour un maire du FN — comment pourrais-je encore à présent saluer mes voisins sans savoir s’ils font partie des irresponsables ? — et ma femme s’est tirée il y a six mois avec son masseur préféré.
Ah ! ma chère et tendre. Nous venions de fêter nos noces d’argent lorsqu’elle s’est envolée. Elle m’a sorti le refrain usuel de l’usure du temps, de la tendresse qui, insidieusement, avait remplacé l’amour, de son besoin de vivre une nouvelle et, peut-être, dernière grande aventure ; de son souhait de nous voir rester amis…
Bref, elle m’a plaqué pour aller se faire enfiler ailleurs.
Aux yeux de tous nos amis, nous représentions pourtant l’exemple à suivre, le couple idéal. Jamais un mot plus haut que l’autre, jamais de discussion envenimée ; une joie mutuelle à nous retrouver chaque matin, à partager la même existence. Le bonheur, quoi !
Je ne comprends toujours pas sa décision. Un bon coup de trique a suffi pour tout détruire. Et elle voudrait qu’on reste amis ! Non mais elle rêve ou quoi ?
J’ai aussi une fille de vingt-trois ans : une lesbienne qui vit en concubinage avec une meuf de son âge depuis plus deux ans. Elle m’appelle bien de temps à autre mais, hormis des banalités, nous n’avons rien à nous dire. Nous n’avons jamais rien eu à nous dire.
Au boulot, j’étais cadre dans une entreprise de transport à la tête d’une équipe d’une trentaine de personnes. Je m’y suis investi pendant près de trente ans mais il a suffi d’une restructuration — le rachat de la boîte par une multinationale — pour que l’on me fasse comprendre que les nouvelles méthodes de travail voulues par les nouveaux patrons n’étaient pas destinées aux ancêtres de la maison. Sans avoir eu le temps de m’y préparer, je me suis retrouvé chez moi, en pantoufles, en prépension.
Décidément, le monde ne va pas bien et je ne vais pas bien.
C’est ce matin-là, sous la douche, que j’ai décidé de tout plaquer. « Serge, me suis-je dit, fous le camp, fous le camp d’ici avant d’étouffer, avant d’éclater, avant de faire des conneries. Rien ne te retient dans ce coin pourri. Personne ne te regrettera. Tu ne regretteras personne. Tu es libre mec, libre. Réveille-toi car la ligne d’arrivée est peut-être moins éloignée que tu ne te l’imagines. » Et, tout en m’habillant, l’esprit soudain plus clair, l’évidence m’a sauté aux yeux : il fallait que je m’échappe, que je quitte tout. Immédiatement.
Deux mois plus tard, après un tas de tracasseries administratives plus énervantes les unes que les autres, j’emménageais ici. Mon nouveau chez moi est une vieille maison rustique entièrement meublée et encore parfaitement habitable. Elle est située au calme dans un village de cinq cents habitants, loin des brumes du Pas-de-Calais, et possède un magnifique jardin arboré pour lequel j’ai craqué.
Nouvelle vie, nouveau départ, je n’ai rien emporté hormis quelques objets usuels indispensables et une vingtaine de livres dont, pour rien au monde, je ne me séparerais.
Adieu ordinateur, smartphone et télévision. Le téléphone fixe du logis pourra me suffire, pensais-je, comme seul contact avec le monde. Sur ma lancée, j’ai vendu ma bagnole trop rutilante pour ce bled et acheté une vieille Mégane d’occasion.
J’appréhendais énormément la rencontre avec les habitants du village — l’étranger n’est-il pas, depuis la nuit des temps, perçu comme un ennemi potentiel ? — mais, contrairement à mes craintes, l’accueil fut chaleureux.
Le maire, un type de mon âge, très jovial, organisa même très vite une petite réception de bienvenue en mon honneur un dimanche après-midi dans l’unique bar du village.
Bien lui en prit, l’ambiance fut festive, la fête bien arrosée, et chacun semblait satisfait que la maison du vieux bougre puisse enfin être à nouveau occupée après tant d’années. Et à vrai dire, la nuit venue, bien que je ne sache toujours pas qui était ce bougre, l’ancien propriétaire, il me semblait faire partie des leurs depuis longtemps.
J’avais de nouveaux amis. Je me sentais bien !
Très vite, j’adoptai deux chats, ou plus exactement, deux chats m’adoptèrent.
Je devais habiter la maison depuis moins d’une semaine et j’étais occupé en fin d’après-midi de tenter de réparer la charnière de l’un des volets de la façade lorsqu’un miaulement plaintif m’interrompit. Je me retournai et aperçus derrière un buisson, à quelques mètres, une chatte malingre au pelage brun tacheté de gris. « Eh bien, lui dis-je, d’où sors-tu minette ? » Pour toute réponse, elle repoussa son cri d’affamée. J’entrai lui chercher un morceau de jambon et tentai ensuite de m’en approcher mais madame me fit comprendre qu’elle préférait que nous tenions nos distances et qu’il était souhaitable que je lui jette le morceau de nourriture. J’obtempérai. Elle le dévora et disparut. Je crus en être quitte mais quelques minutes plus tard, elle réapparaissait tenant dans sa gueule un chaton aux poils roux et blanc. Elle le déposa près du buisson, commença à se lécher et attendit…
Le lendemain, nous étions installés confortablement tous les trois à la maison. Je décidai de les nommer Minouche et Papou.
Ma solitude n’avait pas duré.
Nous habitons le coin depuis six mois.
Le printemps s’installe, la nature reprend vie.
Durant ce semestre, sinon profiter du temps qui passe, je n’ai rien fait et, cependant, pas une seule seconde je ne me suis ennuyé.
Avant, j’étais toujours tendu, stressé, anxieux, obsédé par les résultats à obtenir. Le vide du dimanche m’horrifiait ; il me fallait vivre dans l’urgence, participer à la course au profit, au chaos infernal. Mais comment ai-je pu être aveuglé à ce point, toutes ces années ?
À présent, ma pension me permet de vivre sans travailler et j’en profite. Pleinement ! Je vis au rythme de Minouche et Papou, dans l’instant présent, sans me soucier du lendemain. Jamais, je ne serais cru capable de cette vie d’ermite, proche de la nature. Cette nouvelle existence me plaît !
Pour me tenir au courant des nouvelles du monde, j’ai pris pour habitude de me rendre au bar du village chaque dimanche midi et d’y prendre l’apéro. J’en profite pour jeter un œil sur le journal local qui y traîne. Cela suffit largement à mon besoin d’informations. Avec les habitués du comptoir, on discute, on alimente les cancans du village, on boit un coup, on boit deux coups, on rit beaucoup.
Et puis un jour, elle est entrée.
Ils se sont tus. Tous. Immédiatement. Instantanément. Installé sur un tabouret face au comptoir, je n’ai pas compris de suite la raison du silence pesant qui avait envahi le bar. Je faillis trébucher en voulant me retourner mais nul n’y fit attention, trop occupés qu’ils étaient à l’observer, à l’épier, à lui balancer des regards haineux.
Alors, la main toujours sur la clenche de la porte qu’elle venait de refermer, elle a parlé. Elle a parlé d’un ton calme et posé, en prenant soin de respirer quelques interminables secondes entre chacune de ses phrases, laissant le temps à chaque client présent la possibilité de lui répondre :
— Eh bien ! vous en faites des gueules…
— Ah ! merci pour l’accueil, vous n’avez donc rien oublié…
— Mais je n’ai nui à aucun d’entre vous à ce que je sache…
— Enfin, vous m’avez reconnue, c’est déjà ça…
— Vous pourriez me souhaiter la bienvenue, non ? Prendre de mes nouvelles après tout ce temps…
Visiblement dépitée par l’absence totale de réaction, elle a soulevé les épaules et s’est approchée du comptoir et a murmuré :
— Oh ! merde, vous me faites vraiment chier.
Puis, plus haut, s’adressant au patron :
— Marc, comme dab, un panaché, s’il te plaît.
Elle s’est ensuite installée sur un tabouret libre à mes côtés et elle a attendu, le regard dans le vide, que Marc veuille bien lui servir sa consommation. Comme à contrecœur, celui-ci s’est exécuté et, sans que je comprenne bien pourquoi, ils ont tous rapidement terminé leur verre et se sont éclipsés les uns après les autres. Sans un regard dans sa direction, sans un mot.
Et alors que les derniers franchissaient le seuil, elle leur a lancé d’un ton désespéré :
— J’ai pas la peste, hein !
Nous restons à trois dans le bistrot, silencieux !
Tandis que Marc, le patron, débarrasse les tables, je l’observe sirotant lentement sa bière. Je suis décontenancé : « Bon Dieu, cette nana c’est le diable ou quoi ? ».
Je la toise de biais. Elle est plutôt mignonne, assez grande — à vue d’œil, près d’un mètre quatre-vingts —, élancée, les cheveux bruns mi-longs, très raides. Elle doit avoir un peu plus de trente ans et porte un jean délavé et un polo échancré qui laisse deviner une poitrine ferme et menue. Alors que j’en suis à deviner la forme de ses seins – j’opte pour la poire – elle me sort brusquement de ma contemplation.
— Ils te plaisent mes nibards ?
Comme un gosse surpris en flagrant délit de gros interdit, je rougis. Je la regarde et je rougis. Puis, prenant conscience de l’absurdité de ma gêne, je souris.
Visiblement satisfaite de son effet, elle me renvoie mon sourire.
Je la sens soudain plus détendue. Elle reprend son verre, le porte aux lèvres, avale une nouvelle gorgée de bière et me demande ce que je branle dans un trou pareil. Avant que j’aie pu lui répondre, Marc intervient :
— Pauline, n’emmerde pas mes clients. D’ailleurs, c’est l’heure de la sieste. Je vais fermer.
Elle le regarde d’un air incrédule, se cabre et éclate :
— Non, mais ce n’est pas vrai ! Oh ! je savais que vous n’alliez pas m’accueillir les bras ouverts, mais une telle hostilité, une telle animosité, ça non, je ne l’avais pas imaginé, même dans mes cauchemars les plus horribles, et Dieu sait si j’ai pu en faire des cauchemars.
— Mais pourquoi t’es revenue, Pauline ? lui répond Marc, visiblement irrité.
— Mais où voulais-tu que j’aille, mec ? Où voulais-tu que j’aille, sinon ici, après douze années de cabane. J’ai plus personne dans la vie, tu comprends ? Plus personne. Tu peux comprendre ça, Marc ? Toi, t’es pas aussi borné que les autres, je le sais. J’ai quand même le droit de revenir vivre dans la maison dans laquelle j’ai passé les vingt premières années de ma vie, non ?
— T’aurais pas dû revenir Pauline. Pas après ce que tu as fait.
— J’ai payé, Marc. N’oublie pas. J’ai payé.
— Pauline, on t’avait tous zappé de notre disque dur, ici. Y’a pas à dire, mais les mauvais souvenirs, si on veut vivre, faut pouvoir les oublier. Faut qu’ils restent enfouis dans un coin et qu’ils ne ressurgissent jamais.
— Bande de salauds.
— Oh ! Pauline, du calme, hein ! Parce que tes vieux, tu les as butés quand même.
Comme assommée, telle un automate, Pauline se lève alors et s’éloigne du comptoir. Elle enfonce une main dans la poche droite de son jean et en ressort quelques pièces de monnaie qu’elle lance violemment par terre aux pieds de Marc. Les larmes aux yeux, livide, elle se dirige ensuite vers la porte d’entrée restée ouverte et, sans le moindre regard dans notre direction, en franchit le seuil.
Cloué sur mon tabouret, j’ai assisté, comme un intrus, à toute la scène. Je me sens mal, très mal.
Choqué, je quitte le bar à mon tour et, perdu dans mes pensées, remonte lentement à pied la rue principale qui mène à mon logis, situé à un petit kilomètre de la place du village.
Arrivé à hauteur de l’arrêt de bus, je l’aperçois, recroquevillée sur l’un des deux sièges en matière plastique de l’abri.
J’ai le cerveau en ébullition : « Dois-je m’approcher d’elle ou l’ignorer ? » J’hésite. Après tout, cette femme, je ne la connais pas et si j’en crois les propos tenus par Marc au cours de leur discussion, mieux vaut peut-être ne pas s’y frotter. Est-ce mon problème finalement si elle a envie de poireauter quatre heures à attendre le prochain car ?
Je m’arrête cependant et lui demande comment elle se sent.