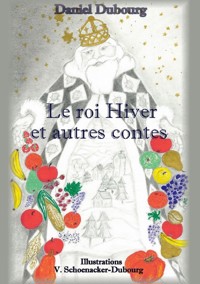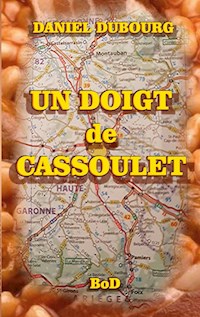Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La vie, lieu semé de moments proches ou lointains, empruntés, imaginés ou vécus, infimes, intimes, marquants, d'arrêts sur images ou de courts métrages. Des êtres s'animent en quelques pages, sous une plume trempée dans les encres du temps. De Madeliene à Mado : la boucle d'un chemin au contour de palette, où vous conduisent les prénoms des acteurs
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Madeleine. La centenaire au cœur de jeune fille
Amélie. Au château du Pont d'oye
Annette. Rêve d'Egypte
Anton. Retour chez grand-mère
Arielle. Devant la vitrine
Arsène. Le Tonkin
Brice. Le catalogue
Edmée. La petite reine
Edouard. Les oignons
Elle. A la fenêtre
Ernest. Le vieil ours
Gil. Elle peut crever !
Helena. Les échanges
Jeanne. Le parloir
Jo. Les mains noires
Justin. La rue du Canada
Lauriane. Retrouvailles
Louis. Avant le retour
Mathieu. La rencontre
Muriel. Les livres
Norma. C'était une voix
Odette. Les amoureux de la ligne Maginot
Quentin. L'automate
Sabine. Enlèvement
Saïd. Le vélo
Théo. Rêve de paradis
Mado. Le saut d'un l'ange
La centenaire au cœur de jeune fille
« J’avais à peine sept ans, peut-être moins, quand je l’ai vue pour la première fois. Petit, je n’avais pas encore rencontré beaucoup de gens très vieux ; je n’imaginais pas que cela puisse même exister, les seules vieilles personnes peuplant mon monde encore restreint étant mes grands-parents. Bien sûr, j’en croisais dans les rues, au hasard de mes promenades ou encore dans des magasins. Donner un âge aux autres échappait à mes préoccupations, car les mots parlant de l’âge m’étaient étrangers, tout comme ceux ayant trait à la mort. Les notions d’infini et d’éternel se gravent peu à peu dans les mémoires des enfants, quand ils découvrent le temps en explorant la vie.
Ma grand-mère m’avait tout juste dit que sa maman était une grand-mère, et plus encore, mon arrière-grand-mère ! J’allais droit vers l’aventure.
Celle-ci commença au fond d’une courette étroite et sombre, peu entretenue où dormaient une poubelle de zinc, quelques seaux et une moto qui n’avait plus roulé depuis longtemps, à en juger par ses pneus assoupis et la poussière qui la satinait. Au fond à droite, une porte que Jeanne, ma grand-mère, poussa en criant qu’elle entrait, ce que nous fîmes. La petite pièce, munie d’une seule fenêtre, rivalisait d’obscurité avec la courette. On avait une pressante envie de tourner le bouton d’interrupteur, de faire un peu de lumière et, pour répondre à l’étonnement marqué sur mon visage, ma grand-mère désigna un objet métallique ouvragé, muni d’un long tube en verre, posé sur la table, où se dansait une flamme :
— C’est ça, la lumière, mon grand !
J’en conclus que cet étrange appareil était inefficace, puisqu’il faisait toujours aussi sombre. Une porte étroite s’ouvrit et une dame toute ridée portant un chignon blanc entra avec lenteur. Sous sa robe qui tombait sur de gros chaussons fatigués, ses jambes tremblotaient peut-être autant que ses mains déformées. Elle était toute petite, l’arrière-grand-mère, un peu ronde et habillée de gris.
La cuisine sentait le renfermé et le bois refroidi. Jeanne ouvrit la fenêtre pour aérer. Dans un coin dormait un gros poêle qu’entouraient quelques bûches et un seau à charbon qui ressemblait au nôtre. La tapisserie, chargée, fatiguée et décollée par endroits sentait un passé où les jours comme les nuits vivaient avec lenteur.
La mémé tremblotante se pencha vers moi et me dit bonjour, d’une voix chevrotante. Sur la pointe des pieds, je déposai un baiser timide et méfiant sur deux joues molles et ridées. Elle se dirigea ensuite vers son buffet de cuisine et en sortit, avec des gestes lents et peu assurés, un bocal où reposaient, soudés par le temps, des bonbons de couleurs différentes et m’invita à me servir. J’eus toutes les peines à en choisir un seul, malgré son insistance, car l’opération était délicate, voire impossible, sauf à tenter d’extraire le bloc compact multicolore. Finalement, je parvins à décrocher du magma rocheux un bonbon rouge qui avait le goût délicieux des cerises que mon grand-père rapportait de son champ. C’est ainsi que je fis la connaissance d’une très vieille dame de ma famille.
— Tu as besoin de quelque chose, aujourd’hui, maman ? demanda ma grand-mère.
Ma grand-mère avait donc une maman visiblement pas toute jeune comme la mienne ! Je commençais doucement à comprendre, du moins à entrevoir certaines choses, les balbutiements de la généalogie !
— Je vais aussi prendre ton linge sale, fit-elle en revenant de l’autre pièce, la chambre sans doute, portant un grand panier joufflu.
Comme midi approchait, la vieille dame s’assit à la table et commença l’épluchage de quelques pommes de terre. Peler au couteau lui prit du temps. La lame dérapait parfois sous les doigts tremblotants, sans couper, heureusement, autre chose que la peau des patates ! Ma première visite s’acheva par une question :
— Comment tu t’appelles ?
— Madeleine ! je suis la mémé Madeleine, mon gamin. Tu te rappelleras ? Tu reviendras me voir bientôt ? dit-elle de sa voix chevrotante.
— Oui, mémé, je reviendrai.
Et ce n’était pas une promesse d’ivrogne, car à mon âge, je ne buvais que du lait et de l’eau ! Ma mère m’apprit bien plus tard que le mari de Madeleine, sa propre grand-mère (eh oui !) avait eu une entreprise artisanale de serrurerie qu’il conduisit à la faillite pour avoir été dépensier et coureur de jupons. J’avais alors l’âge de comprendre cette expression fort imagée et je la mettais en scène : les jupons couraient, voletaient, flottaient au vent comme des drapeaux et, derrière eux, des coureurs infatigables s’époumonaient pour tenter de les saisir ! Comme je souhaitais grimper à la première branche de mon arbre généalogique, elle ajouta que Madeleine avait beaucoup travaillé, trop travaillé, y compris pour les autres, élevant deux filles et deux garçons, jusqu’à s’user, à force de prendre de la peine. J’aurais, par la suite, tout le loisir, si l’on peut dire, de comprendre le sens et la difficulté de cette mission, lot de si nombreux parents et source de tant de joies parfois teintées de peines.
Quand j’eus onze ans, nous quittâmes la grande ville pour une petite bourgade brodée de verdure, et je perdis un peu de vue la vieille Madeleine que je pus revoir au moment de mes études, pour sa plus grande joie, car je logeais non loin de là, chez mes grands-parents.
Les années avaient tant passé, que Madeleine eut un siècle ! Madeleine centenaire ! Une perle rare, une exception ! Madeleine qui avait toute sa tête, ou presque, qui tremblotait un peu plus, qui faisait des efforts surhumains pour tenter de se rappeler, mais oubliait dès le lendemain les prénoms des membres de sa famille devenue nombreuse. Madeleine qui mangeait cependant son bout de lard quotidien, à l’aide des rares chicots qu’il lui restait, et buvait son canon journalier !
Malgré ce cap atteint, mon arrière-grand-mère n’était doyenne de rien du tout. Ni de sa ville ni de son département ni de sa Lorraine. Non, non ! Simplement parce que la doyenne, qu’elle connaissait et qu’elle invita à sa grande fête, habitait deux cents mètres plus bas !
À dix-sept ans, je réalisais que notre Madeleine était née en 62 ! 1862 ! donc avant la guerre de 70, dont je conservais précieusement une grande photo sépia où posait mon autre arrière-grand-mère, Corse et Normande, au bras de son hussard casqué, et qui était décédée 10 ans plus tôt. Je ne l’avais jamais connue, mais je me souviens être allée à son enterrement, dans le Pays d’Auge.
J’avais fouillé des livres d’histoire et cherché des témoignages de cette époque lointaine, pour découvrir tout ce qu’elle avait bien pu connaître d’un passé meurtri par une nouvelle guerre qui m’avait vu naître prématuré au moment où elle mourait sans signer de traité de paix.
Exceptionnel, l’événement ne passa pas inaperçu, puisqu’il fut relaté, photo à l’appui, dans les deux quotidiens du département. On m’avait placé juste derrière elle et je n’étais pas peu fier. Il fallait beaucoup de baisers à Madeleine, alors je m’en approchais parfois, comme pour demander un bonbon empesé de sucre. Pour mettre les petits plats dans les grands, la salle de bal d’un restaurant voisin faisant face à la Place de la Nation, celle-là même où, chaque année, je me grisais d’émotions sur les manèges, avait été réservée. J’avais profité de l’occasion pour lier connaissance avec une petite-cousine équipée de couettes fort à la mode, à l’époque.
Madeleine était aux anges, ravie d’être entourée des siens. Souriante, elle parlait, disait son bonheur d’être là avec de petits mots livrés d’une voix chevrotante. Elle mangea de tout, lentement, car sa tête ornée d’un chignon ouvragé dodelinait sans cesse avec charme et constance, jouant avec la fourchette qui cherchait le chemin de la bouche. Elle n’hésita pas à lever le coude, modestement, certes, mais avec un réel plaisir. La doyenne vint pour le dessert : cent deux ans ! Ce fut donc un jour à mettre en mémoire.
C’est un peu plus tard, que Madeleine s’en alla sur la pointe des pieds. Elle fit connaissance avec l’hôpital où on tenta de l’opérer du col du fémur, suite à une chute sur un tapis, chez une de ses filles, loin de chez elle, à une cinquantaine de kilomètres. C’était trop, trop d’émotion, de douleur, de dépaysement, de vie soudain agitée, de peur de ne plus jamais revoir son étroit logement sombre. Son cœur de jeune fille, avaient dit les médecins, avait pourtant bien tenu. Je comprenais que j’en avais hérité »
Autour de la table, la dizaine de pensionnaires fidèles de l’Atelier des souvenirs, que j’animais chaque semaine, m’avait écouté sans mot dire. Je savais que certains étaient originaires des environs ou y avaient habité et qu’ils connaissaient bien la grande ville toute proche.
— Aujourd’hui, vous voyez, c’est moi qui vous ai livré un souvenir d’enfance proche des vôtres, par le prix que vous leur donnez ; et je sais qu’ils vous sont précieux. Excusez-moi, si j’ai été un peu long. En tout cas, je vous remercie de m’avoir écouté. À présent, je dois m’en aller, et puis je vois votre goûter arriver !
Une dame en tenue rose poussait un chariot dans la pièce et commençait à servir les pensionnaires, proposant thé, lait, café, compote, petits gâteaux, brioche ou bien flan à la pistache et crème brûlée. Il suffisait de demander.
À ce moment, une petite dame frisée comme un mouton me demanda :
— Le restaurant où vous avez fêté le centenaire de votre Madeleine était-il juste à côté de la courette sombre ?
— Oui, pourquoi ?
— Parce que la demoiselle qui a fait le service de table en 62, c’est moi !
Au château du Pont d’Oye
Madame,
Jamais je n’avais reçu courriel plus insolite, plus inattendu. Inespéré, aussi. À cette époque, je mettais la dernière plume à un recueil de contes, pour tout vous dire, une commande à laquelle j’avais travaillé de longs mois. Je ressentais un vrai besoin de me plonger dans d’autres histoires, d’une tout autre façon.
La page s’ouvrait sur un château entouré de forêts, de verdure, si j’ai bonne mémoire. Il avait un drôle de nom : il était question d’oie, je crois. Ainsi, je ne quittais pas les contes…
Quinze ans ont passé…
J’allais m’y rendre, sans doute, sans aucun doute. J’allais me retrouver pendant une semaine, comme plongé dans un creuset, un athanor, en compagnie d’autres auteurs. Rien que pour écrire. Nous serions une dizaine, en résidence d’artiste, à prêter notre plume à des sujets de dernière minute, cocasses, imprévisibles, insolites comme cette invitation qui donne une folle envie de fourrer pêle-mêle habits, brosse à dents, blocs et stylos dans sa valise, de sauter dans sa voiture pour s’évader au plus vite, comme si un être cher vous appelait à l’autre bout du monde parce qu’il se languit de vous revoir après tant d’années.
Des photos me conduisaient dans l’immense et austère bâtisse ourlée d’un parc peuplé de hauts et vénérables arbres, d’un kiosque, d’un pavillon, d’une fontaine, peut-être. Mon imagination déjà prenait le large. Tout prêtait à être concentré, attentif, rêveur et distrait à la fois. Savoir s’envoler d’une page à ciel ouvert et y revenir par la pointe du stylo. Captivant.
Assis au bureau de ma chambre, sur la terrasse ou sur le perron, j’écrivais, m’arrêtant parfois pour baigner dans le silence ombragé et l’air frais de passage. Toujours ce cadre paisible et mi-obscur, dedans comme dehors, où les meubles vernis ou cirés viendraient vous conter des fragments de vie de certains locataires parfois disparus, qu’on devinait pourtant tout proches.
C’était en quelle saison ?
J’ai refermé hier soir votre dernier livre où vous racontez de façon originale une partie de votre enfance dans ce château, en compagnie de votre famille. Vous avez laissé sur un banc une pensée fugace, dans une chambre une impression soudaine et intime, sur une marche d’escalier un souvenir infime, mais impérissable, qui vous est cher, et sur la table de la cuisine, à côté d’un bol de lait fumant, une anecdote amusante.
Je vois des enfants courant gaiement, un père très occupé, une mère tout autant, les deux proches de vous, sans compter votre sœur, complice. Cela respire votre humour posé par touches légères, votre sens de l’observation aigu, le regard à la fois amusé, sérieux et profond que vous posez sur tout ce que vous approchez. Tout est paisible, feutré. Et le temps a la douceur d’un édulcorant.
J’aurais aimé écrire là-bas…
J’ai gardé mon rêve en poche, nostalgique, mais non déçu. Je n’ai pas préparé ma valise, pas même rassemblé crayons, stylos et calepin, souris et ordinateur. Je n’en ai parlé à personne et, sans oublier, je me suis dit que ce serait pour une autre fois… Aléatoire.
Au dernier moment et après mûre réflexion, j’ai jugé raisonnable de ne pas répondre favorablement à l’invitation. À l’époque, mes proches avaient bien besoin de moi, de ma présence. Et en venant chez vous, j’avais le sentiment de ne penser qu’à moi, égoïstement, et de me ménager des instants privilégiés qui auraient été sans doute inoubliables. Je ne m’en suis jamais voulu ; je n’ai jamais regretté ; j’ai juste espéré que l’occasion se reproduirait. Et j’ai idéalisé le souvenir.
Je passerai là-bas un jour ; je n’en suis pas si éloigné. Deux heures de route à peine, pour quelques minutes de pause, adossé à ma voiture, par simple nostalgie. Vous n’y serez plus, comme vous me l’avez dit.
Merci de m’avoir souhaité ma fête. Votre gentil petit mot, que je n’ai cessé d’attendre m’est parvenu le jour même. Si je vous devine ou vous reconnais sous l’un des fameux chapeaux que vous aimez porter, je serai heureux de vous saluer, et encore bien plus, de partager avec vous, ne serait-ce qu’un court moment à la terrasse d’un café. Si vous en avez le temps.
Sait-on jamais ?
Rêve d’Égypte
Quarante-deux ans de maison. Deux patrons, dont le dernier pendant vingt-cinq ans. Un bel exemple de fidélité et de compétence reconnues de tous. Beaucoup sont passés là, puis partis, et des tout premiers, il n’en reste aucun. Préparateurs, conditionneurs, femme de ménage sont présents dans le labo pour dire au revoir à Annette et passer un dernier bon moment en sa compagnie. La dame, toujours discrète, n’est pas une « grosse marrante », elle ne manie pas la plaisanterie et l’humour, mais elle sait les apprécier. Elle est entrée dans cette pharmacie au moment de ses vingt ans, après avoir obtenu le diplôme de préparatrice et, toujours affable, a accompli son travail avec un sérieux jamais démenti.
Sur la paillasse du labo est dressé un buffet abondant et varié, présenté avec sobriété : un magnum de champagne côtoie des jus de fruits, du whisky et des réductions sucrées et salées. Certains avaient proposé une soirée dans un proche restaurant, mais Annette n’en avait guère envie. On a donc respecté son souhait. Rien n’empêchera la remise du cadeau de départ, véritable surprise ! Cela ira bien ainsi. Elle est comme ça, Annette : pas de bruits, pas de vagues, sans tambour ni trompette, la petite et fluette souris qui a côtoyé les meubles de chêne sombre et ouvragé, si vieux qu’ils ne craquent plus depuis des lustres, mais qui sauraient, s’ils avaient la parole, vous dire d’interminables anecdotes fleurant l’eucalyptus, la menthe ou la verveine.
Le patron a fermé l’officine une heure plus tôt, afin de donner un air de fête à l’événement, a-t-il dit. Il est vrai que procéder ainsi permet que chacun soit moins fatigué, donc plus disponible. De plus, les autres retraités proches ou lointains qui ont œuvré ici ont été ravis de cette solution. Leur présence fera chaud au cœur d’Annette et ravivera des souvenirs, pour certains, assez anciens : elle a toujours été d’un commerce agréable avec tout le monde, clients, médecins, livreurs et collègues, s’est toujours proposée pour rapporter à quelques voisins éloignés des cornets de médicaments ou d’autres babioles.
Pendant de nombreuses années, Annette a beaucoup donné : auprès de sa vieille maman partie voici cinq ans, après une maladie longue et pernicieuse, ou à aider son frère aîné, exigeant et peu sociable, qui a passé des mois en fauteuil, à ressasser ses malheurs et ses espoirs envolés, depuis le départ de sa femme.
De quoi sont faites les journées d’Annette ? Depuis de nombreuses années, elles se ressemblent. Pas de sorties, peu de contacts, pas d’amis. Une vie de recluse qu’elle s’est faite, en quelque sorte. Elle lit un peu, noircit des grilles de mots croisés et regarde parfois des films ou des documentaires à la télévision, mais ne fait rien qui l’oblige à trop se prendre la tête. Trop de fatigue, de lassitude. Presque de l’ennui et une forme de lente solitude qui s’insinue.
À midi, elle se contente d’un repas frugal pris sur le pouce dans l’arrière-boutique de l’officine silencieuse et déserte : une pomme, une madeleine, un yaourt. Voilà qui prend peu de place et ne requiert pas de vaisselle. Ensuite, en attendant la réouverture, elle lit une revue quelconque. Ce n’est pas le soir venu, au retour du travail, qu’Annette va se mettre au fourneau. Elle connaît sa maison par cœur, à force d’y tourner en rond !
Divorcée depuis quinze ans, elle a tout fait pour que son fils réussisse sa vie. Il n’a manqué de rien, pense-t-elle. Après de brillantes études, il s’est expatrié dans la capitale, puis s’est sans doute noyé dans un travail absorbant de cadre commercial. Elle ne le voit plus depuis plusieurs mois, ne reçoit pas de nouvelles. Pourquoi tout ce silence ? Adrien a-t-il des difficultés ? Le seul numéro qu’elle compose régulièrement ouvre sur une messagerie invariablement surchargée et les pages blanches de La Poste ne le localisent pas.
Jusqu’à présent, Annette s’accrochait à son métier, comme une fuite déguisée, une occupation qui remplit ses journées et sa tête.
Mais elle a décidé de se bouger, dès demain. Une ferme résolution comme celle que l’on prend au jour de l’an. Elle fera de la marche, partira en voyage selon ses moyens, ira au cinéma, au théâtre, invitera d’anciens collègues. Des amis, elle s’en fera peut-être, en participant à un atelier de dessin ou de poterie. Elle ferait bien du yoga, mais… Elle sait bien qu’elle est casanière. « Tout va changer ! » se dit-elle parfois.
Le pharmacien a écrit un joli petit discours, truffé de souvenirs, de quelques plaisanteries sur des anecdotes de toutes ces années passées ici, entre fioles, bouteilles, brosses à dents et boîtes. Cordial. Attendrissant. Il a pu apprécier la disponibilité et les multiples qualités de son employée, qu’il ne manque pas de souligner. Les collègues en témoignent par des sourires entendus et des hochements de tête, et manifestent leur émotion et leur attachement. On applaudit chaleureusement, au point final ; certains essuient une larme furtive. Et le cadeau libère les émotions. Annette, émue et fébrile, embrasse un superbe bouquet de fleurs, puis ouvre une enveloppe avec un rien de nervosité. Elle en tire un chèque et un petit mot qui lui souhaite un voyage de rêve en Égypte. Cette fois, elle part en sanglots, touchée déjà par tant de générosité, mais surtout parce que tous se sont rappelé qu’elle nourrissait le désir de s’envoler pour le Nil, Assouan et les pyramides.
Depuis longtemps, elle voulait visiter l’Égypte. Elle économisait. Mais son mari, égoïste et casanier ne voulait rien savoir : son PMU, ses copains de l’usine et ceux du foot, c’était son univers culturel. Elle avait tant lu sur l’Égypte, avait acheté tant de beaux ouvrages emplis de magnifiques photos. C’était un simulacre d’évasion. Mais les pages d’un beau livre ne remplacent pas les couleurs, les senteurs et les ambiances d’un coin de planète.
Après le lunch de départ, les embrassades, les poignées de main appuyées, prolongées et les promesses de se revoir bientôt après tant d’années, c’est le trou noir, le silence, le retour définitif, cette fois, à l’isolement. La coupure brutale.
Voici six mois qu’Annette est en retraite et elle peine à récupérer d’une fatigue accumulée depuis longtemps. Pour se délasser, elle feuillette des catalogues de voyages.