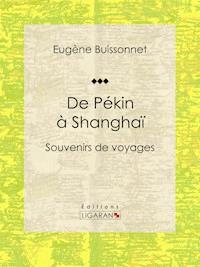
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "En relisant dernièrement diverses notes de voyage, je fus frappé par le caractère d'actualité tout particulier que présente la partie qui a trait à une excursion de plusieurs mois que je fis il y a quelque temps dans l'intérieur de la Chine et, par le conseil de plusieurs amis, je me suis décidé à en livrer le récit à l'impression. Cette publication me paraît d'autant plus opportune qu'en ce moment l'attention publique est mise en éveil, surtout par les..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076332
©Ligaran 2015
Le présent ouvrage était sous presse lorsque les malheureux évènements de 1870 et 1871 sont venus en interrompre la publication. Mais ce livre n’en conserve pas moins toute son actualité, en dépit de ce retard d’un an apporté dans sa présentation en public. En effet les appréhensions de l’auteur sur le manque de sécurité des intérêts européens en Chine, ainsi que ses appréciations sur l’état des choses dans ce pays et la marche à y suivre, sont pleinement justifiées par l’attitude de plus en plus agressive que prend chaque jour le gouvernement chinois, lequel n’a trouvé que d’équivoques édits à rendre et des protestations évasives à faire au sujet du massacre de Tientsin qui, l’année dernière, a jeté l’épouvante la plus grande chez tous les Européens résidant dans l’empire du Milieu, et a nécessité l’envoi d’une nouvelle ambassade chinoise en ce moment en France.
Paris, juillet 1871.
En relisant dernièrement diverses notes de voyage, je fus frappé par le caractère d’actualité tout particulier que présente la partie qui a trait à une excursion de plusieurs mois que je fis il y a quelque temps dans l’intérieur de la Chine et, par le conseil de plusieurs amis, je me suis décidé à en livrer le récit à l’impression. Cette publication me paraît d’autant plus opportune qu’en ce moment l’attention publique est mise en éveil, surtout par les préoccupations toutes naturelles que cause le renouvellement des traités avec le Céleste-Empire et par la présence en Europe de l’ambassade chinoise qui, depuis déjà assez longtemps, erre d’une capitale à l’autre, dans l’accomplissement d’une mission jugée beaucoup trop favorablement en principe, mais qui, petit à petit, perd les apparences heureuses qu’elle avait, pour ne paraître plus que ce qu’elle est réellement, c’est-à-dire l’expression pure et simple de l’esprit rétrograde du gouvernement chinois.
Depuis quelques années, l’intérêt que l’Europe porte à l’extrême Orient s’est accru d’une manière sensible, et cela s’explique par nos relations rendues chaque jour plus suivies et plus considérables par la vapeur et l’électricité.
La Chine nous était à peu près inconnue il y a trente à quarante ans, et on se préoccupait si peu de ce qui s’y faisait que tout au plus lisait-on les relations de nos missionnaires, qui étaient tout ce qu’on possédait alors de connaissances sur cet immense pays, en dehors de quelques récits de voyageurs et des élucubrations savantes de certains esprits qui avaient fait leur spécialité de l’étude fort peu attrayante de sa littérature et de son organisation civile et religieuse. Cette indifférence se comprend parfaitement, par suite de notre manque à peu près complet de rapports avec cette contrée mystérieuse, puisque jusqu’au moment de la guerre de 1842, dite Guerre de l’Opium, et du traité de Nankin qui en a été la conséquence, cela se bornait à quelques relations commerciales fort peu importantes et de la plus grande irrégularité entre l’Angleterre et la Chine.
Maintenant il n’en est plus ainsi : l’expédition anglo-française de 1860 d’abord, les guerres civiles qui ont dévasté récemment l’empire, et l’intercourse commercial qui ne fait que progresser chaque année, appellent de plus en plus l’attention générale sur ce pays, devenu tellement intéressant qu’il ne nous est plus permis d’ignorer ce qui s’y passe. La révolution qui s’est produite dans la nature de nos relations avec cet empire a été jusqu’à présent très peu sensible dans ses parties reculées ; mais elle a fortement émotionné la région accessible aux étrangers, et leur présence a bouleversé la vie civile de ses habitants, en tendant à les amener graduellement vers une rénovation complète dans l’organisation gouvernementale et administrative, si désirable à tous égards. Pour nous, cette révolution a produit des résultats très appréciables : elle a détruit nombre de vieux préjugés, elle a élucidé beaucoup de points douteux et mis au grand jour de nouveaux faits ; notre commerce a été amené par elle à trouver de précieux éléments dans les innombrables richesses de ce pays, et le temps n’est pas éloigné où notre industrie trouvera les moyens d’y jouer un rôle très important.
En fin de compte, nous sommes ancrés en Chine et il ne nous est plus permis d’en sortir ; d’abord nos intérêts matériels y sont trop considérables et, à l’époque actuelle, il n’est pas admissible qu’une aussi vaste contrée soit laissée livrée à elle-même et reste en dehors de l’influence de notre civilisation, ainsi qu’elle l’était il n’y a pas très longtemps et que le voudraient encore tous ceux composant son gouvernement, qui ne nous ont certainement pas admis de bonne volonté.
Bien entendu que je n’ai pas l’intention de faire ici le précis de l’histoire contemporaine de la Chine, dont les évènements ont été, du reste, déjà plus d’une fois soumis à un sérieux examen : c’est un simple journal de voyage que je prends la liberté de présenter à la bienveillance de mes lecteurs, et j’en conserve avec soin la forme modeste qui, sans la moindre prétention littéraire, me permet de placer à l’occasion nombre d’observations intéressantes, justifiées par des connaissances acquises pendant un séjour antérieur d’une douzaine d’années dans le Céleste-Empire.
J’espère qu’on me pardonnera le décousu inévitable d’un récit fait dans de semblables conditions, dont tout le mérite consiste dans la sincérité des impressions et une certaine expérience du pays ; j’espère aussi qu’on voudra bien me suivre jusqu’à la fin dans les réflexions qui m’ont été suggérées par un nouveau séjour de quelques mois fait en Chine pendant le cours d’un récent voyage autour du monde, ainsi que par l’agitation qui se produit actuellement dans la presse locale à propos de l’attitude peu rassurante que prend le gouvernement chinois depuis qu’il est question de traiter avec lui sur un pied d’égalité et dans les mêmes termes qu’avec les nations civilisées.
Ces réflexions m’ont paru, dans les circonstances actuelles, être le complément obligatoire de mon travail, et je les livre avec confiance à l’appréciation bienveillante du lecteur, qu’elles pourront intéresser à plus d’un titre.
E.B.
Saint-Vallier, avril 1870.
Les hasards de l’existence passablement aventureuse que je mène depuis quelques années m’amenant de nouveau sur les côtes de Chine, et devant me trouver à Shanghaï et au Japon quand viendra le printemps prochain, je me décide à employer mon temps d’ici là à faire un voyage par terre à travers les provinces du Céleste-Empire que je connais le moins, ce qui me permettra de poursuivre mes études sur ce pays si intéressant à tous égards, dans lequel j’ai passé de longues et laborieuses années et dont j’ai conservé le meilleur souvenir, en dépit des luttes nombreuses que j’y ai soutenues, des peines que j’y ai éprouvées et des maladies inhérentes au climat et aux conditions de l’époque qui ne m’ont pas épargné. Et puis, je ne peux pas me dispenser d’une visite à Pékin chaque fois que je touche au sol chinois ; il y a longtemps que je désire faire plus ample connaissance avec le Petchili, le Chantong et le Honan, et jamais meilleure occasion ne s’est encore présentée à moi pour cela.
Je suis venu de France il y a quelques mois en passant par le Nord de la Russie et traversant la Sibérie de l’ouest à l’est dans toute son étendue. J’ai voyagé à cheval, à dos de chameau ; en voiture, traîneau ; j’ai usé de tous les moyens de locomotion possibles, passé des mois entiers en tarantas nuit et jour et sans désemparer ; j’ai été presque mis en capilotade par les cahots inhérents aux télégas dans la traversée des steppes sibériennes ; j’ai descendu le fleuve Saghalien ou Amour jusqu’à son embouchure, en bateau à rames, steamer et même en radeau, couchant à la belle étoile les trois quarts du temps, exposé à toutes les intempéries, passant du froid le plus glacial aux chaleurs les plus intenses, piqué par les moustiques, dévoré par les taons, puces et autres insectes, ne buvant pas toujours à ma soif et plus d’une fois n’ayant rien à me mettre sous la dent ; j’ai fait mon trou dans la glace en traversant le Volga et n’en suis sorti que par miracle ; j’ai failli me noyer à l’embouchure de l’Amour par suite du naufrage d’une chaloupe dans laquelle je me trouvais, et j’en ai été quitte pour un bain peu récréatif qui a duré huit heures.
Après cela j’ai goûté des délices de la navigation à voiles à bord d’un prétendu clipper qui a mis quarante-deux jours pour m’amener de Nikolaïevski en Chine, traversée qui aurait dû se faire en quinze ou vingt jours au plus. Comme un pareil retard n’avait pas été calculé, les provisions ont naturellement fait défaut, et on a été pendant plus de vingt jours mis à la ration la plus stricte de biscuit et salaisons, ce qui, avec le manque d’eau, m’a gratifié du scorbut pendant quelque temps, et jusqu’à présent manquait à ma petite collection de misères. J’ai assisté à bord de ce charmant bâtiment aux scènes les plus déplorables d’insubordination, amenées presque toujours par les emportements sans raison du capitaine ; j’ai eu aussi personnellement une ou deux prises de corps avec ce personnage, ce qui fait que j’ai été on ne peut plus heureux quand est venu le moment où j’ai pu quitter et le bâtiment et celui qui le commandait, en emportant une opinion telle qu’assurément je ne remettrai plus les pieds à bord d’un voilier qu’à mon corps défendant.
Maintenant je reviens de Corée, où je suis très satisfait d’avoir pu aller, grâce à la gracieuse autorisation de l’amiral Roze, qui commandait l’expédition qu’on vient de faire contre ce pays. Je suis à bord du Laplace, corvette à vapeur de l’État, qui a bien changé depuis près de trois semaines que je m’y trouve.
Pendant les premiers jours et en allant de Tchefoo en Corée, le Laplace était bourré de provisions et transformé en vrai bâtiment de transport, ce qui faisait qu’on ne pouvait circuler qu’avec grand-peine sur le pont, récipient obligatoire en pareille circonstance, attendu que les navires de guerre ne sont nullement disposés pour prendre autre chose que ce qui est régulièrement prescrit pour leurs besoins particuliers, et que l’emplacement disponible dans leur cale est généralement à peu près insignifiant. L’avant du navire était alors devenu une ménagerie des mieux assorties, où bœufs, moutons et porcs se pressaient les uns contre les autres et semblaient ne faire place qu’à regret aux canards, lapins, pigeons, poulets, faisans, oies, etc., qui y étaient entassés pêle-mêle dans des paniers à claire-voie. Quant à l’arrière, ce n’était que rangées de barriques de vin, pyramides de caisses de conserves, eaux-de-vie et liqueurs de toute sorte, arrimées à la hâte, presque à la disposition du matelot, qui ne manquait pas de mettre en œuvre toutes ses facultés inventives pour opérer le transvasement d’une bonne quantité de liquide au profit de ses appareils distillatoires, qui, comme on sait, se distinguent par leur remarquable élasticité.
À présent le pont est débarrassé des provisions, bestiaux, etc., qui l’encombraient. On a repris de plus belle les mesures de propreté ordinaires à bord de tout navire, mesures poussées à leur dernière limite sur certains bâtiments de guerre. Le lavage en est la plus importante, et les matelots du Laplace paraissent prendre un plaisir tout particulier à cet exercice ; bien longtemps avant le jour on est réveillé par les coups de sifflet des maîtres, par les bruits de toutes sortes que fait la fourmilière du bord en mouvement, fourbissant, grattant, balayant, remuant les cordages, et surtout par les seaux d’eau qui sont lancés à tour de bras sur tous les points du navire, et en telle abondance qu’on croirait que ces tritons, ne tenant aucun compte de l’exiguïté infime de leur coque, relativement à l’immensité liquide, ont juré de ne s’arrêter qu’après avoir fait entrer le contenant dans le contenu.
23 novembre.
À dix heures nous mouillons à Tchefoo, et en même temps que nous arrive le vapeur Yuen-tze-Fee en route pour Tientsin. Comme il ne fait que toucher ici, je m’empresse de retenir mon passage et de me rendre à son bord, après avoir fait mes adieux au commandant et à l’état-major du Laplace, dont je n’oublierai de longtemps la gracieuseté. Le commandant Amet a surtout droit à toute ma gratitude pour ses excellents procédés, et les uns et les autres ont certainement fait tout leur possible pour me rendre agréable mon séjour à bord du Laplace, dont j’emporte le meilleur souvenir.
Nous partons à midi. Je suis le seul passager européen à bord du Yuen-tze-Fee.
24 novembre.
Une forte bourrasque s’est élevée pendant la nuit et dure toute la journée ; le bateau étant très petit, il roule et tangue d’une façon désordonnée. Vers la tombée de la nuit, nous mouillons à douze ou quatorze mille de Takou ; le vent est si violent que le bateau reste sous vapeur, et qu’on est, par moments, obligé de faire machine en avant pour soulager les ancres.
25 et 26 novembre.
La bourrasque est presque devenue tempête ; impossible d’avancer, et par conséquent nous restons sous vapeur à l’ancre, faisant tête au vent.
Le Yuen-tze-Fee est un bateau que je ne recommanderai jamais à personne. Il est à hélice et si petit que la moindre mer le fait danser d’une affreuse manière ; ses cabines sont loin d’être confortables et ne brillent nullement par la propreté. Les passagers chinois, toujours assez nombreux à bord de ces vapeurs faisant le service régulièrement, ne sont séparés de moi que par une faible cloison, et il se dégage de leur compartiment des nuages de la fumée d’opium qui, joints à l’odeur de graillon de cuisine et aux émanations de certains lieux beaucoup trop à proximité, font un ensemble révoltant.
27 novembre.
Le vent est tombé dans la journée, et au moment de la haute mer, à cinq heures du soir, nous essayons d’entrer en rivière ; mais après ces forts vents du nord-ouest qui ont chassé l’eau au large, le passage de la barre est loin d’être chose facile, et nous restons en plein, dans la vase, avec huit pieds et demi d’eau, à côté du vapeur Coréa, qui est dans cette position peu amusante depuis cinq à six jours déjà.
Il fait un froid très vif et le navire est entouré de glaçons.
28 novembre.
Au point du jour, on essaye de déséchouer le navire, mais cela n’a d’autre effet que celui de l’enfoncer plus profondément dans la boue ; car le Yuen-tze-Fee cale dix pieds et demi, et à marée haute il n’y a encore aujourd’hui que huit pieds et demi sur la barre, tandis qu’il n’y a pas trois pieds à marée basse et que la mer découvre complètement tout près de nous. Heureusement le fond étant mou, le navire a pu faire son lit dans la vase, de manière à lui permettre de reposer également et sans danger, à moins que le vent ne s’élève de nouveau, ce qui rendrait alors sa position assez hasardeuse.
Comme, avec les faibles marées actuelles, le vapeur peut rester là quelque temps, je me décide à descendre à terre dans un mauvais bateau chinois venu de Takou, et en compagnie de quelques passagers chinois. Les bateliers profitent de la circonstance pour nous rançonner, et ils exigent une cinquantaine de piastres pour le voyage, ce qui est plus que la valeur de leur bateau.
Je quitte le vapeur à midi, et avec les nombreux glaçons qu’il s’agit d’éviter et le manque d’eau qui nous oblige à faire un long détour, je n’arrive au village de Takou qu’à la nuit, transi de froid et à peu près incapable de remuer bras et jambes, par suite de l’immobilité la plus complète dans laquelle j’ai dû demeurer pendant les six heures passées à bord du bateau chinois, trop chargé et encombré outre mesure, que la moindre oscillation eût fait chavirer.
Bien entendu qu’avec l’obscurité et le froid qu’il fait, je ne perds aucun temps à visiter les fameux forts de l’entrée du Peïho, occupés pendant longtemps, ceux de la rive gauche par les troupes françaises, et ceux de la rive droite par les forces anglaises. Ils ont été évacués au commencement de l’année et rendus en parfait état aux Chinois, qui les auront bientôt laissés tomber en ruines. C’est devant ces forts qu’a été éprouvé l’échec de 1859, qui avait fait croire un moment aux Chinois qu’ils étaient de force à nous résister ; ce dont ils ont été bien vite détrompés par l’attaque et la prise de ces mêmes forts au début de l’expédition contre la Chine en 1860.
Je me procure deux voitures et me mets en route pour Tientsin à la hâte, bien enveloppé de couvertures et de fourrures qui sont loin d’être un luxe par le temps qu’il fait.
Rien de plus incommode que les voitures servant au transport des voyageurs dans le nord de la Chine. Ce sont tout simplement des caisses en bois terminées en demi-cercle, en forme de carrioles, recouvertes extérieurement de toile bleue et reposant directement sur un fort essieu, quelquefois en fer, mais le plus souvent en bois ; elles ont les dimensions les plus exiguës et n’ont pas ombre de siège, de sorte qu’on ne peut ni s’y asseoir, ni s’y étendre, et qu’on en est réduit à s’accroupir à la turque ou en chien de fusil. Les coudes et autres parties saillantes du corps étant constamment en contact avec le bois, cela devient on ne peut plus douloureux à la longue, avec les secousses de tous les instants qui sont dues à l’affreux état des routes et chemins chinois jamais entretenus. Les deux roues sont munies de moyeux projetant d’un pied au moins, qui ont pour effet, non prévu je crois, d’empêcher la voiture de verser complètement, toutes les nombreuses fois qu’il lui arrive de chavirer.
L’attelage est à peu près aussi intelligent que la suspension : ces voitures sont tirées généralement par deux mulets dont l’un est dans le brancard, tandis que l’autre est attelé sur le côté droit, à deux traits d’une longueur démesurée attachés vers l’essieu. Ce dernier n’a pas de brides pour le diriger, de sorte qu’il va de droite à gauche, s’arrête, court, suivant les lubies qui lui passent par la tête, et à tous moments s’empêtre les jambes de derrière dans ses traits sans fin, ce qui cause des temps d’arrêt nombreux. En somme, ce mulet allant en tête ne tire que rarement, et presque toujours est un embarras pour le pauvre limonier.
En route je rencontre quelques Européens et un grand nombre de Chinois en voiture, et à dos d’âne, se rendant à Takou, afin de pouvoir s’embarquer pour le sud dans les derniers bateaux à vapeur ou à voiles pouvant encore partir avant que la rivière soit prise par les glaces. Je vois aussi une énorme quantité de colon et autres marchandises expédiées précipitamment au même point et dans le même but, de manière qu’il y a en ce moment un mouvement tout à fait inusité sur la route de Tientsin à Takou.
L’attelage des charrettes employées au transport des marchandises n’est pas plus pratique que celui des voitures dont je parle plus haut : cinq ou six bêtes, chevaux, mulets et bœufs, sont souvent attelées à la même charrette, malgré leurs allures particulières : le limonier au brancard et les autres par de longs traits attachés au-dessus de l’essieu, de sorte que, s’il s’agit de tourner surtout, c’est une confusion inextricable.
J’arrive à minuit à Sing-tze-Kou, et j’y couche dans une auberge chinoise.
26 novembre.
Je me remets en route à six heures. Même mouvement extraordinaire tout le long du chemin ; les ânes, très nombreux par ici, sont mis en réquisition par une foule de voyageurs chinois.
Le pays entre Takou et Tientsin n’est qu’une immense plaine, d’alluvion, inculte et aride du côté de Takou et le long de la mer, où elle est encore périodiquement inondée, mais assez bien cultivée à mesure qu’on approche de Tientsin. La route longe le Peïho sans cependant suivre les nombreux coudes que fait cette rivière. Les villages, disposés généralement sur des remblais de quelques pieds qui les garantissent des inondations, sont très nombreux le long de la route et de la rivière ; ils sont presque exclusivement composés de maisons en terre et sont entourés de petits jardinets très bien entretenus.
J’arrive à Tientsin à dix heures, et me rends immédiatement chez mon ami Sandri, qui ne m’attendait pas si tôt.
Tientsin, sur le Peïho, a été ouvert d’une manière effective au commerce européen au moment de l’expédition franco-anglaise en 1860. À l’origine, les étrangers s’étaient tous installés dans quelques habitations chinoises situées dans le faubourg longeant la rivière, mais maintenant on a établi une concession sur un endroit appelé Sze-tzu-Ling, à deux milles en aval de Tientsin et sur le bord du fleuve Peïho ; là sont déjà construits un assez grand nombre de maisons et de magasins, et la majorité des négociants étrangers y réside et vaque à ses opérations commerciales.
Le système des concessions en Chine étant généralement peu connu, quelques mots d’explication à leur sujet ne seront certainement pas ici hors de propos.
Jusqu’à la guerre de 1842, le peu d’Européens qui se trouvaient en Chine résidaient soit dans la colonie portugaise de Macao, soit dans le port de Canton, où ils étaient claquemurés dans ce qu’on appelait les factoreries, quartier peu étendu, composé de maisons construites à l’européenne, mais appartenant à des Chinois qui les louaient aux étrangers.
Le besoin d’extension étant de la dernière évidence, les Anglais se firent abandonner l’île de Hong-Kong par le traité de Nankin, qui fut le résultat de cette guerre, et, de plus, ils obtinrent l’ouverture au commerce européen des ports de Shanghaï, Tanchow, Amoy et Ningpo, où des espaces de terrain qu’on nomma concessions furent désignés d’un commun accord pour la résidence future des étrangers.
Je vais prendre Shanghaï, qui est le port le plus important, comme exemple de l’installation de ces concessions. Là, les Anglais eurent d’abord leur concession peu de temps après la traité de Nankin ; puis les Américains à leur tour conclurent leur traité et se firent attribuer une concession au nord de celle des Anglais ; vint ensuite la France, qui, en 1847, sentit le besoin d’avoir la sienne, qu’on établit entre la partie anglaise et les murs de la cité chinoise. En principe, les Anglais, Américains et Français pouvaient seuls acquérir des immeubles dans leurs concessions respectives ; mais plus tard il fut convenu que tous les étrangers pourraient indistinctement devenir propriétaires, sous la condition de se soumettre à l’organisation municipale de chaque quartier, organisation résultant de la convention faite entre la Chine, l’Angleterre, la France et les États-Unis, qui, sous le nom de land régulations, régit les conditions d’établissement des concessions, et a depuis été consentie par toutes les autres nations qui ont conclu des traités avec la Chine. Les intérêts étant identiques, l’Angleterre et les États-Unis renoncèrent à leurs droits particuliers sur leurs quartiers, qui furent alors réunis et formèrent une concession commune aux étrangers, sous la protection générale des puissances ayant des traités avec la Chine. La France ne jugea pas à propos de faire de même, et la concession française est plus spécialement sous sa protection immédiate et s’administre en vertu d’instructions émanant du ministère des affaires étrangères. Cette position particulière faite à la partie française a pour avantage de donner un certain relief à l’influence nationale ; mais, par contre, elle a le tort de laisser tous les intérêts de la concession livrés beaucoup trop à l’arbitraire des consuls, ce qui ne laisse pas que de présenter certains dangers, ainsi qu’on a pu s’en convaincre pendant les conflits regrettables qui ont eu lieu il y a quelque temps entre le consul général et l’administration municipale du moment.
Les achats de propriétés sur ces concessions se sont opérés de gré à gré entre les propriétaires originaires chinois et les acquéreurs étrangers ; ils se sont généralement faits sans difficulté, excepté dans quelques rares occasions, où on a dû recourir aux autorités chinoises et consulaires, qui alors ont fixé d’un commun accord un prix de vente maximum. Ces terrains ainsi achetés ne payent au gouvernement chinois que l’impôt foncier ordinaire, qui est très modéré. Les sujets chinois ne peuvent plus être propriétaires sur les concessions, mais ils peuvent y résider comme locataires, et ils y sont maintenant fixés en nombre considérable, grâce à la protection qu’ils trouvent dans le voisinage des Européens contre les exactions de leurs mandarins.
En l’état, les autorités chinoises n’ont rien à voir dans les concessions, qui sont administrées complètement par des conseils municipaux nommés par les résidents étrangers ; les taxes municipales sont fixées en assemblées générales des résidents, sur la proposition desdits conseils, qui, par ce moyen, pourvoient aux besoins de police, voierie, éclairage, et tous autres d’utilité publique ; bien entendu que les Chinois habitant les concessions sont soumis à ces taxes, pour ce qui les concerne, tout comme les résidents européens. Ces conseils municipaux rendent chaque année compte de leur gestion aux intéressés de qui ils relèvent, et on pourra se rendre compte de leur importance quand on saura que le budget de la concession française est annuellement de près d’un million de francs, et que celui du restant des concessions est de plus de deux millions.
Les étrangers sont soumis aux lois de leurs pays respectifs, et les Chinois sont naturellement sous la coupe de leurs autorités ; mais celles-ci ne peuvent exercer contre ceux de leurs nationaux habitant les concessions que de concert avec les consuls sous la protection desquels les concessions se trouvent placées, ce qui est une mesure très sage qui prévient les abus que les mandarins ne manqueraient pas de commettre, au détriment des intérêts européens, si ils étaient libres d’opérer à leur guise dans lesdits quartiers étrangers.
Voici grosso modo l’organisation des concessions à Shanghaï, qui a marché d’une manière si satisfaisante que quand le traité de Tientsin a ouvert, en 1860, de nouveaux ports aux étrangers, on n’a eu qu’à la suivre plus ou moins fidèlement pour la création des concessions de Hankow, Kiu-Kiang, Tientsin, etc., ainsi que pour les municipalités qui y ont été installées, avec cependant quelques modifications que l’expérience avait indiquées.
La concession de Tientsin est aussi divisée en trois parties : française, anglaise et américaine. La partie anglaise, qui est la mieux située, est à peu près complètement occupée, tandis que les autres ne le sont qu’en partie. Cette concession est bordée par un beau quai, devant lequel viennent mouiller les navires à vapeur et à voiles auxquels leur faible tirant d’eau permet de remonter la rivière.
Comme dans les autres nouveaux ports ouverts au commerce européen, les affaires sino-européennes sont déjà en grande partie passées entre les mains de Chinois émancipés, qui font leurs achats de marchandises à Shanghaï et ne se servent guère plus des négociants étrangers de Tientsin que comme agents pour l’expédition et l’entrée en douane de leurs marchandises.
C’est à Tientsin que le grand canal impérial aboutit, ce qui, dans le temps où ce grand canal était un bon état, n’a pas peu contribué à donner à cette ville une grande importance qu’elle a toujours conservée. Pendant la belle saison, quelques centaines de navires étrangers et des milliers de jonques fréquentent ce port et y apportent en abondance les produits européens, ceux du Japon et de toutes les parties de la Chine, lesquels sont ensuite répandus dans le Petchili, une partie du Honan, le Shensi, le Shansi, une partie de la Mongolie et de la Mandchourie, au moyen de brouettes, charrettes et d’une quantité innombrable de bateaux qui remontent le Peïho, le grand canal et deux autres canaux ou rivières canalisées importantes se reliant au Peïho à une courte distance en amont, et allant très avant dans l’intérieur. La ferme du sel pour tout le nord de la Chine, qui a son centre à Tientsin, apporte aussi son contingent au mouvement énorme de ce port ; les fermiers, assez nombreux du reste, qui ont seuls le droit de fabriquer et vendre, ont leurs approvisionnements tous réunis sur la rive gauche du Peïho, en face de la ville, sur une longueur de deux à trois kilomètres et une largeur de trois à quatre cents mètres. Ces approvisionnements, qui s’élèvent toujours à un nombre de tonneaux incalculable, sont formés de tas de sel de dix à quinze mètres de haut, recouverts de nattes, se touchant presque tous, et devant lesquels se renouvellent constamment une multitude de bateaux chargeant et déchargeant, les uns apportant le sel de Tatou et des environs, où sont disposées des salines très étendues, et les autres l’emportant sur les points les plus reculés de l’intérieur.
Tientsin se compose de la ville murée, de forme carrée, et de ses faubourgs très étendus qui longent les deux rives du Peïho et celles du grand canal, et sont reliés entre eux par deux ponts de bateaux et de nombreux bacs. L’intérieur de l’enceinte murée est très misérable et ne renferme que des mauvaises cases en terre, en dehors des yamens, des tribunaux et des demeures des mandarins.
La population de l’ensemble de l’agglomération de Tientsin est de cinq à six cent mille âmes, dont la majeure partie se trouve dans le faubourg qui longe les murs de la ville à l’est et au nord, et qui, en suivant le Peïho et le grand canal, a trois à quatre kilomètres de long sur une largeur très restreinte. C’est dans ce faubourg que sont concentrées toutes les affaires, et la principale rue, qui le traverse presque d’un bout à l’autre, est bordée à droite et à gauche de boutiques de tous genres : marchands de cotonnades, lainages, curiosités, toutes sortes d’articles européens et chinois, magasins de fourrures en grand nombre, pâtissiers, confiseurs, débits de comestibles, etc., etc., et, se faisant remarquer entre tous, marchands de vieux habits par centaines, étalant leurs marchandises fripées et l’offrant aux passants en entonnant une litanie de louanges et de mises à prix qui ne finit pas de toute la journée.
Certains quartiers de Tientsin se distinguent par une saleté repoussante ; les fossés de la ville, entre autres, sont le réceptacle d’ordures et de pourriture d’où se dégagent pendant toute l’année, et en été surtout, des odeurs pestilentielles capables d’empoisonner en vingt-quatre heures toute autre population que la population chinoise, qui paraît se complaire dans ce milieu révoltant ; la plaine qui longe les murs de l’ouest est spécialement affectée à la manufacture en grand de la poudrette, laquelle se pratique de la manière la plus simple et sans le moindre égard pour les organes olfactifs un peu délicats.
On voit à Tientsin un assemblage de mendiants des plus remarquables ; tous les degrés des maladies les plus repoussantes sont représentés parmi eux, et il est impossible de décrire les haillons qui couvrent ou plutôt qui laissent très souvent à nu, et par les plus grands froids, ces parias de l’espèce humaine.
Les Chinois étant très peu soigneux, les incendies sont très fréquents, surtout en hiver et dans le nord de la Chine, où le danger est augmenté par le chauffage des maisons. Pendant mon séjour ici, un incendie se déclare et, en moins d’une nuit, réduit en cendres un millier des plus riches maisons longeant la rue principale du grand faubourg, lesquelles, se touchant toutes par leurs devantures en bois, présentent au fléau une pâture facile et non interrompue que les moyens indigènes sont incapables de garantir. Il y a bien des pompes, des seaux, etc., qui sont amenés précipitamment sur le lieu du sinistre par des compagnies ad hoc ; mais chacun ne paraissant préoccupé que de faire le plus de bruit et de créer le plus de désordre possible, l’incendie a beau jeu avec de tels sapeurs-pompiers, qui ne semblent même pas se douter de ce que c’est que faire la part du feu, chose cependant si facile avec le genre et la légèreté des constructions chinoises ; aussi le feu ne s’arrête le plus souvent que faute d’aliments.
9 décembre.
Je me mets en route à sept heures du matin pour aller faire à Pékin ma tournée projetée. Je ne sors pas des moyens de locomotion ordinaires et prends deux voitures, l’une à mon usage particulier et l’autre pour mes bagages et mon fidèle Assé, qui est parfaitement à son affaire depuis qu’il se retrouve au milieu de ses compatriotes, et ne regrette nullement la Corée, où il ne s’était décidé à me suivre qu’à contre cœur, la perspective de coups de fusil ne pouvant que le séduire fort médiocrement.
La plaine du Peïho jusqu’à une certaine distance de Pékin, où elle est bornée par une chaîne de montagnes allant du nord-est au nord-ouest de cette ville, est uniforme et passablement monotone. Il y a de nombreux villages le long de la route, et quoique le sol ne soit pas très fertile, il est assez bien cultivé et produit du blé, du millet, du sorgho, du ricin, des haricots, un peu de coton et des légumes de toutes sortes autour des habitations.
On ne s’écarte guère du Peïho pendant une partie de la route, qui est aussi mauvaise qu’on peut la désirer.
Halte de midi à deux heures à Yan-Tsoun, grand village sur le bord du Peïho. Arrivé à huit heures à Ho-si-Wou, autre village très important qui est la couchée ordinaire, et qui contient une grande quantité d’auberges dont les murs sont ornés de nombreuses inscriptions et de listes de noms d’Anglais, qui éprouvent invariablement le besoin de laisser quelques traces de leur passage.
10 décembre.
En route à quatre heures du matin, et comme il fait très froid, je m’empaquette de mon mieux dans ma voiture, dont je ne sors qu’au relai de Tchang-Kia-Wan, où je fais halte de onze heures à une heure.
Tchang-Kia-Wan est une petite ville très misérable dont les murs sont en ruines, et qui, en 1860, a été le théâtre d’un combat entre les Chinois et le corps franco-anglais.
Peu de temps après être sorti de Tchang-Kia-Wan, on aperçoit les murs de Tanchow, ville de premier ordre, marquée d’une tache pénible dans l’histoire de la dernière expédition en Chine, par le guet-apens dans lequel sont tombés un certain nombre d’envoyés anglais et français ayant le caractère de parlementaires, dont quelques-uns seulement se sont échappés après de grandes souffrances, et le plus grand nombre est mort au milieu d’atroces tortures. On a retrouvé les corps de la majeure partie de ces derniers, mais on est encore dans la plus complète ignorance sur le sort de deux ou trois.
Tout près de Tanchow se trouve le fameux pont de Palikao, où la cavalerie tartare de San-ko-lin-sin a été complètement mise en déroute, et d’où le général Montauban, qui commandait les forces françaises, a tiré son titre de comte. Lorsque j’y suis passé, il y a trois ans, on voyait parfaitement les traces des boulets européens sur les parapets en marbre de ce pont.
Le sol devient très sablonneux à mesure qu’on avance, et par le temps sec qu’il fait on avale de la poussière en quantité.
Rien ne fait soupçonner la proximité de la capitale de l’empire du Milieu, si ce n’est un certain nombre de riches cimetières particuliers entourés de murailles à jour, complantés d’arbres et ornementés de chimères et de portiques ouvragés. La route conserve à peu près la même largeur, est tout aussi mal entretenue qu’ailleurs, et ne paraît pas être beaucoup plus fréquentée ; aussi est-on tout surpris quand on voit s’élever devant soi les remparts monumentaux de Pékin, qui n’a pas même de faubourgs, puisqu’on ne voit en dehors des portes que quelques masures occupées par des malheureux débitants et des employés fiscaux.
J’arrive à cinq heures à la légation de France, où j’étais attendu.





























