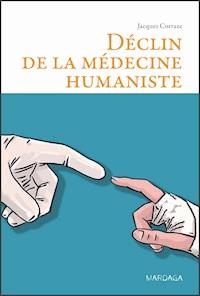
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Essai philosophique à l’attention des médecins et étudiants en médecine, défendant le modèle biopsychosocial de la médecine
Dans cet essai philosophique, l’auteur évoque le paradoxe de la médecine moderne en France : son haut niveau de rigueur dans les sciences biologiques couplé à son désintérêt pour les sciences humaines. Suite aux progrès considérables réalisés en sciences médicales, la fragmentation scientifique d’un état pathologique est de plus en plus poussée. Cela incite le médecin à se focaliser sur l’unique objectivation de la maladie : « C’est un cancer de la prostate », « C’est un astrocytome grade 3 »... Or il y a bien lieu de résister à cette focalisation car, in fine, c’est à un être humain que le médecin reste confronté : un patient qui souffre, a peur, se pose des questions, se trompe dans ce qu’il peut espérer et dont l’état psychologique va influer sur le devenir de sa maladie.
L’auteur défend le modèle biopsychosocial de la médecine : outre ses compétences scientifiques, un médecin se doit de connaître les réactions potentielles de son patient pour lui communiquer le diagnostic et le persuader des thérapeutiques à suivre.
Ce livre donne à réfléchir à une relation dans laquelle le malade est reconnu comme être humain souffrant et où le médecin joue son rôle d’acteur responsable et de soutien empathique.
Références à de nombreuses situations concrètes de consultation
EXTRAIT
Ce livre est une tentative de réponse complexe à une question simple :
quelles sont les conditions qui permettent à une médecine humaniste d’exister ?
Pour comprendre le cadre de référence, il faut accepter de saisir la médecine là où elle se pratique, et non au travers des images d’une heureuse et prudente rêverie. Je me place dans la réflexion clinique et dans l’expérience, toutes deux les plus réalistes possible. Et je m’adresse à tous ceux pour lesquels la rencontre du malade est une pratique quotidienne.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Jacques Corraze est agrégé de philosophie, docteur en lettres et sciences humaines, docteur en médecine et psychiatre. Il a enseigné à Paris V Sorbonne, à la faculté des lettres de Nice puis à l’université P. Sabatier de Toulouse. Il est aujourd’hui professeur honoraire des Universités.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Guérir quelquefois.
Aider souvent.
Consoler toujours. »
Edward Livingston Trudeau (1848-1915)
À mon père, à ma mère… in memoriam.
À Colette, et à mes enfants. À mes élèves, et à Jacques Bénesteau qui suivit avec attention la construction de cet ouvrage.
Préface
Ce livre est une tentative de réponse complexe à une question simple : quelles sont les conditions qui permettent à une médecine humaniste d’exister ?
Pour comprendre le cadre de référence, il faut accepter de saisir la médecine là où elle se pratique, et non au travers des images d’une heureuse et prudente rêverie. Je me place dans la réflexion clinique et dans l’expérience, toutes deux les plus réalistes possible. Et je m’adresse à tous ceux pour lesquels la rencontre du malade est une pratique quotidienne.
Une médecine humaniste, pour autant qu’elle existe, se doit de s’adresser à l’homme dans sa globalité, à son corps comme à sa vie affective et sociale, à sa détresse, à ses faiblesses. J’admets fort bien qu’il peut s’agir d’un idéal, mais si je l’ai vu bafouer, je l’ai également vu pratiquer avec toute la noblesse que mérite notre art. Évidemment, la médecine est une affaire humaine !
Dans son livre, La philosophie de la chirurgie (1951), René Leriche consacre un chapitre à l’humanisme en chirurgie. Il rappelle à cette occasion sa leçon d’ouverture au Collège de France en 1937. Il y affirmait que les progrès de la médecine « lui font courir un danger auquel elle ne va peut-être plus pouvoir résister : celui d’oublier, à côté de ses humeurs [il s’agit de la vieille théorie hippocratique], l’homme qui est son objet, l’homme total, être de chair et de sentiment. Et d’instinct, elle se demande s’il ne faudrait que soit remise à sa place l’éminente primauté de l’observation de l’homme par l’homme, afin qu’on ne voie pas s’effondrer le vieux sens hippocratique devant la dictature des appareils. »
L’évolution considérable des sciences et des techniques depuis le XXe siècle a fait subir nombre de mutations à la médecine. En accédant à la précision et à l’efficacité, l’art médical a eu sur la pathologie et sa thérapeutique une prise étonnante. Il s’agit d’un remarquable et louable progrès, si l’on compare cet état à celui de siècles où la médecine pouvait tuer plus de gens qu’elle n’en guérissait. Mais cette évolution a également nourri la consubstantielle arrogance d’individus plus avides d’un titre que d’une fonction.
Progressivement les conditions du milieu social ont changé, comme celles de l’exercice de la médecine, pour déboucher sur un modèle relationnel qui s’impose de plus en plus. À partir du survol de la machine humaine, où peine à s’inscrire le vivant en détresse, on attend les réponses scientifiquement fondées aux questions posées à la technique biologique et physico-chimique. Or, médecins et malades appartiennent à la même culture, partagent la même attente : bénéficier des progrès de la science.
Dans ce contexte, l’homme n’est plus considéré que comme une mécanique vivante détraquée, et les médecins, de par leur formation, estiment que c’est la finalité même de leur art de réparer cette mécanique et qu’il n’y a pas lieu d’aller plus loin.
La signification de la médecine, son apprentissage, sa pratique ne peuvent néanmoins être appréhendés en dehors du système culturel et des valeurs qui les conditionnent. Et, à cet égard, tout est loin d’être rose dans l’univers quotidien de l’exercice médical.
En effet, alors que l’acte médical n’était qu’exceptionnellement parasité par l’incompréhension, les conflits, l’inversion des rôles, on voit, en raison des mutations multiples de notre société, progresser un modèle délétère dans lequel la médecine humaniste abandonne la place.
Un tableau des plus sinistre tend à s’imposer : on obtient chez le médecin des biens de santé comme on achète dans les supermarchés des objets de consommation ; on sait ce que l’on veut et, si l’on n’est pas satisfait, on sait le montrer ; on se permet d’oublier son carnet de chèques pour payer une consultation ou de ne pas prévenir si l’on décide de ne pas se rendre au rendez-vous (selon la Confédération des Syndicats Médicaux Français, en 2013, 28 millions de rendez-vous par an ne seraient pas honorés) ; si l’on arrive en retard comme d’ailleurs quand on arrive en avance, on exige d’être reçu immédiatement. Dans tous les cas, on négocie. On négocie le diagnostic, la thérapeutique, sa forme non substituable, la durée du congé de maladie, les transports, les effets du traitement alors même qu’on n’a pas observé les règles de la prescription. On achète des médicaments au-delà des prescriptions du médecin, même s’ils doivent finir dans le fond d’une armoire, à l’instar d’aliments oubliés dans quelques coins obscurs du réfrigérateur. Lors de l’hospitalisation, on retrouve le même type de comportements et l’on voit ce qu’on appelait jadis « le mauvais malade » se répandre de manière spectaculaire. Ce qui, selon la loi d’action/réaction, engendrera inévitablement de « mauvais médecins » et un désastre des vocations.
La prise en charge des frais de santé par « un pouvoir immense et tutélaire », fonctionnant par ponction obligatoire ou redistribution, a par ailleurs généré dans l’esprit du malade l’image d’un club de vacances dispensant ses bienfaits selon le mode du « tout compris ». Le personnage du médecin assume le rôle d’un agent de services rétribué indirectement par une entreprise mythique aux ressources inépuisables et aux ordres du consommateur. Une société d’« assurés tous risques » s’est substituée à une organisation d’individus solidaires où chacun a le souci du bon fonctionnement de l’ensemble. Toute référence au coût du traitement ternirait la noblesse du droit à la santé ; toute tentative de soustraction du praticien aux impératifs singuliers du malade ou de sa famille est dès lors susceptible de déclencher des mouvements de colère.
Sommes-nous entrés dans une nouvelle culture où la médecine doit suivre et se résigner sous peine d’être ridicule ? La souffrance du malade a-t-elle, elle aussi, changé de culture ? Peut-on la réduire à un échange commercial ?
C’est sans compter sur un mouvement basé sur l’exigence d’une médecine humaniste qui a pris naissance aux États-Unis, au milieu du dix-neuvième siècle, et qui y reprend vigueur depuis plusieurs années. Sous des termes différents, cette exigence aspire à un seul but : donner à l’acte médical aussi un sens humain. Elle est devenue matière d’apprentissage et s’insère dans de nombreux programmes de formation.
Reste à savoir si cette dimension est le fruit d’un référentiel culturel spécifique aux États-Unis ou si on pourrait assister à son développement en Europe, en France, où le cadre d’exercice de la médecine est fort différent. Reste à savoir comment permettre une relation authentique entre le médecin et son patient, dans le cadre d’une consultation dont la durée est déterminée par des impératifs socio-économiques.
C’est toute la question que pose cet ouvrage.
PARTIE I
Le malade, la médecine, le médecin, et leurs confrontations historiques
Chapitre 1
De l’expérience de la maladie à son explication
L’EXPÉRIENCE DE LA MALADIE
L’expérience de la maladie est l’illustration pathétique d’un dualisme qui est le cœur de la condition humaine. L’individu se présente comme un être malade, comme actualisation d’un sujet conscient au travers de sa souffrance, mais qui ne trouvera son salut que dans la reconnaissance objective de sa maladie. Or, de cette démarche vers la connaissance, le sujet sera exclu.
Des origines de la pensée occidentale à nos jours, de Socrate à Heidegger, l’homme n’est pas réductible à une unité originelle, il est réductible à deux dimensions qui peuvent s’accorder ou s’opposer. Par notre condition d’être vivant, nous sommes en tant qu’individus avec notre subjectivité au centre de référence d’un monde où nos actions prennent place et nous assurent notre survie. C’est la dimension psychologique, c’est notre milieu de comportement, celui des événements, c’est notre vie quotidienne où existent nos émotions. Par contre, la pensée, la réflexion cognitive nous ouvre un monde de concepts universels qui réduit la réalité à un système objectif dont la fin est une vérité s’appliquant à la totalité du réel y compris à nous-mêmes. Au sein de cette démarche objectivante, l’homme n’est alors qu’un être de nature soumis à ses lois d’où toute référence personnelle, toute subjectivité sont exclues. Bref nous vivons – c’est-à-dire percevons, ressentons, agissons – dans un monde, alors que nous pensons dans un autre. Cette opposition est fort présente dans la philosophie de Malebranche, « le père de la psychologie scientifique », selon Pierre Janet. Malebranche faisait une différence entre « connaître et sentir ». « Connaître la douleur, ce n’est donc pas la sentir. » Ce que nous sentons renvoie au sujet et nous fait percevoir « que je suis » et non « ce que je suis ».
Il n’est plus possible d’échapper au dualisme de notre condition, quand on est face à la maladie et à l’épreuve affective vécue par le malade qui s’impose à tout observateur. Comme l’affirme Heidegger, « l’angoisse comme la mort individualisent ». Le malade, qui est de l’ordre de la subjectivité que lui imposent sa souffrance et sa détresse, va se voir opposer la maladie, comme la réalité objective. La science médicale va s’adresser à un malade qu’elle ignore par essence, au nom de son efficacité même, avec un langage qu’il ne comprend pas. La restitution de la santé, l’élimination de la souffrance passent par la voie longue de la science et non par la voie courte de la compassion et du miracle. L’aspiration de la médecine humaniste est de tenir simultanément un double langage et de réconcilier les deux dimensions.
Mais reste la question de savoir si nous excluons l’individu de la science et si nous usons à son encontre de l’opinion ou des ressources mystérieuses de notre propre inspiration. Si, selon la célèbre formule d’Aristote, « il n’y a de science que de l’universel », les choses ne peuvent se passer autrement. Or, il s’avère, malheureusement pour les propagateurs de ce modèle, qu’il existe une science des singularités. Paradoxe étonnant ! Autant la médecine est soumise à l’autorité scientifique de la biologie, autant elle abandonne au sens commun la relation psychologique du médecin et du malade. Tout se passe comme si elle attendait de l’étudiant devenu professionnel qu’il découvre la réalité de son exercice sur un terrain exclu de l’université ou comme si le cadre de son activité échappait à la connaissance, à l’analyse, bref qu’il soit par nature dépourvu d’existence objective.
La science de l’individu ne met pas une note finale à notre problème. La psychologie différentielle comme la neurobiologie, en multipliant les situations et les traits, arrivent à différencier un individu d’un autre. Néanmoins la dichotomie aristotélicienne ne se ternira pas et l’expérience nous l’imposera. Car, s’il y a une science des individus qui objective leur identité, la réaction de l’individu va se manifester au-delà de ce qu’il considérera comme une vision réductionniste, et elle persistera. Nul ne consent aisément à se réduire à un objet d’observation. En définitive, c’est par la communication spécifique que l’individu sera reconnu par un autre, et dont il sera l’adresse subjective. Si la clinique aspire à être humaniste, elle se doit d’apprendre à atteindre, derrière le malade, son existence.
L’EXPLICATION DE LA MALADIE
C’est sous cet angle que je vais envisager l’histoire de la médecine. Selon cette perspective, l’histoire de la médecine est celle des rapports entre la singularité du malade et l’universalité de la maladie, entre les exigences de l’individu et celles de la médecine scientifique.
La maladie comme surnaturelle
Si l’on cherche l’essence de la maladie au travers de l’histoire, on constate très vite qu’elle est comprise d’abord comme étrangère à l’ordre naturel, même si la conception de la nature s’est modifiée au cours du temps. Selon cette mentalité, l’homme malade est victime d’une force maléfique, malfaisante. « Pour Homère, la maladie est en dehors de la nature : totalement étrangère à l’homme et ne dépendant que des caprices des dieux, elle échappe à l’ordre naturel » (Mirko Grmek). Pour la pensée primitive, comme pour la pensée commune, la maladie est un désordre, foncièrement étranger à la vie, et dont la source est surnaturelle.
La maladie comme conséquence d’une transgression
Si la nature est conçue à l’image d’une société régie par les lois de puissances supérieures, le désordre que représente la maladie sera la conséquence d’une transgression de l’ordre moral. Nous retrouvons cette croyance jusqu’au dix-neuvième siècle chez des médecins, et de nos jours encore il arrive que l’exorcisme soit pratiqué sur des maladies, mentales il est vrai.
Dans une représentation d’un monde étroitement soumis à l’action permanente et omniprésente d’un Dieu unique, la maladie est la sanction consécutive au refus d’obéissance. Dans la Bible, le Deutéronome fait le tableau complet des malheurs qui frappent ceux qui ne se sont pas soumis à l’ordre divin. Les maladies apparaissent en bonne place comme bien méritées par les fautes du porteur, elles rétablissent l’ordre divin qui a été violé (Deutéronome, 28 : 22, 27). « Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées à l’Égypte ; car je suis l’Éternel qui te guérit » (Exode, 15 : 26). Bref, affirmait Salomon Reinach, « pour les auteurs bibliques, comme pour les sauvages actuels [sic], la maladie est surnaturelle ; c’est un effet de la colère des esprits ». En réalité, une telle croyance a traversé les siècles et au début du dix-septième siècle, pour Van Helmont, un médecin reconnu pour tel en 1599, les maladies sont la conséquence du péché originel : « La maladie… toujours contre nature est un certain mal par rapport à la vie ; quoiqu’elle vienne du péché. » On pourrait même poursuivre : « Van Helmont a toute une classe de maladies envoyées par Satan et ses suppôts, les sorciers et les sorcières » (Daremberg, 1870). Trois siècles plus tard, « en plein XIXe siècle, un médecin adepte de la philosophie de Schelling, le professeur bavarois Johann von Ringseis, soutint que les maladies proviennent du péché originel, de l’influence du serpent-diable sur Ève enceinte. Les maladies sont… des petits démons au service de Satan » (Grmek).
La maladie intégrée à l’ordre de la Providence
Dans le célèbre tableau de Raphaël, L’École d’Athènes, Platon tient sous son bras gauche un exemplaire de son livre Le Timée tout en montrant le ciel de son index droit. Cet ouvrage a ouvert la voie à une constante de la pensée occidentale en accordant à l’univers physique et biologique une valeur morale. Selon Brochard (1926), Le Timée est resté un des ouvrages qui ont exercé le plus d’influence sur les destinées de l’esprit humain. Sa dernière partie est d’ailleurs consacrée à la médecine.
D’après Le Timée, le monde, créé par Dieu, est ordonné selon une finalité bienfaisante où l’action de la divinité est qualifiée de providence (pronoia). « Ce monde est la plus belle chose des réalités muables, son auteur, la plus bienfaisante des causes. » Du meilleur des êtres ne pouvait être engendré que le meilleur des mondes : « Il n’était loisible, ni il ne l’est à l’être le meilleur, de faire autre chose que l’ouvrage le plus beau. » Voici Dieu contraint à construire un monde de biens. Redoutable nécessité de la bienfaisance de Dieu pour tous ceux qui voudront, dans la suite de l’histoire, préserver sa liberté absolue !
Face à la maladie, aux maux incontestables des vivants en général et plus singulièrement des humains, les réponses viseront toutes à dédouaner Dieu, à justifier le mal comme conforme à la bonté divine, bref à l’exclure de l’ordre de la nature, à anéantir le concept de désordre. Cela ne veut absolument pas dire que la maladie et la santé coexistent à la santé au nom des mêmes lois physiques, mais que la maladie fait partie des biens de ce monde et qu’il faut en louer la divinité. Pascal, selon sa sœur Gilberte Périer, dans les souffrances d’une pathologie grave rendait grâce à Dieu : « La maladie est l’état naturel des chrétiens. »
Cette attitude permet de mettre en cause toute activité visant à éliminer la maladie, puisqu’elle s’oppose aux desseins divins : « Pour les moralistes du Moyen Âge, par exemple, la santé du corps entrave, plus qu’elle ne favorise, le salut de l’âme, but suprême de la vie humaine » (Grmek). L’attitude qui consiste à faire l’éloge de la vertu de la maladie est antérieure à l’influence chrétienne. Pline le Jeune, dans une lettre à Maximus (L. VII, XXVI), affirme : « Nous sommes meilleurs quand nous sommes malades. Existe-t-il un seul malade porté à l’avarice ou à la débauche ? Le malade est indifférent à l’amour, ne convoite pas les honneurs, il néglige la richesse… il croit alors aux dieux… en bonne santé nous devons être ce que nous nous promettons d’être quand nous sommes malades. »
Cette perspective a pu réapparaître dans une conception laïque du christianisme tenue par Ivan Illich condamnant la médecine comme « contre-productive » parce que privant l’homme de l’usage libre de son corps, de l’art de sa souffrance, et l’enfermant dans la Némésis de la maladie. Cette conception, comme toutes celles prônant le retour à une nature authentique, a le défaut majeur de rejeter non seulement l’historicité de l’homme et la force irréversible de l’évolution, mais encore de présenter comme une réalité vivante, celle d’une nature primitive, une pure construction de l’esprit.
Cette transposition merveilleuse d’un mal physique, d’ordre psychologique, en bien conceptuel, d’ordre métaphysique, je la qualifie de transmutation du mal.
La maladie comme participant à l’ordre physique
Si les philosophes ioniens de la nature n’avaient pas affirmé qu’il existait une explication naturelle de tous les phénomènes, qu’en remontant la chaîne des effets et des causes on atteignait un ordre universel et nécessaire, et que l’on pouvait, grâce à une observation dépourvue de préjugés et au pouvoir de la raison, pénétrer les secrets du monde, la médecine ne serait jamais devenue une science (Werner Jaeger).
C’est Hésiode qui intégra les maladies aux lois naturelles (Grmek), ouvrant la voie à la médecine grecque des médecins hippocratiques. Pour l’anatomiste et médecin que fut Alcméon de Crotone, pythagoricien et philosophe présocratique du cinquième siècle avant Jésus-Christ, les maladies sont des phénomènes naturels et donc « ne proviennent pas d’une action directe des dieux et ne sont pas elles-mêmes des démons capricieux aux comportements imprévisibles » (Grmek). Cette nouvelle étape de l’explication des maladies sera le cadre de référence de la médecine hippocratique : « c’est de la Grèce, et de nulle part ailleurs, que nous vient directement, et presque sans aucun alliage étranger, notre médecine actuelle » (Daremberg). Werner Jaeger a insisté sur le prestige dont bénéficia la médecine dans la culture grecque : « Il n’est pas exagéré d’affirmer que la doctrine de la connaissance éthique de Socrate, sur laquelle tournent tant d’arguments des dialogues de Platon, serait impensable sans le modèle de la science médicale à laquelle elle se réfère si souvent. »
Chapitre 2
La construction de la médecine occidentale comme une double technique
Nous voici en présence des fondements mêmes de notre médecine occidentale, tels qu’ils furent conçus par l’Antiquité grecque.
LA MÉDECINE FACE AUX MÉCANISMES D’ACTION
Si nous n’avons qu’une seule voie pour comprendre, celle de l’intelligence dite théorique ou conceptuelle, nous avons deux moyens d’action ou de modification du milieu : la technique pour le monde matériel, la communication pour influencer les êtres vivants. Dans le premier cas, nous avons affaire à l’intelligence pratique, celle de l’homo faber, dans le second, à l’intelligence sociale, celle de l’homo socialis. Platon, dans Le Politique, différencie parfaitement les trois domaines d’exercice. Par ailleurs, la pensée grecque a privilégié deux exercices de l’intelligence sociale : la ruse ou metis, et la rhétorique ou art de l’influence par la parole.
Entre ces deux moyens d’action on assiste, au cours de l’histoire des idées, à des mouvements de bascule. La maîtrise du milieu est un impératif vital. Chez l’homme, la parole a pris une telle importance que son pouvoir augmente d’autant plus que les moyens d’action sur le milieu physique sont déficients. (En faisant subir à la sémantique un glissement pernicieux, le journalisme de nos jours a conféré au pouvoir vicariant de la parole le nom de « communication ».) Faute d’agir sur le milieu, on va s’efforcer d’agir sur les hommes. De par son attitude de technicien, Descartes rompt avec la scolastique. L’impuissance du médecin au XVIIe siècle fait de la médecine une rhétorique qu’on peut illustrer par les confrontations permanentes entre praticiens dans lesquelles s’évanouissent malades et maladies, mais où triomphent psittacisme et verbiage.
Si l’on remonte à une conception archaïque, l’homme est allé de la main à l’outil, et de l’outil à Dieu. Anaxagore affirme que « l’homme est le plus raisonnable des animaux parce qu’il a des mains ». Beaucoup de constructions mythologiques renvoient à l’homo faber. L’homme a le pouvoir de modifier, conformément à ses fins, certains éléments présents autour de lui. Ce qu’il ne pouvait modifier en raison de son pouvoir limité, il l’a imputé à une puissance analogue mais dotée de capacités beaucoup plus vastes. L’univers a été considéré comme le résultat de l’activité d’un ouvrier supérieur, le Grand Architecte. Comme l’homme parvenait dans le domaine qui est le sien à maîtriser son milieu, il n’a pas borné le pouvoir de la puissance supérieure de contraintes extérieures à elle. Le monde devait son existence à la Grande Puissance qui pouvait construire ou déconstruire selon ses désirs : arrêter la course du soleil, ouvrir la mer pour laisser passer une armée, frapper une nation de fléaux, un individu, d’une maladie. Une volonté créatrice absolue, illimitée, susceptible de modifier ses buts faisait obstacle à l’existence de toutes lois, de toute nécessité. Nous sommes en présence de « l’activité de Dieu au cours de la création et dans la marche subséquente du monde » (Jean Bottéro, 1959).
À côté de cette conception technicienne prend place le pouvoir de la parole, la voie de la rhétorique qui au niveau humain n’a de pouvoir que sur les hommes, mais qui, chez la puissance divine, acquiert le pouvoir d’agir sur les choses et de les ordonner. La parole est dotée d’un pouvoir créateur autant sur l’animé que sur l’inanimé. À la Puissance Supérieure ayant le pouvoir du chef, il suffit de donner un ordre pour que la fin soit réalisée. Les moyens techniques de Dieu résidaient donc dans le mot qui était suivi de l’existence de la réalité souhaitée. Dieu « profère un ordre », et la matière lui obéit : Abracadabra ! (« Je créerai selon mes paroles », en araméen).
TECHNIQUE ET RHÉTORIQUE : LA GRÈCE ET LA TECHNIQUE COMME DIMENSION ESSENTIELLE DE L’HOMME
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, la pensée grecque est parfaitement consciente du pouvoir des techniques, d’une part celles qui transforment le milieu physique et d’autre part celles qui agissent sur les hommes par la parole (logos) entendue comme instrument de persuasion. Affirmer que pour un Grec du Ve siècle ce qui importe, ce n’est pas agir sur la nature mais sur les hommes (Jean-Pierre Vernant), c’est non seulement placer la rhétorique au sommet des valeurs, mais c’est aussi sous-estimer les hommages rendus à la technique par tant d’autorités de ce temps.
Il est vrai que la rhétorique, l’art de la persuasion, contraint les âmes comme la technique contraint la matière. C’est exactement ce qu’affirment les rhéteurs, mais ils tiennent l’art de la parole comme supérieur à la puissance des autres techniques. Le fameux rhéteur sophiste Gorgias affirmait que la parole peut contraindre l’âme sans lui laisser le moyen de s’y soustraire. Platon fait dire à Gorgias qu’un rhéteur est supérieur à un médecin par sa capacité à persuader un malade récalcitrant d’absorber un remède, alors que le médecin avec toute sa science échoue.
Platon a parfaitement mis la rhétorique à sa place : elle n’est qu’un moyen qui doit se mettre au service d’une fin qui lui donne son caractère moral ou non. Elle peut se mettre au service du mal et donner dans la manipulation perverse, ou au service du bien et devenir un instrument de l’altruisme.
Le triomphe de la pensée technique
Il convient de remarquer que la Grèce classique a célébré les triomphes de la technique : « Au Ve siècle les réalisations pratiques de la race humaine étaient aussi admirées que ses compréhensions de l’univers. Les étapes du progrès matériel de l’homme furent célébrées… par les trois grands tragédiens, tout comme par des philosophes tels qu’Anaxagore et Démocrite ainsi que par le sophiste Protagoras » (W.C.K. Guthrie). La philosophie de Platon comme celle d’Aristote sont riches de réflexions sur les techniques. Le morceau le plus célèbre reste l’apologie de l’homo faber dans Antigone de Sophocle : « être aux mille ressources… sachant l’art d’échapper aux maux inguérissables… sage dans ses moyens, inventif au-delà de toute espérance…, génie universel que rien ne prend au dépourvu…, riche d’une intelligence incroyablement féconde ».
Dans le dialogue de Platon, Protagoras, Protagoras propose un mythe et ordonne l’intelligence pratique et l’intelligence sociale. D’abord Epiméthée accorde aux animaux tout ce qu’il leur convient pour être parfaitement adaptés aux milieux, chaque espèce ayant sa part d’organes fonctionnels. Quand arrive le tour de l’homme, il ne reste plus rien à distribuer. L’homme se trouve nu et incapable de survivre. C’est alors que Prométhée lui fait don de l’ensemble des techniques qu’il dérobe à Athéna (la sagesse) et à Héphaestos (l’artisan des arts du feu). « L’homme fut ainsi mis en possession des arts utiles à la vie », la possession de la technique et la condition préalable à la survie de l’espèce humaine. Il manquait l’art politique que Zeus accorda à tous les hommes et non aux seuls spécialistes, sous la forme de la conscience morale et du sens de la justice, conditions nécessaires pour que les hommes collaborent entre eux et constituent des cités.
La partie essentielle de la philosophie d’Aristote affirme la synonymie de l’art et de la nature. Il affirme que l’art imite la nature parce qu’en vérité il conçoit la nature comme une œuvre d’art. La finalité d’un dessein est au cœur de la nature, une œuvre d’art où le principe actif, l’artisan, n’est pas extérieur mais intérieur ; la croissance d’un arbre est tout comme un lit qui se construirait tout seul.
Il en résulte une finalité au cœur d’une nature qui fait les choses au mieux : « La nature ne fait rien en vain. » Quand Aristote corrigera Anaxagore en proposant de passer de l’esprit à la main et non de la main à l’esprit, il s’autorisera de la conviction que l’homme est le plus habile (sophotatos) de tous les animaux. Pour ce faire, il usera du mot sophos qui s’entend de l’habileté dans les arts mécaniques.
LES DEUX DIMENSIONS DE LA TECHNIQUE MÉDICALE : LE MOMENT HISTORIQUE D’HIPPOCRATE
Le rôle du médecin
Hippocrate en inaugurant la médecine occidentale, comme la chirurgie, en fait un art à double sens. Il va concilier la technique artisanale et celle du rhéteur.
D’abord, la médecine est une technique qui a pour objet la conservation et la restauration de la santé physique. À ce titre, elle implique une connaissance théorique et une habileté pratique qui porte sur le corps. Mais elle est également un certain mode relationnel entre des personnes. Selon sa formule : « Le médecin doit être pour l’âme et pour le corps. » Ou encore : « Là où est l’amour des hommes est aussi l’amour de l’art. » Le rôle du médecin tient en deux mots : « Le médecin sera grave (semnos) et humain (philanthropos). » Cette gravité se retrouve dans « le sang-froid qui ne se trouble pas… dans la possession de soi-même dans les perturbations qui surviennent ». En grec le premier sens de Therapeia, c’est le service des dieux. C’est entendre que le médecin est au service du malade.
Cette relation est également une relation d’influence. Il importe en effet, pour exercer son art, d’obtenir la collaboration de l’individu, car « le médecin se règle sur la licence que lui donne le malade ». Donc, « il faut avoir des gracieusetés pour les malades, flatter leurs sens et tolérer leurs fantaisies quand elles ne font courir aucun danger ». Cette technique d’influence nécessaire à la pratique de la médecine va s’actualiser dans les communications non verbales et verbales.
En effet, comme l’écrit Hippocrate dans son ouvrage Le Médecin : « Ce ne sont pas de petits rapports que ceux du médecin avec les malades. » Hippocrate a insisté sur la présentation du médecin, sur le rôle qui va lui donner sa crédibilité : un physique qui respire la santé, la propreté, dégageant un parfum discret, une mise correcte. Il doit avoir « l’air grave et humain… la physionomie réfléchie, sans austérité, autrement il paraîtrait arrogant et dur… les mœurs exemplaires ». Bref, précise Hippocrate : « je n’interdis pas le soin de plaire ; ce soin vaut la peine d’être recommandé au médecin… Il faut que le médecin ait à son service une certaine urbanité, car la rudesse repousse et les gens en santé et les gens malades. » Voici le médecin qui s’approche du malade : « En entrant, rappelez-vous la manière de s’asseoir, la réserve, l’habillement, la gravité, la brièveté du langage, le sang-froid qui ne se trouble pas, la diligence près du malade, le soin, la réponse aux objections, la possession de soi-même dans les perturbations qui surviennent, la sévérité à réprimer ce qui trouble, la bonne volonté pour ce qui est à faire… ne laissez rien manquer pour le service du malade. » Voici le médecin exerçant son art : « On fera toute chose avec calme, avec adresse, cachant au malade, pendant qu’on agit, la plupart des choses, lui donnant avec gaieté et sérénité les encouragements qui conviennent… tantôt le réprimandant avec vigueur et sévérité, tantôt le consolant avec attention et bonne volonté ; ne lui laissant rien apercevoir de ce qui arrivera et de ce qui le menace, car plus d’un malade a été mis à toute extrémité par cette cause, c’est-à-dire par un pronostic où on lui annonçait ce qui devait arriver ou ce qui menaçait. »
Nous avons bien là le Trépied d’Aristote qui règle les mécanismes d’influence. Il faut être crédible (ethos), convainquant (logos) et émouvant (pathos).
C’est ce qu’Hippocrate attribue comme singularités au médecin : « gracieux par disposition, fortifié par la bonne réputation qui en résulte ; tournant, dans ce qui est démontré, le regard vers la vérité ».
Platon a confirmé le rôle qu’Hippocrate avait conféré aux médecins. Il fait du médecin un technicien au même degré que les autres, mais grâce à trois singularités son art accède à un degré supérieur. Par son exercice, le médecin a d’abord pour fin le bien du malade, ensuite il ne se contente pas d’ordonner, mais il doit user de mécanismes d’influence, enfin il ne peut se contenter de travailler en aveugle à l’image d’un artisan esclave, d’un empirique dépossédé de la connaissance. Le médecin se situe au même niveau qu’un architecte ou qu’un ingénieur. « Le véritable iatros se distingue du praticien vulgaire par sa connaissance de la nature et des causes générales des maladies » (J.-P. Vernant).
Cet authentique médecin (iatros), homme libre traitant des hommes libres et opposé à l’empirique, esclave traitant des esclaves, est magistralement décrit par Platon dans un passage des Lois (780 c, d), où il faut entendre par « libres » des comportements qu’il faut louer et par « esclaves » des comportements qui sont à bannir. Parmi les médecins esclaves « aucun ne donne à l’esclave qu’il traite la moindre explication sur sa maladie… il ne consent pas davantage à en recevoir de lui. Une fois faite l’ordonnance que lui dicte sa routine, à l’égal d’un homme qui entend parfaitement son métier et avec l’arrogance d’un tyran, il court d’un saut vers un autre esclave malade. » Le médecin libre se comporte d’une tout autre façon : « il dialogue autant avec le patient lui-même qu’avec ses proches dont il tire des informations autant que du premier. En même temps, dans la mesure du possible, il informe à son tour la personne malade. Plus encore, il ne prescrit rien sans avoir auparavant acquis la confiance de son patient. » D’un côté, ignorance, refus de dialogue, autoritarisme ; de l’autre, savoir, écoute, échange d’informations, et noble influence.
La connaissance médicale hippocratique et son destin
Hippocrate et son école établirent les bases méthodologiques de la médecine scientifique. On peut les résumer à l’aide de trois notions. D’abord, les maladies sont des réalités naturelles soumises aux lois de la physique. Ensuite, la médecine est une technique dont le but est le rétablissement de la santé et qui y parvient en aspirant à deux finalités avec des moyens adaptés à chacune d’entre elles. Enfin, la médecine est une science, c’est-à-dire un système conceptuel qui se construit à partir d’observations. Littré faisait remarquer que la médecine hippocratique satisfaisait au programme défini par Platon dans le Gorgias : « La médecine recherche la nature du sujet qu’elle traite, la cause de ce qu’elle fait, et sait rendre compte de chacune de ces choses. » Le médecin aboutit à une connaissance générale de la maladie, c’est la prognose. « La prognose est la première construction scientifique que nous connaissons de la médecine… elle n’est point fondée sur des vues rationnelles et hypothétiques… elle part d’observations et d’expériences réelles… le sens scientifique des Grecs se manifeste, là comme ailleurs, avec une grande sûreté et une grande supériorité » (Littré).
Si la démarche méthodologique d’Hippocrate appartient à l’essence de la médecine, il reste que les concepts explicatifs portent la marque de son temps et c’est leur pérennité au cours des siècles qui est étonnante. Nous sommes en présence d’un phénomène qui va marquer toute l’histoire de la médecine occidentale. À partir de la connaissance dont il disposait et qui, pour nous naturellement, est aberrante autant que naïve, Hippocrate va formuler une pathogénie des maladies, comme une thérapeutique générale qui en est la conséquence logique, et qui seront la référence centrale de notre médecine pendant plus de deux mille ans. Chez les êtres vivants, les quatre éléments constitutifs du monde, air, eau, feu, terre – avec leurs qualités physiques, chaud et humide, froid et humide, chaud et sec, froid et sec –, se transforment en liquides correspondants ou humeurs, le sang, la pituite ou lymphe, la bile jaune, et la bile noire. On passe donc de la physique des corps bruts à celle des corps vivants. L’organisme est un ensemble de cavités qui communiquent et où circulent les humeurs. Quand les rapports de ces humeurs sont harmonieux (la crase ou eukrasie





























