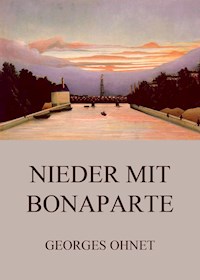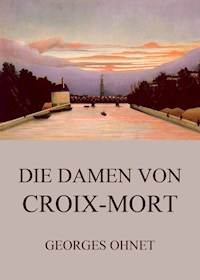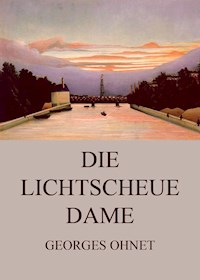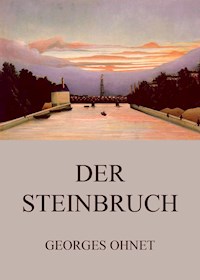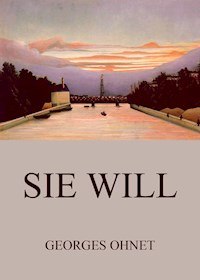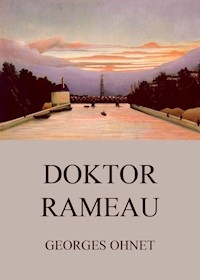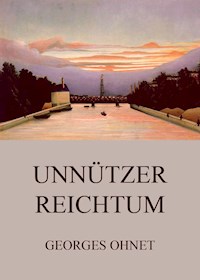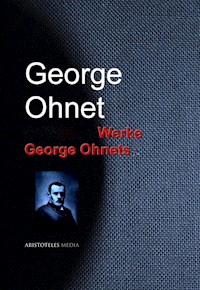3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le lieutenant Ploêrné, apprenant que la Marquis de Girani se vante d'avoir séduit une jeune femme que Ploêrné connaît, le tue en duel. Ploêrné pense que la jeune femme en question est Thérèse, son amie d'enfance, qui l'aime en secret et qui s'accuse. Il épouse finalement Lydie. Or celle-ci éperdument amoureuse de Girani décide de se venger et de ruiner son mari...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dette de haine
Dette de hainePREMIÈRE PARTIEIIIIIIIVDEUXIÈME PARTIEVVIVIIVIIIIXXPage de copyrightDette de haine
Maurice Leblanc
PREMIÈRE PARTIE
I
Par une brumeuse et froide matinée de décembre, dans le salon d’une riante bastide de la route de la Seyne, aux portes de Toulon, devant un grand feu, étaient groupés, causant et fumant, sept hommes, dont le plus âgé n’avait pas dépassé la quarantaine. Une table à jeu, sur laquelle les cartes et les jetons attendaient la reprise de la partie, venait d’être abandonnée. Midi sonnait, et le maître de la maison, médecin principal de la marine, laissant pour un instant ses hôtes à eux-mêmes, était allé voir si le déjeuner s’apprêtait. Le soleil se montrait timidement au dehors, et des flocons de neige voltigeaient dans l’air, chassés par un âpre mistral qui couchait les tiges flexibles des tamaris, sifflait dans les mimosas et les oliviers, et tendait douloureusement les nerfs des habitants de la Provence. Un jeune homme, portant l’uniforme de lieutenant de vaisseau, debout devant une fenêtre, tambourinait machinalement sur les vitres, en regardant dans le jardin.
— Eh bien ! Listel, qu’est-ce que vous voyez ? demanda un de ceux qui fumaient, en lançant dans le feu sa cigarette éteinte.
— Rien du tout, cher ami.
— Alors, à quoi pensez-vous ?
— À rien du tout.
— C’est le commencement du bonheur. Moi j’ai faim.
— Vous allez être satisfait. Houchard est allé jeter un coup d’œil sur le fourneau et donner quelques suprêmes conseils à son cordon bleu.
— Il paraît que c’est aujourd’hui qu’on déguste la fameuse bouillabaisse de turbots et de homards.
— Roubion n’a qu’à bien se tenir !
— Vous savez qu’il prétend que la bouillabaisse n’est bonne qu’avec du rouget, du loup et de la rascasse.
— Il ne sait pas ce qu’il dit ! s’écria un gros homme tout rond, qui, en ouvrant la porte, laissa pénétrer une appétissante odeur de cuisine.
— Houchard, tu me rappelles les dieux de la mythologie, qui s’avançaient enveloppés d’un parfum d’ambroisie… Toi tu sens la truffe, ami : c’est d’un bien bon augure !
— Vous en avez, cuites au vin de champagne ! Mais pour en revenir aux théories de Roubion…
— N’y reviens pas… Nous sommes sûrs de ta victoire… Rien de culinaire, chez toi, ne peut être inférieur. Tu étais né cuisinier. Et si tu n’avais pas été destiné par ta famille à soigner la santé de tes semblables, tu aurais été porté par ta vocation à la leur détruire à force de mets succulents !
— Plaisante, va. J’aurai ma revanche tout à l’heure, avec un certain poulet à la provençale et un pilaw…
— Tais-toi, ou je n’aurai pas la force d’attendre une seconde de plus.
— Il faut cependant encore un quart d’heure de patience… Du reste, tout notre monde n’est pas arrivé.
— Quelle chienne de saison ! dit un des convives, qui avait remplacé le lieutenant Listel à la fenêtre. Voilà que le temps tourne tout à fait à la neige.
Le ciel s’était soudain assombri, et les flocons, plus pressés, tombaient droits et lourds dans l’air glacé. Le jardin, en quelques minutes, était devenu tout blanc et un silence étouffé s’étendait au dehors.
— Et il y a des malades qui viennent de Paris tout exprès pour grelotter ici.
— C’est une succursale du pôle Nord !
La porte du salon, en s’ouvrant, interrompit les imprécations. Sur le seuil, retenant le battant, comme pour empêcher de voir dans l’antichambre, se montrait un grand garçon d’une trentaine d’années, à la figure encadrée de favoris blonds, aux yeux gris, à la bouche rieuse, dont la mise très élégante trahissait cependant, par d’infiniment petits détails, l’officier habillé en bourgeois.
— Tiens ! C’est Burel… Allons, lambin, tu as failli te faire attendre.
— J’ai une excuse… Devinez qui je vous amène ?
— Si c’est le beau temps, qu’il soit le bienvenu.
— C’est mieux ! Car le beau temps, au premier jour, va revenir. Le ciel de Provence ne boude pas longtemps. Et l’ami que j’ai là, vous n’étiez pas sûrs de le revoir.
— Qui est-ce donc ? Ne nous fais pas languir, dit le lieutenant, avec une tranquille indifférence.
— Regardez.
Le nouvel arrivant ouvrit largement la porte et, s’effaçant, fit passer devant lui un homme de moyenne taille, vêtu de son caban d’ordonnance, le visage bruni par le hâle et maigri par les fatigues. En un instant la scène changea. Le docteur s’élança de son fauteuil, chacun se leva, et, avec une expression de joyeux étonnement, ce nom sortit de toutes les bouches :
— Ploërné !
— Oui, mes amis, Ploërné, que je viens de cueillir, tout à l’heure, sur le seuil de la préfecture maritime, et que je vous amène pour déjeuner, si toutefois vous voulez de lui, comme convive.
— Voilà une question !
— Et d’où arrivez-vous, cher ami ?
— Depuis combien de temps es-tu à Toulon ?
— Est-ce que tu rentres pour tout à fait ?
— Es-tu en bonne santé ?
Toutes ces questions s’étaient croisées autour du jeune homme. Lui restait au milieu du salon, un peu étourdi, souriant, l’air doux, sans songer à ôter son lourd manteau. Mais ses amis déjà s’empressaient et, pendant qu’il répondait avec calme, lui enlevaient sa casquette, son caban, son sabre, et le laissaient près de la cheminée, en tenue, ainsi qu’il avait dû s’habiller pour se présenter devant le grand chef, les regardant tous de ses yeux attendris.
— Oui, je suis en bonne santé, quoique je revienne de là-bas avec un congé de convalescence. Je suis depuis ce matin à Toulon, débarqué de la Provence, paquebot des messageries orientales qui arrive directement de Shang-Haï. Et je rentre pour tout à fait.
— Et tu as laissé les camarades en bon état ?
— Pas en trop bon état. Le service a été dur et la campagne mauvaise. Nous avons perdu beaucoup de monde.
— Étiez-vous avec Marchand ?
— Oui ; mort du choléra à Formose.
— Et Briqueville ?
— Tué à Fou-Tchéou.
— Et Darner ?
— Mort du typhus à Hanoï.
— Et Serrurier et Bouet ?…
— Morts !
Les voix tombèrent. Nul n’osait plus interroger ce revenant du pays des deuils. Il semblait que la funèbre mention : « mort, » devait suivre chaque nom prononcé. Tous ces braves gens, habitués pourtant au danger, groupés autour de Ploërné, le regardaient avec une curiosité effrayée.
— Eh mais ! vieux, tu nous arrives avec les cinq galons ! s’écria le lieutenant Listel.
— Oui, dit Ploërné. Et, baissant la voix comme s’il eût craint de blesser ceux de ses camarades dont il venait de dépasser le grade : c’est à la suite de ma blessure que j’ai été proposé par l’amiral, et nommé.
À ces mots : « l’amiral, » il y eut un grave silence, et tous les fronts s’assombrirent.
— Tu étais avec lui, Ploërné ?
— Oui, il m’avait pris comme officier d’ordonnance, en remplacement de Desvarennes.
— Étais-tu présent quand il est mort ?
— Oui. J’étais remis de ma blessure et rentré à bord. Il s’est éteint dans mes bras.
— Ce qu’il a fait avec la flotte a été admirable, n’est-ce pas ?
— Oui, messieurs. C’était un chef de premier ordre. Tout le monde avait en lui une confiance inébranlable. Il aurait dit aux hommes : Nous allons prendre le ciel à l’abordage. Ils auraient répondu : À Dieu vat. Et ils auraient marché. Avec lui rien n’était impossible, il savait vouloir vaincre. La marine, en lui, a fait une perte inestimable.
— Et toi tu as perdu un bon patron.
— Hélas ! Messieurs, pour moi le tort matériel subi est peu de chose, comparé au tort moral, et cet homme excellent manquera plus à mon affection qu’à mon ambition, car je quitte le service… Si je vous ai dit tout à l’heure que je rentrais pour tout à fait, c’est que je donne ma démission.
— Comment ! Mais tu es fou ! À trente-deux ans, avec ton grade et tes états de service ?… Tu aurais les étoiles à quarante-cinq ans… Et tu renonces à un pareil avenir ?
— Oui, mes amis, dit Ploërné, avec sa douce fermeté, je renonce à tout ce que la vie me promettait de glorieux… Et le sacrifice que je fais m’est facile, car en échange je suis assuré du bonheur.
— Ah ! Mon gaillard, s’écria Listel, tu vas te marier ? Ce n’est que pour une femme qu’un marin tel que toi abandonne la mer… Si tu es amoureux, tu as raison… Notre carrière est exigeante, il faut s’y consacrer tout entier et le marin qui, par un gros temps ou en face de l’ennemi, a une autre préoccupation, un autre souci, que le salut du bâtiment qu’il conduit et de l’équipage qu’il commande, sent son esprit hésitant et son âme troublée. Notre cœur, à nous autres, doit battre dans les flancs mêmes de notre navire, ou bien nous sommes de mauvais chefs. Tu as raison, Ploërné, de ne pas te partager entre deux maîtresses. Mais il faut que celle à qui tu donnes cette preuve de tendresse soit bien belle, car tu aimais la mer !
— Oui, elle est belle et vaut le renoncement que je fais pour elle. Et quand vous la connaîtrez, vous serez d’avis qu’avec ces airs de me sacrifier, je donne peu, pour recevoir beaucoup.
— Voilà qui est à merveille, tu es content de ton sort, et c’est chose assez rare pour qu’on l’admire.
— Mais, mes chers amis, intervint le docteur, il me semble que, dans l’entraînement de cette heureuse reconnaissance, nous oublions l’objet de cette réunion qui est de déjeuner.
— Ah ! Voilà bien le matérialisme de ces médecins ! Quand nous sommes tout cœur, venir nous rappeler notre estomac.
— Au fait, il est midi et demie… Qui attend-on encore ?
— Eh ! Le marquis Girani.
— Il se sera oublié à Monte-Carlo, et ne sera pas rentré hier.
— Mettons-nous toujours à table… S’il doit venir, cela le fera arriver.
Houchard sonna et, à son domestique qui parut, dit :
— Servez.
Dans un amical désordre, les convives se dirigèrent vers la salle à manger. C’était un fin gourmet que leur hôte. Rien qu’à l’ordonnance de la table, il était facile de le deviner. Devant chaque couvert, un assortiment de verres, de toutes les tailles et de toutes les formes, s’étageait, depuis le petit verre pour le château-yquem, jusqu’à la longue flûte pour le champagne, en passant par le demi-verre pour le bourgogne, pour rejoindre le verre teinté de jaune pour le vin du Rhin. La nappe, quoiqu’on fût en hiver, était couverte de fleurs. Mais les fleurs ne poussent-elles pas sous la neige dans ce fortuné pays de Provence ? De belles écrevisses en buisson faisaient pendant à un formidable pâté de foies gras. Et le caviar alternait avec les crevettes roses.
Le soleil, perçant entre deux nuages, laissait tomber un rayon sur les cristaux, sur l’argenterie et leur donnait un éclat joyeux. Tout était soigné, aimable et tentant, fait pour le plaisir des yeux et le régal des lèvres.
— Allons, messieurs, prenez place, dit l’hôte avec une imposante solennité, nous allons entrer en séance, et au diable les retardataires !
— Il n’y en a pas, répondit une voix sonore.
Et un homme jeune, élégant et vif, entra en riant dans la salle à manger.
— Ah ! Girani, vous voilà. À la bonne heure ! Serrez la main de ces messieurs et asseyez-vous. Trop de politesses nous retarderaient. Je vous présente seulement notre camarade M. de Ploërné. Cher ami, le marquis Girani… Là, maintenant plus de cérémonies… Soyons tout à la dégustation.
Le nouveau venu s’était gracieusement incliné, et avait pris place entre le docteur et le lieutenant Listel. Ploërné, assis à l’autre extrémité de la table, regardait l’Italien avec curiosité. C’était le seul des convives qu’il ne connût pas. C’était le seul civil parmi tous les militaires réunis dans la salle à manger. C’était le seul étranger parmi ces Français. Au premier abord, la présence du jeune homme déplut au commandant. Il trouva anormale cette camaraderie si étroite de ses amis avec le marquis. Celui-ci, quoiqu’il eût, à deux reprises, rencontré les yeux de Ploërné fixés sur lui, ne paraissait pas attacher la moindre importance à l’inspection qu’il subissait. Très à l’aise, très gai, très familier, agréable et complaisant convive, il mangeait de belle humeur, et riait, avec une charmante facilité, de ce que disaient ses compagnons et de ce qu’il disait lui-même. Il était fort joli garçon, avec un teint olivâtre, des yeux bruns, trop langoureux pour un visage d’homme, des moustaches frisées et des dents blanches. Son front hardi, couronné de cheveux noirs crépus, relevait ce qu’il y avait d’un peu efféminé dans sa physionomie. Il parlait sans accent, mais avec cette volubilité et ce nasillement, particuliers aux Napolitains, qui donnent à la voix une sonorité criarde. Cependant, en dépit de sa verve insouciante, il semblait se surveiller et, s’il répondait avec abondance quand on s’adressait à lui, il ne cherchait point à diriger la conversation.
L’ayant observé physiquement, Ploërné voulut avoir quelques renseignements sur la situation sociale de celui qui l’occupait. Il se pencha vers son voisin, ce grand garçon blond qui l’avait amené, et lui dit :
— Qu’est-ce que c’est que cet Italien ?
— Eh bien ! Mais c’est le marquis Girani.
— Cela ne me dit rien, le marquis Girani… D’où vient-il ? Que fait-il ? Comment le connaissez-vous ?
— Là ! Quelle curiosité ! Le prends-tu pour un espion ?
— Qu’en sait-on ? fit gravement le commandant. Depuis la guerre, n’en sommes-nous pas infestés en France ?
— Cher ami, celui-là est un trop bon vivant pour songer à autre chose qu’au plaisir. Il aime trop les femmes, le jeu, la bonne chère pour nourrir de noirs desseins. Les âmes profondes n’ont pas cette ardeur de gaîté. Les conspirateurs ne sont pas toujours en fête. Où diable ce garçon-là nicherait-il dans son cerveau une idée sérieuse ? Il ne pense qu’à rire.
En effet, l’Italien, comme pour confirmer l’opinion émise sur lui, riait, en ce moment, d’un rire frais et perlé, d’un rire d’enfant.
— Y a-t-il longtemps que toi et nos camarades vous êtes en relations avec lui ?
— Mais depuis le commencement de l’hiver. Nous l’avons rencontré à Monaco, pendant que nous étions au mouillage à Villefranche. Listel, s’étant culotté, comme un nigaud, au trente et quarante, mais culotté jusqu’à son dernier sou, ne savait plus comment rentrer à bord, quand le marquis Girani, qui avait joué à la même table que lui, devinant son embarras, se mit gracieusement à sa disposition. Il retournait en voiture à Nice. Il ramena notre camarade. Listel alla le remercier. Girani lui rendit sa visite. Bref, c’est un gentil garçon, il nous plut, et nous sommes devenus ses amis. À dire vrai, il ne peut maintenant se passer de nous ; il est de toutes nos parties.
— Vous êtes sans défiance, à bord de l’escadre, dit avec ironie Ploërné.
— Eh ! Vous êtes diablement soupçonneux en Chine !
— C’est utile.
— Mais, ici, en pleine paix.
— Parbleu ! C’est en pleine paix que se prépare la guerre. Et c’est avec des Girani, aidés par la loyale bonhomie et l’hospitalité aveugles de quelques officiers soit de l’armée de terre, soit de la marine, que l’Italie peut avoir les plans de nos défenses des Alpes et le relevé des canons de notre flotte.
— Bêta ! Comme si nos canons étaient difficiles à dénombrer. Il suffit de se promener, en you-you, dans le port, pour savoir notre compte.
— Oui, mais ce qu’on ne sait pas autre part que dans votre compagnie, ce sont nos craintes, nos espérances, nos projets, nos plans. Vous êtes discrets, je le sais bien. Vous ne dites rien. Cependant un mot vous échappe, un jour, qui n’a pas de signification par lui-même, mais qui, rapproché d’un autre, lâché la veille, devient clair. Et, de mot en mot, de jour en jour, un gaillard indifférent en apparence, très avisé en réalité, tel que ce Girani, en sait aussi long que nous autres, sur la mobilisation de la flotte, sur la désignation de ses commandants. Et tout cela s’est fait au milieu des parties de poker, des rasades de champagne, et de la course aux petites femmes !
— Diable !
— Maintenant, je te dis ça, reprit Ploërné en voyant son ami un peu décontenancé, mais rien ne prouve qu’il y ait quoi que ce soit de réel dans ma supposition. Votre ami est peut-être un parfait galant homme qui, comme tu le crois, ne pense qu’à rire, à aimer et à boire. Mais il pourrait, tout aussi bien, être autrement, sans que vous vous en soyez seulement douté. Et cela ne dépend que de lui. Bah ! Parlons d’autre chose. Nous autres, les Tonkinois, comme vous nous appelez, nous avons l’esprit tourné au noir. Nous avons trop souffert !
Le repas était arrivé au point où la faim déjà amortie permet au dilettantisme gastronomique de s’exercer avec discernement. Le docteur Houchard voulut donner quelque répit à ses convives et, pour procurer un entracte salutaire, s’adressant à Ploërné :
— Ainsi, cher ami, vous avez fait un rude service dans ces mers de Chine, si dangereuses pendant la mauvaise saison. Et les bâtiments, comment se comportaient-ils ?
— Aussi bien que possible, répondit le jeune homme. Vous savez que tant vaut le commandant, tant vaut le navire. Nos vieux rafiots se sont comportés comme des cuirassés tout neufs. Mais la campagne finie, tout ça ne vaudra plus que comme ferraille. Le blocus de Formose a été terrible. Pendant des jours et des jours, nous sommes restés à croiser par des temps à ne pas laisser un Chinois dehors. Et nous labourions la mer, sans autre espérance que de recommencer le lendemain la dure besogne que nous avions faite la veille. Sans un repos pour les hommes, sans une relâche à terre. Toujours sur les vagues et sous le ciel, avec cette coquine de côte à l’horizon, et, tout autour, des ouragans, des typhons, des coups de mer, à croire que le bois et le fer allaient être écrasés… Et la dyssenterie à bord ; on disait la dyssenterie ; entre nous, c’était bien le choléra. Chaque semaine quelques-uns de nos braves mathurins disparaissaient, et quand on ne pouvait aborder, parce que le temps était trop mauvais, c’était une messe dite sur le pont devant tous les camarades, puis le glissement du pauvre corps par l’ouverture d’un sabord, et l’ensevelissement dans les profondeurs de la grande tourmentée qui berçait ainsi le sommeil des morts, comme la veille des vivants. Nous en avons vu partir, de cette façon-là, beaucoup, et dans la mer et dans la terre nous avons semé bien des os. D’autres venaient remplacer les disparus. Heureux ceux qui, étant pauvres, sont tombés frappés par l’ennemi, car les veuves de ceux qui succombent épuisés par les fatigues et minés par la maladie ne touchent pas la pension entière… Oui, mes amis, entre celui qui meurt du choléra ou du typhus, à des milliers de lieues de la mère-patrie, et celui qui tombe frappé d’une balle ou d’un éclat de mitraille, les bureaux font une différence. La peau de l’un ne vaut pas la peau de l’autre. Et, entre des braves qui ont été égaux devant le danger, les règlements créent l’inégalité de la mort.
— Ah ! Cher ami, si tu veux réformer, tu auras fort à faire. Nous sommes exposés à cent injustices de cette sorte. Il n’y a pas qu’en Chine qu’on voit des chinoiseries, et l’hôtel de la rue Royale en possède une fort belle collection.
À ces paroles, une protestation énergique s’éleva tout autour de la table.
— Au diable ! On ne parle pas politique ici ! Devisez d’amour ou de guerre, dites du bien ou du mal des femmes, suivant votre tempérament, mais laissez l’administration croupir en paix… Ploërné, parlez-nous des femmes du pays.
— D’affreuses Annamites, aux dents noircies par le bétel, aux lèvres brûlées par la chaux… Ah ! Mes amis, n’appelez pas ça des femmes.
— Eh ! Fichtre ! J’ai connu, moi, quelques Chinoises qui n’étaient point si méprisables… Et quant aux Japonaises…
— Charmantes, les Japonaises ! s’écria Listel. Elles n’ont qu’un seul défaut, c’est, maintenant, de vouloir s’habiller à l’européenne. Leurs yeux noirs, leurs pommettes saillantes et leur teint de cuivre, avec l’ample robe brodée de couleurs brillantes, c’était pourtant joli !
— Mais dans tous les pays la couleur locale se perd. Constantinople, dans dix ans, ne sera plus à voir… Et grâce aux chemins de fer, la Perse tout entière se fera, prochainement, habiller à la Belle-Jardinière… Ah ! nous sommes bien à l’époque du nivellement général : avant peu, le progrès nous aura faits tous égaux dans le mesquin et l’horrible !
— C’est l’avenir auquel le monde est réservé. Tout sera médiocre. On ne connaîtra plus les grands raffinements du luxe. Et, excepté chez les dix ou douze milliardaires qui se partageront la fortune du globe, il n’y aura plus rien d’exquis, de délicat ou d’unique. L’article de bazar, en tout, bien conditionné et à prix réduit, voilà ce qui nous attend. De même que les hommes paraîtront des épreuves plus ou moins laides tirées du même modèle, tant ils seront pareils, de même les objets industriels, artistiques, de quelque nature qu’ils soient, seront des reproductions identiques. Chacun aura le même chapeau, la même redingote, le même parapluie, la même voiture, le même mobilier. La bagatelle rare, le bibelot précieux, le petit rien charmant et très cher, n’existeront plus qu’à l’état de collection dans les musées. On n’en fera plus que par milliers à la fois, tous coulés dans le même moule, fabriqués avec la même substance, la même couleur. L’uniformité universelle, voilà à quoi nous marchons. Et ce sera terrible !
— N’en voyez-vous pas un exemple, dans les constructions récentes ? dit l’Italien, de sa voix sonore. Regardez les quartiers nouveaux qu’on élève à Naples, à Rome… Toutes les maisons y sont semblables. Non pas seulement aux maisons voisines, mais aux maisons de Paris bâties en même temps. Cinq étages, et la même façade… À moins de regarder le numéro, on peut entrer chez son voisin, en croyant aller chez soi.
— Eh bien, mes amis, goûtez-moi ce cognac, dit le maître de la maison avec autorité, et vous pourrez affirmer que nulle part ailleurs il n’y en a de semblable. Le voilà le produit exquis et rare ! Mais Listel a raison. Dans dix ans on n’en pourra plus boire. Déjà on n’en sait plus trouver !
Le café parfumait de son arôme la salle à manger. Un bien-être délicieux engourdissait les convives. Les fleurs étouffées commençaient à se pencher alanguies.
La fumée d’une première cigarette monta en spirales bleues vers le plafond. Au dehors le temps s’assombrissait de plus en plus, et la neige tombait dense, lourde et silencieuse. Entre ces hommes jeunes tous et libres, car il n’y avait là que des célibataires, la conversation d’abord sérieuse, puis satirique, avait pris un tour galant, et maintenant on parlait de femmes. Ardent sujet de controverse, si chacun avait émis son opinion ou voulu faire triompher ses préférences, mais les convives se bornaient à raconter leurs intrigues ou leurs aventures. Et les demoiselles faciles de Toulon et de Marseille, les petites actrices des théâtres et quelques bourgeoises inflammables, avaient les honneurs de la description. Rien de spécial, rien de nouveau : la classique amourette de garnison. Et, à part le quartier où logeait la belle, la couleur de ses yeux ou de sa chevelure, le petit nom qu’elle portait, sa gaîté ou sa mélancolie, c’était la même histoire, avec le même début et le même dénouement. Du « tout fait » comme pour l’industrie.
En causant, on s’était levé et, de la salle à manger, on avait gagné le salon. Là, enfoncés dans des fauteuils profonds, les yeux demi-clos, un bon cigare aux lèvres, les jeunes gens s’étaient mieux sentis entraînés aux confidences, et, depuis une heure, aucun n’avait plus de secrets pour son voisin.
Seul Ploërné demeurait grave et écoutait sans faire sa partie dans ce chœur d’indiscrétions. Outre que, par caractère, il n’eut pas été enclin à publier ses bonnes fortunes, revenant des pays lointains, il n’avait rien à raconter. Il examinait avec un peu de dédain ses camarades, occupés à de telles misères. L’austérité de la vie menée par lui, depuis deux ans, au milieu des fatigues et des dangers sans nombre, le rendait sévère pour ces futilités d’oisifs obligés d’absorber ainsi les loisirs de leur existence vide. Il ne se souvenait plus d’avoir été pareil à eux. Il les jugeait suivant ses impressions du moment et une tristesse l’envahissait à se sentir si peu en communion d’idées avec tous ces hommes, qui étaient ses égaux, et desquels il se sentait maintenant si complètement séparé.
Puis il pensa que c’était probablement pour la dernière fois qu’il se trouvait en leur compagnie, que tout, dans l’avenir, allait l’éloigner d’eux, et que, par conséquent, son impression pénible ne pouvant pas durer, n’avait aucune raison d’être. Il ne sut pourtant pas réagir contre la mélancolie qui l’envahissait irrésistible. Pendant qu’il était si loin de France, la nuit, sur le pont de son navire, en face de l’immensité du ciel et de la mer, il ne se rappelait pas avoir éprouvé une sensation d’isolement aussi complet qu’au milieu de ces jeunes gens qui riaient, buvaient et fumaient, en se dénombrant leurs amoureuses conquêtes.
Il fit un nouvel effort pour se soustraire à cette impression, et sa pensée l’emporta loin de cette réunion joyeuse, dans un milieu plein de calme et de sérénité. C’était, non loin de Nice, au bord de la mer, dans une anse de la baie de Villefranche, au pied même de la tour sarrasine qui couronne la pointe de Saint-Hospice, une villa blanche et rose ensevelie sous la verdure et les fleurs. Là vivaient, dans une paisible solitude, trois femmes : une âgée et deux toutes jeunes, attendant son retour, pleines d’impatience. Sa tante, Mme de Saint-Maurice, avec l’inquiétude de ne pas vivre assez longtemps pour le revoir, ses deux cousines, l’une avec le désir joyeux d’une amitié fraternelle, l’autre avec l’ardeur d’une tendresse promise inaltérable.
Dans le salon, dont les fenêtres donnaient sur la mer, il se figurait les trois femmes réunies, travaillant paisiblement, sans se douter que l’absent était si près d’elles. Quelle surprise et quel bonheur quand il paraîtrait à l’improviste ! Car elles ne devaient pas espérer le voir avant deux mois, d’après ses dernières lettres. Parti subitement, il n’avait pu écrire, parce qu’il devait arriver en même temps que la poste, et quant à télégraphier, il s’en serait bien gardé, craignant d’épouvanter sa tante dont il connaissait l’horreur pour ces mystérieuses feuilles bleues qui, dans leurs plis fermés, semblent toujours receler l’annonce d’un malheur.
Et puis il se faisait un égoïste plaisir de leur joyeux étonnement. La cloche de la grille tintait, l’aboiement du chien annonçait l’arrivée d’un serviteur venant ouvrir. Et c’était Leïla, cette quarteronne, nourrice de sa fiancée, amenée de l’île de France par Mme de Saint-Maurice. Elle poussait, en le reconnaissant, un cri de stupeur, et la maison s’animait comme par enchantement. La vieille tante paraissait à une fenêtre, les deux jeunes cousines accouraient les mains tendues, les yeux riants, les lèvres épanouies.
Ah ! Le charmant tableau ! Et laquelle embrasserait-il le mieux, de l’amie ou de la fiancée ? De celle, naïve et franche, avec laquelle il n’avait point d’arrière-pensée ni de contrainte, qu’il avait toujours traitée en petite camarade, ou de l’autre, compliquée et fantasque, qu’il redoutait tout en la chérissant, et avec laquelle il n’avait jamais sa liberté de cœur et d’esprit. Oh ! Quoi qu’il en fût, ravissement et délices pour l’exilé, qui allait retrouver tout ce qu’il aimait : la vieille tante respectée comme une mère, et les deux jeunes filles, dont l’une lui promettait pour toute sa vie une sœur charmante et dévouée, l’autre une femme exquise et adorée. Comme il avait hâte de terminer ses affaires avec les grands chefs, pour brûler la route et courir vers la maison entrevue dans tous ses rêves ! Et comme tout ce qui n’était pas le cher bonheur de revoir celles qui le préoccupaient uniquement, lui paraissait mesquin, inutile et bas !
Il s’attardait dans ses pensées, avec ravissement, et il s’était si bien abstrait de ce qui l’entourait que ce fut presque avec surprise qu’au bout de quelque temps, il retrouva la notion des choses extérieures. Il lui sembla qu’il s’éveillait d’un assez long sommeil, pendant lequel un songe délicieux l’avait charmé. La voix du marquis italien, chantante et colorée, parvint à son oreille. Girani, avec toutes sortes de précautions et de réticences, commençait le récit d’une aventure d’amour. Ses compagnons l’avaient plaisanté sur son mutisme, lorsque tous se livraient aux confidences, peut-être aux hâbleries. Mais il n’avait pas d’abord répondu à leurs vives exhortations. Il gardait un visage fermé, sans pouvoir cependant dissimuler un sourire qui avait porté au plus haut point d’ardeur la curiosité des assistants.
— Ah ! Vous êtes un cachottier, marquis : je suis sûr que, de nous tous, vous êtes le plus favorisé ! Tourné comme vous l’êtes, riche, libre, eh ! vous devez réussir admirablement auprès des femmes… En ce moment, vous avez tout l’air d’un homme qui savoure un secret bonheur !…
Girani se taisait toujours, et cependant l’éclat de son regard, la palpitation de ses lèvres, le rayonnement de son visage, étaient le plus éloquent des aveux. Les autres, acharnés à savoir ce qu’il voulait taire, le pressaient. Ne pouvait-il conter son aventure, sans faire connaître celle qui en était la séduisante héroïne ? Car elle était ravissante, on s’en doutait !
— Oh ! Oui, ravissante ! laissa échapper le marquis.
Une exclamation générale avait accueilli cette imprudente parole, et, sur la pente de l’indiscrétion, l’Italien peu à peu s’était laissé glisser. Maintenant, il contait sa romanesque intrigue, et tous étaient silencieux, attentifs, captivés, un peu jaloux. C’était à Monaco, en visitant le palais du Prince, qu’il avait rencontré celle qu’il adorait, accompagnée d’une autre jeune fille, et d’une vieille dame. Rien de plus honnête que le maintien de ces enfants sous la garde de leur parente. Il s’était discrètement tenu à l’écart, mais les observant de loin, pris par leur grâce décente et leur naïf contentement. Pendant une heure, il les avait ainsi suivies, écoutant leurs réflexions, leurs remarques, leurs questions au gardien qui les guidait, s’enivrant de leur charme, et ne sachant laquelle lui plaisait davantage, de la brune ou de la blonde. Car, des deux jeunes filles, il y en avait une blonde et l’autre brune.
Elles ne paraissaient même pas s’être aperçues de sa présence, et si, pour descendre un escalier obscur et difficile, il n’avait pas offert l’appui de sa main à la vieille dame, sans doute les deux charmantes touristes n’auraient pas levé les yeux sur lui. Cependant, arrivées dans la cour, elles s’étaient retournées et, là, lui avaient avec un simple sourire adressé un remerciement. Elles étaient montées, à la porte du château, dans un landau bien attelé, et avaient pris la route de la Condamine.
Lui était resté à Monte-Carlo, les yeux ravis de la beauté, si dissemblable et si parfaite pourtant, des deux jeunes filles, l’esprit tout rempli de leur souvenir. Il avait été au trente et quarante, avait perdu une grosse somme et, indifférent à sa mauvaise fortune, il avait passé le reste du jour à penser à ces deux belles personnes qui l’avaient si promptement, si sûrement conquis et que, selon toute vraisemblance, il ne devait plus revoir.
Mais le hasard s’était chargé de les remettre en présence et, cette fois, de lui indiquer nettement quelle était celle qu’il était destiné à aimer. Il avait, pour occuper une de ses journées, formé le projet de visiter la frégate américaine qui, tous les ans, stationne dans la rade de Villefranche, et, après deux heures données à l’inspection détaillée que lui avait facilitée la bonne grâce des officiers, il était revenu à terre. Là, avant de prendre le train, il s’était promené au bord de la baie, dans les chemins fleuris et ombreux, regardant la mer d’azur se briser murmurante sur les rouges récifs, roulant dans ses vagues argentées les longues algues vertes, qui traînaient au fond comme des chevelures de naïades.
Il allait, sans pensée, plein de cette joie de vivre, qui naît de l’air pur, de la brise légère et du ciel sans nuage, lorsqu’au détour du chemin il s’était trouvé face à face avec deux femmes qui venaient en cueillant des fleurs. La première était une quarteronne au madras rouge, à la peau cuivrée, qui portait dans ses bras une botte de mimosa et de jasmin. La seconde était une des deux jeunes filles rencontrées au palais Grimaldi. Ils s’étaient reconnus, et, avec un sourire, elle avait répondu à son salut. Puis elle avait passé, et lui, sans pouvoir s’en défendre, l’avait suivie, de loin, pour ne la point inquiéter, ne perdant pas de vue, à travers les trouées des massifs, les découpures des bosquets, sa robe claire qui se détachait sur le fond de verdure. Il était ainsi arrivé à une villa blanche et rose ensevelie sous les fleurs. La jeune fille avait disparu, et, après une longue attente devant la porte, sûr que c’était là qu’elle habitait, il avait repris le chemin de Monte-Carlo, le cœur profondément troublé et l’esprit uniquement occupé par la belle inconnue.
Ce récit avait d’abord frappé distraitement l’oreille de Ploërné. Il songeait. Subitement, les personnages du récit de l’Italien étaient, par un inexplicable phénomène, devenus les mêmes que ceux de son rêve. Trois femmes : une vieille et deux jeunes. Et un instinct secret l’avertissait que c’étaient celles qu’il évoquait, au même instant, dans sa pensée. Pourquoi ? N’y avait-il donc qu’elles que le Girani eût pu rencontrer ? N’importe ! Un tremblement intérieur, une angoisse douloureuse s’emparaient de lui, et, sans que rien motivât son inquiétude ou sa jalousie, il souffrait cruellement. Il écoutait l’Italien, qui poursuivait son récit, banal dans ses péripéties de campagne amoureuse : guet, pour apercevoir la belle habitante de la villa, station prolongée au bord de la baie, pour échanger avec elle un regard, puis, hardiesse soudaine qui, l’occasion se présentant, le poussait à lui parler, et colère dédaigneuse de la jeune fille. Alors une lettre pour s’excuser, sa persistance à écrire, quoiqu’on ne lui répondît pas. Et enfin la connivence de la mulâtresse qui s’était intéressée à sa cause. Tout le malpropre développement de l’aventure galante avec cette malheureuse enfant, au milieu de la fumée des cigares, sous le regard allumé de ces hommes, parmi les réflexions égrillardes et les questions outrageantes, voilà ce que Ploërné entendait. Et il n’y avait point à douter que ce fussent les mêmes femmes qu’il aspirait à revoir, la même maison vers laquelle il se dirigeait avec une hâte si joyeuse. Ses espérances, son bonheur, en une seconde, tout avait été renversé, profané. Et le beau lac limpide, dans lequel sa vie à venir se reflétait si douce, se changeait en un cloaque fangeux dont il se détournait avec horreur.
Cependant l’Italien, de sa voix chantante, continuait son histoire. Il en était aux rendez-vous dans le jardin embaumé, pendant les molles nuits aussi belles que les jours, à la clarté de la lune qui prêtait son mystère au charme des entretiens à voix basse. Une douleur immense s’empara de Ploërné. La certitude s’imposait à lui, quoiqu’il voulût maintenant fermer ses yeux à la précision des détails qui attestaient l’horrible réalité des faits. Dans ce naufrage de tout son être moral, une seule illusion surnageait. Il y avait deux jeunes filles, dans la maison maintenant déshonorée. Laquelle s’était perdue ? La sœur ou la fiancée ? Choix atroce et qui lui déchirait le cœur, mais qu’il fallait faire, cependant. Et il en venait à espérer que celle qui avait tout oublié, c’était celle qu’il n’aimait que comme une amie, comme une compagne d’enfance, et que celle qu’il adorait avait su se conserver à lui tendre et fidèle. Dans sa pensée, ce redoutable problème se posait : Laquelle ? Et il tremblait de questionner, autant qu’il souffrait de ne pas savoir.
Mais là où il n’hésitait pas, c’était dans la haine subite, formidable, sauvage, qui enflammait tout son être contre le héros de la galante aventure. Pâle, les dents serrées, les yeux ardents, il se ramassait comme pour bondir sur l’Italien. Son cœur battait à l’étouffer. Et cependant son cerveau était calme, presque glacé : il calculait ce qu’il allait faire ; ses mains tremblantes, énervées, s’agitaient dans des menaces inconscientes, pressées de frapper, et sa tête raisonnait lucide. Il se disait : Je ne puis brusquement l’interrompre pour le souffleter. Il doit y avoir au moins une courte explication, entre ce misérable et moi, afin que mes amis ne s’imaginent pas que je suis, tout à coup, devenu fou furieux. Et cependant il faut que je l’insulte, que je lui crache ma colère et mon mépris à la face, que je me donne cette jouissance de lui rendre ce qu’il vient de me faire endurer depuis un quart d’heure.
Un brouhaha de voix l’avertit que le récit était terminé. Autour du marquis souriant, les convives échangeaient leurs impressions.
— Heureux, ce Girani ! Oui, certes, une telle bonne fortune !
— Il n’y a que ces bruns à figure pâle pour affoler les femmes !
— Un vrai roman, en tous cas, et des plus intéressants.
— On comprend les absences du cher marquis, maintenant… Il est plus souvent dans les environs de Villefranche qu’à Nice et à Monte-Carlo, ou avec ses amis de l’escadre !…
— Messieurs, me blâmez-vous ?… demanda l’Italien, avec fatuité.
— Non pas !… Mais quel sera le dénouement de l’histoire ? À toute histoire, il faut un dénouement… Si la jeune fille est de bonne famille, et riche, et si vous l’aimez, comme vous nous l’avez dit, mon cher, épousez-la !
L’Italien resta un instant pensif, un nuage passa sur son front, puis son sourire reparut :
— Oui, l’épouser, sans doute ; mais que dirait la marquise Girani, qui est à Florence ?…
— Marié ! Ah ! Diable ! Voilà une complication… Vous ne nous aviez pas raconté que vous étiez marié !
— Je vis assez mal avec ma femme, et je n’en parle pas volontiers. Mais elle existe, et nous n’avons pas le divorce en Italie… D’ailleurs la marquise est une fervente catholique, elle résisterait à une tentative de rupture du lien conjugal.
— Et cependant vous adorez la jeune fille ?…
— Je l’adore.
Il y eut une seconde de silence ; puis une voix, dont l’âpreté fit vibrer les nerfs de tous les assistants, prononça ces paroles :
— Il faut alors, pour vous être conduit de la sorte avec elle, que vous soyez un fier misérable !
Le silence se rétablit profond, pesant, mortel. Tous les convives debout, immobiles, regardaient Girani devenu blême, et, à trois pas de lui, Ploërné, qui souriait, mais d’un terrible sourire.
— J’ai mal entendu, balbutia l’Italien, ou bien, vous avez voulu plaisanter ?… Nous sommes entre amis, mais l’expression est pourtant un peu vive…
Le commandant fronça le sourcil, et, s’avançant jusqu’à toucher le marquis, il dit :
— Je n’ai pas plaisanté, et je répète que l’homme qui a commis l’infamie dont vous venez de vous vanter, est le dernier des misérables !…
— Mais, monsieur, vous m’insultez ! cria Girani.
— Vous avez mis du temps à vous en apercevoir ! dit Ploërné avec une sombre ironie.
L’Italien fit un geste, pour en appeler à ceux qui l’entouraient. Une stupeur l’anéantissait. Il ne comprenait pas cette intervention subite, cette agression inattendue, et cette comédie se terminant brusquement en drame.
Le lieutenant Listel s’était jeté entre les deux hommes et essayait de raisonner Ploërné :
— Non ! s’écria le commandant, point de raison. Je connais les femmes dont ce drôle a parlé… J’atteste ici qu’il a menti et s’est vanté ignominieusement. Il a besoin d’une leçon, je me charge de la lui donner !
À ces mots : « Je connais les femmes, » le marquis eut un hochement de tête. Il commençait à voir clair. Il voulut parler, mais deux des assistants l’entraînaient, afin de le séparer de Ploërné et d’éviter une collision imminente. Le commandant était resté au salon, entouré de ses amis qui s’efforçaient de le calmer. Mais il gardait un visage impénétrable, et à tous leurs raisonnements opposait le silence. Ils tâchaient de lui expliquer qu’il y avait là un déplorable malentendu, qu’après tout il était fort possible qu’il se fût trompé ; que peut-être, en tout cas, le marquis avait exagéré les choses. Il demeurait immobile, muet, avec un sourire d’une effrayante fixité. Il n’écoutait même pas ce que lui disaient ses amis. Une des dernières phrases, prononcées par l’Italien, avait, dans le cerveau du commandant, provoqué une nouvelle tempête : « Que dirait la marquise Girani qui est à Florence ? » Ainsi le séducteur était marié. Il ne restait même pas à Ploërné cette ressource un instant acceptée – avec quelle douleur cependant ! – de contraindre cet homme à réparer la faute commise en épousant sa complice. Il n’aurait même pas cette satisfaction de pouvoir rendre l’honneur à celle qui s’était si follement compromise. C’était cette déception déchirante qui l’avait fait éclater en paroles insultantes et qui l’animait, en ce moment, d’une rage formidable. Aux exhortations de ses compagnons il ne répondait toujours pas. Une pâleur s’était étendue sur son visage, les ailes de son nez se pinçaient, et ses lèvres mordues étaient crispées par le même menaçant sourire.
— Voyons ! Il doit y avoir moyen d’arranger cette affaire-là, dit Listel… Tu ne connais pas Girani, tu ne peux avoir d’animosité contre lui… Il y a certainement une erreur… On va s’expliquer… Tiens, voilà nos camarades qui reviennent.
La porte s’était ouverte et Houchard rentrait avec un des convives. Ils étaient fort agités, mais ils souriaient. C’était de bon augure.
— Eh bien ! s’écria Listel, où en êtes-vous par là ?
— Nous en sommes à un arrangement… Ah ! Diable ! Ça n’a pas été tout droit.
— Mais êtes-vous constitués comme témoins ?
— Sans doute.
— Alors il faut que nous restions seuls tous les quatre. Où allons-nous mettre Ploërné ?
— Mais à quoi bon rester seuls, puisque, dans une minute, nous allons être obligés de rappeler le commandant pour lui soumettre l’accord que nous proposons, et dont l’acceptation par lui terminera amiablement l’affaire… Il n’y a eu que des paroles, point de voies de fait… Après un déjeuner d’amis, où on s’est un peu échauffé, rien d’irréparable…
À ces mots : « rien d’irréparable », une lueur passa dans les yeux de Ploërné, et sa bouche se contracta plus douloureuse. Il ne parla point cependant, attendant la suite de la négociation.
— Voilà à quoi nous sommes arrivés, reprit le major, après avoir raisonné beaucoup Girani qui était comme un fou en voyant les conséquences de son bavardage… Car il n’y a eu qu’un bavardage… Vous entendez, commandant… Notre convive nous a raconté un roman de sa façon… Les personnages sont vrais, mais l’intrigue est fausse. Il nous l’a déclaré… Il le déclarera devant vous… Il a, en effet, rencontré la jeune fille dont il s’agit… Il en a été amoureux, il a rôdé autour de sa maison, c’est encore vrai, mais il ne lui a jamais adressé la parole, il n’a jamais eu d’entrevue avec elle… Il s’est vanté… Il a pris son rêve pour la réalité… Il était gris, en somme, ce qui n’est pas un grand crime. Et vous avez été vraiment dur pour lui !…
Ploërné interrompit son camarade par une violente protestation :
— Vraiment ! Vous trouvez ? dit-il d’une voix enrouée par l’émotion.
— Voyons ! Ne vous fâchez pas !… Nous reconnaissons tous nos torts, nous acceptons votre sortie, un peu vive, comme une punition de notre forfanterie, mais quand nous aurons fait toutes ces concessions, au moins vous consentirez bien, vous, à retirer les expressions outrageantes dont vous vous êtes servi ?…
Le commandant resta silencieux et immobile. Il n’acquiesçait ni du geste, ni de la voix. Il semblait si peu disposé à accepter l’accommodement qui lui était proposé, que les quatre témoins se regardèrent pleins de trouble et d’inquiétude.
— Voyons, Ploërné, dit Listel, tu ne peux pas refuser de terminer une affaire dans des conditions aussi avantageuses pour toi… Ou bien tu vas nous laisser croire que tu cherches à Girani une mauvaise querelle… Allons, tu acceptes… C’est entendu ?…
Ploërné fit quelques pas d’un air irrésolu, puis s’arrêtant brusquement :
— Nous étions une douzaine d’hommes ici. Il peut arriver que tous ne soient pas discrets et que l’affaire s’ébruite. Pour mettre mieux à couvert l’honneur de celle dont j’ai pris la défense, je veux une déclaration écrite.
— Eh bien ! Nous prenons sur nous de te la promettre. Girani ira aussi loin que possible dans la voie des concessions. D’ailleurs il paraît avoir aussi à cœur que toi, de défendre la réputation de la personne dont il a si inconsidérément parlé.
Ploërné devint plus pâle encore, à cette assurance de l’intérêt que son adversaire prenait, malgré tout, à celle qu’il avait compromise. Les deux témoins sortaient. Le commandant et ses deux amis restèrent seuls.
— Tu vois, fit Listel, cela s’arrange à ta satisfaction…
— Tout à fait ! murmura le commandant avec une âpre ironie.
Ils se turent, attendant. La neige, au dehors, continuait à tomber. Dans la pièce voisine, au milieu du silence, des bruits de voix se faisaient entendre. Au bout de quelques minutes, la porte se rouvrit, et les témoins reparurent. Houchard, très grave, tenait à la main une feuille de papier. Il la tendit à Listel, qui la lut avec son camarade, puis la passa à Ploërné, qui la regarda d’un œil presque indifférent.
— Maintenant que nous avons fait tout ce que vous avez voulu, Ploërné, nous attendons que vous fassiez à votre tour la concession exigée… Vous y consentez, n’est-ce pas ?
Le commandant leva la tête, et, regardant les quatre témoins de cet air qui les avait déjà si fort troublés, il dit avec une tranquillité affectée :
— Avant tout, je veux dire un mot à M. Girani.
— Mais, mon cher, c’est tout ce qu’il y a de plus incorrect ! s’écria Listel. Nous avons déjà conduit l’affaire très irrégulièrement…
— C’était pour le bien, insinua pacifiquement le docteur. Ne le regrettons pas.
— Mais ce que vous réclamez maintenant…
— C’est à prendre ou à laisser, dit Ploërné avec sa douceur inquiétante.
— Nous allons donc demander au marquis s’il veut y consentir.
La porte était restée entr’ouverte. Girani, qui sans doute écoutait, parut sur le seuil. Il s’avança vers le commandant avec une contenance fort digne. Du geste Ploërné l’amena dans l’embrasure de la fenêtre, et là, le dévorant du regard, tout son sang subitement remonté du cœur au visage :
— Laquelle des deux avez-vous voulu désigner, dit-il d’une voix étouffée et tremblante… Laquelle des deux… Lydie ou Thérèse ?
Le problème de sa vie allait, en une seconde, se résoudre. Il attendait la réponse de l’Italien, plein d’une anxiété affreuse.
— Laquelle ? répéta-t-il sourdement. Oh ! Répondez ! Il y va, pour moi, de bien plus que la vie !…
Le marquis hocha la tête soucieux ; puis, avec fermeté :
— Je ne puis vous répondre.
— Pourquoi ?
— Parce que ce serait commettre, à votre instigation, une nouvelle indiscrétion cent fois plus grave que la première, car, maintenant, je sais devant qui je parle.
— Ah ! Malheureux ! Vous ne comprenez donc pas le mal que vous me faites !… Prenez garde !…
Sans répondre un seul mot, Girani s’était écarté. Les yeux étincelants, Ploërné l’avait suivi.
— Eh bien ? demanda Houchard, avec l’espoir que les deux adversaires étaient réconciliés.
— Eh bien ! s’écria Ploërné, j’ai pris connaissance de la déclaration de monsieur, j’ai eu avec lui une explication supplémentaire, et après avoir lu ce qu’il a écrit, entendu ce qu’il a dit, je déclare que, non content de s’être conduit comme un drôle, il se conduit maintenant comme un lâche !
— Monsieur ! fit Girani en s’élançant sur Ploërné.
Mais le commandant avait été plus prompt et sa main levée venait de s’abattre sur le visage du marquis.
Les quatre hommes s’étaient jetés entre les adversaires ; tous criaient :
— Ploërné, vous êtes fou ! Messieurs, il ne sait ce qu’il fait !… Girani, éloignez-vous !…
La voix de Ploërné domina le tumulte, très nette et très froide :
— Je sais ce que je fais, messieurs, point d’équivoque. Nous ne sommes que des hommes ici. Donc pas de ménagements. Il ne s’agit plus que de se battre. Monsieur doit en avoir tout aussi envie que moi… Il y a des armes chez notre ami… Celles que vous voudrez. Mais séance tenante… Je pars demain, je n’ai pas le loisir de remettre cette affaire.
Il paraissait aussi calme que quand il était entré dans le salon, avant le déjeuner.
Listel l’avait emmené dans un coin, et très grave lui disait :
— Qu’est-ce que tu préfères comme arme ? Qu’est-ce que tu tires le mieux ?…
— C’est à lui que le choix appartient… Ce qu’il voudra, comme il voudra… Et, n’aie pas peur, je vais le tuer, aussi vrai qu’il n’y a qu’un Dieu !
— Fais bien attention… Il est de première force au pistolet !
— Tant mieux. Au moins je ne l’assassinerai pas !
Il regardait son ami avec une telle confiance, avec une telle certitude que celui-ci en restait épouvanté. D’un homme aussi brave que l’était Ploërné, aucune forfanterie ne pouvait être soupçonnée. Il y avait donc, dans l’assurance qu’il donnait de tuer son adversaire, une sorte de violence faite à la destinée, une domination des faits par la volonté, qui terrifiait. Et le lieutenant, qui avait cependant vu de sanglantes batailles, ne pouvait reprendre son sang-froid, demeurait inerte et tremblant devant son ami résolu et implacable. Le maître de la maison revenait, après quelques minutes de conversation avec les témoins de Girani.
— Tout est décidé, fit-il. Le pistolet, à vingt-cinq pas, au visé… Trois balles tirées par chacun des adversaires…
— C’est bien ! dit le commandant.
— Il fait dehors un fichu temps, reprit le major. Si vous vouliez, j’ai derrière la maison un grand hangar, qui servait au précédent propriétaire de pressoir pour les olives… Il a bien trente mètres… Vous y seriez à couvert.
— Où il vous plaira. Mais faisons vite !
— Il est enragé, ce Ploërné, dit tout bas Listel à son co-témoin. Tout à l’heure il m’a fait peur… Ça va être très sérieux, prépare d’avance ta trousse, des bandes et tout ce qu’il faut pour raccommoder un blessé.
— Sacrebleu ! Et s’il y a mort d’homme ?…
— Alors ce sera l’affaire des pompes funèbres !… Mais quelle responsabilité pour nous !
— Tout se passe correctement, n’est-ce pas ?
— Autant qu’il est possible, dans une situation aussi anormale.
— Tu prêtes tes pistolets ?
— Ces messieurs les ont.
— Aucun des adversaires ne les connaît ?
— Aucun. On va tirer, à pile ou face, le choix des places et le droit de charger. Remplis toutes ces formalités, moi je reste avec Ploërné.
Listel s’éloigna. Dans la pièce voisine, l’un des témoins de Girani attendait. Dans le salon, le marquis et le commandant n’étaient séparés que par la distance d’une fenêtre à l’autre, assistés chacun d’un de leurs amis. Assis devant une petite table, l’Italien écrivait. Penché, le front assombri, il se hâtait, et sa plume courait sans une hésitation. Il savait bien ce qu’il voulait dire. Il poudra l’encre fraîche, plia la feuille, la mit sous enveloppe, écrivit l’adresse : « Monsieur… monsieur… » Burel, qui regardait machinalement, ne put lire le nom. Puis il glissa la lettre sous une seconde enveloppe, et, se tournant vers le jeune officier :
— S’il ne m’arrive rien, ou si je ne suis que blessé, vous me rendrez ce papier. Si je suis tué, vous la porterez au consulat d’Italie à Toulon, sans ouvrir la première enveloppe, sans regarder le nom du destinataire… Vous me le promettez sur l’honneur ?
— Soyez tranquille, je vous le promets.
Au même instant, Listel reparut et dit :
— Messieurs, quand vous voudrez.
D’un même mouvement les deux hommes s’avancèrent, Girani le premier, Ploërné ensuite avec le maître de la maison. Au bas de l’escalier, celui-ci passa devant pour montrer le chemin. On traversa le vestibule, une office, une petite cour, un bout de jardin, et on se trouva sous un bâtiment, portant sur quatre piliers de briques, formant un grand parallélogramme. Sur les quatre côtés, l’air libre et, sous le pied, un sol de terre battue. Dans un coin, du bois à brûler rangé, quelques bouteilles vides et des caisses. Rien qui pût servir de point de repère ou de guide pour le tir : un endroit préparé à souhait. Tout autour la neige tombait, et, dans le jardin déjà blanc, les arbres frissonnaient sous le souffle du vent.
— As-tu quelques recommandations à me faire ? demanda Listel à Ploërné, en le menant à sa place, qui venait d’être marquée, après un mesurage scrupuleux de la distance.
— Aucune autre que d’aller à mon hôtel, si je suis tué, et de prendre tous mes papiers, pour les porter au préfet maritime. Il les classera, gardera ce qui intéresse le service, et rendra le reste à ma famille.
— Bien. Donne-moi la main, voici Burel qui t’apporte ton pistolet, moi je vais porter le sien à Girani.
Le commandant pressa la main de son camarade, sans laisser paraître la moindre émotion. Il était ferme, froid, merveilleusement maître de ses nerfs. Il examinait le terrain avec un calme parfait, et venait de remarquer que, sur un massif de lauriers poudrés à frimas, son adversaire se détachait en noir, comme une véritable cible. Il prit le pistolet que lui tendait Burel, en releva le chien pour appuyer fortement la capsule, le mania deux fois, pour s’assurer qu’il était bien en main, puis, le serrant fortement, il abaissa le bout du canon vers la terre.
— Tu sais, mon vieux, lui glissa Burel, je suis témoin de ton adversaire, mais je voudrais bien te revoir intact, tout à l’heure.
Le commandant le regarda avec fermeté et répondit ces seuls mots, sorte de prière résignée du marin au moment d’aborder le danger : À Dieu vat !
Les témoins s’étaient rangés de chaque côté, et, dans l’espace libre, les adversaires se trouvaient en présence. Girani blême, Ploërné sombre. Tous deux très résolus. Listel, dans le silence, demanda :
— Êtes-vous prêts, messieurs ?
— Oui, répondirent les combattants, d’une seule voix.
Il y eut un léger temps, puis le commandement :
— Feu… un, deux, trois.
Les deux pistolets se levèrent en même temps, une flamme jaillit de celui de l’Italien, et la casquette galonnée du commandant, enlevée par la balle, sauta à dix pas. Ploërné, nu-tête, les sourcils froncés, les lèvres serrées, le canon à la hauteur du visage, offrait l’aspect formidable d’un homme sûr de lui, et qui a réservé son feu. Il resta une seconde immobile, et on eût entendu battre le cœur des assistants, en proie à une angoisse horrible. Enfin une détonation retentit, et le marquis roula dans la poussière.
Tous les témoins s’étaient précipités sur lui. Houchard les écarta du geste et, ouvrant la redingote et le gilet du blessé, il vit sur le plastron blanc, à la hauteur des côtes, un filet de sang qui suintait. Il écarta la chemise : un petit trou violacé étoilait le flanc du malheureux qui, la bouche déjà rouge, haletait avec effort. Le regard anxieusement fixé sur le médecin, il attendit son arrêt :
— Ce ne sera rien, déclara Houchard.
Mais sa physionomie démentait à ce point son langage que l’Italien baissa la tête avec un triste sourire et dit :
— Merci, mon ami ; tout ce que je vous demande, c’est de ne pas me faire souffrir.
Il eut une suffocation, puis ajouta :
— Ah ! C’est un coup bien visé… Et voilà une marquise veuve !
Les témoins se rapprochaient de Houchard pour savoir ce qu’il augurait de son examen.
— Fichu ! murmura entre ses dents le docteur. Il faudrait le transporter chez moi, dit-il plus haut, afin que je puisse le soigner comme il convient. Descendez-moi donc un matelas… Avec une échelle nous ferons une civière…
— Non ! non ! râla Girani. Vous voyez bien que c’est fini… Par grâce, ne me torturez pas…
Houchard dit à ses amis :
— Alors un matelas seulement, pour qu’il soit mieux.
Ploërné s’était détourné et adossé à un des piliers du hangar, la tête nue, il attendait. Listel revint auprès de lui.
— Eh bien ? demanda le commandant.
— Il n’en a pas pour une heure… Remontons, tu ne peux rester là.
Ploërné fit quelques pas, le front penché. Il ramassa sa casquette à laquelle un lambeau d’étoffe était arraché. Mais il fut arrêté par Houchard, comme il allait quitter la place :
— Il voudrait vous parler, avant de mourir, dit-il. Venez, vous ne devez pas lui refuser cette consolation suprême.
Sans répondre, le commandant s’avança, seul. Girani, étendu sur des couvertures, le visage trempé d’une sueur glacée, la bouche rentrée, agonisait.
— Que voulez-vous de moi, monsieur ? dit gravement Ploërné.
— Que vous me tendiez la main, haleta le mourant.
— Soit ! Mais avant, sachez ce que je n’ai pu vous déclarer devant tout le monde. De ces deux jeunes filles, sur lesquelles, indifféremment, peuvent se fixer les soupçons qu’a excités votre récit dans mon esprit, l’une est ma fiancée, et je l’aime de toutes les forces de mon âme… Mesurez l’étendue du mal que vous avez fait. Par grâce… vous voyez, c’est moi qui vous supplie… Ne me laissez pas dans l’horrible incertitude où je suis… Délivrez-moi de mon angoisse et parlez. Laquelle avez-vous voulu désigner : Thérèse… ou Lydie ?… Souhaitez-vous que je vous dise celle que j’aime ?
Girani, de sa tête sur laquelle les ombres violettes de la mort s’étendaient déjà, répondit : non.