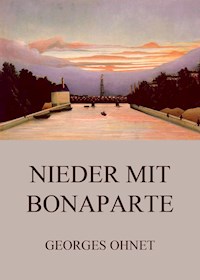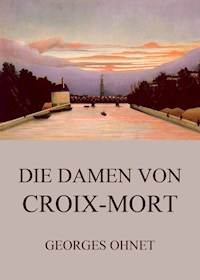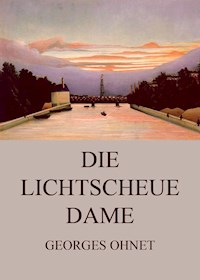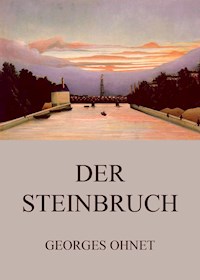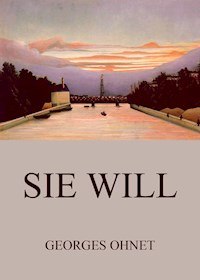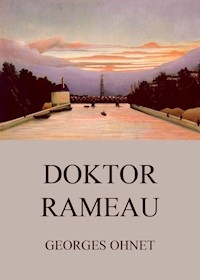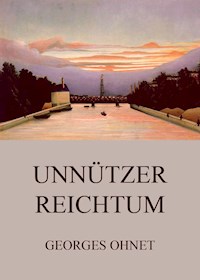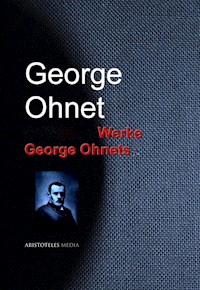1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait
| I
Rue de Châteaudun, sur la façade d’un des immeubles qui avoisinent les jardins, derniers vestiges des seigneuriales demeures où habitèrent Talleyrand et la reine Hortense, se lit, sur une plaque de marbre, cette inscription : Banque de l’Alimentation — Vernier-Mareuil. Cette maison, hautement estimée dans le commerce, porte les noms de deux hommes très connus dans le monde parisien pour leur soudaine et rapide ascension vers la grande fortune. En vingt ans, Vernier et son beau-frère Mareuil, partis de rien, sont arrivés à tenir une place prépondérante à la Bourse, et les banques les plus solides sont obligées de compter avec eux. Par l’alimentation, ils étendent leur influence sur le négoce des vins, des eaux-de-vie et des liqueurs, et enlacent le Midi tout entier sous les mailles d’un gigantesque filet dont ils tiennent la corde dans leurs bureaux de la rue de Châteaudun.
Ils ont établi, pour lutter contre la mévente des vins, un système de prêts sur warrants qui met en leur dépendance tous les viticulteurs de France embarrassés dans leurs affaires. Il est juste de dire qu’ils n’abusent pas de cette puissance formidable, qu’ils ne l’exercent qu’au profit de leurs adhérents, et se bornent, en ce qui les concerne, à se procurer dans des conditions avantageuses les alcools qui leur servent à fabriquer les apéritifs célèbres avec la vente desquels ils ont commencé leur fortune. À la Bourse du Commerce, Vernier-Mareuil sont aussi glorieusement connus, traités avec autant de respectueuse déférence que Rothschild, à la Bourse des Valeurs. Ils sont, au point de vue spécial de l’alimentation, de véritables potentats. Et quand on a dit d’une spéculation : « Les Vernier-Mareuil en sont », il n’y a plus qu’à s’incliner devant la réussite certaine.
Vernier n’avait pas eu des commencements brillants.
Après son service militaire, fait, tant bien que mal, dans un régiment de ligne, à Courbevoie, il était entré, à vingt-quatre ans, chez un marchand de vins du quai de Bercy, qui l’avait initié à tous les mystères de la science œnophile. Il avait, pendant quelques mois, manié le campèche, l’acide tartrique, et fabriqué des tonnes de vin, dans lesquelles l’eau de la Seine entrait pour plus que le jus de la vigne. Le commerce lui avait paru si facile et si simple qu’il avait rêvé de l’exercer pour son propre compte...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
I
II
III
IV
V
VI
GEORGES OHNET
MARCHAND DE POISON
LES BATAILLES DE LA VIE
roman
Paul Ollendorff éditeur,
1903
Raanan Editeur
Livre 675 | édition 1
Marchand de Poison
Les Batailles de la Vie
PREMIÈRE PARTIE
I
Rue de Châteaudun, sur la façade d’un des immeubles qui avoisinent les jardins, derniers vestiges des seigneuriales demeures où habitèrent Talleyrand et la reine Hortense, se lit, sur une plaque de marbre, cette inscription : Banque de l’Alimentation — Vernier-Mareuil. Cette maison, hautement estimée dans le commerce, porte les noms de deux hommes très connus dans le monde parisien pour leur soudaine et rapide ascension vers la grande fortune. En vingt ans, Vernier et son beau-frère Mareuil, partis de rien, sont arrivés à tenir une place prépondérante à la Bourse, et les banques les plus solides sont obligées de compter avec eux. Par l’alimentation, ils étendent leur influence sur le négoce des vins, des eaux-de-vie et des liqueurs, et enlacent le Midi tout entier sous les mailles d’un gigantesque filet dont ils tiennent la corde dans leurs bureaux de la rue de Châteaudun.
Ils ont établi, pour lutter contre la mévente des vins, un système de prêts sur warrants qui met en leur dépendance tous les viticulteurs de France embarrassés dans leurs affaires. Il est juste de dire qu’ils n’abusent pas de cette puissance formidable, qu’ils ne l’exercent qu’au profit de leurs adhérents, et se bornent, en ce qui les concerne, à se procurer dans des conditions avantageuses les alcools qui leur servent à fabriquer les apéritifs célèbres avec la vente desquels ils ont commencé leur fortune. À la Bourse du Commerce, Vernier-Mareuil sont aussi glorieusement connus, traités avec autant de respectueuse déférence que Rothschild, à la Bourse des Valeurs. Ils sont, au point de vue spécial de l’alimentation, de véritables potentats. Et quand on a dit d’une spéculation : « Les Vernier-Mareuil en sont », il n’y a plus qu’à s’incliner devant la réussite certaine.
Vernier n’avait pas eu des commencements brillants.
Après son service militaire, fait, tant bien que mal, dans un régiment de ligne, à Courbevoie, il était entré, à vingt-quatre ans, chez un marchand de vins du quai de Bercy, qui l’avait initié à tous les mystères de la science œnophile. Il avait, pendant quelques mois, manié le campèche, l’acide tartrique, et fabriqué des tonnes de vin, dans lesquelles l’eau de la Seine entrait pour plus que le jus de la vigne. Le commerce lui avait paru si facile et si simple qu’il avait rêvé de l’exercer pour son propre compte. Il avait loué une petite boutique avenue de Tourville, près de l’École militaire, et s’était mis à pratiquer la falsification des boissons avec autant de suite que de succès.
Mais bientôt la vente du vin, dans lequel il n’y avait pas de vin, lui parut sans intérêt. Il rêva de doter l’ivrognerie nationale d’un produit personnel, et comme ses études en l’art de frelater les liquides lui avaient donné quelques notions de chimie, il se décida à créer un apéritif. Ce n’était encore qu’un « Prunelet », à base d’alcool à quatre-vingt-dix degrés, qui faisait dresser les cheveux sur la tête à tout homme sain, mais procurait une douce sensation de chaleur dans la gorge de tout pochard invétéré. Or, ce n’était que pour les pochards que Vernier-Mareuil travaillait.
Il avait promptement compris qu’il n’y a rien à faire avec les gens sobres, et que la société, détraquée par le socialisme, affolée par la haine de tout ce qui est respectable : la morale, la religion, la patrie, était mûre pour le coup de grâce de l’ivrognerie triomphante. Il lisait les journaux, dans ses heures de chômage, et savait qu’un alcoolique engendre un alcoolique. Il cultivait donc l’abâtardissement de la race avec un soin méthodique, et chaque billet de mille francs qu’il serrait précieusement dans sa caisse représentait, pour lui, la raison, le courage, le génie peut-être des malheureux qu’il avait intoxiqués.
Il était sans remords. « Si ce n’est pas moi qui leur vends ce qu’ils aiment à boire, disait-il, les jours où il raisonnait avec lui-même, ce sera le voisin, et je n’en aurai pas le bénéfice. On n’empêche pas de boire celui qui a soif. Et qu’est-ce que ça fait que ce soit l’un ou l’autre qui en profite ? » Il ne s’expliquait pas sur la question des poisons qui formaient la base de son breuvage. Il était établi, pour lui, que tous les commerçants se livraient aux mêmes procédés de fabrication. Il n’y avait donc pas à se préoccuper de la moralité du négoce, qui était infâme par destination. Il eut cependant quelques petits ennuis qui auraient pu lui ouvrir les yeux sur la régularité de ses opérations s’il n’avait pas été décidé à rejeter tout scrupule.
Il rentrait, depuis quelques semaines, à la caserne, de l’École, tant de soldats dans des états d’abrutissement ou de fureur d’un caractère si morbide, que le médecin-major, qui ne péchait cependant pas par excès de soin, s’inquiéta et crut devoir faire une enquête sur les débits dans lesquels fréquentaient les hommes qui présentaient ces symptômes d’empoisonnement alcoolique. Les adjudants interrogés furent tous d’accord pour désigner le café de l’avenue de Tourville, où trônait, en bras de chemise, le tablier noir du mastroquet sur le ventre, le distillateur Vernier. Le major se lit apporter une bouteille du « Prunelet » au nom engageant et à l’apparence débonnaire, qui ravageait ainsi les cerveaux des hommes de la classe, et, se défiant de ses facultés d’analyse, il envoya purement et simplement le liquide au Laboratoire municipal, avec une apostille du colonel.
Le résultat ne se fit pas attendre.
Le rapport de l’expert fut foudroyant, comme la liqueur elle-même. Les substances les plus nocives étaient mélangées dans l’apéritif Vernier-Mareuil, avec une audace qui ressemblait à de la candeur. On aurait précipité un homme sain et vigoureux dans l’épilepsie, en peu de temps, avec un produit moins compliqué. Il y avait exagération dans l’empoisonnement. Une descente de police eut lieu dans la cave où le brave garçon composait sa liqueur. On trouva un matériel bien simple : un coquemard en fonte, un alambic, un fourneau, de l’alcool et des poudres. Le tout n’emplit pas une petite charrette à bras. Sainte-Anne était déjà peuplée de plus d’aliénés dus à Vernier que son matériel ne pesait de décigrammes.
Traduit en police correctionnelle, le délinquant fit preuve d’une telle douceur, exprima de tels regrets que les juges crurent à son inconscience. Il fit, comme pendant le reste de sa vie, aux heures les plus difficiles, la meilleure impression. Il avait reçu du ciel le masque d’un honnête homme et une voix persuasive. Il n’en faut pas plus, dans des temps où la vertu est rare, pour parvenir, avec les actions les plus abominables sur la conscience, aux plus hautes situations.
De sa première rencontre avec la justice de son pays, Vernier se tira avec cinq cents francs d’amende et l’affichage du jugement à la porte de son établissement. Il poussa un ouf de satisfaction. Son avocat — car il s’était fait défendre ; c’est sans doute ce qui lui valut d’être condamné — lui avait laissé entrevoir six mois de prison. Il rentra donc avenue de Tourville avec la tranquillité d’un homme qui se considère comme innocenté, puisqu’on ne l’a pas jeté sous les verrous.
Il protesta de la pureté de ses intentions à l’égard de l’armée française, laissa entendre que le major était un âne. Mais il changea de mixture, supprima les poudres et augmenta le degré d’alcool.
Sa clientèle doubla. On eût dit que, depuis qu’il était avéré que Vernier assassinait ses pratiques, l’engouement pour sa liqueur se fût accru, comme si ce flot de buveurs qui roulait devant son comptoir se précipitait, de son plein gré, à la démence et à la mort. Vainement de nouveaux échantillons avaient été prélevés sur ses produits, par la rancune en éveil du major. Ils ne contenaient plus rien de nuisible que de l’alcool qui corrodait la tôle des tables et brûlait le drap des uniformes. Mais c’était de la production courante. Et, à moins de consigner l’établissement, il n’y avait rien à faire.
Cependant Vernier voyait prospérer son commerce. Il était béni par la Providence comme s’il eut fait le bien. Son orgueil n’en était pas enflé. Mais il songeait au moyen de décupler ses capitaux. C’est alors qu’il se trouva en rapport avec l’homme qui devait donner à son industrie morticole toute l’extension qu’elle méritait de prendre pour le malheur de l’humanité. Il rencontra Mareuil. Celui-ci était un bohème qui battait le pavé de Paris, continuellement à la recherche des dix francs qu’il lui fallait pour vivre avec sa sœur, dans un petit appartement des Batignolles. Maigre, noir, hâbleur comme un bon méridional, il avait essayé de tout, même de la littérature, sans parvenir à se faire une place. Il ne répugnait à aucune tâche, pourvu qu’elle fût rétribuée.
Cependant il était honnête et n’aurait pas pris un centime à son prochain, à moins que ce ne fût en traitant une affaire.
Alors, rouler la partie adverse lui paraissait le premier des devoirs, presque une nécessité professionnelle. Il était sobre, dur et entêté comme un âne. Il n’aimait au monde que sa sœur Félicité, et n’avait qu’un but : lui assurer un avenir tranquille. Elle faisait de la lingerie bien misérablement dans son petit logis, pendant que Mareuil cherchait la fortune sur le pavé de bois de la ville. Il était rabatteur pour le compte d’un annoncier, quand sa déambulation sans répit le conduisit avenue de Tourville. Il entra dans le café de Vernier, et sur les offres du patron qui lui poussait un verre de son fameux Prunelet, il entra en propos. Vernier vanta les vertus de sa liqueur. Mareuil s’étonna qu’il n’eût pas l’idée d’en faire célébrer les mérites par la presse. Il entonna son boniment :
— La réclame, monsieur, n’est-elle pas le plus puissant, le seul levier de l’époque ? Avec la réclame, monsieur, on fait passer un idiot, aux yeux des électeurs, pour un homme de talent et on le pousse au ministère ! Avec la réclame… Tenez, monsieur, la réclame, c’est bien simple… Je vous fais une annonce périodique, pendant un mois, de semaine en semaine, dans mes journaux… Ça ne vous coûte rien !
— Rien ? s’écria Vernier, alléché par cette déclaration. Alors que gagnez-vous ?
— Vous allez comprendre le mécanisme de l’opération… Je vous avance ma publicité… Mais vous, sur toute vente de votre Prunelet que vous ferez hors de votre établissement, vous me paierez un droit de dix centimes par bouteille.
Vernier, qui n’avait jamais débité de sa liqueur que chez lui, regarda son interlocuteur avec un air narquois.
Il se dit : « Tu veux m’enfoncer. Je ne sais comment. Mais l’enfoncé, ce sera toi. Qu’est-ce que je risque ? Si je ne vends rien, je ne paierai pas. Et si, par hasard, la réclame agissait… si je vendais ! »
Une flamme d’orgueil monta au cerveau de Vernier, qui se vit marchand en gros, expédiant des caisses de Prunelet dans tous les cafés de la province, et, qui sait ? de Paris peut-être. Il dit :
— Ça me va. Topez ! Mais vous dînerez bien avec moi pour causer de notre affaire.
Déjà, c’était « notre » affaire ! Les deux complices firent un petit dîner fin, dans l’arrière-boutique du café, et Mareuil rédigea, au dessert, l’annonce dont il comptait bien obtenir de son patron la publicité gratuite. C’était, à peu de chose près, l’annonce si honnêtement alléchante qui servit, plus tard, au lancement du célèbre Royal-Vernier-Mareuil-Carte jaune. On y trouvait déjà « les cognacs supérieurs récoltés, par Vernier lui-même, dans son domaine de Régnac (Charente) ». Brave Vernier, qui achetait de l’eau-de-vie de grains, à réveiller les morts ! Le domaine de Régnac ! Il fallut se le procurer, aux jours de la prospérité, et le baptiser ainsi pour sauvegarder la vérité des boniments antérieurs.
Mareuil, vers les dix heures, partit de l’avenue de Tourville, nanti d’une fiole de Prunelet qu’il offrit à son annonceur, en l’honneur des quelques lignes de sa première réclame. Mais ce n’était ni sur la publicité des journaux, ni sur l’excellence de la liqueur que Mareuil comptait, c’était sur son action personnelle. Le Prunelet de Vernier, déposé chez un entrepositaire par les soins de Mareuil, s’enleva par caisses, dès la première quinzaine ; et voici comment.
Mareuil avait des camarades. Il convint avec eux d’une petite comédie à jouer dans les cafés du boulevard. Mareuil entrait. À la question du garçon : « Que faut-il servir à Monsieur ? » il répondait nettement :
— Prunelet-Vernier, et de l’eau frappée…
Naturellement le garçon répondait :
— Prunelet-Vernier ? Nous n’avons pas ça…
— Ah ! vous n’avez pas ça ? Quand vous l’aurez, je reviendrai.
Il sortait. La dame du comptoir appelait le garçon et s’informait. L’explication donnée par lui jetait l’inquiétude dans l’esprit de la caissière. Dans la même journée, deux ou trois amis de Mareuil venaient réclamer tour à tour du Vernier. La conséquence forcée, c’était l’achat d’une caisse de Prunelet. Une fois la caisse achetée, il fallait la vendre. Et alors une autre parade commençait : celle du garçon passionné pour faire consommer aux clients le Vernier que la maison avait sur les bras. La tactique de Mareuil réussit tellement bien qu’en six mois il toucha quinze cents francs de commission, et que Vernier entama la fabrication de sa liqueur en grand. Il installa un dépôt décent rue Montmartre. Et, comme il fallait une personne de confiance pour tenir les comptes, ce fut Mlle Félicité Mareuil qui, de la lingerie, passa aux écritures. Vernier l’apprécia. Elle était blonde, douce et timide. Il lui fit la cour, et, au moment où il vendait son café de l’avenue de Tourville pour s’établir distillateur à Aubervilliers, il épousa la sœur de Mareuil, devenu son associé.
L’union de ces trois êtres était exemplaire. Ils ne vivaient que pour le travail.
Vernier distillait, transvasait, soutirait, emballait. Mareuil courait la France et l’Étranger pour placer le Prunelet. Et Félicité tenait la caisse, qui s’emplissait à mesure que les hangars de la fabrique d’Aubervilliers se vidaient de leurs piles de caisses, répandant l’abrutissement, la folie et la mort aux quatre coins du monde. Jamais gens plus honnêtement laborieux, plus scrupuleusement consciencieux, ne concoururent à une œuvre aussi malsaine. On leur eût donné le prix Montyon, pour l’application et la probité avec lesquelles ils dirigeaient leur commerce. Si on eut mesuré les ravages causés par ce qu’ils fabriquaient, on les eût condamnés au bagne. C’étaient de vertueux assassins. Ils faisaient tout doucement fortune en empoisonnant l’humanité.
Vernier, en quête de progrès, ne s’en tenait pas à la fabrication du Prunelet. Il avait lancé son Royal-Vernier-Carte jaune, et préparait une « Arbouse des Alpes » dont il espérait merveilles. La fabrique d’Aubervilliers s’agrandissait, et les travées succédaient aux travées, multipliant les bouilleurs, les cuiseurs, les alambics. C’était, dans l’intérieur des bâtiments, une succession de tuyaux de cuivre distillant les poisons divers qui se déversaient dans des cuves, puis passaient aux ateliers de saturation, où les divers arômes qui constituaient les secrets de la fabrication leur étaient incorporés.
Un laboratoire de chimie était annexé à l’établissement. Là, dans un cabinet sévère, Vernier recevait avec une magistrale sérénité les représentants de l’administration chargés de contrôler les entrées et les sorties d’alcool. Tout se faisait au grand jour chez lui. Il se savait si bien libre de tout mettre dans ses bouteilles, à la condition de ne pas frauder le fisc ! Et n’avait-il pas pour complice l’État, qui se trouvait être son meilleur client ? Plus il vendait de liqueurs, plus l’État percevait de droits.
Alors la France entière pouvait bien tomber en état d’épilepsie. Qu’importait ? Puisque les intérêts de l’État étaient sauvegardés !
Cependant, une ombre vint obscurcir la sérénité splendide avec laquelle Vernier travaillait à faire sa fortune en abâtardissant la race française. Il y avait, attaché au laboratoire, un dégustateur chargé de rendre compte de l’égalité du dosage des produits. Chaque cuvée était goûtée par lui, afin que jamais les liqueurs ne pussent présenter dans leur composition la moindre différence. Le dégustateur logeait dans un petit pavillon voisin de l’administration, et, toute la journée ; il sirotait les échantillons prélevés pour lui à la fabrique. Il ne les avalait jamais. Il les crachait, afin, disait-il en riant, de n’être pas pochard, tous les matins, avant dix heures.
Au bout de deux ans, cet homme, très solide en apparence, mourut. Il fut remplacé par un autre employé, qui ne dura que six mois. Le troisième fit un an et devint phtisique. C’était un garçon de vingt-deux ans qui soutenait sa mère. Il se mit à tousser, à pâlir. Sa mère, affolée, vint trouver Vernier et le pria de changer son fils de service. Le bon Vernier y consentit. Mais le malade était déjà trop gravement atteint. Il mourut, comme son prédécesseur. Alors la mère, dans une crise de désespoir, vint, après l’enterrement, faire une scène horrible à Vernier, l’accusant de la mort de son enfant. Elle criait à travers ses larmes, ameutant le personnel de l’usine :
— Ce sont les infamies que vous lui avez fait boire qui l’ont tué ! Il me le disait : « C’est comme du plomb fondu qui me coule dans la bouche, à la dixième dégustation ! » Sa poitrine n’y a pas résisté… Il est mort pour que vous entassiez des centaines de mille francs. Mais ça ne vous portera pas bonheur !
Vainement Mareuil, qui était présent, essaya de raisonner cette pauvre femme ; il lui glissa doucement des billets de banque dans la main. Elle les rejeta avec indignation.
— Est-ce avec de l’argent que vous espérez me payer mon fils ? Le tort que vous m’avez fait est impossible à évaluer. C’est mon cœur que vous m’avez pris !
Et comme Mme Vernier, enceinte, paraissait à son tour pour tâcher de calmer la douleur de cette mère farouche, celle-ci reprit avec véhémence :
— Vous serez punis dans votre enfant ! Oui, si le ciel est juste, vous aurez un fils qui vous fera expier tout le mal que vous avez fait aux familles !
Mme Vernier rentra consternée chez elle. Les imprécations de cette femme en deuil l’avaient saisie. Elle se sentit frappée d’un pressentiment. Elle se renferma dans un sombre mutisme. Vernier ne savait que lui dire pour dissiper l’impression déplorable produite par cette scène. Il s’en ouvrit au docteur Augagne, qui, déjà très en vue comme gynécologue, avait été appelé auprès de Mme Vernier pour lui donner des soins. Le jeune agrégé l’écouta, pensif. Puis, avec une grande fermeté de langage :
— Il est incontestable que l’industrie que vous avez entreprise et où vous faites fortune est pernicieuse. Vous me répondrez que les fabricants d’allumettes, qui font manier le phosphore par leurs ouvriers, les miroitiers, qui les mettent à même le mercure pour l’étamage des glaces, et les marchands de couleurs, qui leur donnent des coliques de plomb, et tant d’autres qui vivent sur la détérioration humaine ne sont pas plus dangereux ni plus coupables que vous. Je ne vous dirai pas le contraire. Cependant, il faut, pour les besoins de la vie, des allumettes, des glaces, des couleurs ; tandis qu’il n’est pas indispensable de boire des alcools. L’ivrognerie est un vice, et l’exploitation d’un vice est un acte abominable en soi.
— Vous ne pouvez pourtant pas me conseiller de fermer boutique et de renoncer à une industrie qui m’a été si avantageuse.
— Au point de vue de la moralité absolue, je ne devrais pas hésiter. Mais, dans la pratique, et avec la moyenne de tolérance qu’exige l’imperfection humaine, je vous dirai : Tâchez de rendre vos produits aussi peu nocifs que possible. L’idéal serait de n’en pas faire. Si vous en faites, tâchez qu’ils soient sans danger. Mais est-il une boisson alcoolique sans danger ?
— Ah ! vous me désolez ! gémit Vernier. Je me considérerais comme un criminel, si je prenais ce que vous me dites au pied de la lettre. Et je suis un brave homme, je n’ai jamais fait tort d’un centime à personne. Je tâche d’être utile à mes semblables le plus que je peux. Je ne refuse jamais un secours à un malheureux… Ma femme…
— C’est un ange ! interrompit le docteur. Je sais le bien qu’elle répand autour d’elle, en votre nom. Mais ceci ne rachète pas cela. Il est mauvais de vivre sur la mort. Votre fortune, qui commence et sera certainement très belle, s’élève sur des tombes. Vous construisez dans un cimetière, avec les ossements de vos victimes. Il faut que vous songiez à cela. Un pays d’imagination comme la France, qui se met à boire de l’alcool, est perdu en vingt ans. La race s’étiole, les sources de la génération se tarissent, l’intelligence s’obscurcit, et, là où triomphaient la sagesse, l’ordre, la patience, se déchaînent la nervosité, l’incohérence et la fureur. Voilà ce que l’alcool fait d’un peuple fier, brave et spirituel : une brute féroce et dégoûtante. Tous les gouvernements étrangers ont édicté des lois pour arrêter les progrès de l’alcoolisme. Dans tous les pays du Nord, la vente de l’eau-de-vie est interdite et un ivrogne est considéré comme un malade. Aussi les races se relèvent, redeviennent énergiques et entreprenantes. Pendant ce temps, la France passe au premier rang de l’alcoolisme, elle marche en tête, la bouteille à la main. Et pourquoi ? Parce que l’État a intérêt à laisser se propager l’ivrognerie, parce que l’alcool est pour lui un moyen de domination et que, par ses milliers de cabaretiers, il a étendu sur la France tout entière un réseau électoral dont il ne veut pas la laisser sortir. L’alcoolisme et la démocratie, dans ce malheureux pays, marchent d’accord. Et quand l’électeur manifeste une velléité de révolte, le débitant d’ivresse est là, qui lui tend son verre et lui dit : « Bois et vote ! » Et peu à peu, en dépit de nos révoltes d’orgueil, nous tombons au dernier rang des nations civilisées. Car il y a une loi inéluctable : la force physique d’un peuple est en raison directe de sa sobriété. Il faut qu’une nation ait du sang dans les veines pour pouvoir travailler et combattre. Or, ce qui fait du sang, c’est le pain. L’alcool ne fait que de la lymphe. Donc une nation qui boit est une nation perdue. Et tous ceux qui l’ont aidée à boire sont des criminels, depuis l’industriel qui fabrique la boisson jusqu’à l’État qui permet qu’on la vende.
Vernier, consterné, regarda partir avec soulagement l’intransigeant Augagne. Il rentra dans son bureau, où il raconta à Mareuil la scène qui venait de le bouleverser.