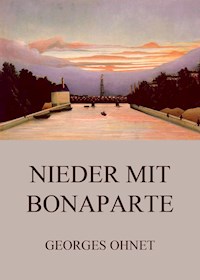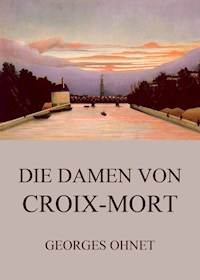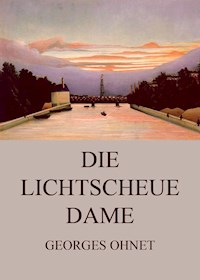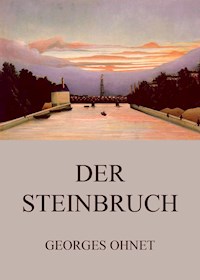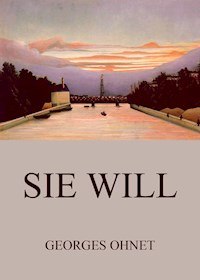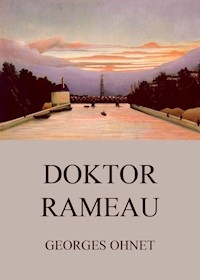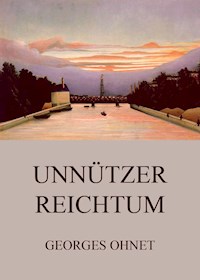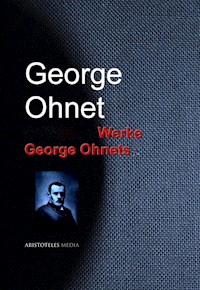1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait
| I
Le docteur Davidoff, d’un air inspiré, tournant vers les convives du prince Patrizzi son visage aux traits rudes et tourmentés, laissa, au milieu de la discussion, tomber ces surprenantes paroles :
– Et vous, croyez-vous à la puissance d’une suggestion répétée, qui fait entrer une idée dans votre cerveau, aiguë et persistante comme la pointe d’une vrille ? Croyez-vous que cette idée puisse influer sur votre état moral, jusqu’à modifier votre état physique, car vous me concéderez bien, n’est-ce pas, que le moral a une action souveraine et décisive sur le physique ?...
– Nous vous le concédons, répondit tranquillement le Napolitain. Maintenant, et c’est là que je vous attends, il faudrait conclure...
À cette riposte, qui promettait une importante suite de développements à la proposition formulée par le médecin russe, parmi les gais viveurs et les aimables femmes qui venaient d’achever de dîner, dans le salon de l’Hôtel de Paris, sur la terrasse de Monte-Carlo, il y eut un instant de silencieuse stupeur. Autour de la table, somptueusement servie, et sur laquelle, dans la chaleur des lumières et la fumée des cigarettes, les fleurs se mouraient asphyxiées, des regards d’étonnement et d’ennui s’échangèrent. Puis, brusquement, protestation indignée de ces mondains arrachés à la futilité coutumière de leurs propos, et jetés dans les aridités d’une conversation scientifique, un ouragan d’apostrophes et de cris se déchaîna.
– Assez de physiologie !...
– Nous sommes ici pour boire, fumer et rire...
– C’est un cabinet particulier et point une clinique...
– Zut pour le docteur ! Il est paf !
– Messieurs, je vous en prie, écoutez, c’est très curieux !
– On embête ces dames !...
– Ouvrez la fenêtre, ça pue la science !
– Moi, j’aimerais mieux être au casino... J’ai rêvé que la rouge passait treize fois...
– En voilà une suggestion que le croupier t’a imposée !...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
GEORGES OHNET
L'ÂME DE PIERRE
roman
Paul Ollendorff, Éditeur
1890
Raanan Editeur
Livre 674 | édition 1
I
Le docteur Davidoff, d’un air inspiré, tournant vers les convives du prince Patrizzi son visage aux traits rudes et tourmentés, laissa, au milieu de la discussion, tomber ces surprenantes paroles :
– Et vous, croyez-vous à la puissance d’une suggestion répétée, qui fait entrer une idée dans votre cerveau, aiguë et persistante comme la pointe d’une vrille ? Croyez-vous que cette idée puisse influer sur votre état moral, jusqu’à modifier votre état physique, car vous me concéderez bien, n’est-ce pas, que le moral a une action souveraine et décisive sur le physique ?...
– Nous vous le concédons, répondit tranquillement le Napolitain. Maintenant, et c’est là que je vous attends, il faudrait conclure...
À cette riposte, qui promettait une importante suite de développements à la proposition formulée par le médecin russe, parmi les gais viveurs et les aimables femmes qui venaient d’achever de dîner, dans le salon de l’Hôtel de Paris, sur la terrasse de Monte-Carlo, il y eut un instant de silencieuse stupeur. Autour de la table, somptueusement servie, et sur laquelle, dans la chaleur des lumières et la fumée des cigarettes, les fleurs se mouraient asphyxiées, des regards d’étonnement et d’ennui s’échangèrent. Puis, brusquement, protestation indignée de ces mondains arrachés à la futilité coutumière de leurs propos, et jetés dans les aridités d’une conversation scientifique, un ouragan d’apostrophes et de cris se déchaîna.
– Assez de physiologie !...
– Nous sommes ici pour boire, fumer et rire...
– C’est un cabinet particulier et point une clinique...
– Zut pour le docteur ! Il est paf !
– Messieurs, je vous en prie, écoutez, c’est très curieux !
– On embête ces dames !...
– Ouvrez la fenêtre, ça pue la science !
– Moi, j’aimerais mieux être au casino... J’ai rêvé que la rouge passait treize fois...
– En voilà une suggestion que le croupier t’a imposée !
– Voulez-vous danser ?
– Oh ! oh ! Laura, assieds-toi sur le piano !
– Eh bien ! mes enfants, allez où vous voudrez, mais fichez-nous la paix...
– N’insistez pas pour que nous restions ! Non ! Vous tenteriez vainement de nous retenir...
– En voilà des malhonnêtes !
Trois ou quatre femmes et cinq ou six jeunes gens se levèrent en tumulte et demandèrent leurs manteaux au maître d’hôtel qui s’empressait. Patrizzi resta assis, souriant aux belles dames qui, avec de coquets mouvements, déplissaient leur jupes et cambraient leur corsage. Il tendit nonchalamment la main à ses amis et dit :
– Que chacun fasse à sa guise. Partez en avant. Dans une heure nous allons vous rejoindre...
Puis, se tournant vers le peintre Pierre Laurier, son ami Jacques de Vignes et vers le docteur Davidoff, qui n’avaient pas bougé :
– Continuez donc, mon cher, dit-il au médecin, vous m’intéressez prodigieusement.
Le médecin russe jeta sa cigarette, en alluma une autre, et, regardant avec autorité ses trois auditeurs, il poursuivit le récit qui avait été violemment coupé par les interruptions des convives maintenant éloignés.
– Je confesse que l’histoire que j’avais commencée devant nos amis est assez singulière et que, pour des sceptiques, elle manque un peu de vraisemblance ; mais, dans nos pays slaves, brumeux et sombres, qui semblent vraiment la patrie des spectres et des fantômes, elle n’aurait pas soulevé la moindre incrédulité... La moitié de nos compatriotes se compose de Swedenborgistes inconscients, qui admettent, ainsi que le grand philosophe, mais sans les raisonner, les phénomènes du monde invisible, et vous affirmeriez devant eux, comme je le fais devant vous, le fait surprenant de la transmission d’une âme à un corps vivant, par la seule volonté d’une personne décidée à mourir, que vous les verriez pâlir, trembler, mais non point protester. Chez nous, on croit aux vampires qui sortent de leur tombe lorsqu’un rayon de lune en touche la pierre, on admet les apparitions révélatrices de la mort prochaine. Et, par la seule raison qu’on croit à ces miracles, on les rend possibles... Une conviction forte est le plus puissant des fluides, et le spiritisme a pour première condition une confiance absolue. Si vous doutez, vous disent les adeptes, n’essayez pas de pénétrer nos mystères, ils demeureront pour vous immuablement insondables... Le monde des invisibles ne se révèle qu’à ceux qui aspirent ardemment à le connaître. Les railleurs et les incrédules le trouveront toujours fermé.
Jacques de Vignes eut un accès de toux douloureuse, qui fit pâlir son beau et mélancolique visage ; il reprit sa respiration avec effort, et, se tournant vers le docteur, comme ranimé par une espérance secrète :
– Et vous avez été témoin de l’aventure ? dit-il, d’une voix étouffée. Vous avez vu cette jeune fille renaître à l’existence, reprendre des forces, retrouver la santé, comme si la vitalité de son fiancé avait passé tout entière en elle ?
– Je ne discute pas la matérialité du fait, répondit Davidoff, je vous en donne purement et simplement la conséquence psychologique. Wladimir Alexievich, voyant Maria Fodorowna, qu’il adorait, s’éteindre peu à peu, ainsi qu’une lampe dont l’huile tarit, ayant consulté vainement tous les médecins de Moscou et m’ayant fait venir de Saint-Pétersbourg, moi qui vous parle, pour entendre tomber de ma bouche un arrêt de mort, eut l’idée de s’adresser à une vieille sorcière Tongouse, qui avait apporté de Nijni-Nowgorod la réputation de faire des prodiges. Il alla la consulter un soir, la veille de Noël. La damnée créature le reçut dans un bouge du faubourg, et, après s’être livrée, devant lui, à de terrifiantes incantations, elle lui donna à boire, dans une tasse de bois, un breuvage d’une odeur bizarre. Comme il hésitait elle le regarda d’un air menaçant, et dit :
– Tu prétends aimer une femme et la vouloir sauver, même au prix de ta vie, et tu n’oses pas seulement boire une liqueur inconnue, fût-elle du poison ?... Oh ! oh ! Homme, fils d’homme, lâche comme tous les hommes... souffre et pleure comme un homme, puisque tu ne sais pas te mettre au-dessus de l’humanité !
Au même moment, Wladimir Alexievich, honteux, vida d’un trait la coupe grossière, et il lui sembla qu’il était en proie à une ivresse subite. Une chaleur délicieuse le pénétrait, et il devenait léger, léger, à croire qu’il allait s’envoler. Ses regards étaient voilés d’un brouillard lumineux, comme si, à travers un nuage, de vives clartés avaient frappé ses yeux. Son sang pétillait dans ses veines, et des hymnes séraphiques chantaient à ses oreilles. Il se sentit emporté dans des espaces immenses, et sur son front glissèrent des fraîcheurs exquises. Peu à peu, il perdit le sens des choses terrestres, et, au milieu d’un transport divin, dans une béatitude extatique, il vit s’avancer vers lui, figure céleste, une blanche et sublime apparition qui, d’une voix douce comme le chant des anges, lui dit :
– Tu veux racheter la vie de celle que tu aimes ? Donne la tienne en échange. Ton âme dans son corps, et ton corps, à toi, dans la froide terre. Tu n’auras rien à regretter, puisque tu seras en elle, et que son bonheur sera la source de ta joie.
Le céleste fantôme s’abolit dans les lumineuses brumes, et Wladimir Alexievich revint à lui. Il se retrouva dans le bouge de la Tongouse, près d’un feu de sapin fumeux. La vieille marmottait des paroles confuses et ne paraissait pas s’occuper de son hôte d’une heure. Épouvanté de ce qui lui avait été révélé, le jeune homme essaya de réfléchir, de se rendre compte de son étrange aventure. Il ne vit, devant ses yeux, qu’une sorcière sale et indifférente, qui l’avait mis en rapport avec les Esprits, comme le gardien d’un temple vous ouvre le sanctuaire où resplendissent les dieux. Il mit la main sur l’épaule de la vieille. Elle tourna vers lui des regards ternes, et de sa voix sardonique :
– Eh bien ! Sais-tu ce que tu voulais savoir ?
– Par quel moyen m’as-tu enlevé la connaissance des choses du monde extérieur ? demanda-t-il. Que m’as-tu fait boire ?
– Que t’importe ? As-tu vu les invisibles ?
– Par quel sortilège me les as-tu montrés ?
– Demande-le à eux-mêmes !... Ils sont là, tout autour de toi ? Vas-tu douter ? Alors reste sans espérance. Fie-toi à eux, et les délices suprêmes t’attendent !
La taille de la sorcière grandit, son visage s’embellit d’une fierté sauvage, en montrant la porte à Wladimir :
– Ne tente pas le ciel... Va-t’en ! Et crois ! Crois !
Il laissa tomber à terre sa bourse, que la vieille poussa vers le foyer d’un pied dédaigneux. Elle ouvrit ses bras, comme pour une invocation dernière, et, le front rayonnant d’une flamme inspirée, elle répéta, avec un accent qui fit vibrer la poitrine de Wladimir Alexievich :
– Crois ! pauvre enfant ! Là est le salut. Crois !
Il sortit, rentra chez lui, écrivit une partie de la nuit, et, le lendemain, quand on entra dans sa chambre, on le trouva mort.
– Et sa fiancée revint-elle à la vie ? demanda Pierre Laurier.
– Elle revint à la vie, répondit Davidoff ; mais, quoiqu’elle fût charmante et adorée, elle ne voulut épouser aucun de ses soupirants, et resta fille, comme si elle eût été fidèle à un mystérieux et intime amour.
– Et croyez-vous à ce prodige, vous, docteur ? demanda Jacques de Vignes avec effort.
Davidoff hocha la tête, et d’un ton railleur :
– Les médecins ne croient pas à grand-chose, dans le siècle où nous sommes. Le matérialisme a de nombreux adeptes parmi mes confrères. Cependant le magnétisme a, dans ces temps derniers, revêtu de si étranges formes que des horizons nouveaux se sont ouverts devant nos yeux. Nous côtoyons le spiritisme qui certifie l’existence de l’âme. Et admettre l’influence de la suggestion mentale sur les sujets en proie au sommeil hypnotique, n’est-ce pas être bien près de croire à un principe supérieur, qui dirige et par conséquent domine la matière ?...
– Vous philosophez, mon cher, interrompit le prince, et vous ne répondez pas.
– Oh ! vous, Patrizzi, dit en riant Pierre Laurier, vous croyez à saint Janvier, et, dans les cas graves, vous invoquez la Madone ; vous portez des cornes de corail contre la jettature et vous palissez quand vous voyez un couteau et une fourchette en croix sur la nappe. Vous êtes donc une recrue toute préparée pour les diableries de Davidoff... Mais Jacques et moi, nous sommes plus coriaces et il nous faudrait quelques preuves pour nous convaincre.
– Ce serait pourtant bon de croire à une influence souveraine, qui pourrait rendre la vie, murmura le malade. Oh ! s’attacher, même follement, à une espérance suprême ! Ne serait-ce pas le salut ? La confiance n’est-elle pas pour moitié dans la guérison ?
– Parbleu ! Voilà les paroles les plus raisonnables qui aient été prononcées depuis deux heures ! s’écria Pierre Laurier... Au diable vos sorciers, vos Swedenborgistes, vos apparitions lunaires et vos âmes, qui passent de corps en corps, comme le furet du Bois-Joli. Donner à un malade la certitude qu’il guérira, c’est presque infailliblement amener sa guérison, voilà la vérité !... Ainsi, prenez mon ami Jacques de Vignes ici présent, et qu’on a envoyé dans le Midi parce qu’il a attrapé un rhume ; faites-lui comprendre que son mal est chimérique, qu’il n’a point les poumons attaqués, qu’il a le plus grand tort de s’écouter, enfin démontrez-lui qu’il n’a qu’un bobo sans importance, et, supprimant la cause, vous supprimez l’effet. Ledit Jacques de Vignes est contraint de renoncer à son parler affaibli, à ses yeux languissants, à ses regards wertheriens... Il revient à la vie, au bifteck, au cigare, et aux jolies femmes...
– Hélas ! murmura Jacques, dont une toux profonde ébranla la poitrine. Que je voudrais pouvoir espérer !... J’aime la vie, et, chaque jour, je la sens qui m’échappe un peu plus...
Le peintre mit la main sur l’épaule du malade, et, d’une voix amicale :
– Tu ne me crois pas, quand je te dis que tu n’es point gravement atteint, tu ne crois pas Davidoff, qui t’a examiné... Tu veux garder, malgré tout, ton inquiétude, et te frapper comme à plaisir ? Tu désoles ta mère, cependant, et tu fais pleurer ta sœur... Rien ne pourra donc te convaincre ? Faudra-t-il que je recommence, pour toi, ce que fit Wladimir Alexievich, et que je te passe une âme de rechange ? Je n’ai que la mienne, tu sais, et elle n’est pas bien fameuse ! Va, si je te la donne, un soir, dans un accès de spleen, je ne te ferai pas un brillant cadeau !... Mais à cheval donné on ne regarde pas la bride, et l’important c’est que tu vives, toi qui as tout pour être heureux, toi qui es aimé, toi qui serais pleuré... Tandis que moi, je peux bien sauter, tout à l’heure, de la terrasse du Casino dans la mer... Qui regrettera ce fou, qui s’appelle Pierre Laurier, ce peintre impuissant à saisir son idéal, ce joueur blasé sur les émotions du jeu, cet amant bafoué par sa maîtresse, ce viveur las de la vie ?
Il ébranla la table d’un coup de poing, et, le visage convulsé par une émotion douloureuse, les lèvres tordues par un rire amer :
– Je suis bien bête de m’entêter à recommencer tous les matins l’existence que je maudis tous les soirs !... Au diable !... Jacques, veux-tu mon âme ?
– Allons, dit Jacques doucement, tu as eu encore quelque querelle aujourd’hui avec Clémence Villa... Quitte-la, mon pauvre ami, si elle te fait tant souffrir...
– Est-ce que je peux ! dit Pierre, devenu très pâle, en appuyant, sur sa main, son front soudainement alourdi.
– Alors, battez-la, fit Patrizzi avec tranquillité.
– Si j’osais ! s’écria le jeune homme dont les yeux étincelèrent. Mais je suis un esclave, devant cette fille... Et tout ce qu’elle veut, elle me l’impose... Ses vices, ses folies, ses trahisons, je supporte tout... J’ai des envies de la massacrer... Et c’est moi que je frapperai, pour m’arracher à sa tyrannie... Oh ! je suis lâche et ignoble ! Je sais qu’elle me trompe avec tout l’hôtel des Étrangers. Je l’ai surprise, l’autre jour, avec un ridicule baryton italien... Elle me ruine, elle m’avilit, elle me met plus bas qu’elle... Et je n’ai pas la force de briser ma chaîne !... Je suis vraiment bien malheureux !
– Non, vous n’êtes pas malheureux, dit le docteur, vous êtes malade... Sortons, on étouffe ici.
– Il est dix heures, fit Jacques de Vignes. La voiture doit m’attendre. Je vais rentrer à Villefranche.
– Couvrez-vous bien, dit le prince, car les nuits sont fraîches.
Le peintre aida son ami à passer son pardessus, il l’enveloppa dans un plaid, et, au bas de l’escalier du restaurant, d’une voix encore vibrante de sa douleur :
– Bonsoir, et tu sais : compte sur mon âme.
Le docteur Davidoff mit Jacques de Vignes en voiture, ferma la portière et dit au cocher : « Allez ! » Puis, ayant écouté, un instant, le roulement des roues sur le sable sonore des allées, il vint lentement vers le peintre qui l’attendait en regardant les étoiles.
– Allons-nous au Casino ? demanda Patrizzi.
– À quoi bon ? La soirée est si belle, marchons un peu.
– De quel côté allez-vous ?
– Sur la route de Menton.
– Et vous vous arrêterez, à un quart de lieue d’ici, à la porte d’une villa dont la grille est fleurie de roses ?
– Oui.
– Et vous en sortirez, tout à l’heure, furieux contre les autres et contre vous-même ?... N’allez pas chez cette fille.
– Et où voulez-vous que j’aille ? Si, vous obéissant, je rentre à mon hôtel, dans la solitude de ma chambre, je vais ne penser qu’à celle que vous me conseillez de fuir... Elle me possède bien, allez, et les liens qui m’attachent sont solides, puisque, malgré mes secousses désespérées, ils ne sont pas encore rompus. Après chaque effort, je retombe plus meurtri et plus faible, et plus captif. Et je me méprise, et je la hais !
– C’est pourtant facile de quitter une femme ! dit le Napolitain en souriant. Malheureusement on ne le sait qu’après. Avant tout, il faut essayer... Mais il est commode de prêter de la philosophie à ceux qui souffrent... Bonsoir, messieurs, je vais faire sauter la banque.
Il alluma une cigarette, et s’éloigna. Davidoff et Pierre Laurier se mirent à marcher dans la nuit, entre les jardins éclairés par la lune. Une douceur embaumée les enveloppait. Ils sortirent de la ville et, à leur droite, au bas des rochers qui dentellent la côte, ils aperçurent la mer, brillante comme une lame d’argent. La nuit était si claire que les fanaux des barques luisaient, au loin, rouges et mouvants. Ils ne parlaient plus, et suivaient la hauteur. Ils s’arrêtèrent, un instant, auprès d’une épaisse brousse de lentisques et de cactus, les yeux perdus dans l’espace et comme oppressés par l’étendue. Un bruit soudain, semblable à celui d’une bête qui se lève brusquement dans un fourré, attira leur attention, et, au bout d’une minute, ils virent, gravissant un sentier qui court sur le flanc de la colline, un homme dont le fusil brillait à la clarté de la lune :
– Qu’est cela ? demanda Davidoff étonné.
Pierre Laurier regarda avec attention, et répondit :
– Un douanier.
Ils attendirent. L’homme montait. Arrivé de plain-pied, il observa les deux promeneurs avec méfiance. Le lieu était désert, quoiqu’on fût seulement à deux kilomètres des dernières habitations ; mais toute la côte est sauvage et propice aux entreprises des fraudeurs.
– Nous prenez-vous pour des contrebandiers ? demanda le peintre.
– Non, monsieur, dit le soldat, maintenant que je vous vois de près ; mais d’en has, en vous apercevant plantés immobiles, j’ai cru que vous veniez donner quelque signal.
– Est-ce qu’il y a des délinquants en campagne ?
– Oh ! toujours ! C’est entre Monaco et Vintimille que la fraude se fait le plus ordinairement. Il n’y a pas de semaines où il ne s’opère quelque descente. Et, depuis quatre jours, nous surveillons une barque qui croise, guettant l’occasion. Mais les coquins nous paieront les nuits blanches qu’ils nous font passer, et, s’ils s’acharnent, ils seront reçus à coups de fusil... Bonsoir, messieurs... Ne restez pas là... l’endroit est mauvais.
Il porta militairement la main à son képi et disparut dans les broussailles qui lui servaient de poste d’observation.
Pierre Laurier et Davidoff se remirent en marche, retournant vers la ville.
– J’envie le sort aventureux des hommes qui sont en butte aux menaces de ce brave gabelou. Ils courent, en ce moment, sur la mer, attentifs et circonspects, prêts au trafic ou à la bataille... Leur coup fait, ils répartiront pour une expédition nouvelle et des dangers inconnus... Ils ne pensent à rien qu’à leur dur et capricieux métier... Je voudrais être à leur place.
– Partez ! Le comte Woreseff, que j’accompagne à bord de son yacht, quitte Villefranche après-demain. Il va en Égypte : nous touchons à Alexandrie, nous remontons le Nil, jusqu’à la deuxième cataracte, nous visitons Thèbes, le désert, les Pyramides... C’est une expédition de deux mois, avec le plancher d’un bateau magnifique sous les pieds, et les splendeurs d’un ciel d’Orient sur la tête... Vous savez avec quel plaisir le comte vous emmènera... Vous travaillerez, vous chasserez... Et surtout vous oublierez !
– Non ! Je serais trop tranquille, trop choyé, trop heureux, auprès de vous. Je ne courrais pas de dangers qui absorbent, je ne prendrais pas de fatigues qui écrasent ; tout, autour de moi, serait trop civilisé... Ce qu’il me faudrait, c’est la vie sauvage. Si vous vous engagiez à me faire capturer par des Touaregs, qui m’emmèneraient captif à Tombouctou... je vous suivrais... Cette fois ce serait le salut !
– Je ne puis vous promettre de telles aventures, dit Davidoff en souriant... Il me faut donc vous abandonner à vous-même.
Ils étaient arrivés devant une très belle villa, peinte en rose, dont les fenêtres brillaient au travers des verdures touffues.
– C’est dit, vous entrez ? demanda le médecin. Adieu donc, car je ne sais si je vous verrai demain, et bonne chance.
Ils se serrèrent la main, et, pendant que le Russe regagnait la ville, le peintre traversait le jardin. Il sonna à la porte de la maison. Un valet de pied lui ouvrit, le fit pénétrer dans un vestibule en forme de patio arabe, orné au centre d’un bassin, sur le fond bleu duquel nageaient des cyprins aux écailles d’or. Autour des colonnes, qui décoraient cette entrée, des rosiers grimpants s’élançaient. Au fond, un escalier de marbre blanc montait jusqu’au premier étage.
– Madame est là ? demanda Pierre Laurier.
– Dans le petit salon, répondit le domestique.
Le jeune homme poussa une porte et doucement entra. Sur un large canapé, au milieu de coussins de soie, Clémence Villa était étendue, feuilletant un livre. Elle leva la tête, étira ses bras, et resta immobile. Pierre s’approcha, et, se penchant sur le fin visage de la belle fille, il lui baisa les yeux.
– Comme tu viens tard ! fit la comédienne, avec une tranquille indifférence, qui contrastait avec le reproche adressé.
– Le dîner du prince Patrizzi s’est prolongé plus que je ne pensais...
– On s’est amusé ?
– Moins que si tu avais été avec nous.
– J’ai horreur de Patrizzi.
– Pourquoi ?
– Je sens qu’il me déteste.
– Non, il ne te déteste pas, mais il m’aime beaucoup.
– Eh bien ? Ne peut-il t’aimer sans me haïr ?
– Il t’aimerait si tu ne me rendais pas malheureux.
– Ah ! l’éternelle chanson !
La jeune femme fit claquer ses doigts, jeta son livre à la volée, à l’autre bout du salon, et, d’un bond hargneux, se retourna sur son canapé, la figure du côté de la muraille.
– Allons, Clémence, la paix, fit le peintre ; parlons d’autre chose...
Mais la comédienne, sans bouger, et le nez sur les coussins, reprit d’une voix âpre :
– Tu sais, ton Patrizzi, il m’a pourchassée, comme les autres, et c’est parce que je n’ai pas voulu de lui qu’il me garde rancune.
La figure de Laurier se crispa, et avec ironie :
– Pourquoi as-tu fait, pour lui, une si blessante exception ?
D’un seul élan, Clémence Villa fut sur ses pieds, et, rouge de colère, les yeux étincelants sous ses sourcils froncés, de sa main agitée d’un tremblement, montrant la porte :
– Mon petit, si tu viens ici pour me dire des insolences, tu peux filer !...
– Oh ! je sais que tu ne tiens guère à moi, tu ne me l’as jamais laissé ignorer, dit le peintre, avec un geste de découragement.
– Alors pourquoi restes-tu ?... Si tu étais aimable encore, je comprendrais ton entêtement. Mais tu passes ton temps à me maudire chez tes amis, ou à m’insulter chez moi. Tout ça, parce que je ne me plie pas à tes fantaisies, et ne m’enferme pas pour vivre avec toi tout seul... Quelle séduisante perspective !... En somme, tu es un ingrat. J’ai quitté, pour te plaire, Sélim Nuño, qui avait été excellent pour moi, et qui supportait, lui, tous mes caprices... Je t’ai aimé beaucoup... oh ! tu le sais bien !... Car, avant ta folie, tu étais un charmant et agréable garçon... Mais voilà que, depuis trois mois, tu perds complètement la tête, alors bonsoir ! Moi, je ne sais pas soigner les aliénés : va dans une maison de santé.
Elle s’était adossée à la cheminée en parlant ainsi, et, dans son déshabillé de peluche rubis, le ton ambré de sa peau luisait comme de l’ivoire. Sa petite tête aux boucles frisées, supportée par un cou un peu long, avait une grâce exquise et, par l’échancrure de sa robe, sa poitrine sertie, comme un bijou, par une précieuse malines, apparaissait voluptueuse, dans son orgueilleuse fermeté.
Pierre lentement s’approcha, et, s’asseyant sur un tabouret presque aux pieds de la jeune femme :
– Pardonne-moi, je souffre, car je t’aime et je suis jaloux.
Elle le regarda durement et d’une voix coupante :
– Tant pis ! Car je ne suis plus disposée à supporter tes soupçons et tes brutalités. Voilà pas mal de semaines déjà que je me tiens à quatre pour ne pas te le dire. Mais j’en ai assez. C’est fini, c’est fini, c’est fini ! Tu peux te dispenser de revenir.
Le peintre pâlit un peu.
– Tu me renvoies ?
– Oui, je te renvoie.
Il resta un instant silencieux, comme s’il hésitait à exprimer jusqu’au bout sa pensée. Puis, presque bas, avec la crainte de la réponse méchante qu’il prévoyait :
– Est-ce que tu en aimes un autre ?
– Qu’est-ce que ça peut te faire ? Je ne t’aime plus, voilà ce qui est important pour toi...
Une rougeur monta au visage du jeune homme, et ses mains tremblèrent. Il mordit sa moustache, et affectant une souriante indifférence :
– Au moins suis-je bien remplacé ? On a son amour-propre !...
– Rassure-toi, interrompit Clémence avec aigreur. Je ne perdrai pas au change. Il est jeune, il est riche, il est beau... Et, depuis longtemps, il m’occupe... Du reste, tu le connais, c’est un de tes amis...
Et, comme le peintre, stupéfait par tant d’audace, se demandait s’il veillait ou s’il rêvait, la jeune femme poursuivit, distillant chaque parole, avec une atroce cruauté, ainsi qu’un mortel poison :
– Tu viens de le quitter... Il dînait ce soir avec toi...
– Davidoff ? s’écria Pierre.
– Imbécile ! ricana Clémence. Ce Russe cynique, qui méprise les femmes, et les conduirait avec un knout ? Me juges-tu si sotte ? Non ! Celui qui m’a plu est un charmant garçon, doux, mélancolique, un peu souffrant, mais qui croit à l’amour et qui s’y donnerait tout entier.