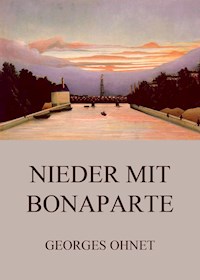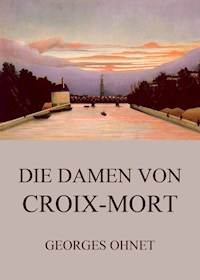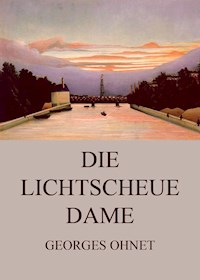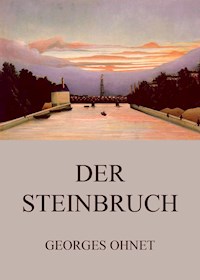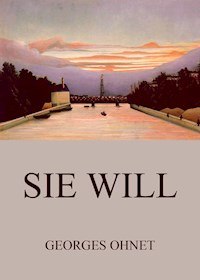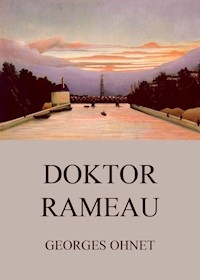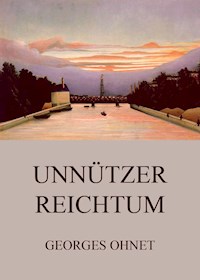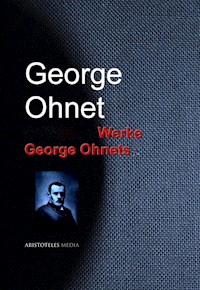1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait
| I
À Dieppe, dix heures venaient de sonner à l’horloge de l’Hôtel de Ville, lorsque la grille du jardin d’une des plus luxueuses maisons de la rue Aguado s’ouvrit, livrant passage à une jeune miss, grande, élégante, blonde, le visage rosé éclairé par deux yeux d’un bleu candide, vêtue d’un joli costume marin avec des ancres au col et des galons d’or aux manches. Derrière elle, sortit une respectable lady habillée de soie noire, coiffée d’un chapeau cloche en paille tressée, et portant deux ombrelles et une jumelle marine. La jeune miss aspira l’air vif et salé, frappa le sol de son pied chaussé d’un soulier verni à talon plat, et dit :
– Joli temps ! Harriett !
La respectable lady, qui était visiblement une gouvernante, agita la tête, poussa une espèce de hennissement approbatif, et, de son coude pointu, éperonnant son élève, se dirigea vers le port.
La mer était d’un gris glacé de rose, doux comme une opale, le soleil fondait les petits nuages légers qui moutonnaient dans le ciel clair, une brise fraîche, venant du large, balançait les tiges fines des tamaris et faisait claqueter les drapeaux qui décoraient la grande porte des hôtels.
Sur la pelouse brûlée par l’été, foulée par le passage des baigneurs, et rouge comme un vieux paillasson, les marchands de chiens promenaient en laisse, pêle-mêle, des meutes de lévriers, de bassets et d’épagneuls. Des jeunes personnes en jersey et des gentlemen en veston de flanelle jouaient au lawn-tennis, pendant que des babies blonds, aux jambes nues, enlevaient au bout d’une longue ficelle un cerf-volant en forme de chauve-souris. Le petit tramway, qui fait le voyage du Casino à la jetée, passait au trot d’un cheval somnolent. Et, criant à tue-tête, des gamins du Pollet offraient aux passants le programme des courses.
Marchant d’un pas rapide, les deux promeneuses étaient arrivées à la hauteur de l’hôtel Royal, lorsqu’un grand jeune homme, sortant de la cour, la tête basse et l’air absorbé, faillit les heurter au passage. Il porta la main à son chapeau, s’excusa avec un léger accent étranger, et se rangea contre le mur. Une exclamation de la jeune miss lui fit lever les yeux, son visage pâle se colora d’une ardente rougeur, ses yeux noirs étincelèrent, et, frappant ses mains l’une contre l’autre, avec une stupeur mêlée de joie :
– Daisy ! Vous ! C’est vous ?..|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
Le chant du cygne
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Le malheur de tante Ursule
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
GEORGES OHNET
NOIR ET ROSE
NOUVELLES
Paris, Paul Ollendorff, Éditeur, 1887
Raanan Editeur
Livre 671 | édition 1
Le chant du cygne
I
À Dieppe, dix heures venaient de sonner à l’horloge de l’Hôtel de Ville, lorsque la grille du jardin d’une des plus luxueuses maisons de la rue Aguado s’ouvrit, livrant passage à une jeune miss, grande, élégante, blonde, le visage rosé éclairé par deux yeux d’un bleu candide, vêtue d’un joli costume marin avec des ancres au col et des galons d’or aux manches. Derrière elle, sortit une respectable lady habillée de soie noire, coiffée d’un chapeau cloche en paille tressée, et portant deux ombrelles et une jumelle marine. La jeune miss aspira l’air vif et salé, frappa le sol de son pied chaussé d’un soulier verni à talon plat, et dit :
– Joli temps ! Harriett !
La respectable lady, qui était visiblement une gouvernante, agita la tête, poussa une espèce de hennissement approbatif, et, de son coude pointu, éperonnant son élève, se dirigea vers le port.
La mer était d’un gris glacé de rose, doux comme une opale, le soleil fondait les petits nuages légers qui moutonnaient dans le ciel clair, une brise fraîche, venant du large, balançait les tiges fines des tamaris et faisait claqueter les drapeaux qui décoraient la grande porte des hôtels.
Sur la pelouse brûlée par l’été, foulée par le passage des baigneurs, et rouge comme un vieux paillasson, les marchands de chiens promenaient en laisse, pêle-mêle, des meutes de lévriers, de bassets et d’épagneuls. Des jeunes personnes en jersey et des gentlemen en veston de flanelle jouaient au lawn-tennis, pendant que des babies blonds, aux jambes nues, enlevaient au bout d’une longue ficelle un cerf-volant en forme de chauve-souris. Le petit tramway, qui fait le voyage du Casino à la jetée, passait au trot d’un cheval somnolent. Et, criant à tue-tête, des gamins du Pollet offraient aux passants le programme des courses.
Marchant d’un pas rapide, les deux promeneuses étaient arrivées à la hauteur de l’hôtel Royal, lorsqu’un grand jeune homme, sortant de la cour, la tête basse et l’air absorbé, faillit les heurter au passage. Il porta la main à son chapeau, s’excusa avec un léger accent étranger, et se rangea contre le mur. Une exclamation de la jeune miss lui fit lever les yeux, son visage pâle se colora d’une ardente rougeur, ses yeux noirs étincelèrent, et, frappant ses mains l’une contre l’autre, avec une stupeur mêlée de joie :
– Daisy ! Vous ! C’est vous ?
– Sténio !... s’écria la jeune miss, bouleversée par une violente agitation. Puis, familière et impérieuse, elle prit le bras de l’étranger, et, brusquement, cédant à une curiosité passionnée :
– Avant tout, parlez-moi de ma sœur... Où l’avez-vous laissée ? Comment va-t-elle ? Mais, folle que je suis, vous êtes à Dieppe... Donc elle y est avec vous !... Sténio, mon ami, je vous en prie, où est Maud ?... Vite conduisez-moi. J’aurai tant de plaisir à l’embrasser !...
– Daisy ! chère enfant ! balbutia Sténio.
Son grand front, couronné de cheveux noirs, courts et frisés, se creusa comme un lac sous le vent d’orage, des larmes roulèrent dans ses yeux, et sa voix devint tremblante.
Au même moment, la respectable dame au chapeau cloche, qui, au premier abord, avait paru pétrifiée d’étonnement, secoua sa torpeur et se décida à intervenir.
– Ma chère, je vous en prie... dit-elle, en se plaçant résolument entre son élève et le jeune homme. Vous savez quels sont les ordres de votre père... S’il se doutait que devant moi... un pareil entretien... Oh ! c’est tout à fait impossible ! Songez donc, chère mignonne !... Si vous n’êtes pas assez raisonnable pour m’écouter, il faut que ce soit monsieur qui comprenne...
Suffoquée, elle fit trêve à son incohérence, et resta devant les deux jeunes gens, cramoisie, les yeux écarquillés, dans un désordre d’esprit à la fois touchant et risible. Alors Daisy, fronçant ses sourcils délicats, et plissant sa petite bouche avec une expression menaçante :
– Harriett, ma bonne, écoutez-moi bien. Vous savez si je suis docile dans les circonstances ordinaires, et si je vous aime !... Mais aujourd’hui, voyez-vous, Harriett, le cas est tellement sérieux... Ma sœur, comprenez-vous, il s’agit de ma sœur, de Maud... Ah ! Harriett, pouvez-vous me forcer à discuter sur un pareil sujet !
Un torrent de larmes lui coupa la parole. Des promeneurs, qui partaient dans un landau pour aller déjeuner à Pourville, regardèrent avec stupéfaction cette vieille dame à qui cette charmante fille parlait en pleurant devant ce grand jeune homme pâle. La gouvernante agitait sa tête grise sous son chapeau cloche, sans mot dire, avec l’entêtement résigné d’une vieille mule. Elle se décida cependant à grommeler :
– Mais les volontés de milord ?...
– Mais les supplications de miss ! répliqua vivement Daisy. Harriett, il faut choisir entre mon père et moi !... Vous m’avez souvent déclaré que, pour rien au monde, vous ne voudriez me quitter et que, quand je serai mariée, vous espériez bien rester dans ma maison pour soigner les petits babies... Eh bien ! Harriett, si, pour me plaire, vous ne manquez pas aujourd’hui à tous vos devoirs... Oh ! j’en aurai un chagrin affreux... mais, Harriett, tout sera fini entre nous !...
– Daisy ! mugit la gouvernante qui éclata en sanglots... Oh ! Daisy, tout pour l’amour de vous, chère petite, vous le savez bien !... S’il vous fallait ma vie... Mais une chose si défendue !... Que dira le lord, s’il apprend ?...
– C’est moi qui lui parlerai... Allons, c’est fini, Harriett. Je vous aime, vous êtes une bonne vieille chérie !...
Et, de ses lèvres roses, elle caressait le visage enflammé de sa gouvernante.
– Je n’oublierai jamais, non, jamais, ce que vous faites pour moi... M. Sténio Marackzy, mon beau-frère, n’oubliera pas non plus, j’en suis sûre !...
L’étranger abaissa gravement sa tête pensive, et, se tournant vers Daisy :
– Vous voulez voir votre sœur ?... Hélas ! vous ne la trouverez plus telle que vous l’avez connue... Elle est bien changée, la pauvre Maud, elle est bien malade !...
La petite miss leva sur son beau-frère des yeux pleins d’angoisse :
– En danger ? demanda-t-elle.
– Oui, Daisy, en danger.
Elle poussa une exclamation étouffée.
Et, suivis d’Harriett, qui semblait marcher au supplice, les deux jeunes gens entrèrent dans la cour de l’hôtel. Comme ils se dirigeaient vers le pavillon carré qui s’élève sur le côté droit de la façade, ils croisèrent une jeune femme très élégante accompagnée d’une religieuse portant le costume gris et la cornette blanche des sœurs des pauvres. Daisy détourna vivement la tête et hâta le pas, entraînant Sténio, comme si elle craignait d’être reconnue en sa compagnie. Mais ses précautions furent inutiles. Et elle entendit, derrière elle, la jeune femme qui disait, avec une expression de profond étonnement :
– Tiens ! miss Mellivan et Marackzy !...
Une inquiétude soudaine serra le cœur de Daisy. Mais elle était emportée par des sentiments tellement violents qu’elle passa outre. Sténio ouvrit la porte du pavillon, et, suivie de sa gouvernante, la jeune miss entra.
La religieuse s’était arrêtée et avait suivi l’étranger du regard. Elle leva les yeux au ciel et dit :
– Ah ! si M. Marackzy voulait laisser mettre son nom sur l’affiche de notre concert, quelle aubaine pour nos petits Orphelins de la mer !...
– Vous savez donc qui est Marackzy, sœur Élisabeth ?
– Son nom, Madame, n’est-il pas universellement connu, à l’égal de ceux de Liszt et de Rubinstein ?...
– Oui, mais, malheureusement pour nous, depuis que sa femme est si malade, il ne veut plus se montrer en public... Dernièrement, à Vienne, il n’a pas consenti à jouer chez l’Empereur, pour qui cependant il a le plus respectueux attachement, car François-Joseph est son premier protecteur...
– Ce qu’il a refusé à un souverain, ne l’accorderait-il pas à des enfants malheureux ?
– Une seule personne pourrait peut-être obtenir de lui... Oui, tenez, par Daisy Mellivan... Oh ! ce serait prodigieux ! On mettrait les places à quarante francs et on emplirait la salle... Trente mille francs de recette assurés !
La sœur Élisabeth croisa ses mains sur sa poitrine avec extase, et ses lèvres s’agitèrent comme pour une prière.
II
Sténio Marackzy est, sans conteste, le plus admirable virtuose qui ait jamais fait vibrer le bois sonore d’un violon. Fantaisiste comme Paganini, il a fait, dans ses jours d’excentricité, des tours de force avec son archet. Mais ce n’est pas à se démancher sur la quatrième corde que le grand artiste a conquis sa réputation. S’il a des doigts divins pour exécuter, il a une imagination de feu pour créer. C’est un improvisateur d’une puissance merveilleuse, et, en même temps, d’une grâce incomparable. Tour à tour, sous son archet magique, s’envolent les mélodies qui, par un prodigieux contraste, évoquent les mélancolies hivernales des plaines immenses, traversées par le Danube aux roseaux peuplés de hérons silencieux, puis les gaietés riantes des fêtes villageoises, dans lesquelles les blondes filles dansent les amoureuses czardas avec leurs fiancés, et enfin les rudesses belliqueuses des marches, où retentissent les sonneries des trompettes, les roulements des canons et le clair tintement des sabres. L’âme de la Hongrie tout entière, triste, joyeuse ou héroïque, chante dans le violon de Marackzy.
Voilà pourquoi, dans son pays, il est aussi populaire que Kossuth, et comment, en Europe, il a fanatisé tous ceux qui ont eu le bonheur de l’entendre.
Fils d’un maître de chapelle du palais royal de Pesth, il n’a pas grandi en liberté comme les sauvages Tziganes qui parcourent les plaines danubiennes. Son instruction musicale a été très soignée, et son éducation d’homme est parfaite. Remarqué par l’Empereur et Roi, un jour qu’il exécutait le solo de violon d’un O Salutaris composé par son père, et emmené à Vienne pour jouer dans les concerts de la cour, il produisit tout de suite une sensation profonde. Pendant tout l’hiver il fit fureur, et ne séduisit pas moins les femmes par sa beauté que par son talent. Il avait vingt ans, une tournure de gentilhomme, l’air pensif et des yeux de jais brillants et doux, où brûlaient toutes les flammes de l’Orient.