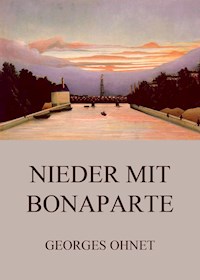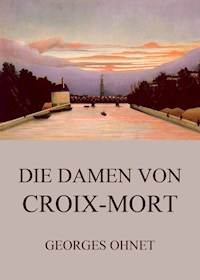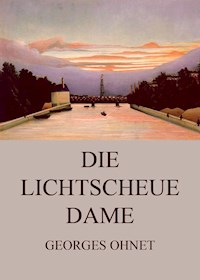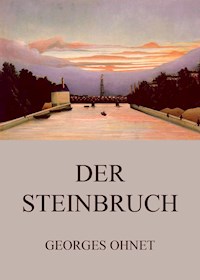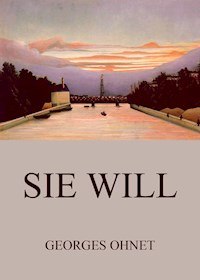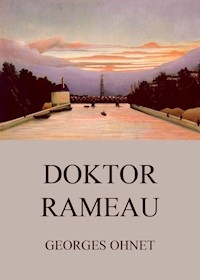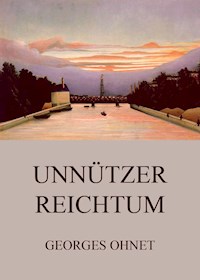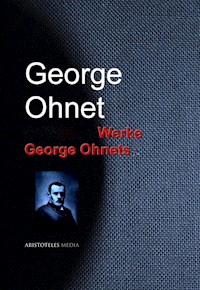1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait
| I
Dans la salle à manger des Étrangers du Club des Chauffeurs, le dîner prenait fin. Il était dix heures. Les maîtres d’hôtel apportaient le café, les valets de pied s’étaient retirés, et dans le salon voisin les boîtes de cigares préparées attendaient les fumeurs. Douze convives, six hommes et six femmes, et pour amphitryon Cyprien Marenval, le célèbre industriel qui a fait une immense fortune en fabriquant et en vendant le racahout qui porte son nom. Autour de la table ornée de fleurs rares, étincelante de cristaux et d’argenterie, dans un désordre et une familiarité que l’excellence du repas et la qualité des vins expliquaient, les demi-mondaines et les aimables viveurs réunis par Marenval, écoutaient un grand garçon blond qui, malgré des interruptions fréquentes, continuait à parler avec une imperturbable tranquillité :
— Non ! je ne crois pas à l’infaillibilité humaine, même chez ceux qui ont pour profession de rendre des arrêts et qui, par conséquent, peuvent se targuer d’une expérience particulière. Non ! je ne crois pas que dès qu’un citoyen, comme vous et moi, est assis sur le banc de bois de la tribune d’un jury, il soit foudroyé par des révélations supérieures qui lui donnent la science infuse. Non ! je ne crois pas que de braves pères de famille, et même des célibataires, parce qu’ils ont revêtu une robe noire ou rouge, avec ou sans hermine, ne soient plus susceptibles de se tromper et rendent des arrêts qui soient indiscutables. En résumé, je réclame le droit de croire à l’aveuglement de nos compatriotes en général et des juges en particulier, et je pose, en principe, la possibilité de l’erreur judiciaire !…
Il y eut un tumulte dans l’assistance. Un concert d’imprécations s’éleva et quelques-unes de ces dames commencèrent à frapper leurs verres avec la lame de leurs couteaux. Les amis de l’orateur essayèrent une fois encore de lui imposer silence :
— Maugiron, tu nous assommes !
— À l’amende d’un souper, Maugiron !
— Il file comme un macaroni, cet animal-là !
— En voilà un qui est vieux jeu ! Il s’occupe de la magistrature !
— Demande une place de substitut, dis !
— Vous êtes tous des idiots, cria Maugiron, profitant d’une accalmie...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SOMMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
I
II
III
IV
V
DEUXIÈME PARTIE
I
II
III
TROISIÈME PARTIE
I
II
III
IV
GEORGES OHNET
AU FOND DU GOUFFRE
roman
Paul Ollendorff éditeur
1899
Raanan Editeur
Livre 676 | édition 1
PREMIÈRE PARTIE
I
Dans la salle à manger des Étrangers du Club des Chauffeurs, le dîner prenait fin. Il était dix heures. Les maîtres d’hôtel apportaient le café, les valets de pied s’étaient retirés, et dans le salon voisin les boîtes de cigares préparées attendaient les fumeurs. Douze convives, six hommes et six femmes, et pour amphitryon Cyprien Marenval, le célèbre industriel qui a fait une immense fortune en fabriquant et en vendant le racahout qui porte son nom. Autour de la table ornée de fleurs rares, étincelante de cristaux et d’argenterie, dans un désordre et une familiarité que l’excellence du repas et la qualité des vins expliquaient, les demi-mondaines et les aimables viveurs réunis par Marenval, écoutaient un grand garçon blond qui, malgré des interruptions fréquentes, continuait à parler avec une imperturbable tranquillité :
— Non ! je ne crois pas à l’infaillibilité humaine, même chez ceux qui ont pour profession de rendre des arrêts et qui, par conséquent, peuvent se targuer d’une expérience particulière. Non ! je ne crois pas que dès qu’un citoyen, comme vous et moi, est assis sur le banc de bois de la tribune d’un jury, il soit foudroyé par des révélations supérieures qui lui donnent la science infuse. Non ! je ne crois pas que de braves pères de famille, et même des célibataires, parce qu’ils ont revêtu une robe noire ou rouge, avec ou sans hermine, ne soient plus susceptibles de se tromper et rendent des arrêts qui soient indiscutables. En résumé, je réclame le droit de croire à l’aveuglement de nos compatriotes en général et des juges en particulier, et je pose, en principe, la possibilité de l’erreur judiciaire !…
Il y eut un tumulte dans l’assistance. Un concert d’imprécations s’éleva et quelques-unes de ces dames commencèrent à frapper leurs verres avec la lame de leurs couteaux. Les amis de l’orateur essayèrent une fois encore de lui imposer silence :
— Maugiron, tu nous assommes !
— À l’amende d’un souper, Maugiron !
— Il file comme un macaroni, cet animal-là !
— En voilà un qui est vieux jeu ! Il s’occupe de la magistrature !
— Demande une place de substitut, dis !
— Vous êtes tous des idiots, cria Maugiron, profitant d’une accalmie.
— En voilà un malhonnête, déclara Mariette de Fontenoy. Dites donc, mes enfants, si on s’en allait en le laissant tout seul.
— Marenval, pourquoi nous fais-tu dîner avec des gens qui ont des conversations sérieuses au dessert ? demanda la jolie Lucette Pithiviers.
— Tiens ! regarde Tragomer, dit Laurence Margillier à Maugiron, qui écoutait impassible toutes ces apostrophes. Voilà un gentil garçon, et qui n’est pas assommant à table. Il n’a parlé que pour dire des choses aimables. J’ai un béguin pour lui, moi. Et s’il veut, je te lâche, pour t’apprendre à faire des conférences.
— Ah ! ah ! dit Maugiron, Tragomer, tu fais tes affaires, mon brave. Et aussi les miennes. Voilà Laurence qui veut me quitter pour toi… N’hésite pas, cher ami : prends-la. Ne rate pas ton bonheur, même au prix de mon désespoir. Mais, avant tout, dis-nous ton opinion sur les erreurs judiciaires.
— Oh ! assez ! Il recommence ! Il est complètement paf ! À la Bodinière ! Faites-lui avaler sa serviette !
Toutes ces interruptions partirent au milieu des éclats de rire. Cependant, celui des convives auquel s’était adressé Maugiron, était resté silencieux et impassible. C’était un homme de trente ans, grand, bâti en force, une tête carrée au teint hâlé, couverte de cheveux noirs bouclés, éclairée par des yeux bleus magnifiques. Sa bouche se serrait grave, sous la moustache brune, et le menton rasé offrait tous les caractères de la fermeté, presque de l’entêtement. Le front large, barré par les sourcils, était blanc, vallonné d’admirables sinuosités, où se révélaient les facultés de réflexion et d’imagination. À le voir ainsi, soudain sérieux, un peu sombre, l’animation des convives se refroidit subitement et ce fut avec une sorte d’inquiétude que le vieux Chambol, l’ami inséparable de Marenval, interrogea le jeune homme dont la gravité contrastait si fort avec la gaieté de cette fin de repas :
— Eh ! là ! Monsieur de Tragomer, qu’est-ce qu’il y a donc ? Est-ce ce jeune godiche de Maugiron qui vous a fâcheusement impressionné avec ses paradoxes ? Ou bien la déclaration de notre gentille Laurence vous paraît-elle un cataclysme social ? Vous êtes bien silencieux et bien triste, pour un homme à qui on a mis sous le nez les plus nobles échantillons d’une cave sans pareille, et sous les yeux les plus jolies épaules de Paris.
Tragomer leva son front penché et un sourire éclaira son visage :
— Laurence est charmante, mais, si j’acceptais sa proposition, elle m’en voudrait demain de l’avoir laissée quitter Maugiron, et Maugiron ne me pardonnerait pas de la lui avoir prise. Double perte que je ne risquerai pas. Si vous m’avez vu un instant absorbé, c’est que je pensais à ce que notre ami vient de dire et que, sous les excès de verve auxquels il s’est livré, je crois qu’il y a un fond de vérité…
— Ah ! s’écria triomphalement Maugiron. Vous voyez ! Tragomer, gentilhomme breton, dont vous ne contesterez pas la sincérité, puisqu’il refuse de me tromper avec ma bonne amie, qui, sans façon le lui offrait, partage l’opinion que j’avais l’avantage de développer devant l’honorable assistance. Parle, Tragomer, tu dois avoir des arguments à fournir à tous ces crétins, qui me huaient, tout à l’heure, et qui t’écoutent maintenant, bouche bée, parce que tes airs de beau ténébreux leur laissent pressentir des révélations sensationnelles. Vas-y, mon vieux, lâche les écluses à ton éloquence. Convaincs-les ! Aplatis-les, Marenval surtout. Car il a été ignoble avec moi, en m’interrompant tout le temps, comme si je faisais l’éloge d’une contrefaçon de son racahout, la plus affreuse saleté du reste qu’on ait jamais fabriquée dans les deux hémisphères !
— Oh ! le voilà reparti ! s’exclama Marenval avec désespoir. Qui arrêtera ce moulin à paroles ?
— Tais-toi ! cria le chœur des convives.
— Tragomer ! Tragomer !
Et les couteaux de frapper les verres en cadence, avec un bruit assourdissant. Le jeune Maugiron fit un geste de la main, pour réclamer le silence, et d’une voix flûtée, il dit :
— La parole est à M. le vicomte Christian de Tragomer, sur l’erreur judiciaire et ses fatales conséquences.
Puis il se rassit, alluma une cigarette, et le silence s’établit, profond, comme si tous les assistants soupçonnaient que Christian avait des révélations importantes à faire.
— Vous n’ignorez pas, dit alors Tragomer, que je suis parti, il y a deux ans, pour un voyage autour du monde, qui m’a tenu éloigné de Paris et de mes amis, jusqu’à l’automne dernier. J’ai, pendant ces vingt-quatre mois, parcouru des pays nombreux et variés, y promenant mon ennui et ma tristesse. J’avais eu, pour quitter la France, des raisons sérieuses. Un grand chagrin avait bouleversé ma vie. Un événement mystérieux, encore inexplicable pour moi, avait amené l’arrestation, le jugement et la condamnation de mon compagnon de jeunesse, Jacques de Fréneuse…
— Oui ! nous nous souvenons de cette déplorable affaire, dit Chambol, et d’autant plus que Marenval était un peu parent, ou allié, de la famille de Fréneuse, et que ce pauvre ami avait été vivement affecté du scandale affreux produit par le procès.
— Ce n’était pas drôle, n’est-ce pas, dit Mariette de Fontenoy, pour un homme comme Marenval, qui est la correction et le chic mêmes, de voir, sur les bancs de la cour d’assises, quelqu’un de ses proches.
Marenval adressa à la belle fille un sourire reconnaissant. Il prit une attitude solennelle et déclara :
— Il y avait de quoi me faire un tort immense dans le monde. J’y entrais, je venais de le conquérir, j’ose le dire, par la tenue de ma maison, par le luxe de mes fêtes et le choix de mes relations. Il n’en aurait pas fallu davantage, pour me couler à jamais. J’étais déjà un industriel, enrichi dans les denrées alimentaires, variété difficile à imposer dans les cercles et à implanter dans la meilleure société. Je passais, du coup, à l’état de parent d’un condamné à mort… Non ! Ce n’était pas drôle !
— Ça, tu peux dire, mon enfant, dit Laurence Margillier, que, pour un snob, tu avais une entrée qui n’était pas ordinaire !
— Je ne suis pas snob, protesta Marenval avec vivacité. J’ai horreur qu’on m’appelle snob ! J’aime seulement la distinction, en tout. Ma vie entière s’est écoulée au milieu de fréquentations nauséabondes. J’en ai assez ! Je ne veux plus voir que des gens bien !
— Tu te ferais fesser pour tutoyer un duc !
— Tu as raison, Marenval. Il ne faut jamais regarder qu’au-dessus de soi !
— Et rechercher ceux qui vous méprisent !
— En tout cas, je risquais d’être méprisé, à cause de cette maudite affaire ! répliqua Marenval d’un air vexé. Aussi je vous prie de croire que j’en ai eu des cheveux blancs !
— Où ça, tes cheveux blancs ?
— Il les teint !
— Pour ne pas les exposer à rougir !
— Je n’en ai pas moins accompli mon devoir envers la famille de Fréneuse. Je me suis mis à la disposition de la mère du malheureux et coupable Jacques.
— Coupable ? interrompit Tragomer avec force. En êtes-vous sûr ?
Il y eut un effet de saisissement, à cette question si nettement posée.
— J’ai partagé, hélas ! la conviction des magistrats, du jury et de l’opinion publique, dit Marenval. Car, malheureusement, il était impossible de douter. L’accusé, lui-même, au milieu de ses protestations, de son affolement, ne trouvait pas un argument à fournir, pas un fait à relever pour sa défense. Aucun témoignage favorable. Et vingt témoignages accablants. Ah ! on peut dire que tout a concouru à le perdre. Et sa propre imprudence, et sa conduite antérieure, et tout, tout enfin ! Je suis navré de parler ainsi, mais ma conviction m’y oblige. Je ne crois pas, je ne puis croire à l’innocence de celui dont M. de Tragomer nous parle et, à moins d’être insensé, il est impossible de douter qu’il ait tué sa maîtresse, la ravissante Léa Pérelli.
— Pour la voler ? ajouta ironiquement Tragomer.
— Il avait, lui-même, engagé la veille, au mont-de-piété, tous les bijoux de la pauvre fille.
— Alors pourquoi la tuer puisqu’elle lui avait donné tout ce qu’elle avait ?
— Les reconnaissances valaient certes vingt mille francs… Jacques devait une somme pareille à la caisse du cercle. La dette fut payée à l’heure voulue et les reconnaissances furent présentées, le jour même, et les bijoux dégagés… Léa Pérelli, à ce moment-là, vivait encore, elle ne fut tuée que le soir… Ah ! cette maudite affaire m’est bien présente à l’esprit.
— Oui, tout ce que vous venez de raconter là est exact, reprit Tragomer ; le pauvre Jacques avait engagé les bijoux, mais il a toujours nié avoir vendu les reconnaissances. Il prétendit que ce devait être le véritable assassin, qui les avait volées et qui avait dégagé les pierreries, avant que le meurtre fût connu. Eh bien ! ce dont on accusait Jacques, ce dont il se défendait, ce meurtre, pour lequel on l’envoya en cour d’assises, s’il n’avait jamais été commis, que diriez-vous ?
Cette fois, le beau Christian ne put douter d’avoir empoigné ses auditeurs. Ils se turent tous et leurs yeux fixés sur lui avec une ardeur passionnée, leurs attitudes tendues par une curiosité violente, attestèrent l’intérêt qu’il avait su exciter dans tous les esprits.
— Alors ? demanda enfin Mariette.
— Alors, dit lentement Tragomer, il a été commis là, je crois, une erreur judiciaire, et notre ami Maugiron parlait, tout à l’heure, avec beaucoup de raison.
— Mais Jacques de Fréneuse et Léa Pérelli ? demanda Laurence Margillier. Je l’ai beaucoup connue, Léa, c’était une aimable fille et qui chantait délicieusement.
Les autres perdirent patience et, incapables de se contenter à si peu de frais, ils crièrent :
— L’histoire ! L’histoire ! Il y a une histoire ?
— Certes, répondit tranquillement Tragomer. Mais vous n’espérez pas que je vais vous la raconter ?
— Pourquoi donc ça ?
— Parce que je sais que j’ai affaire aux dix langues les mieux pendues de Paris, et que je ne tiens pas à ce que mon secret…
— Il y a un secret ?
— À ce que mon secret courre, demain, les rues, les boudoirs et les journaux.
— Oh !
Ce fut un cri de réprobation général. Maugiron lui-même abandonna le parti de Christian et passa à l’ennemi, en criant plus fort que tous les autres :
— À bas Tragomer ! Honte à Tragomer !
Mais le gentilhomme breton les regardait de ses yeux bleus tranquilles, et le coude sur la table, le menton dans sa main, écoutait impassible leurs malédictions. Il les laissa exhaler leur mécontentement, puis il dit de sa voix calme :
— Si M. Marenval veut m’écouter, je vais lui raconter, à lui, ce que je sais.
— Pourquoi à lui plutôt qu’à nous ?
— Parce qu’il est allié à la famille de Fréneuse et parce que, comme il le disait tout à l’heure, il a grandement souffert de cette situation. Je trouve donc équitable, aujourd’hui, de lui donner occasion d’en tirer avantage…
— Et comment cela ?
— C’est ce que je me réserve de lui expliquer, à lui-même, dans un instant…
— Très bien ! Il nous met à la porte, par-dessus le marché !
— Maugiron, je te pardonne, tu as trouvé ton maître. Tragomer est encore plus assommant que toi !
— Comment ! Chambol, l’inséparable Chambol ne sera pas toléré ?
— Il est onze heures, dit Tragomer, l’Opéra réclame Chambol, on donne Coppélia. S’il ne paraissait pas, que diraient les petites de la danse ?
— Eh bien ! mes enfants, vous voyez, nous avons beau être charmants, on ne nous retient pas !
— Non ! Marenval, tu insisterais vainement pour nous faire rester !
— Épargne-toi les supplications. Nous serons inflexibles. Nous partons ! Marenval, nous partons !
— Allons, ne faites pas les niais, dit Marenval avec solennité. La circonstance, vous le voyez, est grave. Laissez-moi, gentiment, avec Tragomer. Et, pour votre peine…
— Ah ! ah ! Cadeau ! crièrent les femmes.
— Eh bien ! oui, là ! Cadeau ! dit Marenval, vous recevrez un petit souvenir, demain, dans la journée.
Elles battirent des mains. La générosité de Cyprien était connue. Le souvenir serait de valeur. Maugiron entonna, sur l’air de la marche du Prophète :
— Marenval ! Honneur à Marenval !
Et tous, en chœur, reprirent avec lui l’hymne pompeux, aussitôt interrompu par celui qui en était le héros :
— Silence ! Vous allez faire venir les commissaires du cercle. Soyez raisonnables ! Allez-vous-en sagement. Embrassez-moi, et bonsoir.
Tous les frais visages s’approchèrent des lèvres gourmandes de Marenval, et se frottèrent à ses rudes favoris. Des poignées de main furent échangées, la bande joyeuse passa dans le salon voisin, pour se vêtir. Marenval ferma la porte, et, seul avec Tragomer, il vint se rasseoir, alluma un cigare, et dit au jeune homme :
— Maintenant, parlez.
— Vous savez, mon cher ami, quels liens d’affection m’unissaient, depuis l’enfance, à Jacques de Fréneuse. Nous avions été camarades de collège. Au régiment nous avions servi ensemble. Notre existence s’était déroulée, pareille. Toutes ses folies de jeunesse, je les avais partagées. Nous péchions par un peu trop d’emportement dans nos plaisirs, et, souvent, nous prêtions à la critique, mais nous étions pleins d’ardeur, de force, et nous méritions un peu d’indulgence.
— Vous, mon cher, vous qui avez toujours conservé, même dans les excès, une tenue et une correction parfaites, mais Jacques…
— Oui, je sais bien, Jacques manquait de mesure, il ne savait pas s’arrêter à temps. C’était un outrancier. Et, dans la joie, comme dans la tristesse, il allait à l’extrême… Je l’ai vu repentant, après quelque grosse sottise, pleurer dans les bras de sa mère, comme un enfant, ce qui ne l’empêchait pas de recommencer, le lendemain. Le malheur, en cela, était que la fortune des siens ne lui permettait pas les prodigalités, auxquelles il se livrait, et que bientôt, l’héritage de son père étant dévoré, mon malheureux ami se trouva à la charge de sa mère et de sa sœur.
— Ah ! mon cher, c’est là que j’ai cessé de le comprendre et que je suis devenu sévère pour lui. Tant qu’il n’avait fait qu’entamer son capital je le jugeais imprudent, car je le considérais comme incapable de se suffire à lui-même, mais je ne le blâmais pas. Chacun a le droit de faire de son argent ce qui lui plaît. L’un thésaurise, l’autre gaspille. Affaire de goût. Mais imposer des sacrifices aux siens, être à la charge de deux pauvres femmes, et cela pour aller faire la noce avec des demoiselles de moyenne vertu ? Voilà où je deviens sévère.
— Eh ! vous n’êtes pas le seul, et tous les conseils que je lui donnai alors furent conformes aux principes que vous posez très justement. Jacques, emporté par la fougue de ses passions, ne tenait aucun compte de mes remontrances. Il me répondait que la morale m’était facile, car je l’étayais sur cent mille livres de rentes, que les riches avaient beau jeu à prêcher la régularité à ceux qui n’avaient pas le sou et que, certes, s’il pouvait ne pas faire de dettes, il serait le plus heureux des hommes. Il en faisait, j’en sais quelque chose. Il aurait mis ma caisse à sec, si je l’avais laissé y puiser à son gré, mais quoique je l’aimasse tendrement, je dus calmer son ardeur à l’emprunt, parce que je vis promptement qu’il me mettrait dans l’embarras, sans en sortir lui-même. Et puis Mme de Fréneuse m’avait supplié de ne plus faciliter à Jacques le désordre en l’aidant de mes deniers. Elle en était, la pauvre femme, à croire qu’en serrant la bride à un cheval emporté on arrive à l’arrêter, comme si toute contrainte, toute résistance, ne servaient pas, au contraire, à exaspérer sa folie.
— N’y avait-il pas, à ce moment-là, un projet d’union entre Mlle de Fréneuse et vous ?
Tragomer pâlit. Sa physionomie devint dure et douloureuse. Ses yeux s’enfoncèrent sous ses sourcils, et leur bleu s’assombrit comme une eau sur laquelle passe un noir nuage. Il baissa la voix et dit :
— Vous me rappelez là un des moments les plus cruels de ma vie. Oui, j’aimais, j’aime encore Marie de Fréneuse. Je devais l’épouser, lorsque la catastrophe eut lieu… Je vois encore la mère de Jacques arrivant chez moi, un matin, à moitié folle d’épouvante et de douleur, se jetant sur un canapé de mon salon, car ses jambes ne la portaient plus, et me disant au milieu de ses sanglots : On vient d’arrêter Jacques… On l’a ramené chez moi, tout à l’heure !
— Le meurtre de Léa Pérelli venait d’être découvert…
— Oui, on avait trouvé, dans la chambre de Léa, une femme tuée d’un coup de revolver et dont le visage était rendu méconnaissable par la blessure…
— Une femme ! répéta Marenval, très intrigué par la forme de la phrase et par le ton dont Tragomer l’avait dite. Douteriez-vous donc que la morte fût Léa Pérelli ?
Tragomer inclina la tête gravement :
— J’en doute.
— Mais mon cher, reprit Marenval avec vivacité, pourquoi n’avez-vous pas dit cela plus tôt ? C’est au bout d’un an que vous venez avancer une opinion aussi extraordinaire ? Qui vous a empêché de parler, au moment du procès ?
— Je n’avais pas, à cette époque-là, les raisons que j’ai, aujourd’hui, de douter.
— Et quelles sont vos raisons ? Sacrebleu ! Vous me faites bouillir, avec votre sang-froid. Vous racontez des choses à bouleverser l’esprit, avec l’air d’un monsieur qui lirait le programme des théâtres ! Pourquoi croyez-vous que Jacques de Fréneuse n’a pas tué Léa Pérelli ?
— Tout simplement parce que Léa Pérelli est vivante.
Cette fois-là Marenval fut abasourdi. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Il roula des yeux effarés, et toute son émotion se traduisit par un hochement de tête, et un claquement de ses mains appliquées sur la table avec force. Mais Tragomer ne lui laissa pas reprendre ses esprits, il redoubla tout de suite :
— Léa Pérelli est vivante. Je l’ai rencontrée à San Francisco, il y a trois mois, et c’est parce que j’ai eu la conviction que j’étais en face d’elle que j’ai abrégé mon voyage et suis rentré en France.
L’enthousiasme dans lequel ce récit jeta Marenval fut plus fort que son scepticisme. Il se leva, fit un tour dans la salle à manger, disant d’une voix entrecoupée :
— Incroyable ! Renversant ! Sacré Tragomer ! Ah ! bien ! je comprends qu’il ait renvoyé les autres. Quel potin ils auraient fait ! En voilà une affaire !
Christian, très calme, le laissait s’agiter, s’étonner, s’exclamer. Il attendit que son auditeur fût revenu auprès de lui, ramené par sa violente curiosité. Il ne le regardait pas. Il paraissait suivre du regard, très loin, une vision, et un sourire triste passait sur ses lèvres. Il dit lentement :
— Quand je pense que Jacques est au milieu de bandits, enfermé dans un bagne, pour un crime qu’il n’a pas commis, une tristesse profonde s’empare de moi. Est-il destin plus épouvantable que celui d’un malheureux, à qui l’on affirme violemment sa culpabilité, à qui on la prouve, que l’on jette dans un cachot, au secret, et qui, pendant qu’on l’insulte dans le cabinet du juge d’instruction, sur les bancs de la cour d’assises, subissant, en public, l’agonie morale et physique du plus atroce martyre, répète aux autres et à lui-même jusqu’à en devenir fou : « Mais je suis innocent ! » et voit accueillir sa protestation par des huées, par des sarcasmes. Les juges se disent : Quel monstre ! Les jurés pensent : Quel scélérat endurci ! Les journalistes font de l’esprit, dans leurs comptes rendus, le public entier marche à la suite. Et voilà un homme dont le sort est décidé sans recours possible. La société, par ses juges, l’a estampillé : assassin, il faut qu’il soit et demeure assassin. N’essayez pas de discuter, la loi est là, et derrière la loi, les juges qui ne se trompent pas, car on nous l’a dit tout à l’heure : il n’y a pas d’erreur judiciaire, ce sont des blagues inventées par les romanciers. Et si, de temps en temps, on réhabilite un condamné, dont l’innocence a fini, le plus souvent quand il est mort, par être démontrée, c’est qu’une faction puissante a su arracher à la justice infaillible l’aveu de son erreur. Encore, est-ce de mauvaise grâce qu’elle se rétracte. Et si, par grand hasard, l’homme est encore vivant, la force publique, au lieu de lui faire solennellement des excuses, de chercher à réparer le tort matériel et moral qui lui a été causé, en lui confiant un poste honorifique et lucratif, en le traitant, en un mot, comme une victime, le fait venir, lui déclare, en rechignant, qu’il est libre, et l’envoie en liberté, comme on envoie au diable, en lui disant, ou à peu près : « Allez ! mon garçon ! Et qu’on ne vous y reprenne plus ! » Belle justice ! Bonne justice ! Bien payée, très décorée, et grandement honorée ! Je t’admire !
Il éclata de rire. Ce n’était plus le tranquille et froid Tragomer, dont les belles filles se moquaient gentiment, parce qu’elles le trouvaient trop réservé. Le sang lui était monté au visage et ses yeux brillaient. Il se tourna vers Marenval qui l’écoutait stupéfait et silencieux :
— Depuis deux ans, Jacques agonise sous le poids écrasant d’une condamnation qu’il n’a pas méritée. Sa mère est en deuil, sa sœur se désespère et veut se faire religieuse. Tout cela parce qu’un coquin inconnu a commis un crime qu’avec une habileté extrême, il a su mettre à la charge de ce malheureux qui semblait, du reste, avoir tout combiné d’avance, à force de désordre, d’imprudence et de folie, pour qu’on le soupçonnât coupable et qu’à partir de ce moment il lui fût impossible de prouver qu’il ne l’était pas.
Marenval commença à s’agiter. Les commentaires de Christian, sur la prétendue infaillibilité des juges, avaient laissé son enthousiasme se refroidir. Il trouva que l’intérêt du récit languissait et, avec toute la rigueur d’un critique qui demande une coupure dans le dialogue, il dit :
— Nous nous égarons, Tragomer, revenons à Léa Pérelli. Vous m’avez déclaré que vous l’aviez rencontrée. Mais où, dans quelles circonstances ? C’est là ce que je veux savoir. Voilà le nœud de l’intrigue. Laissons le reste, nous y reviendrons plus tard : mais parlez-moi de Léa Pérelli. Vous étiez à San-Francisco et c’est là que vous vous êtes trouvé en face d’elle. Où ? Comment ?
— De la façon la plus inattendue et, pourtant, la plus simple. J’étais arrivé la veille, avec Raleigh-Stirling, le fameux sportsman écossais, qui excelle à pêcher le saumon, et que j’avais rencontré sur le lac Salé, en train de capturer des monstres. Il m’avait suivi, il se proposait de faire quelques prises dans le Sacramento. Moi, j’avais chassé dans le Canada, et tué quelques bisons. Il y avait plusieurs semaines que, lui et moi, nous vivions au désert. Ce fut un agréable changement de nous retrouver au milieu de l’animation civilisée d’une ville, parmi des compagnons aimables. Et, justement, le plus riche banquier de la ville, Sam Pector, était un parent de mon compagnon de route. Aussitôt averti de notre arrivée, il nous envoya chercher dans sa voiture, fit prendre nos bagages à l’hôtel, et, moitié de gré, moitié de force, nous installa chez lui. C’est un célibataire de cinquante ans, riche comme on l’est dans ces pays-là, vivant comme un prince, et ne craignant pas le plaisir. Après un excellent dîner, le premier soir, il nous dit : Il y a représentation, à l’Opéra. On donne Othello avec Jenny Hawkins dans Desdemona et Rovelli, le grand ténor italien, dans le personnage du More. Nous irons, si vous le voulez bien, les écouter dans ma loge. Si vous vous ennuyez, nous rentrerons, ou nous irons au cercle Californien, à votre choix. À dix heures nous faisions notre entrée dans l’avant-scène de Pector, et nous trouvions le public emballé par les chanteurs qui vraiment avaient du talent, mais étaient entourés de malheureux artistes dont la nullité faisait de cette représentation, en dehors des scènes tenues par les protagonistes, un véritable scandale musical.
Jenny Hawkins ne se montra qu’à la fin de l’acte. Et, dès son entrée, je fus troublé par l’impression très nette que je connaissais la femme qui venait de paraître devant moi. C’était une brune, aux traits accentués, aux yeux hardis, à la taille élancée. Elle s’avança vers la rampe, et commença à chanter. À la même seconde, comme si la mémoire me revenait soudainement, je me rendis compte de la ressemblance qui m’avait frappé. Jenny Hawkins était le portrait de Léa Pérelli. Mais une Léa aussi brune que l’autre était blonde. Plus grande aussi et plus forte. L’impression que je ressentis fut extrêmement pénible. Je me détournai et regardai dans la salle, pour ne plus voir ce fantôme, qui venait, au bout du monde, me rappeler les circonstances si douloureuses, à la suite desquelles je m’étais expatrié. Mais si je ne la voyais plus, je l’écoutais et c’était le beau et large chant de l’Ave Maria que sa voix pure apportait à mon oreille. Bien souvent, j’avais entendu chanter Léa, autrefois, quand j’allais chez elle avec Jacques. Et je ne retrouvais plus son organe. C’était cela et ce n’était pas cela, comme le visage de Jenny Hawkins était celui de la morte, et, cependant, en différait par certains détails. Et puis comment cette chanteuse eût-elle été Léa Pérelli, qui avait été tuée rue Marbeuf, deux ans auparavant, et, en expiation du meurtre de laquelle, le malheureux Jacques de Fréneuse était relégué à Nouméa ? Folie ! Vision ! Rencontre fortuite, qui ne pouvait avoir aucune conséquence. Sensation qui me troublerait, l’espace d’une soirée, pendant cette représentation, et cesserait dès que la toile serait tombée. Hélas ! Les terribles réalités, auxquelles je me trouvais ramené par cette ressemblance, seraient plus durables et rien ne pourrait faire qu’elles ne fussent pas cruellement et irrévocablement acquises. Je me disais ces choses, en écoutant chanter l’artiste, et cependant l’émotion que j’avais ressentie, en la voyant entrer en scène, avait été si vive que je voulus la contrôler par un nouvel examen. Je me retournai et regardai la femme. Elle était à genoux, sur un prie-Dieu, sa belle tête appuyée sur ses mains croisées, et les yeux fixés vers le ciel comme pour l’implorer. Je frémis. Pour la seconde fois, mais d’une façon infiniment plus intense que la première, j’eus la sensation que Léa Pérelli était devant mes yeux. Un soir que Jacques la boudait, après une des violentes querelles qu’ils avaient trop souvent ensemble, je l’avais vue s’agenouiller ainsi, près du fauteuil où Jacques se tenait enfoncé. Elle avait posé ses coudes sur le bras du fauteuil, et, la joue appuyée sur ses mains croisées, elle avait regardé son amant avec un tendre et suppliant sourire. C’était la même physionomie, le même geste, le même regard et le même sourire. Était-il possible qu’une pareille ressemblance, je ne dis pas physique, mais morale, existât ? Cette épreuve affermit ma croyance plus que je n’aurais souhaité. Un trouble extraordinaire s’était emparé de moi. Je me penchai vers notre hôte, et lui demandai :
— Est-ce que vous connaissez cette Jenny Hawkins ?
— Certainement. C’est la troisième fois qu’elle vient chanter à San-Francisco, et, chaque fois, elle y a eu du succès.
— Lui avez-vous parlé ?
— Plus de dix fois ; j’ai soupé avec elle, lorsqu’elle était la maîtresse de mon ami John-Lewis Day, le grand marchand d’or de Sacramento. C’est une très aimable fille.
— Quel âge croyez-vous qu’elle ait ?
— Mais, vingt-cinq ans, peut-être. Elle paraît un peu plus âgée à la ville qu’à la scène, parce qu’elle n’a plus le maquillage, et puis cette existence d’artiste en tournée est très fatigante et fane la beauté d’une femme. Elle est très agréable. En ce moment, elle n’a personne, si elle vous plaît, je vous présenterai.
À la pensée de me trouver en présence de cette femme, mon cœur battit violemment et je dus devenir un peu pâle, car Pector se mit à rire et dit :
— Oh ! êtes-vous si impressionnable, mon cher, ou bien l’abstinence vous a-t-elle donné une telle fringale que la vue de la chair fraîche vous met hors de vous ? Le fait est que les squaws des Indiens des lacs ne sont pas régalantes, n’est-ce pas ?
La grosse gaîté de l’Américain me laissa le temps de me remettre. Je continuai mon interrogatoire :
— Est-ce que Jenny Hawkins parle l’anglais sans accent ?
— Elle le parle très purement, mais vous savez que nous autres, en Amérique, nous avons comme vous, en France, diverses prononciations suivant la province où nous sommes nés. Je ne serais pas surpris que Jenny Hawkins fût canadienne. Il y a un arrière-goût français, dans sa manière d’accentuer certains mots.
— Elle parle étonnamment l’italien…
— Oh ! il a bien fallu qu’elle l’apprît, dans l’intérêt de sa carrière. Toutes les troupes qui passent ici chantent en italien ou en allemand…
— Est-elle gaie de caractère ?
— Non. Plutôt mélancolique.
— Et les cheveux qu’elle montre, dans son rôle, sont-ils à elle, ou porte-t-elle une perruque ? Est-elle brune réellement ?
— Êtes-vous bizarre ! Qu’est-ce que cela peut vous faire ? N’aimez-vous les femmes que quand elles sont d’une certaine couleur ? Avec les eaux de teinture, peut-on aujourd’hui savoir si une chevelure est naturelle ? Voulez-vous mon opinion ? Eh bien ! je crois que Jenny Hawkins est naturellement brune, mais qu’elle a dû autrefois se teindre en blonde…
— En blonde ! m’écriai-je, très troublé. Elle a un léger accent français et elle s’est teinte en blonde !
— Allons ! mon cher, vous verrez que toutes les chances seront pour vous : la Jenny sera une vraie brune et une fausse Américaine ! Mais voici le rideau qui tombe. Allons sur le théâtre, si cela vous plaît : nous parlerons à la prima donna, et nous l’inviterons à souper.
— Encore un mot, dis-je, combien y a-t-il de temps que, à votre connaissance, Jenny Hawkins chante en Amérique ?
— Il y a certainement trois ans.
— Trois ans ! Et sous le nom de Hawkins ?
— Mais oui.
Toutes mes combinaisons se trouvaient dérangées par cette affirmation que la chanteuse était connue à San-Francisco depuis trois ans, et sous le nom qu’elle portait actuellement. Comment aurait-elle pu être Léa Pérelli à Paris et Jenny Hawkins en Amérique, au même moment ? Elle avait passé toute une année, sous mes yeux, il y avait trois ans seulement, dans cet appartement de la rue Marbeuf où on l’avait trouvée morte, un matin. Ce dédoublement était inadmissible. L’identité de l’Américaine était clairement établie. Cependant elle était l’image vivante de la malheureuse dont Jacques expiait le meurtre. Et une force plus puissante que le raisonnement, que la vraisemblance, que la sagesse, opprimait ma pensée et je me répétais malgré tout : c’est Léa Pérelli.
Nous étions sortis de la loge, et nous traversions le couloir du vaste théâtre. Une clef, que Pector avait dans sa poche, ouvrit la porte de communication, et nous passâmes de la lumière des lampes électriques aux ténèbres des coulisses. Je suivis mon guide qui évoluait parmi les portants, les décors et les accessoires, avec l’assurance d’un vieil abonné. On le saluait au passage. Il rencontra le directeur de la tournée, qui se précipita au-devant de lui, comme s’il était un souverain. J’en demandai la raison à Raleigh-Stirling. Il me répondit flegmatiquement que son parent était un des quatre propriétaires du théâtre, qui mettaient cette magnifique salle, presque gratuitement, à la disposition des impresarii, afin d’assurer à leurs concitoyens et à eux-mêmes des plaisirs artistiques. Le manager nous conduisait maintenant. Nous avions escaladé un étage et nous suivions le couloir des loges d’artistes. Devant une porte nous fîmes halte, notre guide frappa et dit :
— Peut-on entrer, ma chère miss Hawkins ?
— Qui est avec vous ? demanda, à l’intérieur, une voix qui n’était pas celle de la cantatrice.
— M. Pector et deux de ses amis.
— Qu’ils entrent.
La porte s’ouvrit et la servante nous accueillit dans un salon, qui précédait le cabinet de toilette où s’habillait Jenny Hawkins. Par la porte entre-bâillée, une vive lumière, une odeur d’eau de Cologne et de poudre, un bourdonnement de paroles, venaient jusqu’à nous. Une roulade se fit entendre. La chanteuse s’exerçait, insoucieuse de notre présence, tout en changeant de robe.
La femme de chambre était entrée auprès de sa maîtresse. Nous étions seuls dans le salon. Pector et Raleigh s’étaient assis près de la cheminée. Moi, invinciblement attiré vers cette porte entr’ouverte, je m’étais avancé, à pas légers, le nez au vent, l’oreille tendue, aspirant l’air, écoutant les bruits vagues. J’avais le dos à la muraille, et par l’ouverture de la porte, il était possible de me voir. Soudain j’entendis près de moi une exclamation étouffée et ces mots dits en français, à voix basse : « Prends garde ! » puis mon nom : « Tragomer ! »
Au même moment, la porte se ferma, et le silence se fit. Cependant je n’avais pas rêvé. Cette fois, j’étais bien sûr d’avoir entendu. Les deux mots « prends garde » précédant l’indication de mon nom, avaient été prononcés et, j’en aurais juré, par une bouche d’homme. Toute cette affaire se développait, si mystérieuse, que je fus pris d’une fièvre d’impatience. Sans me soucier de ce qu’en pourraient penser mes compagnons, je fis un pas pour tourner le bouton de la porte, si singulièrement refermée, et pénétrer dans la pièce voisine, quand cette porte s’ouvrit d’elle-même, et, sur le seuil, Jenny Hawkins parut.
Elle s’avançait souriante, le regard assuré. Ses yeux tombèrent sur moi, le premier, et je ne les vis pas se troubler. Il y avait, sur ses lèvres, une grâce insouciante et elle me fit de la tête un signe amical, avec la facilité d’accueil qui caractérise les artistes, habitués, comme les princes qui traversent la foule, à recevoir les hommages d’inconnus. Pector était venu au-devant d’elle et présentait son cousin et moi-même. À l’énoncé de mon nom la cantatrice inclina la tête, avec une nuance d’intérêt étonné, et dit gaiement à Pector :
— Ah ! gentilhomme français ! En Amérique, espèce rare ! Parle-t-il l’anglais ?
— Oui, madame, dis-je, sans plus attendre. Assez mal pour m’exprimer, mais assez bien pour vous deviner.
J’avais appuyé à dessein sur le mot « deviner ». La chanteuse ne parut pas comprendre la portée menaçante que j’avais donnée à ma réponse, elle sourit et me tendit la main en disant :
— Enchantée, monsieur, de faire votre connaissance.
Il faut que j’en convienne. À cette minute décisive, il n’y avait en Jenny Hawkins, que bien peu de chose de Léa Pérelli. Comme ces portraits effacés par le temps, qui ne laissent distinguer que les traits affaiblis du modèle, la ressemblance s’atténuait, et la morte disparaissait chassée par la vivante. Je cherchais, déjà vainement, tous les détails qui auraient pu me rappeler Léa Pérelli, et je ne les retrouvais pas. L’attitude de la femme que j’avais sous les yeux n’était plus la même que celle de la pauvre disparue. La naïve gaîté, l’air rieur, les gestes d’enfant, tout ce qui caractérisait l’italienne, était remplacé, chez l’Américaine, par la fierté froide, l’assurance grave, et le ferme maintien de l’artiste sûre du public et d’elle-même.
— Je ne vous garderai pas longtemps auprès de moi, quelque plaisir que j’en aie, dit Jenny Hawkins, il faut que je descende en scène pour le dernier acte. Comment avez-vous trouvé Rovelli ? Il a bien chanté, n’est-ce pas ? C’est un grand artiste.
— Son succès n’a été qu’égal au vôtre, dis-je, et je le trouve mieux partagé que vous par le compositeur.
— Oui, dit-elle avec une légère inclination de tête. Ce rôle n’est pas le meilleur de mon répertoire. Si vous venez m’entendre chanter la Traviata, je vous y plairai davantage.
— Je ne crois pas, répondis-je hardiment. Il me serait très pénible de vous voir mourir en scène.
Elle leva le front, plongea son regard dans le mien et dit :
— Pourquoi ?
— Parce que cette mort me rappellerait de poignants souvenirs.
Elle se mit à rire :
— Ah ! Français ! Impressionnable et sentimental. Qu’a de commun la musique de Verdi avec vos souvenirs ?…
— Je vous l’expliquerai, si vous le voulez…
— Je n’ai pas le temps, et c’est dommage.
— Eh bien ! ma chère, intervint Pector. Voulez-vous venir souper avec nous, ce soir, après la représentation ?
— C’est très aimable à vous de m’y engager, mais je serai trop lasse. Il faut ménager ma voix.
— Alors, demandai-je, voulez-vous me permettre de me présenter chez vous, demain, dans la journée ?
— Bien volontiers. Je loge à l’Hôtel des Étrangers, place de l’Hôtel-de-Ville ; à partir de quatre heures, si cela vous plaît. Vous accepterez une tasse de thé et nous causerons.
Je m’inclinai sans répondre. Elle tendit la main à mes compagnons et à moi-même, nous conduisit jusqu’au couloir des loges et rentra chez elle, en refermant soigneusement la porte.
Une fois hors de la présence de cette femme, je repris la faculté d’analyser, de discuter et de comprendre. Si je n’avais pas entendu mon nom et les brèves paroles adressées à Jenny Hawkins par l’homme qui se trouvait dans sa loge pendant que nous étions dans le salon, j’aurais pu renoncer à établir, entre Léa Pérelli et la cantatrice, un rapprochement, qui se faisait plus vague à mesure que je précisais mes observations. Mais il y avait les paroles et le nom entendus. Qui était l’homme, dont j’étais connu, et qui disait à la Hawkins de prendre garde quand j’apparaissais ?
L’identité des deux femmes, détruite par les différences d’allure, d’expression que j’avais remarquées, par toutes les impossibilités matérielles de temps, de condition, de nationalité, relevées par Pector, se trouvait rétablie par la seule intervention de cet inconnu, qui me signalait à Jenny Hawkins, évidemment comme un danger. Je me sentais repris de toutes mes angoisses, emporté par une ardente curiosité. Je ne me souciais plus de la cantatrice. Je voulais savoir qui était son compagnon, ce français qui me connaissait, et qui, seulement entrevu, devait m’éclairer la situation.
Arrivé dans la salle, Pector demanda :
— Restons-nous ?
— Ma foi, dis-je, j’ai un peu mal à la tête. Depuis six mois, je n’avais pas été à pareille fête. Et toutes les notes de la partition se battent dans ma cervelle. Je ne serais pas fâché de prendre l’air.
— Eh bien ! Je renverrai la voiture. Nous rentrerons à pied.
Après un temps très court, nous sortions dans la rue et, fumant un excellent cigare, nous flânions dans les vastes quartiers de la ville. Le hasard nous avait amenés sur la place, où se dresse le monumental Hôtel de Ville. Je demandai :
— Où est l’Hôtel des Étrangers ?
— En face de nous, cette large façade éclairée. Ce n’est pas une maison à dix-sept étages, comme celles de New-York. Nous avons de la place ici, pour construire. Voulez-vous entrer ? Il y a un excellent restaurant…
Pector, avec sa manie américaine de flâner dans les lieux publics, d’aller, dans les bars, manger un sandwich, boire un cocktail, servait ma fantaisie. Je venais de concevoir le projet d’attendre Jenny Hawkins, devant la porte de l’hôtel, pour la surprendre avec son compagnon. Un pressentiment me disait qu’elle rentrerait en sa compagnie, et que là, en une seconde, j’apprendrais le secret de cette femme. Car il n’y avait pas à en douter : elle avait un secret. Je suivis mes deux compagnons dans l’intérieur de l’hôtel, je m’assis, avec eux, devant une table chargée de rafraîchissements composés pour mettre le feu dans le corps. Puis, au bout d’un instant, j’appelai le garçon :
— À quelle heure finit le théâtre ?
— Vers minuit.
— Bien.
Pector me demanda, en riant :
— Est-ce que vous voulez guetter Jenny Hawkins ?
Il semblait avoir lu dans ma pensée. Je lui répondis :
— Ma foi, je ne serais pas fâché de voir comment elle est, à la ville, après l’avoir vue à la scène. Les femmes perdent tellement, quand elles abandonnent leur costume et leur fard ! Si elle n’en vaut pas la peine, je lui brûle la politesse demain.
— Croyez-moi, elle en vaut la peine.
— Parbleu ! Je vais bien voir !
— Faites ! Nous vous attendons.
Je partis vite. J’avais obtenu, avec beaucoup de chance, la liberté d’action que je souhaitais. Maintenant restait à obtenir du hasard la faveur de me trouver sur le passage de la chanteuse. Le portier, gratifié d’un dollar, se chargea de me renseigner.
— Milord, la dame descend de voiture sous la voûte, traverse le vestibule, monte par cet escalier. Son appartement est au premier… Elle ne tardera pas à rentrer…
Je sortis sous la voûte. Je relevai le collet de ma pelisse. Il faisait froid, ce soir-là, quoiqu’on fût en avril. Et fumant, en marchant, j’attendis. Un grand bruit de piaffements, le roulement des roues sur le trottoir, m’avertirent, après quelques minutes, que la voiture de la diva arrivait. Le portier s’avança pour aider à descendre. La portière s’ouvrit et, tout emmitouflée dans ses fourrures, Jenny Hawkins s’élança, leste, en montrant une jambe charmante. Elle regarda, autour d’elle, m’examina rapidement, ne me reconnut pas, car j’enfonçais ma figure dans mon col et mon cigare fumait terriblement, et s’adressant à une personne restée dans l’intérieur, elle dit en français :
— Allons, ami.
Celui qu’elle appelait s’apprêtait à sortir de la voiture, je m’avançais vers lui. À ce moment précis, j’eus la certitude que je tenais la clef du mystère. Mais l’homme qui penchait la tête, m’aperçut et rentra vivement à l’intérieur. Il dit seulement, d’un ton bref :
— Jenny !
Et c’était bien la même voix qui avait parlé dans la loge. La chanteuse, inquiète, s’approcha de la portière, se pencha à l’intérieur, puis, se tournant vers le cocher :
— Union Square…
Elle pivota sur ses talons, entra, en coup de vent dans le vestibule et disparut. La voiture tourna, sortit. Et sans avoir pu voir son mystérieux occupant, je restai seul sous la porte cochère. Le portier s’approcha de moi et me dit :
— Jolie femme, milord. Le monsieur n’est pas rentré, ce soir, avec elle… Si milord veut écrire, je puis monter la lettre.
Je donnai un second dollar à ce complaisant serviteur et je regagnai la salle où Pector et Raleigh savouraient leurs liqueurs nationales.
— Eh bien ? demanda le banquier.
— Décidément, vous avez raison : elle en vaut la peine. J’irai demain.
Nous rentrâmes nous coucher. Mais le lendemain à l’heure du déjeuner, comme Pector paraissait dans la salle à manger :
— Mon cher vicomte, vous n’avez pas de chance dans vos tentatives galantes. Je viens d’être averti, par la direction de l’Opéra, que la troupe italienne ferait relâche ce soir. La Hawkins a attrapé froid, hier soir, elle ne pourra pas chanter. Et, comme elle est attendue, après-demain, à Chicago, elle part tantôt, par le rapide. Adieu le rendez-vous. Du reste, voici une lettre qui vous est adressée et qui vous apporte, sans doute, ses regrets.
J’ouvris l’enveloppe. Sur un carré de bristol, au coin duquel était timbré ce chiffre J. H. entouré de cette devise : Never more, je lus ces lignes : « Je suis désolée de manquer votre visite, dont je me promettais un grand plaisir, cher monsieur, mais les artistes ne sont pas toujours maîtres de leur volonté. Aujourd’hui je n’aurais pu vous parler, car je suis enrouée. Je pars pour Chicago et New-York, où je passerai quelques semaines. Si les hasards de votre voyage vous y amènent, je serai heureuse que vous me donniez une revanche. Une poignée de main amicale. Jenny Hawkins. »
Je restai songeur. Mes deux compagnons se moquèrent de ce qu’ils appelèrent mon sentimentalisme. Ils ne pouvaient soupçonner les graves préoccupations, les soucis poignants que me causait ce brusque départ. Après les divers incidents de notre mise en présence, l’indisposition, assurément feinte, de la chanteuse, et son parti pris de me fuir, étaient une confirmation de mes soupçons, presque un aveu.
Je réfléchis profondément à la situation. Si Léa Pérelli, par un enchaînement de circonstances, inexplicable pour moi, vivait, après que Jacques de Fréneuse avait été condamné pour l’avoir tuée, il était évident que ce mystère recouvrait une monstrueuse iniquité. Je pris la résolution inébranlable de l’éclaircir et de réparer le mal qui avait été fait à mon malheureux ami. Mais ce n’était pas en Amérique, vaste continent où Jenny Hawkins errait vagabonde, que je pouvais tenter de suivre une piste, de procéder à une enquête, et essayer d’établir la vérité. Là, j’étais seul, sans appui, sans ressources, tout à fait désarmé. Le crime avait été commis en France. C’était en France qu’il convenait de poursuivre la révision du procès. Et la première précaution à prendre, la plus élémentaire, devait consister à rompre tout contact avec Jenny Hawkins et son compagnon inconnu. Il fallait les laisser se remettre de leur alarme, leur rendre une complète sécurité, afin de les mieux surprendre quand le moment paraîtrait favorable. Et pour cela, avant tout, il importait qu’ils n’entendissent plus parler de moi.
Cette résolution arrêtée, je m’y tins fermement. Je traversai l’Amérique, m’embarquai à la Nouvelle-Orléans, et, il y a trois semaines, j’arrivai à Paris. Je me suis, pendant ce temps-là, occupé à reprendre pied, à renouer les relations, détendues par une absence de dix-huit mois, et à chercher l’occasion d’entamer les hostilités. Cette occasion m’a été fournie ce soir. Je vous ai narré mon aventure, et je vous demande, si vous, Marenval, avec votre grande fortune, votre goût pour les choses qui ne sont pas communes, et la hardiesse que vous montrez à heurter, quand vous le jugez bon, les idées courantes, vous voulez collaborer, avec moi, à réhabiliter un innocent et à confondre un coupable ? Et puis, mon cher, voyez-vous, ce ne sera pas banal. Il y aura une grande maestria à tenter cette œuvre-là. Ce n’est pas à la portée du premier venu. Jacques de plus est votre parent. Vous remporterez, aux yeux de tout Paris, un vrai triomphe, si vous réussissez. Et je crois que vous aurez une page étonnante dans l’histoire de ce temps-ci, qui se distingue par son égoïsme et sa veulerie. À la fin du XIXe siècle, quand personne ne croit plus à grand’chose, n’est pas qui veut un justicier et un redresseur de torts. Et, en conscience, mon cher ami, tenir cet emploi, c’est être sûr de jouer un rôle unique.
Marenval avait écouté le récit de Tragomer avec une attention passionnée. Il avait palpité aux épisodes et frémi aux péripéties. Il avoua, plus tard, qu’il s’était senti empoigné comme jamais il n’avait eu l’occasion de l’être, et qu’une voix secrète lui avait murmuré à l’oreille : Marenval, il y a une affaire « épatante » à mener là, et c’est toi qui en auras l’honneur ! Lorsque Christian eut terminé, il retrouva la parole, et éclata comme une chaudière dont les soupapes ont été trop comprimées :
— Eh bien ! Tragomer, je ne regrette pas ma soirée ! Oh ! vous venez de me donner chaud, mon bon ! Quelle histoire ! Vous avez eu un fameux flair de me la raconter. Je suis, en effet, l’homme qu’il vous faut. Nous allons manigancer ça, dans les grands numéros. On ne me met pas dedans, moi ; j’ai l’habitude des affaires, et je connais les hommes. Les femmes aussi ! Ah ! mon brave Tragomer ! Vous avez dû vous en faire du sang d’encre, pendant la traversée, quand vous ruminiez toute l’aventure ! Mais, à partir de maintenant, nous allons mettre les fers au feu, et ça va marcher !
Christian interrompit son impétueux compagnon :
— Surtout de la prudence. Pas une parole prononcée au hasard. Vous ne soupçonnez pas toutes les difficultés auxquelles nous pouvons nous heurter.
— Comment ! Des difficultés ! Mais tout le monde va nous aider. La justice, les pouvoirs publics, le chef du gouvernement… Dès que nous aurons des preuves sérieuses à fournir de l’erreur commise, chacun s’empressera de la vouloir réparer. La seule partie délicate de l’affaire, c’est l’enquête.
— Tout est délicat, dit Tragomer. Ne comptez pas sur le concours de la justice. Sa première pensée sera de se défier, la seconde de résister à nos efforts. Il n’est jamais agréable d’avouer qu’on s’est trompé. Et la justice, par profession, n’admet pas qu’elle soit sujette à l’erreur. Vous savez combien de temps, de travaux, de vouloir et de puissance, il a fallu pour obtenir les rares réhabilitations qui ont été consenties par la magistrature. Presque toutes ont été arrachées à la justice par la politique. Ne vendez donc pas la peau de l’ours : il n’est pas encore par terre. Nous avons de beaux atouts dans la main : votre immense fortune, vos grandes relations, votre ténacité et votre intelligence. J’ajouterai, si vous le permettez, mon courage et ma volonté.
— Oui, certes, bon Christian, s’écria Marenval, en serrant les mains du jeune homme. À nous deux, nous réussirons. Je serai silencieux, circonspect, je vous le promets. Vous n’aurez pas un reproche à m’adresser.
— C’est bien ! Écoutez-moi encore, pendant quelques instants. J’ai des renseignements complémentaires à vous fournir. D’abord Jenny Hawkins n’est plus en Amérique, elle est en route pour l’Angleterre.
— Pour l’Angleterre ! Elle y chantera ?
— À Londres, à Covent-Garden. Je l’ai appris par les journaux anglais, ces jours-ci. Enfin, le hasard m’a servi mieux que je ne l’espérais, et m’a fourni, sur l’homme mystérieux qui accompagnait la chanteuse à San-Francisco, des données précieuses…
— Vous le connaissez ?
— Je crois le connaître. L’autre soir, au cercle, je jouais, avec des amis, au bridge, lorsque, à la table voisine de la nôtre, un des joueurs, en allumant sa cigarette au chandelier placé près de lui, renversa l’abat-jour qui prit feu. Son partenaire dit alors vivement : « Prends garde ! » Et je sursautai à ces deux mots prononcés. Je venais de reconnaître la voix, l’intonation, l’accentuation qui m’avaient frappé en ces mêmes paroles, entendues par moi dans la loge de Jenny Hawkins. Je me retournai brusquement, et je regardai celui qui venait de parler. Il m’avait vu me retourner, et lui aussi me regardait. Nos yeux se croisèrent, se fouillèrent. Et, au fond des siens, je lus nettement cette pensée : il m’a reconnu. Il affecta de sourire et dit gaîment :
— Ne brûlons pas le matériel, n’est-ce pas Tragomer ?…
— Et cet homme, interrompit Marenval, ce membre du cercle, qui vous traitait si familièrement… C’était ?…
Tragomer devint sombre, l’animation de son visage fit place à une morne pâleur et, baissant la tête, il dit :