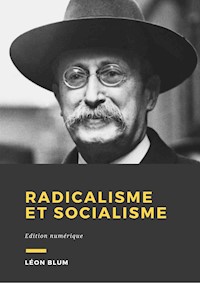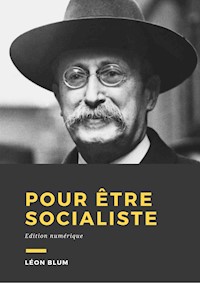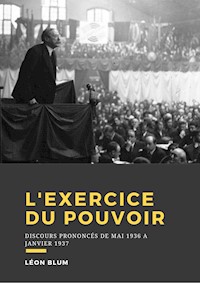Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Ce livre touche à des questions trop diverses et trop complexes pour que j’aie pu disposer les idées et les observations qu’il renferme dans un ordre rigoureux. Dans la vie morale comme dans la vie sociale, tout se lie, tout se tient ; il n’est point de solution provisoire qui n’engage une infinité d’autres problèmes, et, à chaque moment de sa pensée, on voit s’ouvrir devant soi, comme un promeneur égaré, des routes multiples et divergentes. Bien que j’eusse un dessein très ferme et que je prétende aboutir à des conclusions formelles, j’ai fait peu d’efforts pour résister aux détours qui me tentaient. Peut-être mon récit gagnera-t-il en liberté ce que ce désordre lui fait perdre en évidence persuasive."
À PROPOS DE L'AUTEUR
Léon Blum, né le 9 avril 1872 à Paris et mort le 30 mars 1950 à Jouy-en-Josas (alors en Seine-et-Oise), est un homme d'État français.
Figure du socialisme, il refuse en 1920 de voter l'adhésion à la Troisième Internationale communiste. Dirigeant de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), il est président du Conseil de juin 1936 à juin 1937 et de mars à avril 1938, puis président du Gouvernement provisoire de la République française de décembre 1946 à janvier 1947.
Après la victoire de la coalition du Front populaire aux élections législatives de 1936, il forme un gouvernement comprenant plusieurs femmes. Il conduit d’importantes réformes socialistes (congés payés, réduction du temps de travail, etc.) ; en raison de l’hostilité des radicaux, il ne vient pas militairement en aide aux républicains espagnols, ce qui conduit le Parti communiste à lui retirer son soutien. Il redevient président du Conseil l’année suivante, mais pour seulement un mois.
Lors de l'occupation de la France par les armées du Troisième Reich, il est emprisonné par le régime de Vichy, traduit en justice lors d'une parodie de procès à Riom en 1942, puis déporté à Buchenwald. Libéré en 1945, il devient ensuite président du Gouvernement provisoire de la République française et prépare aux institutions de la IVe République.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MARIAGE
Léon Blum
– 1907 –
Si l’on veut débarrasser ce livre de l’excès de généralisation où m’entraîna sans doute le désir de prouver, il pourra ne pas paraître inutile. Je l’ai médité longtemps, et, en le relisant achevé, je me sens plus persuadé que jamais de sa vérité fondamentale. C’est cette conviction que j’invoque auprès de ceux de mes lecteurs que l’œuvre pourra choquer.
Je demande la permission de rendre publique la dédicace que j’en fais à ma femme, entendant signifier par là que dans la conception de ce livre il n’entra pas de déception ni de rancune, mais au contraire un sentiment de reconnaissance, et qu’il fut écrit par un homme heureux.
L. B.
I
Ce livre touche à des questions trop diverses et trop complexes pour que j’aie pu disposer les idées et les observations qu’il renferme dans un ordre rigoureux. Dans la vie morale comme dans la vie sociale, tout se lie, tout se tient ; il n’est point de solution provisoire qui n’engage une infinité d’autres problèmes, et, à chaque moment de sa pensée, on voit s’ouvrir devant soi, comme un promeneur égaré, des routes multiples et divergentes. Bien que j’eusse un dessein très ferme et que je prétende aboutir à des conclusions formelles, j’ai fait peu d’efforts pour résister aux détours qui me tentaient. Peut-être mon récit gagnera-t-il en liberté ce que ce désordre lui fait perdre en évidence persuasive. Et d’ailleurs, en telle matière, une digression peut être un bon argument.
Je crois cependant utile d’exposer dès à présent au lecteur de quelles données je suis parti et par quelles idées j’entends conclure. Cette précaution est contraire à tous les préceptes de l’art dramatique ou romanesque, et, d’autre part, mon système — si je puis dire — ainsi présenté dans sa nudité, risque de sembler, suivant les goûts, trop choquant ou trop banal, trop paradoxal ou trop sommaire. Mais il vaut mieux courir ce risque et tout sacrifier à la clarté. C’est au lecteur, désormais associé à ma tâche, qu’il appartiendra d’intégrer dans le plan préalablement connu de mon livre les réflexions, les analyses, les anecdotes qui sembleraient d’abord s’en séparer.
On se souvient que l’an dernier un certain nombre d’hommes politiques, d’hommes de lettres, de jurisconsultes — et dans le nombre j’en sais que j’admire ou que j’honore — réunis par un journaliste actif, constituèrent un comité pour la réforme du mariage. Je n’entends pas résoudre ou poser un seul des problèmes sur lesquels l’officieux comité publia son sentiment. Je ne traite aucune des questions légales qui peuvent accompagner l’idée du mariage, ni l’âge de la majorité matrimoniale, ni le consentement des parents, ni la forme du contrat, ni la légitimation des enfants naturels, ni la reconnaissance des adultérins, ni rien d’analogue. Mon intention est de n’entrer dans aucune controverse et de ne gêner aucune spécialité.
Il m’est arrivé seulement de constater, comme tout le monde, par une suite d’expériences ou d’observations quotidiennes, combien, dans le mariage tel qu’il est aujourd’hui pratiqué, le bonheur est fortuit et difficile. J’en suis venu à me demander, ce qui est fort banal encore, si cet état s’expliquait par quelque vice inhérent à la notion même du mariage, c’est-à-dire de la monogamie, ou par les modalités présentes de l’institution, c’est-à-dire les habitudes sociales. Et ainsi, précisant peu à peu le problème, j’ai recherché si quelques changements relativement simples, opérés non pas dans nos lois mais dans nos mœurs, et qui laisseraient à peu près intacte l’organisation actuelle de la famille et de la société, ne suffiraient pas pour transformer ce qui est aujourd’hui cause de division ou de conflit en condition de commerce et d’entente.
En d’autres termes, et tenant pour démontré que le mariage ou la monogamie légale est une institution qui fonctionne mal, je me suis demandé s’il convenait de l’abandonner radicalement, pour s’en tenir aux formes modernes de la polygamie, c’est-à-dire aux unions multiples et précaires, ou s’il était possible de l’amender. J’ai été conduit à conclure que le mariage n’était pas une institution mauvaise, mais une institution mal réglée et dont on tire un mauvais parti, une institution, si je puis dire, généralisée à l’excès, convenable à certains cas, à certains moments de la vie, mais non pas à tous. Le mariage ne devient pernicieux que dans la mesure où il est pratiqué sans sagesse et imposé sans discernement, comme il arrive dans l’état présent des mœurs. Ce n’est ni un poison ni une panacée. C’est un aliment sain, mais qu’il faut assimiler à son heure.
Il m’a fallu quelque courage pour dominer le préjugé favorable que l’union libre m’inspirait. Je sens vivement ce que cette expression seule a de séduisant et de noble. Le discours que Carl Vogt tint à sa fille, et dont MM. Donnay et Descaves tirèrent si bon parti dans Oiseaux de passage, a quelque chose qui retentit dans tout cœur bien placé. Mais l’union libre, ou bien n’est qu’une protestation contre la formalité même du mariage, contre l’intrusion de l’autorité sociale dans une convention privée, et l’on me permettra bien de dire qu’en ce cas elle constitue un pur enfantillage, ou bien n’est qu’une union provisoire, autorisant d’avance les changements ultérieurs, les préparant même et leur servant de transition naturelle. Dans ce dernier cas, l’union libre est polygamique. Or, ni la monogamie légale ni la polygamie libre n’apportent au problème de la relation des sexes une solution satisfaisante et complète. On ne peut dire ni de l’homme ni de la femme que soit la monogamie soit la polygamie constitue la loi naturelle et unique de leurs rapports. L’homme et la femme sont d’abord polygames, puis, dans l’immense majorité des cas, parvenus à un certain degré de leur développement et de leur âge, on les voit tendre et s’achever vers la monogamie. Les unions précaires et changeantes correspondent au premier état : le mariage est la forme naturelle du second. Et l’on aperçoit la très mince portée du changement que je propose : il consiste à ne se marier qu’au moment où l’on se sent disposé pour le mariage, quand le désir des changements et de l’aventure a fait place, par une révolution naturelle, au goût de la fixité, de l’unité et du repos sentimental.
Cette méthode n’a rien de fort original, et la meilleure preuve en est que, dès aujourd’hui, la plupart des hommes se marient conformément à mon ordonnance. Mais les femmes ?... Ce seul point d’interrogation enferme tout le problème. Si le mariage, tel que nous le pratiquons, est par essence malheureux, s’il oppose, use et endolorit les corps et les cœurs dans tout ce qu’ils ont de contraire et de sensible, si le bonheur y constitue « un hasard dont on frémit », et la paix, la simple douceur de la paix, une sorte de jouissance providentielle, ne tenons-nous pas maintenant la cause du mal, ne tenons-nous pas aussi le remède ? Le vice propre du mariage actuel, c’est qu’il unit un homme tendant ou déjà parvenu à la période monogamique avec une femme encore neuve, avec une femme qui, normalement, avant de se fixer, devrait dépenser, épuiser l’instinct de changement qui est en elle. Examinons même, dans l’état présent, le cas le plus rare, le plus favorable, un mariage d’amour entre deux très jeunes gens. La jeune fille est vierge, le jeune homme n’a laissé, dans de brefs et banals contacts, que l’apparence et la surface de sa virginité. Vous croyez ce mariage heureux ? Cependant, et hors des exceptions qu’il faut toujours réserver, ce mariage ne sera pas heureux ou ne sera pas solide, et nous n’avons, pour nous en convaincre, qu’à regarder autour de nous avec l’attention et dans la direction convenables. On n’attente pas impunément aux lois naturelles. Le mariage est la monogamie codifiée, et la monogamie ne correspond, chez l’homme ou chez la femme normale, qu’à un état second du cœur et des sens. Tout mariage qui unit l’homme et la femme avant qu’ils soient parvenus l’un et l’autre à cet état est un mauvais mariage.
J’admets d’avance tous les exemples particuliers qu’on m’opposera, je marque dès à présent toutes les restrictions que je crois utiles, et j’y insisterai par la suite. Je connais, et tout le monde connaît, des hommes et des femmes en qui le désir du changement semble illimité, insatiable. On sait, ou du moins on cite, des unions qui, de l’adolescence à la mort, ont attesté l’amour égal et invariable de deux êtres. Daphnis, sous ses cheveux blancs, était devenu Philémon. Je n’éluderai pas cette objection. Mais je n’envisage ici que l’humanité normale, cette moyenne humaine pour qui sont faites les lois et les mœurs. A son regard, la loi que j’ai fixée est juste. Je vois le geste du lecteur sincère qui s’est consulté lui-même et s’est déjà reconnu.
⁂
Il y a déjà dix ans ou davantage, j’ai connu deux sœurs, toutes deux jolies, et qui, toutes deux, crurent se marier par amour. Il est bien vrai que l’aînée, Geneviève, était amoureuse de son mari, nommé Lucien D..., mais on en pouvait douter pour la seconde. En réalité, Henriette avait épousé son cousin, Georges H..., parce que chacun, autour d’eux, les avait toujours destinés l’un à l’autre, que cette union, qui ne pouvait être évitée, n’avait rien qui leur déplût, mais qu’au contraire leur amitié d’enfance avait tranquillement grandi avec eux. Geneviève et Henriette se marièrent le même jour à la même église. Lucien D... et Georges H... étaient presque du même âge, vingt-cinq ans.
Lucien et Geneviève connurent quelques années d’un violent bonheur dans lequel on les vit plonger et disparaître. Puis cette ardeur, sans tomber, devint moins régulière et moins constante. Ils passèrent par des crises alternées d’élan et de lassitude. Parfois, il leur semblait que leur amour, fatigué, pouvait encore être rafraîchi par quelque forme d’émotion différente, par quelque événement imprévu ; tantôt ils éprouvaient, sans en prendre clairement conscience, qu’ils auraient eu besoin de trouver entre eux autre chose que de l’amour. Leur commune passion les ressaisissait alors avec une fougue impétueuse et brutale. Ces changements trop brusquement tranchés firent naître ou développèrent chez Lucien une sorte de préoccupation inquiète et défiante que Geneviève toléra impatiemment. Avec un mari qui l’eût aimée moins, elle-même se fût montrée exigeante et jalouse. Aimée plus encore qu’elle n’aimait, c’est elle qui devint attentive, puis rebelle aux excès inévitables de l’amour. Lucien le sentit, souffrit, sa jalousie s’aiguisa ; au bout de quelques mois, elle était déjà plus vive en lui que la passion. Il était prêt, sans le savoir, pour une de ces faiblesses auxquelles les déceptions amoureuses disposent les hommes si naturellement. Lucien trompa donc sa femme, et il est habituel qu’en pareil cas ce soit le plus amoureux qui trompe le premier. Mais Geneviève avait trop peu d’expérience ou de réflexion pour comprendre la nécessité de cet effet. Une telle trahison, survenue après tant de protestations et de récriminations amoureuses, la jeta dans un état de stupeur et de dégoût qu’aucun effort ne put surmonter. Elle se sépara de Lucien.
Cependant, des accidents d’un ordre plus banal, mais tout aussi graves, s’étaient produits dans le ménage de la sœur cadette. Henriette et Georges étaient tous deux d’un caractère tranquille, tendre et sentimental. Leur vie s’était établie sur un fond d’amitié solide et confiante, sur une communauté d’intelligence et de goût qui rendait agréable et pleine l’existence de chaque jour. Mais Henriette, au fond de son cœur, déplorait de ne pas se sentir aimée d’amour, et Georges éprouvait le même regret. Chacun d’eux, sans avoir la force ou le besoin d’aimer soi-même, souffrait confusément de n’être pas aimé de l’autre. L’exemple tout proche de Geneviève et de Lucien ravivait leur inquiétude et réveillait sans cesse en eux, par un effet de contagion nécessaire, de ces velléités d’amour auxquelles l’amour n’obéit jamais. Sur ces entrefaites, une amie d’Henriette s’éprit d’une violente passion pour Georges. Et l’on voit bien que Georges se fût courageusement défendu contre un amour qu’il eût éprouvé lui-même, mais qu’à cette crise de sa vie il se trouvait sans défense contre l’amour qu’il inspirait. Il se laissa enlever par madame X... et quitta la France avec elle.
Henriette se vit donc abandonnée par son mari au moment où Geneviève venait de quitter le sien. Pour des raisons d’ordre multiple, et surtout sous l’influence de scrupules religieux, les deux sœurs renoncèrent à demander le divorce ; elles résolurent de vivre ensemble. Je n’ai pas à décrire ici par le menu ce que fut, pendant six ans qu’elle dura, cette période de leur vie. Deux femmes riches et jolies, l’une ayant fait une expérience si vive de la passion et l’autre la cherchant encore, se sentant excusées d’avance de tous leurs actes, assez libres pour consentir à toutes les nécessités d’une intrigue, assez tenues vis-à-vis du monde pour devoir se contraindre au secret, trop jeunes pour ne pas chercher à être aimées, trop désabusées pour attendre beaucoup de l’amour, deux femmes de ce caractère devaient traverser beaucoup d’aventures, et ce fut par là qu’elles passèrent, en effet. Mais ce détail est hors de notre sujet. Ce qui importe, c’est qu’après plusieurs années de cette existence partagée, le hasard remit en présence Henriette et Georges. Ils furent étonnés l’un et l’autre du geste amical et du sourire joyeux par lequel ils s’accueillirent. Les circonstances ne leur permirent pas de prolonger cet entretien, mais Henriette ressentit un vif désir de le renouveler, et, à plusieurs reprises, employa pour rencontrer son mari les mêmes précautions et les mêmes ruses que pour rejoindre ses amants. Ce qui la surprit le plus fut de retrouver aussitôt près de Georges la même aisance, la même liberté de communication et de parole : dans ses conversations avec Georges, elle redevint dès l’abord plus naturelle et plus sincère qu’elle n’avait jamais été avec sa sœur. Elle se sentit toute proche de lui confier les secrets de pensée et les vérités de cœur qu’elle n’avait encore franchement ouverts à personne. De jour en jour, leur confession mutuelle se fît plus complète et plus intime. Tous deux étaient fatigués de l’amour ; tous deux recherchaient une vie stable et sûre ; tous deux se reprochaient d’avoir méconnu le bonheur qui leur avait été donné. Ils n’avaient jamais cessé de le regretter, ils le désiraient encore ; ils se sentaient capables de l’essayer à nouveau et de le goûter davantage. Le résultat fut qu’un beau jour Henriette quitta sa sœur et retourna vivre près de son mari, au grand scandale du monde.
Le bonheur d’Henriette ne fut voilé que par une seule ombre : qu’allait devenir Geneviève encore une fois délaissée. Mais, si les deux sœurs s’aimaient tendrement, les deux beaux-frères étaient restés liés par une forte affection et leurs relations amicales ne s’étaient jamais interrompues. Georges conçut donc naturellement le projet de réunir Lucien à Geneviève comme lui-même s’était réuni à Henriette. L’entreprise était difficile, et je passe sur les précautions infinies qu’il dut imaginer pour rassurer, puis pour tenter deux âmes ardentes et ombrageuses. Il eût échoué s’il n’avait pas été servi par la secrète fatigue, par le sourd besoin de certitude et de repos, qui avait atteint et gagné peu à peu ces deux amants jadis insatiables. Mais enfin il obtint de sa belle-sœur et de son ami un assentiment de principe, sur quoi il les remit en présence.
C’est Henriette qui m’a peint leur rencontre, et le récit qu’elle m’en fit était, bien malgré elle, plus comique qu’attendrissant. Lucien et Geneviève demeurèrent dans une sorte d’embarras penaud et stupide, échangèrent avec effort quelques paroles généralement dénuées de sens, si bien qu’on crut devoir les laisser seuls. Leur gêne mutuelle se prolongea et devint d’autant plus pesante qu’elle tenait, comme ils le comprirent parfaitement, non pas à une émotion, mais à une déception réciproque. Au bout de quelques minutes, Geneviève rappela Henriette et quitta la chambre, tandis que Georges essayait de réconforter Lucien. Mais le dialogue qu’échangèrent de chaque côté de la porte les deux hommes et les deux femmes fut le même, presque mot à mot.
— Qu’as-tu ?
— Mais, précisément, je n’ai plus rien.
— Ne l’aimais-tu pas ?
— Je l’aimais, j’ai gardé de cet amour un souvenir puissant et doux, le souvenir le plus riche de ma vie. Mais, je le sens, nous ne pouvons plus nous aimer.
— Ne pouvez-vous du moins vous plaire ?
— Nous ne savions que nous aimer.
— Tu ne crois pas le bonheur possible entre vous ?
— Nous n’avions en commun que notre amour. Du moment que nous ne nous aimons plus, que sommes-nous l’un pour l’autre ? Des étrangers, des inconnus. Tout notre lien est dans le passé. Mais cet amour passé, nous ne pouvons ni le recréer ni lui substituer quelque amitié nouvelle. Ne gâtons donc pas le seul bien qui nous reste, nos souvenirs. Adieu !...
Quelques mois après, Geneviève demandait enfin le divorce et se remariait. Elle épousait un ami discret et modeste, dont elle avait apprécié, dans une conjoncture difficile, la bonté, la délicatesse et l’agrément.
— A quoi diable prétendez-vous que cette histoire conclue ? me demande ici l’interrupteur commode auquel je me réserve d’avoir tant de fois recours.
— Je prétends prouver qu’on ne saurait impunément enfreindre les lois naturelles. Je suis peut-être présomptueux d’employer ici le mot « loi ». Ma loi n’est qu’une hypothèse, mais toute hypothèse probable peut être dénommée loi et garde honnêtement ce beau nom tant qu’on ne l’a pas démontrée fausse. L’histoire de Geneviève et Henriette vérifie mon hypothèse. Voilà tout.
Vous entendez bien comment, le jour de leur mariage, chacun chuchotait à l’église : « Les heureux couples ! A la bonne heure ! Voilà comme on devrait toujours se marier !... » Les bonnes gens avaient tort. Ni Geneviève, ni Henriette, ni leurs deux maris n’étaient en état de mariage. Ils devaient payer leur faute et ils l’expièrent, en effet. Leurs deux ménages devaient se dissoudre nécessairement, et pour une même cause : c’est qu’aucun des quatre conjoints n’était encore parvenu à l’âge et au moment où l’on peut vivre en ménage. D’ordinaire, l’homme seul satisfait à cette condition et la femme seule y manque. Ici, les uns et les autres y manquaient, ce qui est moins grave mais ce qui est très grave encore. Qu’ils jetassent dans la vie commune une dose insuffisante ou exagérée d’amour, ils devaient fatalement s’user à cet éternel conflit de la passion et du mariage, ou plutôt de l’instinct et de la raison. Leur instinct les conduisait au changement, au trouble, à la mobilité inquiète et ardente des passions jeunes ; leur raison les enfermait dans la vie régulière et prématurément bâtie qui ne convient qu’aux cœurs assagis.
— Pourtant, vous reconnaissez bien que Geneviève et Lucien se sont aimés ?
— Sans doute. Mais pensez-y, et vous m’accorderez qu’ils n’ont été mari et femme que de nom, que leur mariage n’est un mariage qu’en apparence, ou parce que quelques formalités sans intérêt en ont marqué et autorisé l’exorde. Ce qu’ils avaient établi entre eux, c’est une liaison passionnée, qui ne pouvait durer qu’autant que la passion durerait. Vous me dites qu’elle pouvait durer toujours. Je n’en connais pas d’exemple, quant à moi, lorsque la passion est réciproque. Mais en tout cas, vous me concéderez que voilà une exception rare, et ce n’est pas sur une exception que nous pouvons fonder le mariage.
Laissez-moi discuter de plus près cette anecdote, qui est pleine d’utiles enseignements. C’est pour une même cause que les deux ménages de Geneviève et d’Henriette se sont disjoints. Mais pourquoi Henriette a-t-elle finalement recouvré son mari, tandis que Geneviève s’est séparée du sien pour toujours ? C’est que le premier couple s’était constitué sur les éléments qui peuvent supporter une union solide et durable, je veux dire l’affection tendre, la confiance, et ces habitudes communes de jugement ou de sensation qui écartent l’ennui, animent tous les incidents de la vie. C’étaient là les conditions d’un bonheur stable, mais mari et femme s’étaient mis à l’œuvre trop tôt, sans avoir épuisé l’un et l’autre l’instinct que j’ai nommé polygamique. Cet instinct troublait en eux la conscience et l’usage d’un bonheur qu’ils n’étaient pas encore aptes à goûter. Une nécessité bienveillante leur procura l’intervalle indispensable pour se mettre en règle avec les obligations de leur nature. Ils firent, pendant un entracte de leur mariage, ce qu’ils eussent fait plus raisonnablement avant de s’épouser. Ils se rejoignirent alors, délivrés, délestés du résidu instinctif qui avait pesé sur leur première tentative, et ils ne retrouvèrent plus, sans l’obstacle, que les raisons qu’ils avaient eues d’être heureux.
Les voici maintenant qui essaient de rappareiller l’autre couple ; ils y échouent, et rien n’est plus instructif que leur échec. Geneviève et Lucien ont, eux aussi, épuisé l’instinct, mais, comme ils n’ont jamais été liés que par leur passion et que leur passion est éteinte, nul élément ne subsiste plus pour la vie commune. Ils ne peuvent plus être amant et maîtresse comme ils l’ont été, d’abord parce qu’ils ne s’aiment plus, ensuite parce qu’ils n’en ont plus le goût. Ils ne peuvent pas devenir mari et femme, ce qu’en fait ils n’ont jamais été, parce qu’ils ne reconnaissent entre eux aucun des sentiments, aucune des affinités sur lesquels peut reposer le mariage. Geneviève est parvenue à l’état de mariage ; elle se marie donc, mais avec un autre homme, non pas avec Lucien. Elle a vécu avec Lucien quelques années qui seront assurément les plus précieuses de leur vie. Mais qu’avaient-ils besoin de se marier pour cela ? Le mariage n’a fait que contrarier leur ardeur et leur joie. Il fallait qu’ils s’aimassent autant qu’ils pouvaient aimer, et qu’ils se mariassent ensuite, une fois calmés, chacun avec l’être qui pouvait demeurer, pour le reste de la vie, son allié, son associé, son compagnon, son ami.
Je conclus donc que la vie d’aventure doit précéder la vie de mariage ; la vie d’instinct doit devancer la vie de raison. Ce que j’ai nommé l’instinct polygamique ne saurait coexister avec le mariage, même dans les cas très rares où le mariage paraît de nature à le satisfaire tout d’abord. Et je dois, à ce propos, préciser, pour l’écarter, une objection que j’ai déjà effleurée tout à l’heure. J’ai connu, nous avons tous connu des cas où le penchant que je dis polygamique se dépense en une seule passion. Une femme, par exemple, avant d’accéder à l’état matrimonial, peut n’avoir aimé et même n’avoir connu qu’un seul homme ; un homme peut n’avoir aimé qu’une seule femme. Persisterai-je donc à nommer polygamique un instinct qui peut se déployer, puis s’épuiser tout entier, dans une liaison unique ? Sans doute, et la contradiction n’est qu’apparente. Quand il arrive qu’une femme emploie, fatigue, dans la passion qu’elle éprouve pour le même homme, tout le goût qu’elle avait de l’amour, c’est que cette passion comporte assez de changement, de vicissitudes, d’alternatives pour équivaloir à plusieurs. Liaison unique en apparence ; en réalité, suite de passions variées, discontinues, constamment renaissantes ou recréées. Une femme, par exemple, que son amant trompe, reprend, puis trompe encore, qui passe de la jalousie à la confiance et de la confiance à la haine, du désespoir à la joie exaltée des réconciliations, cette femme, qui paraît n’avoir aimé qu’une fois un seul homme, aura réellement connu plusieurs amours. Cette même femme qui se sera si cruellement affligée des trahisons de son amant ou de son mari, qu’on aura vue guetter chez lui pendant des années les reprises de la passion, qui aura vécu dans une anxiété tendue vers ce seul désir, si l’amant ou le mari eût été fidèle, l’eût trompé elle-même infailliblement. Un de ces bonheurs tranquilles, constants, qu’aucune angoisse, aucun retour ne renouvelle, n’eût pas étanché son appétit de l’amour. Il arrive donc qu’une femme ait réellement connu plusieurs hommes en un seul, et c’est dans ce cas seulement que l’instinct, auquel je maintiens justement son nom, se satisfait d’un objet unique. Mais ce n’est pas cet homme-là qu’une femme doit épouser. Qu’elle l’aime autant qu’elle en aura le cœur ; qu’elle se marie ensuite, avec un autre.
— Ainsi, ce n’est pas la même affaire d’aimer et de se marier ?
— Qui en doute ?
— Et ce n’est pas le même homme, la même sorte d’homme, qu’une femme aimera dans son premier état, épousera dans le second ?
— N’en doutez plus.
Pour démontrer que la vie humaine comporte une période de jeunesse avide et passionnée qui ne s’élude pas impunément, je pourrais aussi rappeler l’histoire d’Élisabeth Masson.
Élisabeth avait grandi dans une maussade maison de province que désolaient l’avarice et la brutalité paternelles. Elle s’était défendue comme font en pareil cas les enfants qui n’aiment pas le vacarme, en se repliant sur elle-même, en diminuant sa vie, en la cachant. Après la mort de M. Masson, elle vint habiter Paris entre sa mère et son aïeul. Mais sa mère était triste et déçue, son aïeul était infirme ; une sorte de timidité provinciale écartait de la maison les amis et les relations possibles. La même contrainte mesquine pesa sur la vie d’Élisabeth et l’étouffa. Comme elle était toujours courageuse, elle adopta les devoirs difficiles de sa vie ; comme elle était bonne, elle s’y attacha. Bientôt, elle en vint à goûter l’intimité resserrée de cette existence ; elle se sentit portée à mépriser plus qu’à regretter les distractions qui lui manquaient. Elle ne tolérait pas qu’on parût la plaindre. Peut-être se jugeait-elle heureuse.
Elle atteignit ainsi sa vingt-cinquième année. On disait communément autour d’elle : « Élisabeth ne se mariera pas avant la mort de madame Masson ; elle ne consentira jamais à quitter sa mère. » On la vit écarter, en effet, les nombreux partis qu’avaient attirés sa fortune et sa réputation. Mais on se trompait sur la cause de ses refus répétés. Tantôt elle s’était blessée qu’on voulût l’épouser sans amour, tantôt elle s’était dérobée devant l’éventualité d’un amour dont elle croyait avoir passé le temps. Comme tous les êtres qui, chargés d’une lourde tâche, ont trouvé peu d’aide à la supporter, elle avait acquis une habitude de jugement sérieuse et un peu amère. Elle paraissait au-delà de son âge réel. Sa démarche et ses mouvements étaient sans assurance. Son teint et ses yeux accusaient déjà comme une patine défraîchie.
Elle épousa cependant Georges Rocher, dont la sœur, madame Noyon, avait été sa meilleure amie, et qui se trouvait plus jeune qu’elle de plusieurs années. Ce mariage fut classé par l’opinion publique dans la catégorie des mariages d’amour et on déclara que mademoiselle Masson avait décidément bien de la chance. Mais Élisabeth n’était nullement amoureuse de Georges Rocher. Se jugeant désormais hors d’état de susciter ou de ressentir une passion, elle avait accueilli, puis laissé grandir l’affection protectrice que lui inspirait ce jeune garçon. Elle l’épousait par raison, par dévouement, par amitié. Et Georges Rocher lui-même, prématurément engagé dans une vie de travail, épousait Élisabeth parce qu’il se plaisait auprès d’elle, qu’il avait éprouvé la douceur, la tendre bienfaisance de sa raison. Il s’estimait incapable d’aimer, au sens romanesque du mot, mais considérait, en revanche, qu’on ne saurait asseoir trop tôt la sécurité de la vie, et que, commise à Élisabeth, elle serait en bonnes mains.
Tous deux avaient secrètement redouté la communauté physique que comporte le mariage. Ils y eussent peut-être renoncé s’ils en avaient eu le choix. Leur surprise fut donc grande de se plaire extrêmement l’un à l’autre. Ce hasard eut pour premier effet d’opérer un rajeunissement marqué dans la personne d’Élisabeth, que sa mère reconnut à peine au retour de son voyage de noces. Quand les femmes ont attendu le mariage trop longtemps, on les voit, en quelques mois, prendre ou laisser, suivant le cas, dix ans de leur âge. Puis il arriva, par l’effet des réactions réciproques du plaisir sur la tendresse et de la tendresse sur le plaisir, qu’Élisabeth Rocher aima son mari. Cet amour resta d’abord marqué des caractères de gravité, de sobriété que lui avaient imprimés les circonstances. Mais il évolua peu à peu, sortit de lui-même, se déploya, occupa l’âme et la vie entière d’Élisabeth. Tout ce qui avait été obscurci en elle passa à la pleine lumière de sa conscience ; tout ce qui avait été contraint se redressa ; le bonheur lui avait rendu la jeunesse. Cette personne de trente ans, sérieuse de nature et que l’expérience avait précocement mûrie, se trouvait, par une sorte de force rétroactive, reportée à la période de son âge que la vie avait obstinément supprimée. Ce n’était même plus une femme amoureuse de son mari, c’était une jeune fille amoureuse de l’amour.
Qu’arriva-t-il ? D’abord qu’Élisabeth essaya de convertir ce qui n’était, chez son mari, que tendresse joyeuse et confiante en élans d’amour passionné. Sans bien comprendre cette exigence, Georges y résista. Tant de fois Élisabeth avait proclamé son bonheur, et qu’était-il donc survenu qui pût le diminuer ou le compromettre ?... « Que veux-tu, disait-il, que te man-que-t-il, Élisabeth ? Ne t’aimé-je pas comme autrefois ? » Élisabeth ne savait que répondre. Elle sentait confusément en elle comme un besoin de sensations extrêmes et contraires, et surtout, elle eût voulu que Georges devinât le premier ce besoin confus et le satisfît avant qu’il se fût dessiné davantage. Mais Georges crut simplement que sa femme était nerveuse ou lasse, et, comme il était médecin, il la soigna. Sur ces entrefaites, madame Noyon, la sœur de Georges, vint habiter Paris. Les confidences d’Élisabeth à Louise Noyon, si vagues et si chastes qu’elles fussent, piquèrent la curiosité de Maurice Noyon, qui s’éprit passionnément de sa belle-sœur. Élisabeth, se sentant garantie de Maurice par tous les obstacles qui les séparaient l’un de l’autre et surtout par ses propres sentiments, puisqu’elle aimait Georges et ne voulait aimer que lui, laissa croître cet amour dont elle jugea la puissance à son absurdité même. Elle s’en laissa pénétrer sans le partager. Et, quand il lui fut devenu indispensable, elle se trouva sans force pour n’y pas céder.
— Elle devint donc la maîtresse de Maurice Noyon ?
— Sans doute, ma périphrase est assez claire. Elle fut la maîtresse de Maurice Noyon et elle s’enfuit avec lui. Mais, tout en quittant son mari, elle sentait bien qu’elle viendrait un jour lui redemander asile, qu’elle était la compagne et Georges le compagnon, destinés à vivre et à mourir côte à côte. Elle avait bien choisi son mari, et ils étaient faits l’un pour l’autre. Par malheur, elle s’était mariée gardant sa jeunesse intacte et secrète, sans même en avoir mesuré l’ardeur, comme tant de jeunes filles, à la liberté de son imagination et de ses désirs. Le bonheur avait animé l’instinct engourdi, et l’instinct venait bouleverser la vie conjugale qu’il eût dû devancer et préparer. « Je ne t’aimais pas quand nous nous sommes mariés, disait Élisabeth à Georges. Je n’espérais plus aimer. C’est le bonheur que tu m’as donné qui m’a rajeunie... Songe à toute mon existence d’autrefois. Ne vois-tu pas qu’à force de donner ma jeunesse il n’en était rien resté pour moi ? Je n’ai compris qu’elle m’avait manqué que lorsque tu me l’as restituée. Et maintenant les années sautées ont reparu. J’aime l’amour comme j’aurais pu l’aimer à vingt ans. Je me suis éveillée de mon contentement trop certain. Je veux un amour plein de périls et d’aventures ; j’ai besoin d’être implorée et conquise encore plus que d’aimer... Quand nous nous sommes mariés — ajoutait-elle avec une clairvoyance que je reconnais assez rare dans une telle situation —, quand nous nous sommes mariés, il y avait en nous quelque chose de trop sage, qui n’aurait dû venir qu’en son temps. Nous serions restés sages, si nous n’avions pas été si heureux. Mais pour nous qui n’avions pas encore aimé, notre bonheur trop tendre devait éveiller l’amour — (à sa place, j’eusse dit l’instinct) — ; il ne pouvait pas tout à fait le satisfaire. »
C’est sur ces paroles qu’Élisabeth se sépara de Georges. Je passe le déchirement de leurs adieux.
L’histoire d’Élisabeth rappelle par plus d’un trait celle d’Henriette, la plus jeune des deux sœurs qui se marièrent le même jour. Mais, bien que la succession des deux récits risquât de sembler monotone, je ne les ai pas rapprochés sans intention. L’histoire d’Henriette est un cas ordinaire ; l’histoire d’Élisabeth est un cas extrême. Henriette s’est mariée jeune, au premier éveil de la vie. Élisabeth, au contraire, si l’on s’en tient aux conditions extérieures d’éducation, de milieu et d’âge, avait apparemment atteint le moment matrimonial. Henriette n’aimait pas son mari et lui fut fidèle. Élisabeth aimait le sien et le trompa. C’est que l’instinct résiste, si je puis dire, à toutes les températures physiques et morales ; c’est qu’il est d’autant plus irascible et redoutable qu’il a été comprimé plus longuement et qu’il s’éveille dans un âge plus éloigné de son temps normal.
Pour Élisabeth, une seule circonstance eût fait que l’instinct demeurât dans son état de virtualité innocente. Il eût suffi qu’elle n’aimât pas du tout son mari. Si elle n’eût pas aimé Georges, elle ne l’eût jamais trompé, et c’est le piquant de son aventure. Imaginez qu’après la mort de madame Masson, elle ait épousé, par une nécessité de sa solitude, quelque homme rassis et bienveillant, elle aurait accepté sans effort une existence à laquelle l’avait formée toute son habitude passée. Son caractère se serait développé, ou simplement continué, dans le même sens ; sa vivacité, sa jeunesse n’eussent jamais reparu. Mais aussi n’aurait-elle jamais connu une minute heureuse. Son exemple s’annulait ainsi de lui-même, car enfin de quoi s’agit-il, sinon d’être heureux ? Même pour Élisabeth, le bonheur ne pouvait durer dans le mariage qu’après satisfaction de l’instinct endormi en elle, mais non pas aboli, et que le mariage même avait suscité.
Tel fut le sort d’une femme vertueuse, instruite à la réflexion et à la contrainte, sûre d’elle-même, éprouvant d’ailleurs pour son mari toute la variété de sentiments tendres que j’ai tenté de préciser ; qu’en sera-t-il des femmes normales, se mariant à l’âge accoutumé, après l’éducation ordinaire ? Les faits répondent pour moi, et l’insistance serait fâcheuse. Le mouvement qui, chez Élisabeth, ne se produisit qu’après plusieurs années de mariage, éclatera, moins violent peut-être, mais aussi moins arrêté, avec cette liberté, avec cette promptitude que nous pouvons constater chaque jour. Ainsi s’explique qu’au premier choc on voie les jeunes mariages se soulever et se disjoindre. Regardez autour de vous ; parcourez des yeux ou de la mémoire : c’est une promenade dans les ruines. Ainsi se préparent chez les femmes les plus solides et les plus droites ces brusques convulsions de la jeunesse comprimée, qui parfois, dans des ménages si anciens déjà, si bien cimentés par l’habitude, déterminent des catastrophes horribles au moraliste et inexplicables pour l’observateur.
Je le demande en toute candeur, et croyant n’exprimer là, sous l’apparence première d’un paradoxe, qu’une vérité bien unie et qui sera banale demain : ne vaudrait-il pas mieux que, même pour les femmes, ces exigences de l’instinct, ces épanchements de la jeunesse, se donnassent cours avant le mariage, c’est-à-dire à une époque où ils sont sans dommage à mon sentiment ? Je suis prêt, si vous l’exigez, à considérer l’instinct que j’ai défini comme un vice, comme une tare originelle. Mais est-il en votre pouvoir de l’extirper ? Tâchez donc d’en cantonner les effets dans la période de la vie où ils seraient moins nuisibles, au lieu de le réprimer comme vous faites tant qu’il serait inoffensif, et de lui laisser sa force intacte et sa liberté pour l’instant où il peut causer des souffrances et des désastres. Qu’avant le mariage la femme dépense donc tout ce qu’il y a d’ardent dans son instinct, tout ce qu’il y a de mobile dans son caprice ; qu’elle épuise, par un nombre indéterminé d’aventures, et peut-être par une seule — car j’ai réservé tout à l’heure et je réserve encore, pour plus de clarté, les cas où l’instinct polygamique peut se satisfaire par un même amour — qu’elle use son inquiétude sentimentale, son inexpérience avide et toujours en quête, qu’elle consume ce moment de la vie où la vie paraît la plus précieuse et la plus courte, où toute heure qui n’est pas donnée à des sensations puissantes paraît une heure anticipée par la mort, où l’imagination ajoute tant de force à l’élan des sens, où l’orgueil donne tant de prix aux offres du cœur. Et puis, par la révolution fatale des choses, viendra l’âge
qui fait que les horizons changent de plan, que, par un glissement gradué, les sentiments, les actes, les mots échangent leur valeur réciproque. Tout a si bien tourné, tout paraît si différent par la distance des points de vue, qu’on ne se reconnaît plus, qu’on ne se retrouve plus soi-même. Voici que les soucis brûlants de la veille sont devenus une fatigue et un ennui. Trop de déceptions ont lassé, trop de jouissances ont engendré le malaise et le dégoût. C’est la crise qui accompagne, dans la croissance continue de l’être humain, tous les changements d’état. Quand elle vous atteint, alors seulement la maturité matrimoniale est accomplie.
Les hommes qui ne se sont pas mariés dans leur extrême jeunesse ont connu cette crise. Et la sagesse commune tient pour imprudent qu’un homme se marie avant d’en avoir senti les effets. Pourquoi ? Que redoute-t-on quand un homme fixe sa vie avant d’avoir « jeté sa gourme » et « mené la vie de garçon » ? On craint qu’après un petit nombre d’années, la vie conjugale ne lui semble fade et monotone. On craint qu’avec le regret des années perdues, avec le sentiment de la jeunesse qui passe, n’apparaisse un appétit impatient de jouissance et de passion. On craint que la solidité du mariage ne résiste pas au déchaînement subit de l’instinct viril. Juste crainte, mais qui n’est pas moins fondée, comme on l’a vu, pour la femme que pour l’homme. Plus sensuelle encore et plus passionnée que l’homme, parce qu’elle est plus personnelle et plus attachée à la vie, la femme aussi a « sa gourme » à jeter, et il n’est pas moins téméraire qu’elle se marie avant de s’en être délivrée. Dès que l’on a conçu le mariage comme un état solide et durable, il apparaît donc nécessaire que la femme, elle aussi, ait mené « sa vie de garçon », sa vie de passion et d’aventures. Puis le jour viendra où elle aussi se sentira fatiguée des agitations et des changements, où un besoin de stabilité et de paix, d’abord confus et rejeté, se fortifiera de chaque émotion nouvelle. Des pensées ou des actions qui avaient paru mesquines et méprisables acquerront chaque jour plus de consistance et d’empire, et ce seront les pensées sérieuses, les actes utiles de la vie, les mêmes qui n’étaient conçus la veille que comme un ragoût de l’amour ou comme un obstacle à l’amour : une maison à tenir et à orner, des relations à entretenir, une fortune à accroître, des enfants à élever, parfois un travail profitable à poursuivre. Ainsi que l’homme parvenu à la même période de sa vie, la femme recherchera l’ensemble des satisfactions à la fois morales et matérielles qui constituera, pour employer un mot de la vieille langue, son établissement. A cet état nouveau doit correspondre un mode de vie nouveau, qui est précisément le mariage. Et c’est aussi pourquoi les bons mariages ne se fondent pas sur les mêmes rapports que les liaisons d’amour.
Veut-on me permettre une comparaison ? Dans ses Études sur la vie humaine, le professeur Metchnikoff a recherché par l’effet de quelle « désharmonie », alors que nous savons la mort inévitable, nous éprouvons tant d’horreur à la pensée de mourir. Qu’on ne s’offense pas de ce rapprochement : je ne tiens pas le mariage pour une sorte de mort prématurée, et il est assez visible que je m’en institue le défenseur. La mort est nécessaire, et nous la tenons pour le plus grand des maux. Le mariage est nécessaire, puisqu’il correspond à un état normal de notre nature, et, dans le fait, il est la source de conflits et de souffrances sans nombre. Se souvient-on comment le hardi professeur résout cette désharmonie apparente ? Il conclut que, par notre faute, nous mourons trop tôt, et avant le temps où la mort nous semblerait bonne et souhaitable. Nous mourons avant d’avoir épuisé la force et le goût de vivre. Mais en reculant le terme trop court de sa durée, l’homme atteindrait l’instant où il se sentirait rassasié de la vie et plein de jours. Dans une société bien administrée, bien alimentée surtout, on ne mourrait pas avant ce temps-là. C’est de la même façon que j’explique et que je prétends dénouer la désharmonie du mariage. Il est un mal quand il nous frappe avant le terme. Attendons qu’il apparaisse comme un repos frais et salutaire à l’homme plein de son ardeur, à la femme rassasiée de passion.
Plus heureux que le professeur Metchnikoff, je puis me fonder sur l’expérience acquise, sur une expérience que chacun, à sa portée, peut acquérir ou renouveler. Il est constant que, entre trente et quarante ans, les hommes sont d’autant plus violemment attirés au mariage qu’ils ont mené jusqu’alors une vie plus diverse et plus mêlée, et tout le malheur est qu’ils épousent alors de jeunes vierges, et non pas des femmes formées par le même entraînement. Il est constant que les femmes libres, après dix ou quinze ans de passions variées, éprouvent un impérieux besoin de se fixer, et ces mariages seraient les meilleurs, en théorie, s’il n’y manquait le plus souvent certaines conditions nécessaires à l’agrément, à la plénitude, voire même à la dignité de la vie conjugale. Mais je n’insiste pas sur ces exemples. J’en retiens seulement la réalité de ce que j’ai nommé l’état de mariage ou le moment matrimonial. L’essentiel est qu’on ne se marie pas avant d’être parvenu à cet état, et qu’en attendant l’harmonie possible de la mort, on sache enfin composer l’harmonie plus simple de la vie.
⁂
« C’est ce que bien des femmes ont réalisé avant votre découverte, m’oppose ici l’interrupteur. Et rien de plus facile, de plus élégant que la solution qu’elles ont conçue, pour leur propre commodité, je le reconnais, et sans songer à faire de théorie. Supposez une femme qui se soit mariée très jeune et, comme la plupart des très jeunes femmes, sans attacher personnellement grande importance au choix de son mari. La voici riche et bien placée. Dans les premières années de son mariage, elle accueillera, sans que son mari, qui sait vivre, y fasse obstacle, un nombre suffisant d’amants actifs. Puis, vers la maturité de sa jeunesse, ayant eu le temps et la facilité de son choix, elle retiendra, pour achever la vie l’un près de l’autre, un homme aimable et dont les goûts s’ajusteront aux siens. Ses premières liaisons étaient précaires et secrètes, celle-ci sera solide, sérieuse, aussi publiquement déclarée que le comporteront les habitudes de la société où elle vit. Voyez madame..., madame..., et tant d’autres. (Et, ici, des noms qui valent, je le reconnais, tout un programme, mais qu’il est sans doute préférable de laisser choisir par le lecteur.) Elles ont largement satisfait l’instinct. Une fois l’instinct fatigué, elles ont choisi le compagnon qui convenait à cet état nouveau. Et tout cela sans révolution, sans réforme, sans discours, par un usage juste et prudent des facilités du mariage. »
Il faut bien que je pare à cette difficulté, tant elle est forte, et je tâcherai de répondre avec bonne humeur. Mais je suis un penseur moral. Et c’est ici qu’il faut que ma moralité éclate avec force, sans néanmoins faire rejaillir sur moi trop du ridicule auquel les moralistes sont exposés. Je reconnais que, dans son dessin général, la pratique de madame A... et de madame B... est ce qui rappelle de plus près ma théorie. Et c’est le lieu de rappeler le mot profond d’une femme, à qui j’entendais dire un jour qu’il fallait avoir le courage de défendre enfin l’adultère, et qu’elle ne voyait point d’embarras dans le mariage dont l’adultère n’eût la solution. Je le crois aussi, mais je n’aurais pas entrepris ce travail, si je jugeais la solution bonne. Je le répète, j’entends écrire un livre moral.
Je passe donc sur les considérations de fait que je pourrais opposer à cette dangereuse diversion, et dont une au moins pourrait sembler topique. Avec leur amant définitif, avec leur amant-mari, madame A... ou madame B... ont dû nécessairement se retrancher certaines des joies qui sont, à mon gré, l’aliment et la récompense du mariage. Quelles que soient la bonne grâce de leurs maris et la complaisance du monde, madame A... n’habite pas avec son amant, madame B... ne voyage pas avec le sien. Ils se sont privés d’avoir des enfants, qui n’auraient point été légalement les leurs et qu’ils n’auraient pu élever de la manière et dans la direction qu’ils auraient choisies. Bien qu’ils soient instruits et soigneux de leurs intérêts respectifs, ces intérêts ne sont point communs. On ne trouvera pas dans leurs habitudes, dans leurs façons d’agir, dans leur ambition même, cette harmonie parfaite, cette unité qui tient à la communauté complète de la vie. Interrogez madame A... ; elle vous avouera que, si un divorce à son âge et dans sa situation ne devait sembler ridicule, elle serait heureuse d’épouser son amant. Consultez madame B... ; elle reconnaîtra que, par l’effet d’une situation chancelante et fausse, le sien lui est devenu presque moins supportable que son mari.
Je pourrais développer ces arguments et d’autres encore, mais il est important que je réplique de plus haut. Si obligeant ou si négligent que l’on suppose le mari, peut-on concevoir qu’une telle situation s’organise sans un assortiment de mensonges grands ou menus, de trahisons plus ou moins louches ? Cela me suffit pour que j’en écarte l’idée. J’accorde que le dernier amant soit public, mais les premiers l’étaient-ils ? Assurément non, et voilà donc le ménage contaminé dès l’origine par toutes les basses attitudes de l’adultère : silence ou complaisance intéressée du mari, faussetés tacites ou explicites de la femme, impostures vis-à-vis de l’amant, du mari, de l’amant précédent, des enfants, du monde et de soi-même. Comment la loyauté d’une femme résisterait-elle à cette corruption ? Même dans la seconde période de sa vie, dans cet état quasi matrimonial où tout peut se passer au grand jour, est-ce que le personnage du mari ne reste pas, suivant les cas, odieux, lamentable ou ridicule ? Est-ce que la raillerie, la pitié, ou le dégoût qu’il inspire ne rejaillissent pas sur les deux autres personnages, sur l’amant comme sur la femme ? Est-ce qu’il ne faut pas recourir à des mobiles bas et sordides pour expliquer, soit que le mari ait gardé la femme, soit que la femme ait voulu demeurer près du mari ? Car il s’agit ici, vous l’entendez bien, non pas d’une passion traversant la vie conjugale sans la détruire nécessairement, ce que j’admets tout comme un autre, mais d’un second mariage qui serait venu se substituer au premier. Pourquoi n’a-t-on pas achevé la substitution, et que fait ici ce figurant inutile dans la maison dont il est le maître, annulé dans la famille dont il est le chef ?
J’entends que sa présence peut éviter certains ennuis, consolider certains avantages, et par exemple il peut être riche, ou noble, ou célèbre, quand l’amant définitif n’a qu’un nom vulgaire et peu de bien. Mais la vie ne se prête pas à ce qu’on retienne à la fois tous les avantages, et j’ai souvent pensé que la moralité consiste peut-être uniquement dans le courage de choisir. C’est à quoi se reconnaissent en tout cas les caractères braves et droits et, dans la façon qu’ont eue madame A..., et madame B... et leurs émules de ruser si profitablement avec la vie, je ne vois point assez de franchise et de droiture. La franchise, la parfaite vérité avec soi-même et envers les autres, peut suffire à régir les rapports des sexes dans le mariage. Mais, si cette règle est unique, elle est étroite, et pour moi je n’y consens pas d’exception. J’écarte donc, pour ingénieuse qu’elle soit, la solution qu’on nous propose. Nos mariages sont assez corrompus, et l’on voit bien que je ne puis me prêter à rien qui les dégrade davantage. Tout mon effort ne va qu’à les assainir par une loyale reconnaissance des besoins et des caractères et par une juste adaptation des mœurs à la nature. Plus la combinaison que je suggère est délicate, plus elle exige de netteté, de probité réciproque. Et c’est de quoi manquent les divers héros et héroïnes de l’interrupteur.
⁂
« Hélas ! on devrait dire aux jeunes filles que l’amour et le mariage sont deux choses différentes, qui ne vont pas ensemble. Elles choisiraient avant, ou bien elles feraient comme vous (entendez : comme les hommes), elles aimeraient d’abord et se marieraient ensuite. » — Ainsi parle l’héroïne d’Amoureuse, avec le pouvoir de divination que lui a prêté un poète, et cette parole contient en vérité tout mon dessein. Oui, il faut dire aux jeunes filles, il faut répéter aux jeunes hommes, que le mariage ne contentera pas leur besoin d’amour ou plutôt de passion, qu’il y est contraire par définition, puisqu’il est la monogamie organisée, et que la passion, dans le premier état de la vie amoureuse, correspond à un instinct polygamique. Il faut dire et répéter que le mariage est une institution nécessaire et bienfaisante, mais à la stricte condition qu’on n’en fasse usage qu’au moment où l’instinct a perdu sa puissance, et j’ajoute que ce moment se manifeste de lui-même à des signes qui ne sauraient tromper. Voilà le langage qu’il faudra tenir aux jeunes filles. Mais j’ai quelque idée qu’elles y obéiront avant même qu’il leur ait été tenu.