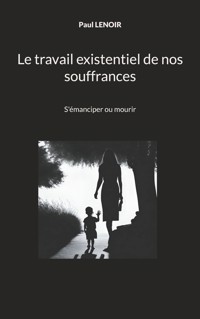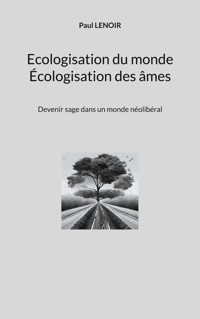
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
La sagesse et le rapport écologique au monde ne sont pas seulement des qualités individuelles. Ils ne sont pas des chemins que nous arpentons seuls. Ils peuvent aussi être un projet politique. Chaque société porte un projet anthropologique et existentiel, qu'elle le conscientise ou non. Cette lecture s'avère plus complexe dans un monde laïque, mais nous avons nos dieux. Ils se déguisent autrement. Ils s'appellent Consommation, Mobilité et Prestige. Nous sommes influencés, éduqués, formés, assujettis, transformés au service de divers projets existentiels : faire de nous des envieux, des matérialistes, des prédateurs environnementaux, des compétitifs, des pressés.. Face à ces forces sociales, il nous faut inventer, créer, un monde de la citoyenneté et de la sagesse comme on construit une ville, pierre après pierre. Dans ce monde là, nous apprendrons, nous discuterons, nous intérioriserons le sens de l'intérêt général, du long terme, de la nature, d'une relation aux autres ouverte et attentive. Nous apprendrons. C'est cela un chemin de croissance. Nous ne le ferons non pas parce que nous nous sommes réveillés un matin investis de cette mission. Nous le ferons parce que la société nous demande d'investir certains lieux, certains espaces sociaux et que ces lieux seront des lieux apprenants, émancipateurs et imprégnés de sagesse. La construction d'une telle société n'est plus une option face aux colères climatiques qui cognent aux portes de nos existences. Le monde de demain serait citoyen ou ne sera plus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
1. Grandir dans un monde néolibéral
1.1. La fabrique sociale d’un homme
1.1.1. Sommes-nous façonnés par l’économie ?
1.1.2. Pourquoi le champ économique aurait-il plus d’influence que les autres ?
1.1.3. Les formes du capitalisme évoluent : nous aussi !
1.1.4. Les relais du champ économique
1.1.5. Cette fabrique des subjectivités peut-elle s’observer sur le terrain de l’État ?
1.1.6. L’exemple du travail du champ managérial
1.1.7. Le développement personnel au service de l’âme néolibérale
1.2. Les principes existentiels capitalistiques
1.2.1. Les gagnants manifestent leur victoire par l’usage de l’avoir
1.2.2. La distinction, l’envie et la comparaison sociale comme ressort anthropologique
1.2.3. Le rapport instrumental au monde et à la nature
1.2.4. Le capitalisme est une réponse anthropologique possible à la question de la mort
1.3. Les injonctions existentielles
1.3.1. Injonction à l'optimisation de soi
1.3.2. Injonction au bonheur néolibéral
1.3.3. Les couleurs existentielles du bonheur néolibéral
1.3.4. Injonction à être un Soi singulier
1.3.5. Injonction à la mobilité
1.3.6. Éthos capitaliste
La croissance psychologique
2.1. Qu’est-ce que grandir ?
•
Les catégories de développement
2.2. Approche en termes de Développement personnel
2.3. Une approche selon la psychologie existentielle
2.4. Approche en termes de réalisation de soi
2.5. Une approche en termes d'individualisation
2.6. L’approche à travers la notion d’éveil
2.7. Une approche de la psychologie positive
2.8. Approche par les talents
2.9. Le mode d’être de Erich Fromm
2.10. Une approche par la sagesse
2.11. Approche en termes de développement éthique
2.12. Une approche par l’émancipation
2.13. Une approche par la culture
3. La Citoyennisation
3.1. Croissance psychologique et bien commun
3.2. Processus de « citoyennisation » comme stade de développement
3.3. Un éthos citoyen : les compétences citoyennes
4. Fabriquer la sagesse un projet de société
4.1. Une société peut-elle porter un projet anthropologique sans sombrer ?
4.1.1. Un projet dangereux ?
4.1.2. La question des renoncements et des libertés
4.1.3. Contrainte et liberté
4.1.4. Le risque des abus de pouvoir
4.1.5. La responsabilité individuelle versus la transformation des structures
5. La fabrique de l’Homoécologicus en pratique
5.1. Inventer des politiques pour promouvoir la Citoyennisation ou comment faire grandir les individus psychologiquement ?
5.2. Construire des organisations citoyennes
5.3. Des conseils citoyens environnementaux par profession
5.4. La sagesse dans l’exercice du pouvoir : produire des élites sages !
5.5. La vie collective et la démocratie participative comme productrice de sagesse et de croissance
5.6. Devenir un protecteur du vivant : responsabilité individuelle de représentation de la Nature
5.7. Pour l’extension du domaine de la citoyenneté : le développement d’un nouvel espace social
5.8. Régulation des réseaux sociaux
5.9. Une révolution des regards dans la transformation des modalités de manifestations de la réussite
5.10. De la révolution des regards à la révolution des mots : la pathologisation du déni
5.11. Introduire de la sensibilité citoyenne dans les processus de sélection
5.12. Fonctionnement du champ politique et sélection citoyenne
5.13. Champ scolaire et sélection : Capital scolaire et forme d'intelligences
5.14. Le champ du travail au regard de la citoyenneté : la citoyenneté professionnelle
6. Conclusion : apprendre à devenir sage !
Les forces du changement vont se déployer que nous le souhaitions ou pas. Nul ne sait quelles formes ces forces prendront, mais tout le monde doit être convaincu que des changements radicaux vont rapidement intervenir. Nous ne continuerons pas tranquillement et très longtemps le cours de nos vies ordinaires.
Cette nouvelle question sociale et politique (la plus grande que le monde ait jamais eu à affronter) nous confronte donc à la nécessité de se saisir de ces forces de changements pour tenter de les orienter dans une direction jugée souhaitable.
Les transformations dont il sera question dans cet ouvrage ne seront pas simplement techniques, organisationnelles ou institutionnelles. Elles seront surtout anthropologiques, existentielles et donc spirituelles car c’est bien dans les racines de l’âme humaine qu’il nous faudra puiser pour construire un autre projet anthropologique.
À la figure de l’« Homoéconomicus » comme moteur de l’histoire doit succéder celle de « l’Homoécologicus », individu capable de réguler ses besoins en renonçant à assouvir l’ensemble de ses pulsions. Autrement dit, un individu social habité par le souci environnemental, par le sens de l’intérêt général et le souci de l’autre.
Bref, un homme sage. Car c’est, en effet, de sagesse dont nous allons parler. Ne nous y trompons pas. Il n’y aura pas de futur positif sans le franchissement de stades de développement psychiques et spirituels de grandes importances, permettant de dompter nos démons. Et le temps nous est compté.
Se pose donc la question de l’émergence de ce sage en tant que nouvelle figure sociale, acteur du changement.
Face à la nécessité d’opérer ce processus de transformation anthropologique, on en appelle à une prise de conscience, une évolution des mentalités. On espère que la sagesse va naître devant le constat de l’imminence du danger. Possible… mais il est aussi possible que le danger révèle des pulsions de survie mortifères. Le danger est aujourd’hui à nos portes et les scores du mouvement écologiste témoignent de la faible prise de conscience collective de l’immensité des enjeux.
Pour qu’un processus de transformation advienne, il doit nécessairement s’inscrire dans une conscience, un corps social et psychique capable de concevoir le projet spirituel sur lequel il s’adosse, d’y adhérer et de le promouvoir. La question du changement social est donc étroitement dépendante de celle de l’évolution des mentalités. Cette mentalité nous renvoie directement à la découverte et l’analyse sociale des formes de subjectivités contemporaines.
Nous sommes, en partie, les enfants d’un système politique, économique, culturel et symbolique. Nous intériorisons une façon d’être, un éthos lié à ce système marqué par un certain rapport au temps, à la compétition, à la consommation, à l’autre, à la nature et pour tout dire au sens même de la vie.
Même si nous ne sommes pas entièrement réductibles à cette forme de subjectivité sociale, elle est l’une des composantes de notre conscience. Cette fabrique de nos âmes se donne à voir dans les dispositions socialement encouragées au sein d’un système politique (réussir matériellement, mode de satisfaction des besoins …), mais aussi dans tous les autres traits de caractère laissés en friche (la bientraitance ou le rapport à la nature sont aussi des dispositions qui se cultivent pour qu’elles puissent se déployer).
La question sociale et environnementale est donc une question à la fois psychique et politique, celle de la fabrique d’une conscience écologiste.
Comment faire advenir une Humanité sage ? Telle est le sujet central de cet ouvrage.
Ce processus de croissance psychologique ne peut pas reposer sur des logiques individuelles. Nous ne nous réveillons pas un matin habités par le souci environnemental surtout quand des siècles de civilisation ont construit un certain rapport à la nature plaçant l’homme en maître absolu du vivant. Changer notre rapport au monde nécessite d’opérer de multiples révolutions : révolution des regards, des mots, du fonctionnement des champs sociaux ou encore des processus de sélection. Nous allons aborder chacune d’entre elles.
Faire reposer une telle œuvre de transformation sur la responsabilité individuelle est le plus sûr moyen que le système ait trouvé pour ne rien changer. Sous couvert de liberté individuelle, il laisse le soin aux forces économiques de produire les dispositions psychologiques nécessaires au bon déroulement des opérations : consommation, production, travail, voyage…et le monde continue de tourner comme il tourne.
Tout système économique porte en lui un projet anthropologique qui le soutient et le justifie. Le capitalisme a vocation à produire un « Homo oeconomicus ». C’est son projet spirituel. Il a besoin que nous soyons habités par ses représentations de ce qu’est la bonne vie. Dans les sociétés religieuses, le sujet doit devenir un « homo religiosus », un être habité par le sens de la religion. C’est un autre projet. Chacun utilise une certaine technologie des subjectivités au service d'une certaine conception de l'homme.
Il nous faut désormais faire advenir un « Homo-écologicus » dont l’âme est habitée par le souci de la nature, acceptant les contraintes, car elles n’en sont plus à ses yeux, une révolution des regards s’est opérée. Ces contraintes sont devenues des comportements ordinaires que l’on est en droit d’attendre de tout être civilisé, aussi banal que nous est devenu le fait de ne plus fumer en présence de l’autre, de ne plus mettre des mains aux fesses ou de mettre sa ceinture. Ainsi, moins manger de viande, prendre l’avion seulement x fois dans la vie et tout ce qu’il faut faire pour sauver la planète est devenu normal.
Il est probablement vrai que toute transformation sociale passe par une évolution des mentalités, mais une telle évolution n’est pas le produit d’un pur hasard, d’un choix individuel et éthique, elle est aussi, et peut-être surtout, le fruit de la construction d’une culture individuelle, collective, sociale, symbolique, et politique permettant d’orienter l’ensemble des énergies vers la fabrique de dispositions vertueuses œuvrant à la recherche du bien commun.
C’est de ce travail social sur notre Etre dont nous allons parler dans cet ouvrage
Après avoir présenté les mécanismes d’influence de nos subjectivités dans la société contemporaine, nous proposons un développement de la notion sagesse en tant que nouveau projet de société. Nous ne nous contenterons pas d’une analyse philosophique des enjeux et nous nous ferons aussi mécaniciens du social.
Ainsi nous plongerons dans une série de sujets pratiques qui façonnent notre société et influencent notre rapport au monde.
Nous examinerons les multiples dimensions de la fabrique de la citoyenneté et formulerons un certain nombre de propositions pour cultiver ce type d’éthos. Nous commencerons par examiner la construction d'organisations citoyennes (1). Nous aborderons également la création de conseils environnementaux, adaptés à chaque profession (2), ainsi que la mise en place d'espaces sociaux visant à accompagner et à promouvoir une utilisation positive du pouvoir (3).
Pour comprendre et mettre en œuvre ces changements, nous explorerons l'importance de la diffusion et du développement de cercles d'apprentissage (4) ainsi que la création de nouveaux espaces sociaux dédiés à l'exercice de la citoyenneté (5). En outre, nous examinerons la régulation des réseaux sociaux (6) et son rôle dans la transformation de notre société.
Ce voyage ne s'arrête pas là, car nous nous aventurerons également à opérer une révolution des regards dans notre relation avec la nature
(7) et dans notre perception des manifestations de la réussite (8). Nous explorerons également la nécessité d'une révolution des mots pour mieux comprendre et surmonter le déni environnemental (9).
Dans une perspective éducative, nous discuterons de l'importance d'introduire la sensibilité citoyenne dans les processus de sélection (10) et de modifier les processus de sélection dans le champ politique (11).
Enfin, nous mettrons en avant la nécessité d'enrichir les programmes scolaires en introduisant de nouvelles matières sur les émotions et le rapport à l'environnement (12), ainsi que l'importance de renforcer la formation professionnelle en intégrant les enjeux émotionnels, existentiels et écologiques propres à chaque métier (13).
Chacun de ces sujets contribue à une compréhension plus complète des défis et des opportunités qui se posent à notre société. Ensemble, ils dessinent un panorama des actions nécessaires pour bâtir un monde où la citoyenneté active, l'environnement et le bien-être de tous occupent une place centrale.
1. Grandir dans unmonde néolibéral
Ce que nous sommes devenus, nous le devons à de multiples facteurs : notre famille, notre classe sociale, notre histoire, nos gènes……et nous le devons aussi en partie aux différents champs sociaux1 que nous fréquentons, à leur(s) logique(s) et leur(s) dieu(x) qui contribuent à façonner notre être, à produire notre habitus2 et parmi les champs actifs sur ce plan, l’espace économique se révèle particulièrement puissant.
On peut dire sans risque de se tromper que la plupart de ceux qui vont lire ce livre ont passé une partie de leur vie, ont grandi dans ce monde économique historiquement daté et géographiquement situé que l’on appellera « néolibéral ». Dans ce monde-là, les entreprises occupent une place centrale, l’état est en retrait, l’impôt a mauvaise presse, la réglementation fait l’objet de nombreuses critiques, la consommation matérielle est encouragée, la loi de l’offre et la demande régule le marché, l’emploi est la condition de la rémunération, le profit est la quête ultime, les capitaux circulent librement, l’individualisme domine, tout peut être marchandise, la place de services publics recule, les syndicats perdent de leur pouvoir…
Nous sommes devenus adultes, nous avons grandi dans ce monde, mais sommes-nous devenus plus sages ? Avons-nous grandi psychologiquement ? Qu’est-ce que ce monde a fait (et continue de faire) de nous ?
L'expression "grandir dans un monde néolibéral" nous invite à porter notre regard sur les processus de croissances psychologiques à l’œuvre dans ce monde-là. Nous allons donc ouvrir cette porte et pénétrer dans les coulisses de la fabrique de l’âme moderne, mais avant cela, examinons quelques instants cette affirmation et ses implicites.
Dans quelle mesure le système économique dans lequel nous vivons contribue au développement et à la diffusion dans le corps social d’un certain nombre de dispositions éthiques et psychologiques façonnant un sujet contemporain doté de certaines caractéristiques ?
Discutons quelques instants cette idée consistant à prétendre notre personnalité, nos comportements pourraient en partie dépendre du capitalisme. Est-ce une évidence ?
1.1. La fabrique sociale d’un homme
1.1.1. Sommes-nous façonnés par l’économie ?
Tout d’abord, nous ne sommes pas tous similaires. Prétendre qu'il existe une culture capitalistique qui diffuse des dispositions que nous intériorisions ne se trouve-t-il pas quotidiennement remis en cause par la simple observation de la diversité des formes d'être au monde et des types de personnalités présentes ?
Le fait qu'il existe une pluralité de personnalités n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de tendances de fond. Nous avons certes de grandes différences, mais appartenir à une culture, c'est intérioriser un cadre commun, des représentations collectives, partager des valeurs, des visions du monde…. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les oppositions de caractères, de mode de vie en fonction des pays ou en fonction des époques. Le rapport à la violence, les rapports aux autres, le sens de la politesse, l'esprit de compétition, les formes de réussite sociale encouragées, les conceptions du travail et tant de choses encore qui contribuent à façonner un univers normatif et qui font que la plupart d'entre nous ne nous différencions qu'à l'intérieur de cet univers des possibles.
Prenons l'exemple du rapport à l'école. Certes on peut tout à fait considérer que chaque parent apporte une marque éducative qui lui est propre dans la scolarité des enfants, mais cela n'enlève pas l'existence d’une logique globale de surinvestissement dans le scolaire. Cela signifie qu’au-delà des différences, nous constatons une évolution collective du rapport à l'école se traduisant par le fait que désormais la plupart des parents accordent une importance beaucoup plus forte que par le passé à la réussite scolaire de leurs enfants. Ils ne le font pas parce qu’ils se sont réveillés un matin brutalement investis de cette mission. Ils le font, car ils ont parfaitement intégré les nouvelles règles du jeu social ayant fait de l’école la pierre angulaire du destin social et souhaitent que leurs enfants réussissent. Cette disposition, ce rapport à l’école aussi intime soit-il relève bien, pour partie, d’une logique de structures sociales et économiques.
Dire que ce que nous sommes est en grande partie modelé par le néolibéralisme c’est dire que parmi l’ensemble des champs sociaux (culturelle, scolaire, sportif…), le champ économique tel qu’il existe est désormais totalement dominant au point où non seulement il occupe une position centrale dans le fonctionnement existentiel de chacun, mais il réussit à exporter ses principes de fonctionnement dans de nombreux autres univers.
Commençons par souligner le fait que chaque espace social tente à sa façon d'exercer une influence sur les dispositions psychologiques pour produire des individus conformes aux intérêts du champ. Il ne faut pas être un grand sociologue pour comprendre que le champ sportif tente de produire des dispositions sportives : un corps musclé, un esprit de compétition, de la persévérance, et il le fait en mobilisant une technologie sociale et symbolique extrêmement puissante dont l'entraînement constitue l'archétype.
De la même façon, si vous souhaitez devenir journaliste, vous devrez aller à la rencontre de cet espace journalistique, de ses règles du jeu, de ses luttes de classements, de ses mécanismes d’entrée et de consécration, mais aussi d’exclusion, des différentes positions sociales possibles et de leurs prestiges …connaissant tout ceci vos commencerez alors une carrière spirituelle3 de journaliste.
Si souhaitez devenir un bon chrétien, vous devrez en apprendre les principes, la bible (chaque champ a sa « bible »). Vous devrez vous soumettre à de nombreux dispositifs ayant pour objet de travailler votre âme (confession, prière…). Vous mettrez en œuvre des rituels, célébrerez des saints. Dans certains pays et/ou à certaines époques, c’est toute votre vie qui se trouve prise dans les mailles de ce champ social.
1.1.2. Pourquoi le champ économique aurait-il plus d’influence que les autres ?
Avec le recul du temps, on peut s’interroger sur les processus d’emprise qui peuvent se cacher dans ce travail sur l’individu de certains espaces quand ils deviennent tout puissants. Au fond, la plupart des univers sociaux sont poussés par une logique de développement, d’influence, de captation qui les conduit à vouloir étendre leur pouvoir. Ce processus d’emprise, on peut l’observer d’un point de vue collectif (quand par exemple une religion devient totalitaire et tente de diriger toutes les dimensions de la vie de ses « brebis »), mais aussi individuellement lorsqu’un individu se trouve totalement soumis aux enjeux du champ (on peut penser au sportif consacrant sa vie entière, sacrifiant son corps et peut-être une partie de sa jeunesse à la réussite sportive et dans une logique extrême on peut aussi penser aux processus sectaires).
Ils cherchent tous à prendre le pouvoir, mais tous les champs n’ont pas la même capacité d’influence.
Ainsi, le champ religieux a pendant des années exercé un pouvoir particulièrement fort sur la subjectivité des individus. En France son pouvoir a bien reculé. L’histoire avec un grand H, c’est-à-dire d’un point de vie anthropologique, c'est aussi l'histoire de la puissance de certains types d'espaces, de leurs prises de pouvoir, de leurs reculs et de leurs luttes, des technologies qu’ils ont inventé pour produire des habitus. C’est l’histoire de ce que nous avons été (un ouvrier, un paysan, un croyant …) et pas simplement dans des nomenclatures administratives, mais dans la profondeur de notre âme.
Aujourd’hui, le champ économique peut être considéré comme le champ dominant
Son influence est immense, car notre position économique (professionnelle) constitue une composante essentielle de notre identité sociale.
Dans le capitalisme, nous sommes d’abord le métier que nous exerçons. Il nous classe et nous définit. Nous le savons tous très bien lorsque nous nous battons pour que nos enfants occupent une position professionnelle la plus prestigieuse possible. Nous le savons très bien lorsque nous posons la question du métier à cet inconnu comme un révélateur de la profondeur de son être.
En outre, notre capacité à satisfaire nos besoins les plus élémentaires dépend de la place que nous occupons dans les organisations économiques et de notre emploi. Pas d’emploi. Pas d’argent. Aucun autre espace ne peut revendiquer un tel capital. En faisant de l’espace économique, le pourvoyeur de ressources qui me permet de me nourrir nous lui accordons une force supérieure à tous les autres champs. Être un bon professionnel constitue donc une injonction particulièrement puissante, car ne pas l'être nous fait courir des risques existentiels majeurs. Vous pouvez refuser de vous soumettre au champ sportif et trouver que les entraînements sont particulièrement difficiles voire même que le football est un sport bête et méchant, mais il vous sera plus difficile de refuser de vous soumettre au monde économique, car vous devrez trouver un travail pour gagner votre vie et par conséquent vous devrez cultiver des dispositions éthiques et pratiques qui vous permettent de le conserver.
Les normes véhiculées dans la sphère économique se révèlent donc particulièrement puissantes.
1.1.3. Les formes du capitalisme évoluent : nous aussi !
Les types de normes économiques évoluent en fonction des époques. Nous ne vivons pas dans le même modèle économique qu’il y a 20 ans et dans 20 ans encore d’autres structures auront été inventées, d’autres règles du jeu auront cours, d’autres technologies auront bouleversé cet ordre social et nous ne serons différents de ce que nous avons été. Les réseaux sociaux ne nous transforment-ils pas encore ?
De nombreux sociologues et à commencer par Max Weber4 ou encore Luc Boltanski5 se sont penchés sur les liens entre ce que nous sommes et les structures économiques.
Au fond, le raisonnement est assez simple. Les besoins du système économique varient en fonction des époques et les configurations économiques aussi (conditions de la concurrence, modèles d’organisation du travail, méthodes de management, nature de la relation salariale, contrat psychologique en vigueur, technologies…).
Le taylorisme et son travail à la chaîne nécessitait d'avoir des individus dociles, sans créativité, acceptant un emploi sans que la question du sens ne se pose de façon trop forte alors que le modèle économique actuel prône la créativité, l'autonomie et flexibilité, car les conditions de la concurrence sont différentes. Il lui faut des individus plus souples, plus mobiles, plus adaptables… Une autre façon d’être……
Dans un monde en mouvement où la compétition peut nécessiter de s'adapter à de nouveaux marchés, d'introduire de nouvelles technologies il nous faut alors disposer d'individus disposant euxmêmes de la capacité à s'adapter, de trouver des solutions…
Le champ économique dispose pour travailler les subjectivités d’une vaste panoplie d'outils : formation, littérature, coach, évaluation, entretien de recrutement et de sélection, mode de rémunération, prime au mérite, dispositif de carrière…
En pratique, c’est le concept de “compétences” qui prend le plus en charge ce travail symbolique.
Le lien avec ce que nous sommes est particulièrement évident quand nous mobilisons les « savoir-être » ou les soft-skills.
Ainsi, l’examen des référentiels disponibles (comme celui issu du pôle emploi) dresse dans le détail des âmes le portrait de l’agent social qu’il nous faut être.
Extrait brochure Pôle emploi – France Travail6
Les savoir-être professionnels sont l’ensemble des manières d’agir et d’interagir dans un contexte professionnel. Ils ne sont pas subjectifs et ils peuvent être illustrés ou démontrés par un exemple concret de situation professionnelle. Ils ont pour but de compléter la description du profil attendu dans les offres d’emploi, de valoriser les candidats via leur profil et leur CV, ainsi que de faciliter les échanges lors des entretiens d’embauche.
Capacité d’adaptation : Capacité à s’adapter à des situations variées et à s’ajuster à des organisations, des collectifs de travail, des habitudes et des valeurs propres à l’entreprise.
Gestion du stress : Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues ou stressantes.
Sens de l’organisation : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Rigueur : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies sans réaliser d’erreur, et à transmettre des informations avec exactitudes.
Travail en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l’entreprise en confiance et en transparence pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à fédérer : Capacité à mobiliser une équipe/des interlocuteurs et à les entrainer dans la poursuite d’un objectif partagé.
Force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s’ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Sens de la communication : Capacité à transmettre clairement des informations, échanger, écouter activement, recevoir des informations et messages et faire preuve d’ouverture d’esprit.
Persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu’à l’achèvement complet d’une tâche quels que soient les imprévus ou les obstacles de réalisation rencontrés.
Autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue.
Capacité de décision : Capacité à faire des choix pour agir, à prendre en charge son activité et à rendre compte, sans devoir être encadré de façon continue.
Prise de recul : Capacité à faire preuve d’objectivité, à prendre de la distance pour analyser les faits, les situations et les interactions avant d’agir ou de prendre une décision.
Réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d’urgence / d’importance
Nous n'avons aucun jugement de valeur à avoir sur ce type de fonctionnement de l’espace en lui-même. Pas plus que nous n’allons reprocher à l'artiste d'essayer de nous faire adopter une vision artistique et culturelle du monde. Les organisations économiques s'inscrivent dans un système où si elles veulent gagner, elles doivent disposer des meilleures ressources et notamment des ressources humaines. Elles vont donc déployer les moyens à leur disposition pour recruter, former, évaluer les individus selon des référentiels qui leur semblent en conformité avec leurs intérêts.
Écartons également une autre critique : ce travail psychique réalisé par les organisations peut aussi s’avérer positif dans certaines dimensions, ces compétences peuvent nous faire grandir. Ce n’est pas l’origine du processus de socialisation qui fait sa valeur morale.
Autrement dit, l’autonomie ou la créativité sont souvent de belles compétences à cultiver.
La crise environnementale nous oblige toutefois à revisiter notre grille de lecture pour apprécier la valeur des dispositions cultivées à l’aune de leur intérêt écologique. Autrement dit, si nous soif de consécration matérielle aboutit à détruire la planète, elle doit être combattue quel que soit l’intérêt que l’on peut lui porter par ailleurs.
1.1.4. Les relais du champ économique
Il ne faudrait pas croire que seul le champ économique est porteur de la force de développement de cet éthos capitaliste. C’est en réalité de nombreuses institutions qui participent à des degrés divers à la fabrique de ce sujet néolibéral. Elles le font, car elles fonctionnent sur des logiciels assez proches (le sens de la compétition dans le sport comme dans l’entreprise) ou encore parce qu’elles peuvent être en charge de satisfaire les besoins économiques et ses règles du jeu deviennent alors les siennes (champ de la formation, de l’éducation…). En d’autres termes, les univers sociaux sont perméables à certaines influences (homologie)
Le concept d'homologie, développé par Pierre Bourdieu, est utilisé pour décrire ces similitudes entre différents champs sociaux, institutions ou domaines d'activité au sein d'une société donnée.
L'homologie suggère que les différentes sphères sociales (champs) partagent des principes organisateurs et des logiques similaires, même si elles peuvent sembler distinctes à première vue. Ces similitudes structurelles reflètent souvent la logique générale de la société dans laquelle elles existent et influencent la façon dont les acteurs interagissent et se comportent dans chaque champ.
Selon Bourdieu, les élites dans chaque domaine partagent souvent des caractéristiques et des intérêts communs en raison de leur position privilégiée dans la société. Ils peuvent entretenir des relations étroites, des alliances ou des connexions qui transcendent les frontières traditionnelles des champs sociaux. Ces élites partagent généralement des goûts, des pratiques et des valeurs similaires, ce qui renforce leur position dominante.
Par exemple, l'homologie des élites peut être observée lorsque des individus occupant des postes de pouvoir dans le domaine politique ont également des liens étroits avec des acteurs importants dans le domaine économique.
De même, l'homologie des élites peut exister entre les mondes de la culture et de l'art, où les élites artistiques, intellectuelles et culturelles partagent souvent des connexions et des valeurs similaires, influençant ainsi les normes et les tendances dans ces domaines.
Il existe un champ du pouvoir avec des dominants capable de diffuser une certaine vision du monde même dans les sphères publiques. Les travaux sur « l’état social actif » nous donnent à voir la diversité des modes de diffusion de cet esprit dans les politiques publiques.
1.1.5. Cette fabrique des subjectivités peut-elle s’observer sur le terrain de l’État ?
Les mutations de l'État contemporain et le développement de l'État social actif7 constituent un autre terrain d'observation de ce processus de production de l’esprit néolibéral.
La mécanique de diffusion d'un certain esprit du capitalisme a pu aussi être analysée à travers un certain nombre de travaux sur les mutations des modes d'intervention de l'État. L’État déploie de nombreuses politiques et les outils et ils peuvent être porteurs d’une certaine injonction à Etre.
FRANSSEN ABRAHAM a travaillé sur la fabrique du sujet à travers la mise en évidence de l’existence d’un nouvel univers normatif au cœur des politiques publiques. Il montre comment ces politiques se trouvent porteuses de référentiels normatifs et d'injonctions sociales.
Ce processus se donne à a particulièrement à observer dans les politiques sociales
« Reformulant et spécifiant la problématique générale de la cohésion sociale, l’ « activation », la « responsabilisation » et l’ « insertion » tendent aujourd’hui à désigner les finalités générales d’une diversité de processus (de prévention, de formation, d’intervention, de socialisation, d’orientation) mis en œuvre par différents opérateurs sociaux (travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, manager, gestionnaires de projets, accompagnateurs, médiateurs, conseillers d’orientation...) vis-à-vis de publics variés : chômeurs (plan d’accompagnement des chômeurs), bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS), élèves en décrochage (sas), jeunes « délinquants »8
Cela signifie que certains éléments de l'esprit capitalistique ont infusé dans les branches de l'État et transforment ses modes d’interventions pour les rendre plus « efficaces » et plus en conformité avec les normes de l’époque.
Dans le champ de l'accompagnement social, les politiques publiques se trouvent désormais marquées par quatre formes d'injonctions.
Travailler l'autonomie
Individualiser les interventions
Mobiliser la notion de projet
Développer une logique contractuelle
« La première marque de la nouvelle fabrique du sujet est sans doute qu’elle se légitime et s’exerce désormais au nom de l’individu luimême. Dans les différents champs du travail social, éducatif et même au sein des dispositifs sécuritaires, on observe une même mutation des principes de légitimité : c’est désormais au nom de sa propre autonomie, à conquérir par l’individu considéré comme déficient, que la relation assistancielle est motivée. Celle-ci d’ailleurs réfute les qualifications d’assistance », d’ « aide », de « prise en charge», de « protection » pour s’énoncer comme accompagnement, soutien, guidance, coaching dans le cheminement de l’individu vers la conquête de son autonomie, dans son développement vocationnel, personnel et professionnel ».
La façon dont une assistante sociale accompagne un usager, le répertoire d’outils professionnels qu’elle mobilise, les discours qu’elle tient prescrivent un savoir-être, une posture et participent à la production d’un éthos.
Avoir des projets, faire preuve d’autonomie, se responsabiliser, être mobile, s’adapter sont désormais les piliers d’une éthique économique et culturelle.
Porté par cette culture, FRANSSEN ABRAHAM dessine ainsi les contours d’un individu-sujet narcissique (post)moderne9 dont les caractéristiques principales sont les suivantes
Détaché des grands récits collectifs émancipateurs,
Sceptique quant aux rôles auxquels il devrait se conformer,
Partagé entre frivolité et anxiété,
Indifférence et hyper-susceptibilité aux autres,
Dégagé de ses classes-communautés d’appartenance pour se reconstruire dans des réseaux d’affinités électives,
Echappant aux préceptes normatifs culpabilisant de la modernité industrielle,
En quête de lui-même, à travers une esthétisation de son existence,
Marqué par une fragilité, voire par une inconsistance identitaire.
Nous avons pu examiner deux domaine de diffusion de l’esprit du temps (le champ économique et les formes d'interventions de l'État). Chacun à leur façon participe de la production d’une vision du monde, du sens social de nos vies. Le champ du travail constitue un autre terrain de compréhension de cette mécanique.
1.1.6. L’exemple du travail du champ managérial