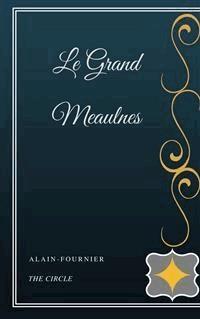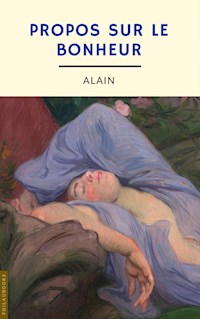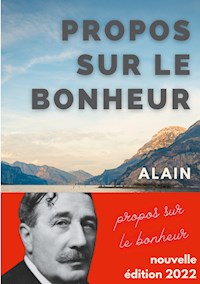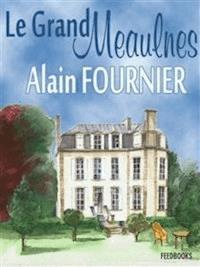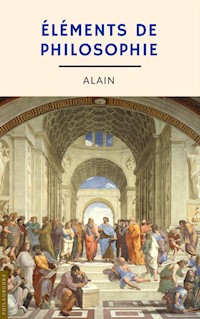
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
- • Texte révisé suivi de repères chronologiques.
« Ayant eu des loisirs forcés par le malheur et les hasards de ces temps-ci, j’ai voulu essayer si l’ordre ne gâterait pas la matière. Et, comme je ne voyais pas de raison qui me détournât d’aborder même les problèmes les plus arides, à condition de n’en dire que ce que j’en savais il s’est trouvé que j’ai composé une espèce de Traité de Philosophie. Mais comme un tel titre enferme trop de promesses, et que je crains par-dessus tout d’aller au delà de ce qui m’est familier, par cette funeste idée d’être complet, qui gâte tant de livres, j’ai donc choisi un titre moins ambitieux. Je ne crois point pourtant qu’aucune partie importante de la Philosophie théorique et pratique soit omise dans ce qui suivra, hors les polémiques, qui n’instruisent personne. Mais si ce livre tombait sous le jugement de quelque philosophe de métier, cette seule pensée gâterait le plaisir que j’ai trouvé à l’écrire, qui fut vif. En ce temps où les plaisirs sont rares, il m’a paru que c’était une raison suffisante pour faire un livre. »
ALAIN.
Le 19 juillet 1916.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Éléments de philosophie
Alain
Table des matières
Avertissement au lecteur
Avant-propos
Introduction
I. De la connaissance par les sens
1. De l'anticipation dans la connaissance par les sens
2. Des illusions des sens
3. De la perception du mouvement
4. L'éducation des sens
5. De la sensation
6. De l’espace
7. Le sentiment de l'effort
8. Les sens et l'entendement
9. De l’objet
10. De l’imagination
11. De l'imagination par les différents sens
12. De l'association d'idées
13. De la mémoire
14. Des traces dans le corps
15. De la succession
16. Le sentiment de la durée
17. Du temps
18. Le subjectif et l’objectif
II. L’expérience méthodique
1. L’expérience errante
2. De l’observation
3. L’entendement observateur
4. De l’acquisition des idées
5. Des idées générales
6. Des idées universelles
7. De l’analogie et de la ressemblance
8. Du concept
9. De l’hypothèse et de la conjecture
10. Éloge de Descartes
11. Le fait
12. Des causes
13. Des fins
14. Des lois naturelles
15. Des principes
16. Du mécanisme
III. De la connaissance discursive
Introduction
1. Du langage
2. Langage et poésie
3. De la conversation
4. De la logique ou rhétorique
5. Commentaires
6. De la géométrie
7. De la mécanique
8. De l’arithmétique et de l’algèbre
9. De la vaine dialectique
10. Examen de quelques raisonnements métaphysiques
11. De la psychologie
12. La personnalité
13. De l’humeur
14. L’individualité
15. Le moi
IV. De l'action
1. Le jugement
2. L’esprit juste
3. De l’instinct
4. Du fatalisme
5. De l’habitude
6. Du déterminisme
7. De l’union de l’âme et du corps
8. Du libre arbitre et de la foi
9. De Dieu, de l’espérance et de la charité
10. Du génie
11. Du doute
V. Des passions
1. Du bonheur et de l’ennui
2. De la passion du jeu
3. De l’amour
4. De l’amour de soi
5. De l’ambition
6. De l’avarice
7. De la misanthropie
8. Des malades imaginaires
9. De la peur
10. De la colère
11. De la violence
12. Des larmes
13. Du rire
VI. Des vertus
1. Du courage
2. De la tempérance
3. De la sincérité
4. De la justice
5. Encore de la justice
6. Encore de la justice
7. Du droit et de la force
8. De la sagesse
9. De la grandeur d’âme
10. De l’art de connaître les autres et soi
11. De la foi et de la vie intérieure
12. L’art de se gouverner soi-même
VII. Des cérémonies
Introduction
1. De la solidarité
2. De la politesse
3. Du mariage
4. Du culte
5. De l’architecture
6. De la musique
7. Du théâtre
8. Du fanatisme
9. De la poésie et de la prose
10. Les pouvoirs publics
Repères chronologiques
Couverture
Copyright © 2022 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0237-6
Avertissement au lecteur
J’ai laissé longtemps cet ouvrage dans son premier état ; c’est que j’apercevais de si grands changements à y faire que j’hésitais devant le travail. J’avais d’ailleurs bien des occasions d’écrire ce que je pensais sur tous sujets. Ce livre a été fort lu. Sollicité par d’excellents lecteurs, j’ai pris le parti d’y faire les changements nécessaires et de le faire paraître sous un titre différent. J’ai pensé beaucoup aux jeunes étudiants ; j’ai recherché ce qui pouvait immédiatement les toucher. L’esprit humain est partout entier et le même ; quand il est neuf, il est encore plus difficile à éclairer. On trouvera donc ici des traces de mon enseignement ; on se rendra compte de ce que furent mes leçons à Henri-IV, et encore mieux au Collège Sévigné. Dans ce dernier cas, surtout, je m’adressais à des esprits tout à fait ignorants de la philosophie classique, au lieu que les vétérans de Henri-IV étaient nourris de la doctrine scolaire. Toujours est-il qu’on peut aborder ce livre sans rien savoir des questions qui y sont traitées. Un étudiant attentif sera donc assez instruit ?
Non, mais il sera en mesure de prendre les problèmes d’un peu plus haut. En vue de quoi je lui recommande Idées qui convient pour initier à la philosophie du second degré et non plus élémentaire. Ces deux ouvrages une fois bien possédés, je ne vois pas ce qui manque à la réflexion personnelle, qui peut, à partir de là, se prolonger sans fin. J’ajoute que, sur les problèmes de la morale et de la politique, le disciple saura bien trouver dans les propos, qui seront bientôt tous mis en recueil, les analyses plus libres qui rapprocheront de la vie réelle les devoirs et la connaissance de soi. Les recueils les plus importants à ce point de vue ont pour titres Minerve et Suite à Minerve, Esquisses de l’Homme, Sentiments Passions et Signes, Les Saisons de l’Esprit ; ces titres sont assez clairs et je prends occasion de cet avertissement pour rappeler que tous ces propos enferment la véritable philosophie, c’est-à-dire celle des grands auteurs.
On demandera peut-être si, par des études ainsi conduites, on se rapprochera un peu de ce qui s’enseigne et de ce qui se dit sous le nom de Philosophie. Là-dessus je ne réponds de rien. Toutefois, dans les Souvenirsconcernant Jules Lagneau, on trouvera le fidèle tableau d’une classe de philosophie justement illustre. Il est vrai que beaucoup reprochaient à Lagneau de s’éloigner un peu trop de l’usage scolaire en matière de philosophie.
Cet écart est expliqué à mes yeux dans la République de Platon, où l’on voit le forgeron se laver les mains, et aller épouser la philosophie. Je comprends par cette fable que la philosophie est un peu trop facile aux rhéteurs, ce qui explique une scolastique assez compliquée. Au reste j’ai souvent pensé que Lagneau concédait beaucoup à cette tradition, quand il reprenait pendant des mois la recherche d’une méthode de la Psychologie. Ce genre d’entreprise menace à la fois et sauve les philosophes d’occasion. On peut parler, on peut diviser, et faire une sorte d’analyse de l’âme. J’entends que c’est une fausse analyse et que j’ai l’ambition d’écrire, si l’âge me le permet, des Exercices d’Analyse qui ressembleront beaucoup à ce livre-ci ; à ce point que je pensais à lui donner ce titre-là. Toutefois je conçois sous ce titre quelque chose de bien plus libre et naturel que mes Chapitres et qui se rapprochera, encore plus de la leçon simple et familière par quoi l’on rêve de commencer l’initiation. Je ne dois point cacher que tous ces travaux, d’abord faciles, ont pour fin de changer profondément l’enseignement de la philosophie en France. On a souvent dit, au temps de Lagneau, que ses meilleurs élèves risquaient d’échouer au baccalauréat. Il n’en était rien ; mais enfin il y a quelque apparence que mes vrais disciples fuissent passer à côté des questions sorbonniques. Je ne fais qu’éveiller ici leur prudence et répéter qu’une analyse directe des mots usuels permet toujours de traiter honorablement n’importe quelle question. Ce problème du vocabulaire, qui est tout dans l’enseignement, sera beaucoup éclairci dans les futurs Exercices d’Analyse, où je compte expliquer l’usage du tableau noir et des Séries, sujet très obscur, mais qui forme aussitôt l’esprit ; tout problème consiste alors à écrire la série pleine qui y correspond. Qui consulter là-dessus ? Je ne vois que Comte, qui, selon moi, doit être mis au rang des initiateurs de philosophie et qui rendra bien des services par ses dix précieux volumes ; si l’on n’y mord point, c’est que l’on refuse d’être instruit. Tous mes vœux à vous, lecteurs, et surtout ne manquez bas de courage.
ALAIN.
Le 10 mars 1940
Avant-propos
à la première édition
des quatre-vingt-un chapitres sur l’Esprit et les passions.
Quelques-uns de mes lecteurs ont souvent regretté de ne trouver ni ordre ni classement dans les courts chapitres que j’ai publiés jusqu’ici. Ayant eu des loisirs forcés par le malheur et les hasards de ces temps-ci, j’ai voulu essayer si l’ordre ne gâterait pas la matière. Et, comme je ne voyais pas de raison qui me détournât d’aborder même les problèmes les plus arides, à condition de n’en dire que ce que j’en savais il s’est trouvé que j’ai composé une espèce de Traité de Philosophie. Mais comme un tel titre enferme trop de promesses, et que je crains par-dessus tout d’aller au delà de ce qui m’est familier, par cette funeste idée d’être complet, qui gâte tant de livres, j’ai donc choisi un titre moins ambitieux. Je ne crois point pourtant qu’aucune partie importante de la Philosophie théorique et pratique soit omise dans ce qui suivra, hors les polémiques, qui n’instruisent personne. Mais si ce livre tombait sous le jugement de quelque philosophe de métier, cette seule pensée gâterait le plaisir que j’ai trouvé à l’écrire, qui fut vif. En ce temps où les plaisirs sont rares, il m’a paru que c’était une raison suffisante pour faire un livre.
ALAIN.
Le 19 juillet 1916.
Introduction
Le mot Philosophie, pris dans son sens le plus vulgaire, enferme l’essentiel de la notion. C’est, aux yeux de chacun, une évaluation exacte des biens et des maux ayant pour effet de régler les désirs, les ambitions, les craintes et les regrets. Cette évaluation enferme une connaissance des choses, par exemple s’il s’agit de vaincre une superstition ridicule ou un vain présage ; elle enferme aussi une connaissance des passions elles-mêmes et un art de les modérer. Il ne manque rien à cette esquisse de la connaissance philosophique. L’on voit qu’elle vise toujours à la doctrine éthique, ou morale, et aussi qu’elle se fonde sur le jugement de chacun, sans autre secours que les conseils des sages. Cela n’enferme pas que le philosophe sache beaucoup, car un juste sentiment des difficultés et le recensement exact de ce que nous ignorons peut être un moyen de sagesse ; mais cela enferme que le philosophe sache bien ce qu’il sait, et par son propre effort. Toute sa force est dans un ferme jugement, contre la mort, contre la maladie, contre un rêve, contre une déception. Cette notion de la philosophie est familière à tous et elle suffit.
Si on la développe, on aperçoit un champ immense et plein de broussailles, c’est la connaissance des passions et de leurs causes. Et ces causes sont de deux espèces ; il y a des causes mécaniques contre lesquelles nous ne pouvons bas beaucoup, quoique leur connaissance exacte soit de nature à nous délivrer déjà, comme nous verrons, il y a des causes d’ordre moral, qui sont des erreurs d’interprétation, comme si, par exemple, entendant un bruit réel, j’éprouve une peur sans mesure et je crois que les voleurs sont dans la maison. Et ces fausses idées ne peuvent être redressées que par une connaissance plus exacte des choses et du corps humain lui-même, qui réagit continuellement contre les choses, et presque toujours sans notre permission, par exemple quand mon cœur bat et quand mes mains tremblent.
On voit par là que, si la philosophie est strictement une éthique, elle est, par cela même, une sorte de connaissance universelle, qui toutefois se distingue par sa fin des connaissances qui ont pour objet de satisfaire nos passions ou seulement notre curiosité. Toute connaissance est bonne au philosophe, autant qu’elle conduit à la sagesse ; mais l’objet véritable est toujours une bonne police de l’esprit. Par cette vue, on passe naturellement à l’idée d’une critique de la connaissance. Car la première attention à nos propres erreurs nous fait voir qu’il y a des connaissances obscurcies par les passions, et aussi une immense étendue de connaissances invérifiables et pour nous sans objet, et qui ont deux sources, le langage, qui se prête sans résistance à toutes les combinaisons de mots, et les passions encore, qui inventent un autre univers, plein de dieux et de forces fatales, et qui y cherchent des aides magiques et des présages. Et chacun comprend qu’il y a ici à critiquer et à fonder, c’est-à-dire à tirer de la critique des religions une science de la nature humaine, mère de tous les dieux. On appelle réflexion ce mouvement critique qui de toutes les connaissances, revient toujours à celui qui les forme, en vue de le rendre plus sage.
La vraie méthode pour former la notion de philosophie, c’est de penser qu’il y eut des philosophes. Le disciple devra se tracer à lui-même le portrait de ces hommes étranges qui jugeaient les rois, le bonheur, la vertu et le crime, les dieux mêmes et enfin tout. Ce qui est plus remarquable, c’est que ces hommes furent toujours admirés, et souvent honorés par les rois eux-mêmes. Joseph en Égypte expliquait les songes ; c’est ainsi qu’il devint premier ministre. Admirez ici l’art de débrouiller les passions, de deviner la peur, le soupçon, le remords, enfin tout ce qui est caché dans un roi. D’après l’exemple de joseph on comprendra qu’en tous les temps, et en toutes les civilisations, il y eut des philosophes, hommes modérateurs, hommes de bon conseil, médecins de l’âme en quelque sorte. Les astrologues, si puissants auprès des tyrans, furent sans doute des philosophes très rusés, qui feignaient de voir l’avenir dans les conjonctions des astres, et qui en réalité devinaient l’avenir d’après les passions du tyran, d’après une vue supérieure de la politique. Ce fut toujours le sort des philosophes d’être crus d’après une vue plus perçante qu’on leur supposait, alors qu’ils jugeaient d’après le bon sens. Faites donc maintenant le portrait de l’astrologue, de Tibère, et de Tibère qui n’était pas moins fin.
Décrivez les passions de l’un et de l’autre dans ce jeu serré. Aidez-vous de la première scène du Wallenstein de Schiller ; et aussi de ce que Schiller et Goethe en disent dans leurs lettres. Vous êtes ici en pleine réalité humaine, dans ce terrible camp, où la force, la colère et la cupidité font tout ; c’est une forme de civilisation. Si vous y reconnaissez l’homme qui est autour de vous, et vos propres sentiments, vous aurez fait déjà un grand progrès. Mais il ne s’agit point de rêver ; il faut écrire et que ce soit beau. Ce sera beau si c’est humain. Poussez hardiment dans cette direction, c’est celle du vrai philosophe. Si vous doutez là-dessus, ouvrez seulement Platon n’importe où, et écartez tout de suite l’idée que Platon est difficile. Ce que je propose ici de Platon n’est ni caché, ni difficile, ni discutable. Faites ce pas, qui est décisif pour la culture.
Le lecteur ne s’étonnera bas qu’un bref traité commence, en quelque façon, par la fin, et procède de la police des opinions à la police des mœurs, au lieu de remonter péniblement des passions et de leurs crises à l’examen plus froid qui les corrige un peu en même temps que l’âge les refroidit.
De la connaissance par les sens
De l'anticipation dans la connaissance par les sens
L’idée naïve de chacun, c’est qu’un paysage se présente à nous comme un objet auquel nous ne pouvons rien changer, et que nous n’avons qu’à en recevoir l’empreinte. Ce sont les fous seulement, selon l’opinion commune, qui verront dans cet univers étalé des objets qui n’y sont point ; et ceux qui, par jeu, voudraient mêler leurs imaginations aux choses sont des artistes en paroles surtout, et qui ne trompent personne. Quant aux prévisions que chacun fait, comme d’attendre un cavalier si l’on entend seulement le pas du cheval, elles n’ont jamais forme d’objet ; je ne vois pas ce cheval tant qu’il n’est pas visible par les jeux de lumière ; et quand je dis que j’imagine le cheval, je forme tout au plus une esquisse sans solidité, une esquisse que je ne puis fixer. Telle est l’idée naïve de la perception.
Mais, sur cet exemple même, la critique peut déjà s’exercer. Si la vue est gênée par le brouillard, ou s’il fait nuit, et s’il se présente quelque forme mal dessinée qui ressemble un peu à un cheval, ne jurerait-on pas quelquefois qu’on l’a réellement vu, alors qu’il n’en est rien ? Ici, une anticipation, vraie ou fausse, peut bien prendre l’apparence d’un objet. Mais ne discutons pas si la chose perçue est alors changée ou non, ou si c’est seulement notre langage qui nous jette dans L’erreur ; car il y a mieux à dire, sommairement ceci, que tout est anticipation dans la perception des choses.
Examinons bien. Cet horizon lointain, je ne le vois pas lointain ; je juge qu’il est loin d’après sa couleur, d’après la grandeur relative des choses que j’y vois, d’après la confusion des détails, et l’interposition d’autres objets qui me le cachent en partie. Ce qui prouve qu’ici je juge, c’est que les peintres savent bien me donner cette perception d’une montagne lointaine, en imitant les apparences sur une toile. Mais pourtant je vois cet horizon là-bas, aussi clairement là-bas que je vois cet arbre clairement près de moi ; et toutes ces distances, je les perçois. Que serait le paysage sans cette armature de distances, je n’en puis rien dire ; une espèce de lueur confuse sur mes yeux, peut-être. Poursuivons. Je ne vois point le relief de ce médaillon, si sensible d’après les ombres ; et chacun peut deviner aisément que l’enfant apprend à voir ces choses, en interprétant les contours et les couleurs. Il est encore bien plus évident que je n’entends pas cette cloche au loin, là-bas, et ainsi du reste.
On soutient communément que c’est le toucher qui nous instruit, et par constatation pure et simple, sans aucune interprétation. Mais il n’en est rien. Je ne touche pas ce dé cubique. Non. Je touche successivement des arêtes, des pointes, des plans durs et lisses, et réunissant toutes ces apparences en un seul objet, je juge que cet objet est cubique. Exercez-vous sur d’autres exemples, car cette analyse conduit fort loin, et il importe de bien assurer ses premiers pas. Au surplus, il est assez clair que je ne puis pas constater comme un fait donné à mes sens que ce dé cubique et dur est en même temps blanc de partout, et marqué de points noirs. Je ne le vois jamais en même temps de partout, et jamais les faces visibles ne sont colorées de même en même temps, pas plus du reste que je ne les vois égales en même temps. Mais pourtant c’est un cube que je vois, à faces égales, et toutes également blanches. Et je vois cette chose même que je touche. Platon, dans son Thééthète, demandait par quel sens je connais l’union des perceptions des différents sens en un seul objet.
Revenons à ce dé. Je reconnais six taches noires sur une des faces. On ne fera pas difficulté d’admettre que c’est là une opération d’entendement, dont les sens fournissent seulement la matière. Il est clair que, parcourant ces taches noires, et retenant l’ordre et la place de chacune, je forme enfin, et non sans peine au commencement, l’idée qu’elles sont six, c’est-à-dire deux fois trois, qui font cinq et un. Apercevez-vous la ressemblance entre cette action de compter et cette autre opération par laquelle je reconnais que des apparences successives, pour la main et pour l’œil, me font connaître un cube ? Par où il apparaîtrait que la perception est déjà une fonction d’entendement, et, pour en revenir à mon paysage, que l’esprit le plus raisonnable y met de lui-même bien plus qu’il ne croit. Car cette distance de l’horizon est jugée et conclue aussi, quoique sans paroles. Et nous voilà déjà mis en garde contre l’idée naïve dont je parlais.
Regardons de plus près. Cette distance de l’horizon n’est pas une chose parmi les choses, mais un rapport des choses à moi, un rapport pensé, conclu, jugé, ou comme on voudra dire. Ce qui fait apparaître l’importante distinction qu’il faut faire entre la forme et la matière de notre connaissance. Cet ordre et ces relations qui soutiennent le paysage et tout objet, qui le déterminent, qui en font quelque chose de réel, de solide, de vrai, ces relations et cet ordre sont de forme, et définiront la fonction pensée. Et qui ne voit qu’un fou ou un passionné sont des hommes qui voient leurs propres erreurs de jugement dans les choses, et les prennent pour des choses présentes et solides ? On peut voir ici l’exemple de la connaissance philosophique, définie plus haut en termes abstraits. Ainsi dès les premiers pas, nous apercevons très bien à quelle fin nous allons. Et cette remarque, en toute question, est propre à distinguer la recherche philosophique de toutes les vaines disputes qui voudraient prendre ce beau nom.
Note
Si vous pensez à ce chapitre. qui, selon mon goût, est un peu trop abstrait et rapide, vous vous direz que la discussion est ouverte. Car chacun résiste à cette idée que les choses sont pleines d’imaginations. Votre bon sens vous soufflera au contraire que les vraies choses sont celles qui n’ont rien d’imaginaire. Et soit. C’est encore une juste idée de la philosophie que celle d’une continuelle discussion avec soi-même et avec les autres et cette notion, elle aussi, conduit fort loin. D’un trait elle conduit à l’idée du semblable, qui est une des plus fécondes pour la réflexion à ses débuts. Le semblable, c’est celui qui peut comprendre et juger ; c’est donc par amitié et confiance que l’on trouve son semblable ; mais le plus beau c’est quand on arrive à ce merveilleux semblable, à soi-même. Car moi je suis pour moi comme un autre qu’il me semble que je connais bien. À bien regarder, toutes mes pensées sont comme un entretien avec ce semblable, avec moi. Oui, même les pensées faibles par lesquelles vous essayez d’ajourner le travail de réflexion et surtout le travail d’écrire. Tout de suite vous éprouvez que ce semblable qui est vous, n’est pas facile à tromper, qu’il flaire d’une lieue la paresse et le mensonge à soi. Vous voilà plongé dans la morale qui est toute dans cette rencontre de moi et de moi ; ce qui est agréable, c’est de retourner de ce semblable gênant à l’autre semblable qui est plus humain, plus juste avec vous, en ce sens qu’il ne suppose pas toujours le mal (la paresse, la lâcheté, etc.). En somme vous commencez à l’aimer, cet autre, mieux déjà que vous-même. Si vous avez occasion de pratiquer quelque vieux confesseur vous saurez ce que c’est qu’un ami. Ainsi entre vous et vous et quelques amis, vivent pour vous vos pensées ; vous les dites vôtres, vous vous distinguez de l’autre, vous prenez conscience de vous-même. Conscience, voilà une notion fort difficile et que vous abordez aisément par ce chemin-ci. Toutefois vous devez vous exercer au petit jeu de moi et toi. Ce n’est nullement difficile et c’est assez amusant. C’est une préparation qui importe beaucoup dans votre présent travail. Je vous suppose en face d’un sujet fort difficile et je parie qu’à exposer seulement ce que, vous, vous en pensez, sentez et pressentez, vous ferez un excellent travail ; j’ai vu cette méthode essayée par un paresseux qui avait du talent. Les résultats furent très brillants. Car ce que vous pensez d’un sujet mal connu peut être faux ou douteux ; toujours n’est-il pas douteux que vous en pensiez ceci et cela. Pour vous fortifier ici, c’est Descartes qu’il faut lire ; d’abord le Discours de la Méthode jusqu’à Dieu, ensuite les Méditations, et vous verrez comment on va fort loin en pensant seulement ce que l’on pense. Je veux qu’à ce propos des discussions, vous formiez aussi la notion préliminaire du scepticisme. Descartes vous y jettera, et vous ne risquerez point de mépriser le sceptique, celui qui examine ; la philosophie, c’est l’examen même. Mais un singulier examen. Premièrement je me dis que mes opinions sont douteuses. Mais je me dis bien plus. Je me dis qu’elles seront toujours douteuses ; j’aperçois que jamais je n’en serai satisfait. Cela, c’est l’esprit même, c’est le départ même de l’esprit. Péguy disait de Descartes : « Ce cavalier qui partit d’un si bon pas ». Lisez cette note de Péguy sur Descartes. Vous serez surpris des bonds que vous ferez dans le monde des esprits. L’aventure est sans risques. Vous êtes toujours assuré de revenir à la modestie par un examen plus attentif de votre savoir et de votre courage. Et alors, comme dit un personnage de Claudel (lisez l’Otage), étant assis parterre au plus bas, vous ne craindrez pas d’être déposé. Il y a aussi de l’orgueil par là, attention ! Faites paraître le confesseur imaginaire ou réel, il ne vous épargnera pas. Bonne occasion d’adhérer plus que jamais à la conscience de vous-même. Tous ces mouvements intimes sont des moments de la philosophie. Et le doute en est une des régions les plus pures. Après cela lisez l’histoire de Pyrrhon qui a mérité de donner son nom aux pyrrhoniens. Pyrrhonisme est mieux dit que scepticisme. Ainsi vous formez votre vocabulaire.
Exercice proposé : distinguez le sens de ces deux mots, pyrrhonisme et scepticisme. Évidemment il y a à dire que l’un des deux est plus profond et plus humain. Cherchez lequel ? Il y a à dire des deux côtés. Pour moi, je pense que Pyrrhon avait plus de portée, parce qu’il décrétait d’abord que nul ne peut rien savoir de rien, ce qui est nier mais affirmer l’esprit et respecter l’esprit. Le sceptique doute au petit bonheur et en détail, pour s’amuser, etc. Exercez-vous à distinguer parmi vos amis, les sceptiques et les pyrrhoniens.
Des illusions des sens
La connaissance par les sens est l’occasion d’erreurs sur la distance, sur la grandeur, sur la forme des objets. Souvent notre jugement est explicite et nous le redressons d’après l’expérience ; notre entendement est alors bien éveillé. Les illusions diffèrent des erreurs en ce que le jugement y est implicite, au point que c’est l’apparence même des choses qui nous semble changée. Par exemple, si nous voyons quelque panorama habilement peint, nous croyons saisir comme des objets la distance et la profondeur ; la toile se creuse devant nos regards. Aussi voulons-nous toujours expliquer les illusions par quelque infirmité de nos sens, notre œil étant fait ainsi ou notre oreille. C’est faire un grand pas dans la connaissance philosophique que d’apercevoir dans presque toutes, et de deviner dans les autres, une opération d’entendement et enfin un jugement qui prend pour nous forme d’objet. J’expliquerai ici quelques exemples simples renvoyant pour les autres à l’Optique physiologique d’Helmholtz, où l’on trouvera ample matière à réflexion.
Certes quand je sens un corps lourd sur ma main, c’est bien son poids qui agit, et il me semble que mes opinions n’y changent rien. Mais voici une illusion étonnante. Si vous faites soupeser par quelqu’un divers objets de même poids, mais de volumes très différents, une balle de plomb, un cube de bois, une grande boîte de carton, il trouvera toujours que les plus gros sont les plus légers. L’effet est plus sensible encore s’il s’agit de corps de même nature, par exemple de tubes de bronze plus ou moins gros, toujours de même poids. L’illusion persiste si les corps sont tenus par un anneau et un crochet ; mais, dans ce cas-là, si les yeux sont bandés, l’illusion disparaît. Et je dis bien illusion, car ces différences de poids imaginaires sont senties sur les doigts aussi clairement que le chaud ou le froid. Il est pourtant évident, d’après les circonstances que j’ai rappelées, que cette erreur d’évaluation résulte d’un piège tendu à l’entendement ; car, d’ordinaire, les objets les plus gros sont les plus lourds ; et ainsi, d’après la vue, nous attendons que les plus gros pèsent en effet le plus ; et comme l’impression ne donne rien de tel, nous revenons sur notre premier jugement, et, les sentant moins lourds que nous n’attendions, nous les jugeons et finalement sentons plus légers que les autres. On voit bien dans cet exemple que nous percevons ici encore par relation et comparaison, et que l’anticipation, cette fois trompée, prend encore forme d’objet.
On analyse aisément de même les plus célèbres illusions de la vue. Je signale notamment ces images dessinées exprès où un réverbère et un homme selon la perspective ont exactement la même grandeur, ce que pourtant nous ne pouvons croire, dès que nous ne mesurons plus. Ici encore c’est un jugement qui agrandit l’objet. Mais examinons plus attentivement. L’objet n’est point changé, parce qu’un objet en lui-même n’a aucune grandeur ; la grandeur est toujours comparée, et ainsi la grandeur de ces deux objets, et de tous les objets, forme un tout indivisible et réellement sans parties ; les grandeurs sont jugées ensemble. Par où l’on voit qu’il ne faut pas confondre les choses matérielles, toujours séparées et formées de parties extérieures les unes aux autres, et la pensée de ces choses, dans laquelle aucune division ne peut être reçue. Si obscure que soit maintenant cette distinction, si difficile qu’elle doive rester toujours à penser, retenez-la au passage. En un sens, et considérées comme matérielles, les choses sont divisées en parties, et l’une n’est pas l’autre ; mais en un sens, et considérées comme des pensées, les perceptions des choses sont indivisibles, et sans parties. Cette unité est de forme, cela va de soi. Je n’anticipe point ; nous avons dès maintenant à exposer en première esquisse, cette forme qu’on appelle l’espace, et dont les géomètres savent tant de choses par entendement, mais non hors de la connaissance sensible, comme nous verrons.
Pour préparer encore mieux cette difficile exposition, j’invite le lecteur à réfléchir sur l’exemple du stéréoscope, après que la théorie et le maniement de cet appareil lui seront redevenus familiers. Ici encore le relief semble sauter aux yeux ; il est pourtant conclu d’une apparence qui ne ressemble nullement à un relief, c’est à savoir, d’une différence entre les apparences des mêmes choses pour chacun de nos yeux. C’est assez dire que ces distances à nous, qui font le relief, ne sont pas comme distances dans les données, mais sont plutôt pensées comme distances, ce qui rejette chaque chose à sa place selon le mot fameux d’Anaxagore : « Tout était ensemble ; mais vint l’entendement qui mit tout en ordre. »
Le lecteur aperçoit peut-être déjà que la connaissance par les sens a quelque chose d’une science ; il aura à comprendre plus tard que toute science consiste en une perception plus exacte des choses. L’exemple le plus étonnant sera fourni par l’astronomie, qui n’est presque que perception des choses du ciel en leur juste place. Cette science est celle qui convient le mieux pour donner au savoir humain ses véritables règles, comme l’exemple de l’éclipse le montrera abondamment ; car il s’agit alors de percevoir exactement le soleil et la lune dans leur alignement naturel, ce qui suppose la connaissance de leurs mouvements relatifs. Telle est la part de l’entendement dans une connaissance qui fut si longtemps confuse, et d’ailleurs effrayante. Le seul effort qui conduit à attendre la lune sur le passage du soleil est déjà beaucoup pour l’apprenti. Et quel progrès pour l’humanité ! Thalès annonçait tranquillement l’éclipse qui devait donner la panique à des armées. Tout le miraculeux est enlevé si l’on pense comme il faut à la lune nouvelle, qui flotte naturellement sur la route du soleil. Sans quoi l’apparition de la lune a de quoi terrifier. Souvenons-nous de ne traiter jamais des sciences que sur des exemples de ce genre-là. Et, puisque nous en sommes à Thalès, n’oublions pas son fameux axiome : « À l’heure où l’ombre de l’homme est égale à l’homme, l’ombre de la pyramide est égale à la pyramide. » Lagneau disait « La pensée est la mesureuse. » C’est un mot à retenir. Allons toujours tout droit dans ce développement, nous verrons naître la géométrie des Grecs. Tout notre effort est maintenant à retrouver l’entendement dans les sens, comme il sera plus loin à retrouver les sens dans l’entendement, toujours distinguant matière et forme, mais refusant de les séparer. Tâche assez ardue pour que nous négligions là-dessus les discours polémiques, toujours un peu à côté, et dangereux, comme tous les combats, pour ceux qui n’ont pas fait assez l’exercice.
De la perception du mouvement
Les illusions concernant le mouvement des choses s’analysent aisément et sont fort connues. Par exemple, il suffit que l’observateur soit en mouvement pour que les choses semblent courir en sens contraire. Même, par l’effet des mouvements inégaux des choses, certaines choses paraissent courir plus vite que d’autres ;. et la lune à son lever semblera courir dans le même sens que le voyageur. Par un effet du même genre, si le voyageur tourne le dos à l’objet dont il s’approche, le fond de l’horizon lui semblera s’approcher et venir vers lui. Là-dessus, observez et expliquez ; vous n’y trouverez pas grande difficulté. En revanche, l’interprétation de ces exemples, une fois qu’on les connaît bien, est très ardue, et peut servir d’épreuve pour cette force hardie de l’esprit, nécessaire au philosophe. Voici de quel côté un apprenti philosophe pourra conduire ses réflexions. Il considérera d’abord qu’il n’y a aucune différence entre le mouvement réel perçu et le mouvement imaginaire que l’on prête aux arbres ou à la lune, aucune différence, entendez dans la perception que l’on a. Secondement l’on fera attention que ces mouvements imaginaires sont perçus seulement par relation, ce qui fera voir ici encore l’entendement à l’œuvre, et pensant un mouvement afin d’expliquer des apparences, ce qui est déjà méthode de science à parler strictement, quoique sans langage. Et surtout l’on comprendra peut-être que les points de comparaison, les positions successives du mobile, les distances variables, tout cela est retenu et ramassé en un tout qui est le mouvement perçu. Ainsi il s’en faut bien que notre perception du mouvement consiste à le suivre seulement, en changeant toujours de lieu comme fait le mobile lui-même. Le subtil Zénon disait bien que le mobile n’est jamais en mouvement puisqu’à chaque instant il est exactement où il est. Je reviendrai sur les, autres difficultés dit même genre ; mais nous pouvons comprendre déjà que le mouvement est un tout indivisible, et que nous le percevons et pensons tout entier, toutes les positions du mobile étant saisies en même temps, quoique le mobile ne les occupe que successivement. Ainsi ce n’est point le fait du mouvement que nous saisissons dans la perception, mais réellement son idée immobile, et le mouvement par cette idée. On pardonnera cette excursion trop rapide dans le domaine entier de la connaissance ; ces analyses ne se divisent point. Remarquez encore que, de même que nous comptons des unités en les parcourant et laissant aller, mais en les retenant aussi toutes, ainsi nous percevons le mouvement en le laissant aller, oui, mais le long d’un chemin anticipé et conservé, tracé entre des points fixes, et pour tout dire immobile. Quand on a déjà un peu médité là-dessus, rien n’est plus utile à considérer que ces illusions que l’on se donne à volonté, en pensant telle ou telle forme du mouvement ; ainsi, quand on fait tourner un tire-bouchon, on perçoit une translation selon l’axe, sans rotation, si l’on veut ; ou, encore, on peut changer dans l’apparence, le sens de la rotation d’un moulin à vent ou d’un anémomètre, pourvu que l’on décide d’orienter l’axe autrement. Ainsi un autre choix de points fixes fait naître un autre mouvement. La notion du mouvement relatif apparaît ainsi dans la connaissance sans paroles.
Ce n’est pas peu d’avoir compris que la relativité est de l’essence du mouvement, et même dans la perception la plus commune. Mais l’occasion est bonne d’épuiser tous les paradoxes sur le mouvement, sans oublier Zénon d’Élée. Où est l’idée ? En ceci que le mouvement est toujours de forme ; le mouvement est la forme du changement. Tel est le principe de cette précaution de méthode que l’on nomme le mécanisme. Ce qui est à comprendre ici, c’est que le mouvement n’est jamais une donnée, mais au contraire toujours un système monté pour nous représenter le changement. Cela paraîtra aisément dans l’exemple d’un ballon que je vois diminuer à mes yeux, ce que je traduis en disant qu’il s’éloigne, ce que je perçois en traçant une ligne qui s’en va de moi à lui et qui grandit d’instant en instant. Le mouvement sur cette ligne n’est nullement perçu. Ce qui est perçu c’est un globe qui se rétrécit. Tous les mouvements, si l’on y fait attention, sont ainsi. On en trouve des exemples dans ce chapitre, et l’analyse en est assez poussée pour que l’on puisse répondre à Zénon. Répondre quoi ? D’abord qu’il est vrai en effet que la flèche ne se meut pas par elle-même. Et en effet son mouvement se rapporte à des objets extérieurs. Le mouvement n’est jamais inhérent à aucune chose ; il n’y peut tenir ni y adhérer. Comment voulez-vous que le mouvement soit dans la chose ? Un mouvement est une pensée de relations et de comparaisons. Une distance s’accroît ; une autre diminue. Mais, si je me borne à la chose même, où trouverai-je le mouvement ? En elle sous la forme d’un élan, d’une provision de mouvement, ou bien sous la forme d’un effort ? Choses à examiner, à discuter. Non pas données de l’expérience. Mais formes dont le tout préexiste aux parties ; pour évaluer un mouvement, je commence par le finir et je l’attends ensuite à l’achèvement. Le mouvement est de forme comme la causalité. Voilà le point de difficulté. Le changement est qualitatif. C’est-à-dire qu’après le changement vous jugez que le monde a un autre aspect, produit sur vos sens un autre effet. Un corps qui était en l’air se trouve maintenant en bas, si vous voulez vous représenter ce changement, c’est alors que vous inventez un mouvement ; et le mouvement est quantitatif ; il ne change point la chose mue ; mais il se mesure par une longueur dans un temps, par une vitesse. La vitesse a quelque chose d’obscur. Car, quand le mouvement est fait, la vitesse n’est plus rien. Toujours est-il que la vitesse est une quantité, un rapport de deux quantités mesurables, où le changement consiste dans l’addition ou la soustraction de parties juxtaposées. Certes ce n’est pas ainsi qu’un rouge sombre devient rouge clair. Non. Mais tout change à la fois et intérieurement à la couleur même. Telle est la qualité. Elle ne s’étend point d’un lieu à un autre, mais elle est ramassée dans chaque lieu ; sans changement de lieu elle peut passer du zéro, par exemple le blanc, à tous les roses et aux rouges. Les difficultés sont ici majeures ; il y faudra revenir. Saisissons d’abord l’opposition entre la qualité et la quantité. Une saveur est plus ou moins salée ; et plus salé ne signifie pas salé à côté de salé ; telle est la qualité. Si vous vous représentez la salure, aussitôt vous en appelez à la quantité ; vous comparez un poids de sel à un autre, vous changez en déplaçant le sel ; c’est toujours mouvement. D’où l’on pourrait dire que le mouvement est la quantité du changement. Cette substitution se fait dans la science même. On suppose toujours que la chaleur se mesure par un mouvement et même consiste dans un mouvement. Telles sont les idées où un esprit hardi se laissera entraîner sur ce propos du mouvement perçu et des poteaux qui courent le long de la voie. On conçoit que Zénon ait secoué la tête devant cet être qui est fait seulement de mes pensées. Revenant à des exemples, il a découvert les difficultés qu’il avait prévues.
Tout ce qui a été dit ici de la perception du mouvement s’applique au toucher, et notamment à la connaissance que nous avons de nos propres mouvements, par des contacts ou des tensions, avec ou sans l’aide de la vue. On jugera sans peine que l’idée de sensations originales, donnant le mouvement comme d’autres donnent la couleur et le son, est une idée creuse. C’est toujours par le mouvement pensé que j’arrive au mouvement senti ; et c’est dans l’ensemble d’un mouvement qu’une partie de mouvement est partie de mouvement. Peut-être arriverez-vous promptement à décider que les discussions connues sur le sens musculaire sont étrangères à la connaissance philosophique. Ce n’est en effet qu’une vaine dialectique dont la théorie sera comprise plus tard, après que le langage aura été décrit et examiné, comme un étrange objet dont on peut faire à peu près ce qu’on veut.
L'éducation des sens
L’observation de certains aveugles guéris de la cataracte congénitale a appelé l’attention des philosophes sur ce que les plus grands ont toujours su deviner, c’est qu’on apprend à voir, c’est-à-dire à interpréter les apparences fournies par les lumières, les ombres et les couleurs. Certes les observations médicales de ce genre sont toujours bonnes à connaître ; mais il est plus conforme à la méthode philosophique d’analyser notre vision elle-même, et d’y distinguer ce qui nous est présenté de ce que nous devinons. Il est assez évident, pour cet horizon de forêts, que la vue nous le présente non pas éloigné, mais bleuâtre, par l’interposition des couches d’air ; seulement nous savons tous ce que cela signifie. De même nous savons interpréter la perspective, qui est particulièrement instructive lorsque des objets de même grandeur, comme des colonnes, des fenêtres, les arbres d’une avenue, sont situés à des distances différentes de nous et paraissent ainsi d’autant plus petits qu’ils sont plus éloignés. Ces remarques sont très aisées à faire, dès que l’attention est attirée de ce côté-là. Mais quelquefois l’entendement naïf s’élève, au nom de ce qu’il sait être vrai, contre les apparences que l’on veut lui décrire. Par exemple, un homme qui n’a pas assez observé soutiendra très bien que ces arbres là-bas sont du même vert que ceux d’ici, et seulement plus éloignés. Un autre, s’essayant au dessin, ne voudra pas d’abord qu’un homme, dans l’apparence, soit plus petit qu’un parapluie. J’ai connu quelqu’un qui ne voulait pas admettre que nos yeux nous présentent deux images de chaque chose ; il suffit pourtant de fixer les yeux sur un objet assez rapproché, comme un crayon, pour que les images des objets éloignés se dédoublent aussitôt ; mais l’entendement naïf nie ces apparences d’après ce raisonnement assez fort : « Cela n’est pas, je ne puis donc pas le voir. » Les peintres, au contraire, sont conduits, par leur métier, à ne plus faire attention à la vérité des choses, mais seulement à l’apparence comme telle, qu’ils s’efforcent de reproduire.
Les choses en mouvement instruisent mieux le philosophe. Ici les apparences sont plus fortes, et le vrai de la chose est affirmé seulement sans qu’on puisse arriver à le voir. Il n’est pas de voyageur emporté à grande vitesse qui puisse s’empêcher de voir ce qu’il sait pourtant n’être pas, par exemple les arbres et les poteaux courir et tout le paysage tourner comme une roue qui aurait son axe vers l’horizon. Le plus grand astronome voit les étoiles se déplacer dans le ciel, quoiqu’il sache bien que c’est la terre en réalité qui tourne sur l’axe des pôles. Il est donc assez clair, dès que l’on pense à ces choses, qu’il faut apprendre, par observation et raisonnement, à reconstituer le vrai des choses d’après les apparences, et que c’est ici la main qui est l’institutrice de l’œil Que l’oreille doive aussi s’instruire, et que nous apprenions peu à peu à évaluer, d’après le son, la direction et la distance de l’objet sonore, c’est-à-dire les mouvements que nous aurions à faire pour le voir et le toucher, c’est ce qui est encore plus évident ; un chasseur, un artilleur continuent cette éducation par des observations classées et des expériences méthodiques ; on peut juger d’après cela du travail d’un enfant qui s’exerce, non sans méprises, à saisir ce qu’il voit et à regarder ce qu’il entend.
Le plus difficile est sans doute d’apercevoir que le sens du toucher, éducateur des autres, a dû lui-même s’instruire. Il est connu qu’un homme qui devient aveugle apprend à interpréter beaucoup d’impressions tactiles qu’il ne remarquait même pas auparavant. Par exemple, en touchant la main de son ami, il devinera mille choses que nous lisons d’ordinaire sur le visage. Partant de là, et en remontant, on peut se faire une idée des expériences de l’enfant sur le mou et sur le dur, sur le poli et le rugueux, et tout ce qu’on en peut conclure concernant les saveurs, odeurs et couleurs des choses. Il est clair aussi que, parmi ces connaissances, il faut considérer avec attention la connaissance de notre propre corps. Qu’elle ne puisse être immédiate, cela résulte de la notion même de lieu ou de distance, qui enferme des rapports, et par conséquent ne peut être donnée dans aucune impression immédiate. Ainsi, dans cette connaissance de notre corps et des choses qui nous semble toute donnée, en réalité tout est appris. Quant au détail et à l’ordre, on peut s’exercer utilement à les deviner, mais sans s’obstiner à vouloir plus que le vraisemblable. Autrement on tomberait dans des discussions subtiles et sans fin, étrangères à la vraie philosophie.
Note
Jules Lagneau proposait à ses élèves cet exercice : « Quelles seraient les impressions d’un aveugle-né, à qui une double opération rendrait successivement, à quelques jours d’intervalle, l’usage des deux yeux ? » Naturellement nous faisions parler l’aveugle lui-même. Nous savions bien distinguer deux choses ; d’abord quelle idée, et d’après quoi, se faisait l’aveugle de ce que c’est que voir (discours, analogie avec l’ouïe). Et ensuite, par opposition, nous décrivions l’expérience réelle qu’il faisait quand le premier bandeau était enlevé et aussitôt remis. C’est ici que l’expression subtile arrivait à donner une idée de la pure sensation. J’ai senti la lumière ! Où ? Comment ? On me dit que j’ai vu la fenêtre, etc., la fenêtre qui est, je le sais, à trois pas de moi. J’allonge le bras ; mais dans quelle direction ? Comment savoir ? J’insiste sur cet exercice parce qu’il contribue à former le style. N’oubliez pas que tous les aveugles-nés ont étonné les médecins par leurs récits. À vous donc d’étonner vos lecteurs, si vous pouvez. Ce qu’il y a ici de plaisant, c’est que vous devez ignorer tout de ces premières expériences de l’aveugle ; et que vous découvrez que vous les devinez assez aisément. Par exemple quand vous savez que vous voyez la fenêtre, vous essayez naturellement de la toucher. Le mouvement de votre bras vous la cache. Vous recommencez… vous interrogez, etc. Il sera capital pour vous d’apprendre à voir votre main, à la reconnaître, à la suivre, etc. Cet exercice de réflexion vous rendra familière l’histoire de votre vue et des autres sens, assez pour servir de départ à vos réflexions. Car il reste de l’incertain ici. Par exemple, comment ai-je appris à voir l’horizon si loin ? Peut-être l’ai-je appris par le secours de la peinture ; ici il est permis d’inventer. Quelquefois quand je rêve, les choses que j’ai sous les yeux reviennent à la confusion initiale. Premièrement je ne distingue plus les objets ; deuxièmement je ne pense plus le près, le loin, ni le grand, le petit. Il est important de remarquer comment je sors de cet état, c’est-à-dire par jugement et mouvement. Les choses alors se reculent à leur place. Vous observez la même chose quand, du premier moment du stéréoscope, vous passez brusquement au relief. Chaque chose se recule alors à sa place. D’autres avancent et même nous étonnent, c’est la naissance d’un monde, c’est la perception succédant à la sensation.
De la sensation
Ce qui est perçu dans une distance et dans tous les rapports de lieu qui supposent des distances, comme sont les reliefs, les formes et les grandeurs, c’est toujours l’effet d’un mouvement simplement possible ; il importe de réfléchir longtemps là-dessus, car c’est de là que dérivent les caractères paradoxaux de l’espace des géomètres, forme de toutes choses, et qui n’a rien d’une chose. Par exemple, ce que je perçois comme relief, ce n’est pas un relief actuel, je veux dire connu par le toucher dans le moment même ; ce sont des signes que je connais et qui me font prévoir ce que je percevrais avec les mains si je les portais en avant. Cela est vrai de toute distance, qui n’est jamais qu’anticipation. Je reviendrai là-dessus. Je veux suivre à présent une réflexion qui sans doute se présente d’elle-même à votre esprit, c’est que tout n’est pas anticipation. Ces signes, comme tels, sont bien donnés actuellement ; ce sont des faits à proprement parler ; et si j’y regarde de près, ce sont des faits de mes yeux, de mes oreilles, de mes mains. Je puis interpréter mal un bourdonnement d’oreilles, mais toujours est-il que je le sens ; quand il ne résulterait que du sang qui circule dans les vaisseaux, toujours est-il que je le sens. Je me trompe sur un relief, mais je sens bien cette lumière et cette ombre ; et quand cette ombre ne viendrait que d’une fatigue de mon œil, il n’en est pas moins vrai que je la sens, comme il est vrai que je sens ces couleurs trompeuses qui suivent les lumières vives ou bien ces formes changeantes et indistinctes dans la nuit noire, si j’ai lu trop longtemps. Il se peut que, par un préjugé, j’interprète mal des pressions sur mes doigts ; mais encore est-il que je les sens. Et si le vin me semble amer parce que j’ai la fièvre, toujours est-il vrai que je sens cette amertume. Il faut toujours qu’il y ait quelque chose de donné actuellement, sur quoi je raisonne, d’après quoi je devine et j’anticipe. Et le mouvement, apparent ou réel, ne serait point perçu sans quelque changement dans les couleurs et les lumières. Rien n’est plus simple ni plus aisément reçu ; je perçois les choses d’après ce que je sens par leur action physique sur mon corps ; et ce premier donné, sans quoi je ne percevrais rien, c’est ce que l’on appelle sensation. Mais cela posé, il reste à faire deux remarques d’importance. D’abord il ne faut pas ici s’égarer dans les chemins des physiologistes, et vouloir entendre par sensation des mouvements physiques produits par les choses dans les organes des sens ou dans le cerveau. Parler ainsi, c’est décrire une perception composée, et en grande partie imaginaire, par laquelle le physiologiste se représente la structure du corps humain et les ripostes aux actions extérieures. Pensez bien à cette méprise si commune quoique assez grossière. Je dois considérer une perception que j’ai, et chercher, par l’élimination de ce qui est appris ou conclu, à déterminer ce qui est seulement présenté. J’arrive par là à ma seconde remarque, c’est qu’il n’est pas si facile de connaître ce qu’est la sensation sans anticipation aucune. Car je puis bien dire, pour la vue, que le donné consiste en des taches de couleur juxtaposées. Mais qui ne voit que c’est encore là une perception simplifiée, dans laquelle je veux rapporter toutes les couleurs à un tableau sans relief, situé à quelque distance de mes yeux ? La pure sensation de couleur est certainement quelque chose de plus simple, et qui ne devrait même pas être sentie dans telle ou telle partie de mon corps, car sentir ainsi, c’est encore percevoir, j’entends connaître des formes, des dimensions et des situations. Il faudrait donc, pour saisir la sensation pure, penser sans penser en quelque sorte. De quoi certains états inexprimables de rêverie, de demi-sommeil, de premier éveil peuvent bien nous rapprocher, de même que les premières impressions d’un aveugle à qui la vue est révélée ; mais justement il ne sait qu’en dire, et il n’en garde pas plus de souvenir que nous n’en gardons de nos premières impressions d’enfant. Ces remarques sont pour écarter cette idéologie grossière, d’après laquelle nos sensations se suivent, se distinguent, s’enchaînent, s’évoquent, comme les faits les plus nets de tous et les mieux circonscrits. Nous aurons à dire qu’un fait est autre chose que ce premier choc et que cette première rencontre de l’objet et du sujet. Il y faudra distinguer la matière et la forme, ainsi que la perception la plus simple nous en avertit déjà.
Il y a un autre chemin bien plus ardu, et à peine exploré, pour distinguer perception et sensation. Il faut alors considérer la qualité et la quantité, et les définir par leurs caractères, ce qui jette aussitôt dans les spéculations les plus difficiles, et c’est une des parties de la Critique de la Raison Pure qui donnent le plus de peine au lecteur. Essayons ici encore de décrire exactement ce que c’est que grandeur et ce que c’est que qualité. Quand la grandeur s’accroît, par exemple quand je tire une ligne ou quand je compte, les parties de la quantité s’ajoutent en restant distinctes. Quand la qualité s’accroît, par exemple quand une lumière devient de plus en plus vive, ce qui s’ajoute à la clarté s’y incorpore sans aucune distinction. On pourrait bien dire que la lumière est changée, que la lumière que j’appelle plus vive est réellement une autre lumière, qu’un bleu plus riche est réellement un autre bleu, une pression plus forte, une autre pression, et ainsi du reste. Pourtant, je suis invinciblement porté à me représenter une lumière s’accroissant, en intensité seulement, depuis la plus faible impression jusqu’à l’éclat qui m’éblouit. Cette grandeur, qui peut ainsi croître et décroître dans le temps seulement, est proprement ce qu’on appelle l’intensité. Mais il semble que ce ne soit pas la qualité pure, et que nous nous aidions ici de la grandeur proprement dite, pour y ranger sous notre regard ces intensités juxtaposées. Dans la sensation pure, il n’y aurait jamais ni accroissement, ni diminution, ni grandeur à proprement parler, mais seulement changement et nouveauté. Chose inexprimable. Mais enfin il est permis de s’en approcher en raffinant sur l’expression, comme beaucoup l’ont tenté, cherchant à décrire les impressions originaires ou données immédiates, telles qu’elles seraient avant toute géométrie. Mais il suffit de définir ici ces recherches subtiles et de prévoir que le langage ne les traduira jamais qu’imparfaitement. L’étude spéciale de la mémoire expliquera mieux, sans doute, qu’il est vain de rechercher la première expérience, ou la première impression. Ces entreprises enferment, semble-t-il, la perception justement la plus audacieuse, et qui interprète le plus.
De l’espace
Peut-être le lecteur commence-t-il à saisir dans son sens plein ce beau mot de représentation, si heureusement employé par quelques bons philosophes. Les choses ne nous sont point présentées, mais nous nous les présentons, ou mieux nous nous les représentons. Dans notre perception, si simple qu’on veuille la prendre, il y a toujours souvenir, reconstitution, résumé d’expériences. Seulement il est utile de distinguer ce qui est jugement parlé, et déjà science, de ce qui est intuition. L’intuitif s’oppose au discursif comme la connaissance immédiate, du moins en apparence, s’oppose à la connaissance que nous formons par recherche, rappel et raisonnement. Or, notre perception est toujours complétée et commentée par des discours, des rapprochements, des conjectures ; par exemple je me dis que cette ligne d’arbres marque telle route, ou que ce triangle sombre est la pointe de tel clocher ; ou encore je me dis que tel ronflement annonce telle voiture automobile ; et l’on pourrait bien croire que ces connaissances sont intuitives au sens vulgaire du mot ; mais il s’agit justement, dans le présent chapitre, de faire apparaître une connaissance intuitive dans le sens le plus rigoureux, c’est-à-dire qui traduit des connaissances, et même très précises, par quelque caractère de la représentation qui nous touche comme une chose.
Je vois cet horizon fort loin. À parler rigoureusement et d’après ce que m’annoncent mes yeux, il est présent par sa couleur aussi bien que le reste, ou non distant si l’on veut ; mais cette distance pourtant me touche comme une chose ; elle est même la vérité de la chose, ce que je puis tirer de cette couleur bleuâtre. Cette distance qui m’apparaît si bien et qui fait même apparaître tout le reste, donnant un sens aux grandeurs, aux formes et aux couleurs, n’est pourtant pas une chose, faites-y bien attention. Cette distance n’est nullement une propriété de cet horizon. Non, mais un rapport de ces choses à d’autres et à moi. Si je veux la connaître, cette distance, en la parcourant, je la supprime ; en un sens j’en aurai bien alors l’expérience quoique toujours par représentation ; mais telle que je la vois maintenant, telle que je crois la sentir maintenant, telle que je la pense maintenant, je la connais, j’en ai toute l’expérience possible. C’est qu’elle est de moi, non des choses ; je la pose, je la trace, je la détermine. Vraie ou fausse, elle est toujours distance, rapport indivisible, non point parcourue en fait, ses parties étant ajoutées les unes aux autres, mais posée toute, et ensuite divisée et parcourue, et donnant d’avance un sens à la division et au parcours.