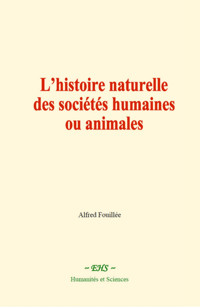Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Les systèmes collectivistes, du moins ceux qui se rattachent au « matérialisme économique et historique », sont trop souvent fondés sur la considération exclusive du travail manuel et du sort des ouvriers. Leur tendance est de négliger ou de rejeter au dernier plan le travail mental et moral. Qui donc a défini le matérialisme économique : la révolte des bras contre la tête ? Cette erreur finit par se répandre en dehors même des collectivistes. N’entendons-nous pas chaque jour classer les professions libérales au nombre des « improductives », souvent par des hommes qui y sont adonnés, parfois même par des littérateurs soudainement enivrés de ce qu’on nomme d’un terme barbare « l’industrialisme ? » Il semble, à les entendre, que les travailleurs d’esprit soient des « parasites ! »…
La loi historique qui veut que la science dans les sociétés humaines devienne de plus en plus dominante, efficace et créatrice est la réfutation du matérialisme économique. Le progrès est menacé par un système qui n’attribue ni à l’effort intellectuel et moral, ni à l’inspiration du génie la part prépondérante. Au rôle de Marthe il sacrifie celui de Marie, comme inutile et « improductif » ; mais nous avons vu que, sans le contemplateur et le chercheur, sans l’homme à idées, quel qu’il soit, le travailleur manuel serait bientôt réduit à l’impuissance : la pensée est supérieure à tous les outils.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alfred Fouillée (1838-1912) est un philosophe français connu pour sa notion d’« idée-force » et son adage juridique « Qui dit contractuel, dit juste ». Agrégé de philosophie en 1864, il enseigne avant de se consacrer pleinement à la recherche. Son œuvre tente de concilier positivisme et idéalisme en insistant sur le rôle actif de l’esprit. Il développe l’idée que la pensée influence la réalité par une action consciente. Son Histoire de la philosophie a été la première du genre publiée au Japon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le travail mental et le collectivisme matérialiste
Le travail mental et le collectivisme matérialiste
Les systèmes collectivistes, du moins ceux qui se rattachent au « matérialisme économique et historique, » sont trop souvent fondés sur la considération exclusive du travail manuel et du sort des ouvriers. Leur tendance est de négliger ou de rejeter au dernier plan le travail mental et moral, de ne pas le reconnaître là où il se cache, de le méconnaître là même où il éclate. Qui donc a défini le matérialisme économique : la révolte des bras contre la tête ? Cette erreur finit par se répandre en dehors même des collectivistes. N’entendons-nous pas chaque jour classer les professions libérales au nombre des « improductives, » souvent par des hommes qui y sont adonnés, parfois même par des littérateurs soudainement enivrés de ce qu’on nomme d’un terme barbare « l’industrialisme ? » Il semble, à les entendre, que les travailleurs d’esprit soient des « parasites ! » Depuis que Rousseau a fait l’éloge du travail manuel, on a vu plus d’un romantique s’éprendre de la menuiserie ou du labourage. George Sand, dans le Compagnon du tour de France, trouvait, chez les travailleurs de la terre, des modèles idylliques. En 1848, bien des bourgeois faisaient apprendre à leurs enfants des métiers manuels. Tolstoï, même de nos jours, en est encore au temps de Rousseau ou de George Sand. Il s’imagine que le remède à tous nos maux, c’est de revenir au travail manuel : labourer la terre, « pétrir soi-même son pain ! » Il ne se demande pas si le vrai sens de l’évolution ne serait pas justement inverse, et si le travail manuel ne doit pas disparaître de plus en plus dans le travail mental.
Les études les plus récentes des économistes nous semblent aboutir, sur ce point, à un certain nombre de lois importantes que nous voudrions dégager. Dans ces lois significatives et révélatrices de l’avenir, si nous savions y lire, nous verrions écrite ou la justification ou la condamnation du collectivisme matérialiste. Recherchons donc la nature et la vraie valeur du travail mental, son rôle par rapport au travail manuel, ses conditions d’exercice et de développement, enfin le but vers lequel il entraîne l’humanité. Le socialisme ouvrier, quand il ne voit que la « question ouvrière » et ne se préoccupe que du labeur des bras, nous apparaîtra peut-être comme un système incomplet, aussi injuste à sa manière que « l’économisme bourgeois. » La vraie question sociale n’a-t-elle pas pour objet le malaise social tout entier, aussi bien celui dont peuvent souffrir bourgeois ou capitalistes que celui dont souffre la « classe ouvrière, » aussi bien celui des travailleurs d’esprit que celui des travailleurs de corps ?
I.
Le travail est l’application de la volonté à une fin qui, pour être atteinte, exige un certain effort, soit du cerveau, soit des muscles, soit des deux à la fois, et qui aboutit à une transformation et utilisation de mouvements. Tout travail est à la fois, mais à doses inégales, nerveux et musculaire ; de plus, le travail nerveux enveloppe toujours un travail du cerveau en même temps que des nerfs proprement dits. Dans le travail manuel, la part des muscles est prédominante, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations délicates exigeant surtout « l’adresse des mains, » par conséquent l’adresse cérébrale. Dans le travail mental, la part du cerveau est prédominante ; les muscles n’ont plus qu’à opérer un effort de fixation et de contention. En revanche, le système nerveux s’use avec rapidité, le cerveau se congestionne par l’afflux du sang. On connaît les expériences de M. Mosso. Il a trouvé moyen de peser la tête d’un même individu travaillant d’esprit, puis se reposant : le poids augmente dans le premier cas. La chaleur augmente aussi dans la tête, les pulsations sont plus rapides et grande est la dépense de matériaux nutritifs. Le maçon qui soulève des pierres et le penseur qui soulève des idées s’épuisent l’un et l’autre, avec cette différence que le penseur, ordinairement, s’épuise davantage. C’est ce qu’il est difficile de faire comprendre au maçon, car il juge tout d’après les efforts visibles. Il ne commence à entrevoir la fatigue des « ouvriers de la pensée » que si on lui impose à résoudre quelque problème sur lequel il use en vain son attention et dont il ne retire qu’un violent « mal de tête ! »
Si l’effort mental intense et continu est, de tous, le plus pénible, c’est qu’il est le moins naturel : le développement intellectuel n’est-il pas une acquisition de l’humanité relativement récente ? L’homme qui pense est, en une certaine mesure, « un animal dépravé. » Voyez quelle difficulté éprouve un enfant à faire attention, surtout quand il s’agit d’idées et, plus encore, d’idées abstraites ! On reconnaît bien qu’il y a là une puissance surajoutée, par cela même délicate et instable. Au contraire, se livrer à un exercice des muscles qui demeure au-dessous des forces, ce n’est nullement épuiser sa santé, c’est l’entretenir. Un tel travail, dit M. Liesse, « fait fonctionner l’organisme et répond à l’usage normal pour lequel cet organisme a été constitué ». Le travail mental, au contraire, est dangereux dans ses résultats, s’il n’est compensé en partie par des exercices musculaires simples, qui activent le fonctionnement de certains organes inutilisés par suite de l’immobilité du corps. Darwin ne pouvait travailler qu’en ménageant avec le plus grand soin ses efforts cérébraux. Il écrivait le matin quelques heures, puis n’occupait plus son esprit pendant tout le reste de la journée, sinon à des distractions peu absorbantes. Il se livrait à un exercice musculaire modéré et faisait notamment de nombreuses promenades. Toutes les fois qu’il voulait enfreindre cette règle, l’effort intellectuel lui causait des vertiges et l’obligeait à de longs repos.
La nature et la valeur du travail mental a toujours été la grande pierre d’achoppement du collectivisme. Marx a fait un effort subtil pour déguiser la difficulté sous les termes les plus ambitieux et les plus obscurs. A l’entendre, le travail mental « n’est qu’un travail qualifié, » ce qui veut dire, sans doute, que l’on y considère la qualité et non plus seulement la quantité de l’effort. Mais alors, que deviendra le « matérialisme économique ? » Pour sauver le système, il faut réduire la qualité intellectuelle du travail à sa quantité matérielle. Qu’à cela ne tienne ! Ce grand alchimiste du collectivisme opérera la transmutation. La qualité du travail mental, dit-il, n’est elle-même « qu’un multiple quantitatif du travail manuel. » Il en résulte que tout « produit, » même une œuvre d’art ou de science, n’est que du travail musculaire multiplié et condensé ou, selon la métaphore de Marx, « congelé. »
Toute réduction de la qualité à la quantité ne serait-elle point le tour de passe-passe d’une dialectique aux abois ? Même au point de vue purement physiologique, il ne serait pas sérieux de soutenir que le travail cérébral soit un simple multiple du travail des bras. Sans doute l’un et l’autre « dépensent du carbone. » Mais le diamant et le charbon « sont aussi tous les deux du carbone ; » ils ne sont pas pour cela équivalents. C’est donc l’effet final qui importe, c’est cette « qualité » qui embarrasse Marx et qui ne peut plus, quoi qu’il en pense, s’estimer avec « l’unité-étalon d’une certaine quantité moyenne de travail musculaire. »