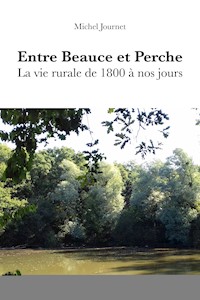
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Michel Journet offre une perspective à la fois personnelle et historique sur les évolutions de l'agriculture.
L’auteur, au- delà du parcours de la famille dans l’entre Beauce et Perche, retrace 2 siècles d’évolution du monde rural par la voie surtout de témoignages. Celui d’un oncle vers la fin du 19 ème siècle sur la vie de son village durant son enfance, suivi de celui d’un charretier amoureux de sa terre racontant sa façon de la travailler. Au 20ème siècle c’est à un paysan, devenu célèbre en ces lieux, de vanter avec humour son ascension vertigineuse ; puis à l’auteur lui-même de conter sa jeunesse passée dans la ferme de ses parents, autour de la grande guerre 1940-45, et décrire la révolution agricole qui suivit. Avant d’apporter sa vision sur le bouleversement de notre monde et les incertitudes sur son devenir.
Dans ce texte hybride entre le témoignage familial et l'essai historique, l'auteur fait part de ses interrogations quant au futur du travail de la terre.
EXTRAIT
En regardant le monde d’aujourd’hui je m’interroge où il va, et tout particulièrement celui de notre France rurale. J’appartiens à une famille terrienne qui a toujours vécu sur le même petit territoire et j’éprouve le besoin de remonter dans le passé des ancêtres d’aller là où mes ancêtres ont vécu et de savoir comment. Puis poursuivre par leurs descendants et de m’intéresser à ceux qui ont travaillé la terre. Ce voyage sera celui de la famille paternelle, il commencera voici 2 siècles à la révolution de 1789 qui vit naître un ancêtre laboureur.
Au-delà de la famille, nous chercherons à retracer l’évolution des façons de vivre dans le monde où ils se trouvaient, et de celles de l’agriculture qui s’y pratiquait. Le film du voyage comprendra une série d’épisodes qui se dérouleront dans l’Entre Beauce et Perche là où la famille a presque toujours vécu.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michel Journet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michel Journet
Entre Beauce et Perche La vie rurale de 1800 à nos jours
Mémoire de famille
PRÉAMBULE
En regardant le monde d’aujourd’hui je m’interroge où il va, et tout particulièrement celui de notre France rurale. J’appartiens à une famille terrienne qui a toujours vécu sur le même petit territoire et j’éprouve le besoin de remonter dans le passé des ancêtres d’aller là où mes ancêtres ont vécu et de savoir comment. Puis poursuivre par leurs descendants et de m’intéresser à ceux qui ont travaillé la terre. Ce voyage sera celui de la famille paternelle, il commencera voici 2 siècles à la révolution de 1789 qui vit naître un ancêtre laboureur.
Au-delà de la famille, nous chercherons à retracer l’évolution des façons de vivre dans le monde où ils se trouvaient, et de celles de l’agriculture qui s’y pratiquait. Le film du voyage comprendra une série d’épisodes qui se dérouleront dans l’Entre Beauce et Perche là où la famille a presque toujours vécu.
Chaque épisode correspondra à une période présentant une certaine continuité. Les principaux évènements seront étayés à l’aide de documents d’archives permettant de les quantifier ; mais l’essentiel viendra de témoignages de la famille, complété par le vécu d’autres acteurs marquants.
Le premier témoignage sera celui d’un ancêtre laboureur qui vécut jusqu’en 1860, le second d’un oncle qui raconte sa jeunesse dans son village avant 1900, le 3e d’un paysan relatant sa vie de paysan entre 1900 à 1970. Et je serai l’auteur du 4e épisode sur mon enfance dans la ferme de mes parents avant et après la dernière guerre 1940-45 ; elle se poursuivra jusqu’à aujourd’hui sur la même ferme exploitée par mon frère puis par son fils.
Nous conclurons en réfléchissant aux grands changements de ce monde rural durant ces 2 siècles, et tenterons d’en tirer des enseignements pour le futur.
LIEUX de VIE
Avant d’entreprendre ce voyage, nous commencerons par décrire les lieux de vie de la famille, ses origines et son parcours. Ces lieux se situent à l’interface des 2 grandes régions composant l’Eure-et-Loir, le Perche à l’ouest et la Beauce à l’est. Elles sont très différentes par le relief les paysages et le type d’agriculture, ainsi que le mode de vie des habitants, qui d’ailleurs en découle. C’est dans la frange de 15 km qui les sépare qu’a pérégriné ma famille dans l’entre Beauce et Perche. Parlons d’abord de la Beauce et du Perche.
La Beauce et le Perche
Le Perche se situe en prolongement de la Normandie alors que la Beauce fait déjà partie du bassin parisien. Dans le Perche vallonné, plus boisé et plus arrosé, c’est le vert qui domine. Dans la Beauce où la plaine sans arbres s’étend à l’infini, c’est la blondeur des céréales qui ondulent sous le vent qui fait sa renommée. Ces deux pays ont inspiré les poètes. Rapportons le portrait attristant qu’ANDRIEUX fait de la Beauce, dans Beauce et Perche vers1925.
Le triste pays que la Beauce,
Car il ne baisse ni ne hausse,
Et de six choses d’un grand prix,
Collines, fontaines, ombrages,
Vendanges, bois et pâturages,
En Beauce il n’en manque que six.
Mais HARDOUIN DUMAZET en fait une description moins sévère.
Une brume légère s’élève des immenses plaines beauceronnes ; le soleil a peine à les percer. La solitude est absolue ; pas un homme, pas un animal dans les champs où se dressent les énormes meules.
Le Perche bénéficie de propos plus flatteurs. BRIANT, professeur au collège de Nogent-le-Rotrou dépeint ainsi sa région.
Ici c’est le velours tendre des pâturages ; là-bas la teinte plus sombre des bois ou des grandes haies qui bordent les chemins ; plus loin le scintillement des ruisseaux sous les ombrages ; partout se répandent des chants d’oiseaux. Ce petit coin de la pâture a un charme infiniment doux qui met de l’enchantement dans les yeux et de l’apaisement dans l’âme.
En ce qui concerne l’agriculture, une étude géographique et historique du début du siècle dernier décrit la Beauce comme le pays par excellence des céréales, et aussi des troupeaux de moutons de race mérinos à la laine réputée. Alors que le Perche était considéré comme celui des pommiers à cidre et des vertes prairies pâturées par les chevaux Percherons, chevaux destinés au labour des terres de Beauce. Et par les vaches laitières normandes pourvoyant ses habitants en beurre et fromages.
L’entre Beauce et Perche de Brou au Thymerais
Ces pays parcourus par ma famille se situent sur un axe sud-nord qui longe à faible distance le parc régional du Perche et ses principaux centres, Nogent-le-Rotrou, Thiron Gardais, Champrond en Gâtine, La Loupe, Senonches. Le relief est moins accidenté que celui des hautes collines boisées du Perche, percées de profondes vallées, son horizon est généralement encore fermé par les bois, le paysage dominant est celui des prés-vergers associés à des cultures de fourrages verts et de céréales propices à l’élevage. Le relief y est suffisant accentué pour que deux rivières y prennent naissance, le Loir au sud où commencera notre voyage, et l’Eure au nord près du Thymerais où il se terminera.
Au sud, les villages de Nonvilliers-Grandhoux et de Corvées-Les-YYs ont déjà fait revivre dans les années 1990 leur passé rural, par un son et lumière dénommé « Entre Perche et Beauce ». Conçu et joué par les habitants, il attira la foule, en faisant revivre durant la première moitié de siècle la vie des habitants. Il utilisa comme cadre une ferme celle du Gravier et comme moyens les outils et les animaux restants encore de ce passé. Au siècle précédent l’histoire de ce pays avait été marquée par la guerre dévastatrice de 1970 et l’incendie de la ville voisine de Châteaudun.
Au nord, Thymert autrefois la capitale du Thymerais connut un passé agité sous Guillaume le Conquérant, son château qu’il occupa vers 1050 fut rasé par Henry I, puis reconstruit sous le nom de Chastel-Neuf sur le site actuel de Châteauneuf en Thymerais. Le Thymerais sera ensuite le siège d’incessantes luttes féodales entre le royaume de France et le duché de Normandie, et aussi d’une bataille sanglante contre les Prussiens à Crécy en 1870. Il appartint un temps au Comté d’Alençon et fit partie intégrante du Perche. De façon moins guerrière ses « Mariettes », petites chapelles dédiées chacune à un saint et situées sur le chemin de Compostelle en font sa réputation. Ainsi que de nombreuses fermes et églises fortifiées pour résister aux envahisseurs.
LA FAMILLE
Sa migration
Je descends d’ancêtres qui ont lentement migré de 1600 à aujourd’hui depuis Dampierre sous Brou au Sud vers Thymert au Nord. Ils se sont prénommés Louis au temps des rois Louis durant les 17 et 18e siècles, puis Michel Jean Michel et Jean Louis Michel de 1750 à 1850. Des vies précaires et incertaines telle celle de Michel né à Mottereau en 1759 qui ne dut son salut qu’à une naissance en été, tous ses frères et sœurs nés en hiver étant morts avant un an ! Plus tard ils irontse fixer à Frazé où sont nés vers 1820 mes arrière-grands-parents Jean-Louis Michel et Jeanne Rosalie. Pour aboutir à Nonvilliers-Grandhoux, là où se sont mariés en 1880 Arsène et Marie Anna mes grands-parents qui donneront naissance à Gabriel, Rose et Marie mon père ? Un siècle plus tard, les conditions n’étaient guère meilleures à la naissance de ma grand-mère Marie Anna l’ainée de 10 enfants. Elle me raconta son enfance misérable aux alentours de la guerre de 1870, ses parents journaliers agricoles durent la placer à 10 ans comme petite bonne dans un café épicerie à Nonvilliers-Grandhoux.
C’est là que commencera avant 1900 le premier grand témoignage de son fils Gabriel, mon oncle ancien instituteur, qui le rédigera sur 3 cahiers d’écoliers que sa fille Mireille m’a transmis. Précédé par celui de Jean Pierre le laboureur.
Autour de Marie Anna et Arsène mes grands-parents
Les frères d’Arsène sont restés dans la région d’Illiers-Combray. Il en fut de même de la branche située au-dessus originaire de Frazé qui s’implantera plus tard à Chartres la capitale de l’Eure-et-Loir. C’est Jacky un cousin de cette branche qui sera le premier à faire notre généalogie du côté paternel.
Marie Anna ma grand-mère est originaire de lieux situés 10 km plus au sud, du côté de Méréglise, « Méséglise » dans le roman « Du côté de chez Swan » de Marcel PROUST. Né dans le hameau de « La Certellerie » sur la commune de Vieuvicq je passerai presque toutes mes vacances scolaires chez cette grand-mère « gâteau », tout comme la tante « Ninnie » pour Marcel Proust. Elle m’apprit de mémoire sa généalogie à partir de 1970, et me confia l’agenda d’un de ses héros, le laboureur Jean Pierre.
La famille de Rose marié à Hélène s’implantera au Chesnay près de Nonvilliers-Grandhoux où ils auront leurs 2 enfants Alfred et Rose Hélène. Y séjourneront aussi Jean le fils d’Alfred et Juliette, ainsi que Paul Monique Françoise et Chantal les enfants de Rose Hélène. Celle de Gabriel marié à Geneviève se fixera à Senonches, dans le Perche 30 km plus au Nord, ils auront 2 enfants Mireille et Éliane, Gabriel y achèvera sa vie comme secrétaire de mairie après avoir occupé un précédent poste d’instituteur à Jouy près de Chartres.
Marie mon père, le cadet, passera sa jeunesse à Nonvilliers-Grandhoux s’y mariera à Élise ma mère, ils viendront d’abord vivre à La Certellerie où Marie Anna était revenue à la retraite dans son pays de naissance. Mes parents y exploiteront une ferme avant de migrer plus tard dans le Thymerais où naîtra mon frère François marié à Jacqueline, ils eurent 3 enfants Agnès Dominique et Florence. Michel, je me suis marié à Christiane, nous aurons trois enfants, Thierry Christian et Valérie, et migrerons à travers la France.
Notre ancêtre, Jean-Pierre le laboureur
Jean Pierre est le premier sur lequel nous disposons d’informations suffisamment documentées. Né avant la révolution de 1789 il connaîtra un itinéraire peu ordinaire, tout en nous racontant peu de choses sur son activité de laboureur, mais davantage sur ses finances, et aussi sur ses relations dans une période historique particulièrement troublée. Puis nous nous attarderons sur ses descendants et surtout sa petite fille Marie Anna ma grand-mère et sur ses frères et sœurs qui la plupart s’éloigneront pour aller chercher fortune ailleurs.
Jean Pierre portait le nom de « Coudray » venant de « coudraie » une cépée de noisetiers abondants dans ce pays.Il naquit sur la commune de Nonvilliers-Grandhoux 14 ans avant la révolution de 1789.
Son livre de compte
J’ai pu reconstituer son histoire grâce à son agenda méticuleusement tenu année après année jusqu’en 1818 que m’a transmis ma grand-mère. Il est fait de feuilles de parchemin maintenant jaunies reliées avec de la ficelle de chanvre et protégées par une couverture épaisse et solide. C’est surtout un livre de comptes sous la forme d’un véritable ouvrage, paginé et comportant une en tête et un sommaire, et rédigé d’une belle écriture à la plume d’oie. Assez inattendu pour un simple laboureur !
Carnet de notes très pragmatique et d’une grande sobriété, presque rien sur sa vie privée, pas même celle de son mariage à la fille du maire de la commune voisine de Vieuvicq l’an 13 de la République (an 2 de l’Empire) ; et la même année que Claude Gournay le maire devenu son beau-père mourut. Rien n’est dit non plus sur les évènements politiques qui ne furent pourtant pas mineurs, la Révolution de 1789 suivie de l’Empire en 1801.
Quelles relations liaient le laboureur et ce maire nouvellement élu par les citoyens de la nouvelle république, et qui signait d’un trait (/) les actes de mairie, tel que j’ai pu le constater sur l’acte de décès de l’épouse de ce dernier signé par lui-même ? Acte rédigé d’une magnifique écriture « ronde » par le secrétaire de mairie formé sous la royauté !
Il est probable que le laboureur et son beau-père étaient tous deux d’ardents révolutionnaires. En revanche les relations ne devaient pas être aussi amicales entre Jean Pierre et son gendre ; en effet ce dernier s’en alla à Paris en sabots défendre auprès de la Convention les intérêts de sa châtelaine menacée d’être guillotinée ! Et il aurait été répliqué à cet audacieux prénommé Louis comme Louis XVI, qu’il ferait mieux de rentrer chez lui s’il voulait éviter le même sort ! C’est ce que ma grand-mère Marie Anna m’a rapporté sur ces ancêtres quelque peu téméraires.
Un laboureur ambitieux
Revenons à Jean Pierre et au contenu de son agenda qui portait sur ses ventes, achats et locations de terres, et peu sur son travail. Ses écrits révèlent une personne ordonnée et économe, mais aussi très soucieuse de ses intérêts. Travailleur qualifié et opportuniste qui semblait bien gagner sa vie, en ce temps où les laboureurs sous la révolution furent sans doute mieux rémunérés, on le devine en comparant son salaire au prix de location de la terre. De sorte qu’il finit par cultiver à son compte et plus tard devenir propriétaire !
Jean Pierre gagnait aussi de l’argent en faisant le banquier auprès de ses voisins, il en prêta même à son frère qui mit d’ailleurs longtemps à le rembourser, sur son agenda il est possible de suivre l’évolution de ses prêts récapitulés année après année pour chaque emprunteur ! L’année de clôture du prêt à son frère, il conclut : on est quitte avec mon frère.
En 1797, Jean Pierre à 22 ans disposait alors d’une petite fermette comprenant four, étable, toit à porcs, cour et jardin. Et en 1801 lorsqu’il quitta le pays de Nonvilliers-Grandhoux pour La Certellerie sur la commune de Vieuvicq il la loua à des voisins pour 40 f par an, puis plus tard à son frère pour 90 F ! À son arrivée à la Certellerie il se loua pour 150 F avec en sus, charbon, viande pain et foin. Le carnet de notes s’arrête en 1817 ; mais en 1827 un bail de location nous apprend que Mr Chabot de la Piboudière lui loue 2 ha 37 ares de terres labourables, 37 ares de pré et 25 ares de pâture. Jean Pierre venait de devenir propriétaire !
Trente années plus tard, soit vers 1860, d’après les archives retrouvées chez ma grand-mère qui descend de Jean Pierre par sa fille, il possédait 12 ha 60 ares de terres soit une surface considérable pour l’époque. Les Archives de Chartres rapportent en effet que 90 % des exploitants cultivaient alors moins de 5 ha de terre et étaient en majorité locataires. À sa retraite il partagea entre sa fille et son fils cet important capital.
L’agenda de Jean Pierre ne nous informe pas des méthodes de culture, mais nous apprenons que les 3 ha loués à Mr Chabot comprenaient 11 parcelles très dispersées d’environ 30 ares par parcelle. Le bail précise aussi ce que le preneur devait au bailleur chaque année : 10 hl ou 40 mesures de « bled froment » bon et loyal, 2 poulets vifs bons et gras et 6 livres de beurre frais à livrer en sa demeure à la localité d’Illiers-Combray. Échéance à Noël pour le « bled froment », et au mois de septembre pour les poulets et le beurre. Rien n’était dit dans ce bail sur les obligations du preneur. D’autres baux font état que le locataire devait marner pour maintenir la fertilité des sols – et laisser pousser des ronces au pied des pommiers afin d’éviter l’écorçage des troncs par les vaches !
Sa fermette à La Certellerie
Jean Pierre devint propriétaire d’une fermette héritée probablement de sa belle-mère et de son beau-père le maire qui décédèrent à 1 an d’intervalle. Et dont ma grand-mère héritera plus tard.
J’allais naître tout près de là et bien connaître cette fermette, j’y suis pris en photo, couché dans un berceau, sous le regard attendri de ma grand-mère. La maison d’habitation était construite en murs de terre et couverte d’un toit de chaume, avec à proximité d’autres bâtiments pour loger un cheval des poules et des lapins, ainsi qu’une étable et un pressoir à cidre. Et au-delà un jardin planté d’arbres fruitiers ainsi qu’un pré et une gentille maisonnette abritant le four à pain. J’en conserve un très bon souvenir, car il allait resservir durant la guerre, on y faisait cuire des « boulots », des pommes recouvertes de pâte à pain. Près de la route qui conduit à Vieuvicq se trouvaient également deux granges qui avaient dû servir à stocker du foin et des gerbes de céréales. Le tout devait occuper plus de 1 ha.
Ce lieu fait partie de mes plus beaux souvenirs d’enfance. Ma cousine Mireille qui y était venue 20 ans plus tôt que moi en fit une description dans son premier mémoire « Je me souviens de mon village en France », témoignant de son attachement comme moi pour ces lieux. Retraçons-en l’histoire, cette fermette Jean Pierre la donna à son fils Wilfrid en 1862 qui la transmis à sa fille Florestine, qui elle la légua ensuite à ma grand-mère en 1891 et y vécut jusqu’à sa mort en 1956. L’histoire de ce lègue mérite d’être conté : ma grand-mère est issue de la fille de Jean Pierre et se trouve donc être la cousine de Florestine qui se maria à Éloi, un agriculteur aisé, le mauvais sort s’acharna sur eux, leurs 2 filles moururent très tôt et leur dernier fils Wilfrid fut tué à la guerre du TONKIN alors qu’il était destiné à reprendre leur ferme.
Je revois encore le portrait des époux Éloi et Florestine situé à l’intérieur de la maison. J’étais impressionné par cet homme coiffé d’une casquette à large lisière et je me suis demandé plus tard si ce n’était pas celle portée à l’armée par leur fils. J’imaginais Wilfrid n’ayant jamais quitté ses champs voguant de port en port avant d’atteindre l’Asie et ses rizières ! Dommage qu’il ne soit pas revenu à la Certellerie pour conter son périple. Je n’aurais certes pas pu vivre d’aussi bons moments dans la maison de ma grand-mère.
Marie Anna ma grand-mère
Ma grand-mère m’avait confié que son arbre généalogique lui avait été raconté de mémoire par Florestine. J’ai découvert par hasard sa transcription au beau milieu de l’agenda de Jean Pierre, et je l’ai ensuite complété à partir d’actes officiels consultés en mairie.
Attardons-nous sur ma grand-mère Marie Anna. Ses parents Louis-Isidore et Léontine eurent 10 enfants dont 2 moururent en bas âge. L’ainé était un garçon Armand et Marie Anna était la deuxième. Elle ne me parla pas beaucoup de son père qui était journalier agricole ni de sa mère qui aurait été souvent souffrante. Elle me parla de sa jeunesse et de ses frayeurs enfantines, à 7 ans elle vit l’arrivée des prussiens coiffés de leurs casques à pointe en 1870, qui persécutèrent les populations de cette région et incendièrent la ville de Châteaudun où de nombreux habitants furent tués.
Elle me raconta sa vie d’écolier qui commença avec le début de l’école publique de Jules Ferry étant née en 1863. Ses parents habitaient un hameau de quelques maisons dénommé La Manoeuvrerie, à 500 m de la Certellerie et à 2 km de son l’école où elle se rendait à pied avec son frère Armand de 3 ans son ainé. Leur grande frayeur sur le chemin de l’école fut une rencontre avec des loups au sortir d’un bois, mais sans dommage. Sa vie d’écolière fut de courte durée, à 10 ans elle la quitta pour un emploi de domestique servant à faire vivre la maisonnée déjà forte de 5 enfants. Elle m’a fait ce récit alors que j’avais 7 ans soit son âge en 1870, et bien sûr il m’impressionnait.
Plus tard, lorsque j’ai préparé le baccalauréat à Chartres je suis souvent revenu la voir pour un week-end, la gare où je descendais était située tout près de La Manoeuvrerie, et je longeais ce petit bois le long de la voie ferrée, gardant le souvenir des loups !
L’exode des enfants
J’ai peu connu les frères et sœurs de ma grand-mère à l’exception des plus jeunes. Ils ont tous quitté cette région où la vie leur était trop difficile, et cherché fortune en ville ce qu’ils trouvèrent d’ailleurs. Les deux garçons Armand et Paul s’en allèrent près de Versailles où ils ont exercé les métiers de meunier et maître-nageur. Des quatre filles, Berthe s’éloigna le moins et posséda un important commerce de produits alimentaires à Senonches où je suis allé la voir avec ma grand-mère, elle était déjà âgée et habitait près de son fils qui avait repris le commerce. Les trois autres migrèrent à Paris, Isabelle fut citée en exemple pour avoir fait fortune à 45 ans sur le marché de fruits et légumes rue Mouffetard dans le 5e arrondissement, Marthe devint chef infirmière ainsi que Blanche la dernière que j’allais fréquenter jusqu’à sa mort à l’âge de 101 ans.
Blanche, ma grande tante
Blanche avait une pièce réservée pour elle chez ma grand-mère où personne n’allait jamais, et où en effet je ne l’ai jamais vu venir. Tout y était propre et bien meublé, avec un vrai lit frontal appliqué au milieu du mur et non pas un lit d’alcôve comme dans les 2 autres pièces, l’un était dans la cuisine où je dormais et l’autre celui de ma grand-mère dans la pièce centrale, où régnait en maître au-dessus de la porte le portrait de Florestine et Éloi, qui donnait sur la chambre de Blanche. Tranchant avec le reste de la maison, joliment agrémentée d’une belle vasque blanche surmontée d’un grand miroir elle m’impressionnait.
Blanche m’a toujours choyé, lorsque je suis devenu étudiant et pensionnaire à Paris elle m’invita souvent pour déjeuner dans son petit logement situé au 2ème étage dans le Vème arrondissement. Je descendais la rue Mouffetard admirant émerveillé son marché où Isabelle avait exercé bien avant ! Je venais du lycée Saint Louis face la Sorbonne où Mireille la fille de Gabriel avait étudié 23 ans plus tôt ! Blanche vint souvent ensuite chez mes parents dans le Thymerais et finit ses jours à l’hospice de Senonches tout près de chez nous, j’y vis encore entouré de ses meubles.
En effet chaque soir assis dans le canapé je regarde la télévision qui loge dans le buffet ancestral de ma grand-mère. J’ai face à moi sa maison de chaume peinte par Arthur le mari de Mireille, et sur le mur de côté, le magnifique portrait d’elle en vraie grandeur peint aussi par Arthur lorsqu’il l’avait connue vers 1925. Et sur l’autre mur 2 autres personnages me sourient un breton et une bretonne en tenues traditionnelles, leurs 2 portraits gravés sur les portes du buffet de Blanche. Après avoir mangé en leur compagnie à Paris 70 ans plus tôt !
Cette grande tante à la haute stature m’a beaucoup impressionné. Vers quarante ans elle avait été infirmière en chef à l’hôpital Cochin durant la guerre 1914-18, je l’ai toujours connue vêtue d’une longue robe blanche comme celles qu’elle devait porter à l’hôpital. Elle resta célibataire, fréquentant toujours un ami autrefois chirurgien à ce même hôpital. Sa vie, ses repas, ses déplacements étaient toujours réglés avec la même précision ; ce qui ne l’empêchait pas d’être très attentionnée, elle s’occupa d’un de ses frères dans le besoin et adopta une jeune fille que j’ai bien connue. Elle fut presque la seule de la famille à recevoir Mireille sa petite nièce émigrée aux USA lorsqu’elle venait en France. Mireille je l’ai ratée de peu un jour chez Tante Blanche vers 1953, elle venait de sortir de chez Blanche avec toujours son chapeau m’a-t-elle dit. Dommage ! Notre rencontre aura bien lieu, mais 50 ans plus tard au Nouveau-Mexique !
Âgée, Blanche conserva son dynamisme et son habitude du commandement. Pensionnaire à l’hospice de Senonches elle renoua avec ses fonctions d’infirmière, ordonnant la préparation des repas, et ensevelissant les personnes décédées avant d’y mourir à 101 ans.
ÉPISODE I : de 1800 à 1900
Nous retracerons d’abord l’histoire de l’agriculture et du monde rural en nous appuyant sur un rapport du professeur Jean Claude FARCY rédigé à partir de documents des archives départementales d’Eure-et-Loir, qui sera suivi du témoignage de mon oncle Gabriel nous racontant la vie dans son village durant son enfance.
L’agriculture
Durant tout ce siècle, l’agriculture va connaître une révolution, que l’abolition de la Monarchie et la déchéance de la noblesse lors de la Révolution de 1789 ont permise. Quels en furent les moteurs et en quoi a-t-elle consisté ?
Les animaux de trait
Avant la Révolution le sol était encore retourné à la bêche, seules les grandes propriétés disposaient de charrues tractées par des ânes, et les terres servaient souvent de terrains de chasse à la noblesse. Puis les vaches commencèrent à être utilisées servant à la fois à produire du lait, tirer des charrois et labourer les champs. Ensuite suivront les bœufs venus d’Auvergne bien plus puissants, puis les chevaux alliant force et allure qui deviendront dominants à la fin du siècle. Le remplacement de l’énergie humaine par l’énergie animale allait tout changer.
Dans notre région de l’Entre Beauce et Perche les héros seront les chevaux percherons élevés dans le Perche pour cultiver les terres en Beauce, enfant j’ai pu encore les admirer jusqu’à leur déclin. Mon futur beau-père faisait 80 km à pied pour aller chercher des antenais de 2 ans, les ramener à la ferme et les dresser aux travaux des champs, c’était un renommé meneur de chevaux. Ce commerce renouvelé chaque année dans le même lieu aboutissait à des échanges amicaux accompagnés de repas bien arrosés d’eau-de-vie ou « goutte ». Vous prendrez bien une goutte !
Les engins de récolte et de battage
La récolte des céréales allait beaucoup évoluer au cours du siècle, avec le passage de la faucille à la faux sous le Premier Empire, et de la faux à la moissonneuse lieuse à la fin du siècle. Tout comme pour le battage avec le passage du fléau du « batteux » à la trépigneuse actionnée par un cheval, lequel en marchant sur un fond mouvant incliné actionnait les rouages servant à battre et séparer la paille du grain. Puis le passage à la batteuse mécanique qui à ses débuts était aussi actionnée par un cheval faisant tourner un manège. Et enfin l’arrivée de la locomobile à vapeur actionnant la batteuse et la presse à ballots de paille vers 1870, chauffée d’abord au bois puis au charbon.
Avant et après la Jachère
La jachère consistait à laisser la terre se reposer nue 1 année sur 3. Elle était suivie la 2e année d’un blé (bled froment) ou d’un seigle ou d’un méteil (blé + seigle), et la 3e année par de l’orge ou de l’avoine destinée aux moutons et aux vaches.
Avec la fin de la jachère ce fut l’assolement triennal, la sole nue alors improductive fut ensemencée avec des plantes fourragères destinées aux animaux herbivores, luzerne, sainfoin, pois ou vesce, puis ensuite d’autres plantes comme les betteraves et pommes de terre. Les plantes fourragères à base de légumineuse ont permis de fertiliser en azote les céréales ensemencées à leur suite, en étant capables de fixer l’azote de l’atmosphère. Cette fertilisation a été complétée par celle des déjections animales des bovins et ovins et aussi des porcs et des volailles. De plus les plantes sarclées, betteraves et pommes de terre, ont permis de nettoyer le sol des mauvaises herbes lors des binages ou au moment de leur arrachage.
Cette véritable révolution de la façon de cultiver allait permettre de multiplier le rendement des céréales par près de 3 au cours du siècle, sans aucun apport d’engrais chimique !
La richesse venue des animaux
La fin de la jachère et l’avènement d’un assolement triennal bien plus productif ont pu se faire grâce à la sole fourragère destinée aux herbivores. Et ces derniers allaient être aussi une source considérable de prospérité pour l’agriculture grâce à la vente de leurs produits, la laine la viande et lait.
La laine
La production de laine fut la première à se développer grâce au croisement de brebis de race beauceronne avec des béliers de race Mérinos venus d’Espagne, un texte de l’an dix parle en ces termes de l’élevage du mouton en Beauce et Perche « Le mouton beauceron est haut monté, d’une gosse stature et pèse de 80 à 90 livres ; il est tondu dans le mois de juin, sa laine est rude longue et épaisse, la toison en suint pèse communément 5 à 6 livres. Dans le perche, l’espèce est plus petite les toisons moins pesantes, mais la laine est plus fine, la toison ne pèse que 3 livres. On a croisé dans le département les races du pays avec des béliers espagnols. Depuis 5 ans ces troupeaux ont prospéré et le département d’Eure-et-Loir pourra bientôt contribuer de manière sensible à affranchir nos manufactures du tribut qu’elles paient à l’étranger ».
La prospérité du mouton mérinos allait durer jusqu’au milieu du siècle pour atteindre 1 million de moutons. Ensuite la concurrence de l’élevage extensif australien allait ruiner cet élevage suite à un prix de la laine divisé par 5. Mais l’élevage de moutons allait évoluer vers la production d’agneaux gras vendus au marché de la Villette, jusqu’à 100 000 par an. De sorte qu’avec un effectif moindre l’élevage de mouton est devenu aussi profitable qu’auparavant.
La viande et le lait
La production bovine connut aussi un développement important. En 1825 le rapport du président de la société d’agriculture de Chartres fait état de la situation dans la Beauce et le Perche : en Beauce s’est développée une population bovine de grande taille en vue de la production de veaux gras à destination de la région parisienne, alors que les vaches se limitent à 4 ou 5 par exploitation, destinées à nourrir le personnel et les gens du village. Dans le Perche c’est la situation inverse, les troupeaux de 10-15 vaches prospèrent pour nourrir une population locale grosse consommatrice de beurre et fromage faits à la ferme, ainsi que de pommes à couteau et de pommes à cidre venant des prés et vergers où pâturent les vaches. Il en est de même dans l’entre Beauce et Perche et notamment dans le Thymerais où le pommier figure comme production dominante.
Le monde rural





























