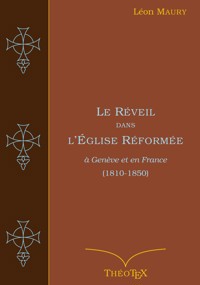2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Si aujourd'hui une majorité d'hommes politiques refusent de reconnaître les racines chrétiennes de la civilisation européenne, ils souscriraient d'autant moins à la thèse de Léon Maury (1863-1931) sur l'origine de l'idée de progrès. De son temps, qui voyait le triomphe des sciences appliquées et l'apparition des grandes théories sociales, la question du progrès passionnait les milieux pensants. Aussi dans une première partie le pasteur Maury se penche sur les écrits des philosophes de l'antiquité : il n'y trouve que tristesse et regret d'un mythique âge d'or ; le concept d'une amélioration morale et sociale de l'humanité en est absent. Secondement il prouve que c'est en réalité de l'Ancien et du Nouveau Testament que sort l'idée d'une marche ascendante de l'humanité, vers un but glorieux situé à la fin de l'Histoire. Dans la troisième partie l'auteur examine comment, sous l'influence des philosophies anti-chrétiennes modernes, la vraie aspiration au progrès était peu à peu remplacée par le dogme laïque d'une évolution fatale. A l'opposé du progrès chrétien, par nature optimiste, l'évolution aveugle et athée ne peut que nourrir un noir pessimisme quant au futur de l'humanité. Un siècle et demi après, la thèse de Maury n'a pas besoin d'être changée sur ce point. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1890.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322484096
Auteur Léon Maury. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]La question du progrès a été une des préoccupations du xixe siècle. Etendue par les uns, réduite par d'autres, rajeunie, transformée, l'idée a agité bien des esprits, le mot a été dans bien des bouches.
« En Allemagne, dès le commencement du siècle, Schelling et Hegel élèvent la doctrine du progrès à la hauteur d'un principe métaphysique. En France, à l'exemple de la philosophie allemande, mais avec une vigueur de composition et un éclat de parole qui n'ont point été égalés dans ces matières, M. Cousin esquisse à grands traits une théorie du progrès qu'il éclaire et démontre par une rapide excursion dans l'histoire universelle. Après lui, ou à côté, des esprits ingénieux ou puissants, St Simon, Comte, Leroux, Lamennais, Reynaud approfondissent ou développent la même thèse, chacun avec la méthode qui lui est propre : les uns en l'appuyant sur le principe de la tradition habilement consultée, d'autres en la déduisant rigoureusement de leur métaphysique, d'autres enfin en s'aidant des lumières de la science positive. Après ces hautes spéculations, les historiens reprennent la thèse du progrès ; les uns, comme M. Michelet, en l'appliquant à l'histoire universelle ; les autres, comme M. Guizot, en l'appliquant à une partie considérable de cette histoire ; d'autres enfin, comme MM. Thierry, Mignet, Henri Martin, en l'appliquant à l'histoire d'un grand pays, soit la France, soit l'Angleterre, soit l'Allemagne. Tous, sur des exemples différents, s'attachent à la démonstration historique de la même loi.
Et pendant que les philosophes et les historiens cherchent cette loi du progrès dans le monde moral, voici les savants qui la trouvent, eux aussi, dans le monde physique, à travers les lentes évolutions de la nature. L'astronomie, la géologie, la paléontologie sont d'accord pour attester l'universelle transformation des mondes ou des planètes qu'elles étudient dans le sens d'un progrès incessant. En sorte que la science entière concourt aujourd'hui à la démonstration éclatante de cette grande vérité… Et de la science la doctrine a passé dans la littérature : la poésie la célèbre et le roman l'explique. Béranger, Victor Hugo, M. de Lamartine lui-même dans ses jours d'espérance, s'en inspirent dans leurs vers, et George Sand en fait la philosophie de ses plus sérieux romans »a.
Soit que cette impulsion venue d'en haut se soit transmise à toutes les parties du corps social, soit par une simple coïncidence, le progrès devient une de ces idoles du forum, dont parle Bacon. Des théories nouvelles s'intitulent volontiers avancées, progressistes, et il se fait du mot progrès un extraordinaire abus. Quelques-uns (Pierre Leroux, M. About et d'autres encore) l'écrivent avec une majuscule ; d'autres, plus utilitaires, en décorent l'enseigne de leur boutique, et ce terme magique doit provoquer invinciblement la confiance du client et apporter à la caisse un appoint considérable, si l'on en juge par le nombre d'industriels qui se placent sous son patronage. « Nom sublime et profané, redoutable et fascinateur, doué d'un singulier prestige et d'une force d'entraînement presque irrésistible, le progrès est l'invocation suprême des sectes et des partis, le mot d'ordre de toutes les batailles d'idées ou de rues. Il a été le ferment des. plus nobles passions ; il est la parure et l'excuse des plus mauvaises : on le voit également proclamé par les héros ou les martyrs et par des charlatans sinistres dont la carrière est d'exploiter la sottise humaineb. »
Quelle que soit la forme sous laquelle se manifeste cette confiance ou même ce fétichisme d'un nouveau genre, il est certain qu'il y a là un mouvement d'opinion qui ne peut être méconnu.
A y regarder de près, la question du progrès n'est autre que celle de notre destinée, du pourquoi et du comment de l'existence : le rôle de l'humanité sur la terre, sa marche, ses conquêtes, son but, la clé de l'énigme du monde, etc., il y a là un ensemble de recherches qui touchent à la plus haute métaphysique et qui ne sont pas, d'ailleurs, sans offrir quelque intérêt, malgré le discrédit que cette infortunée science a encouru.
Et d'autre part, quand on songe à cette menue monnaie du progrès, au vulgaire sans façon avec lequel on exploite cette grande idée, ou aux criminelles entreprises qu'on couvre de son nom, il paraît vraiment bien utile et désirable d'éclairer ceux qu'on enrôle ainsi sans qu'ils s'en rendent eux-mêmes bien compte, entraînés qu'ils sont par de pompeuses déclarations et de fallacieuses promesses. Leur montrer ce qu'il y a sous les mots et au fond des choses, ce qu'est la vraie théorie du progrès, substituer à l'illusion dont ils s'enchantent eux-mêmes un but véritablement accessible et indiquer les moyens de le réaliser, leur épargner ainsi les déceptions et les découragements inévitables qui ont pour triste mais certaine conséquence d'affaiblir la foi au progrès, voilà autant de résultats pratiques et immédiats de la spéculation, lesquels ne semblent pas davantage à dédaigner.
Pour considérer la question sous ces deux faces et atteindre ce double but, nous nous proposons de rechercher l'origine de l'idée du progrès.
Cette idée en effet a eu son histoire, et pour avoir le vrai sens d'une idée comme d'un mot, il faut aller à son étymologie.
L'étymologie du mot lui-même, progressus, nous indique son acception incontestée : c'est une marche en avant : ce mot est « comme une sorte de nom propre par lequel on désigne la marche de la société du genre humain pris en masse vers un degré de plus en plus élevé de perfection et de bonheur, vers un développement de plus en plus complet de toutes ses facultés, vers une amélioration indéfinie de ses œuvresc. » Or, ce développement peut être envisagé à un triple point de vue : le progrès scientifique ou intellectuel, le progrès moral, le progrès social.
Nous laisserons de côté la première de ces manifestations : l'idée du progrès scientifique est aussi ancienne que la science elle-même : nous aurons l'occasion de le constater incidemment au cours de cette étude. Le fait est acquis.
En est-il de même de l'idée du progrès moral et social ? La question n'est point si définitivement tranchée ; les avis sont divers : d'une part, on ferait volontiers remonter cette idée jusqu'aux systèmes philosophiques ou aux croyances religieuses de l'antiquité gréco-romaine ; de l'autre, on la trouverait seulement dans les idées chrétiennes ; une troisième solution en verrait les premières traces dans des auteurs du XVIe siècle.
Etudier successivement ces trois opinions, voilà ce que nous nous proposons de faire dans les pages qui suivent : heureux serons-nous si en apportant quelque lumière dans la théorie, qui est la Vérité, nous pouvons produire aussi quelque force dans la pratique, qui est la Vie.
Ouvrages consultés : Decharme : Mythologie. — Preller : Grieschische mythologie. Römische mythologie. — Alf. Maury : Histoire des religions de la Grèce antique. — Renouvier : Manuel de la philosophie ancienne. — Girard : Le sentiment religieux en Grèce, d'Homère à Eschyle. — Franck : Dictionnaire des sciences philosophiques. — Zeller : Philosophie des Grecs. — Fouillée : Histoire de la philosophie. — Encyclopédie moderne, article âge. — Encyclopédie duxixesiècle, article progrès. — Laurent : Histoire du droit des gens. — Hippolyte Rigault : Histoire de la querelle des anciens et des modernes. — Javary : De l'idée du progrès. — Ritter : Histoire de la philosophie ancienne. — Hild : Trois articles de la Revue de l'histoire des religions sur Le pessimisme moral et religieux chez Homère et chez Hésiode, 1886. sept. oct. ; 1887, Janvier-Février ; 1888, mars-avril, etc., etc.
Ce qui nous frappe dès l'abord dans le paganisme, c'est une conception pessimiste de la destinée humaine. C'est à tort que l'on croit trouver dans l'hellénisme l'activité exubérante, la joie de vivre pour soi sans regrets stériles sur les conditions de la vie, et le bonheur de se survivre dans des générations nouvelles, à qui l'existence est transmise, non comme un don funeste, mais comme un bienfait. Un critiqued dit, en parlant de la civilisation homérique : « Ce monde où tout est bruit et éclat, où tout a un air de fête, jusqu'à la mort même », et un autre critique ajoute : « Tout y a un air de force ; mais de fête, c'est une autre affairee. »
Le pessimisme n'est point en effet un mal tout moderne ; il y a eu de tout temps des pessimistes ; il y a un pessimisme contemporain de l'humanité. Dans toutes les races, dans toutes les civilisations, des imaginations puissantes ont été frappées de ce qu'il y a d'incomplet, de tragique dans la destinée humaine et elles ont donné à ce sentiment l'expression la plus touchante et la plus pathétique. Les théoriciens modernes du pessimisme ne se sont pas privés de puiser à ces sources lointaines pour les besoins de leur cause. Ainsi les œuvres de Schopenhauer sont semées de citations empruntées à toutes les littératures, et Léopardi aime à rattacher aux fables mythologiques ses fantaisies sur le malheur universel.
Le sentiment de la misère actuelle de l'humanité se manifeste dans la plus ancienne poésie des Grecs par la façon dont elle conçoit ses origines et sa condition passée. Les dieux et les hommes sont sortis de la même souche, et il fut un temps où leur existence était la même. Elle s'écoulait en commun, au sein de jouissances sans mélange, les hommes étant les égaux, ou tout au moins les commensaux des dieux. Mais maintenant l'humanité est déchue de cette félicité primitive.
Hésiode a dramatisé l'idée de cette décadence dans le mythe des âges. Ce mythe faisait probablement partie des traditions les plus populaires, car on le trouve à toutes les époques de l'histoire littéraire de l'antiquité.
Indiquons-en les principaux traits, tels que nous les relevons chez Hésiode : ce seront à peu près les mêmes qui se retrouveront dans les traditions analogues : « D'abord les immortels habitants des demeures olympiennes firent d'or la race des hommes à la voix articulée. Ces premiers hommes existaient sous l'empire de Saturne, quand il régnait dans le ciel : ils vivaient comme des dieux, l'âme exempte de soucis, étrangers aux fatigues et au chagrin : la triste vieillesse ne les approchait pas : mais les pieds et les mains toujours semblables, ils goûtaient la joie des festins hors de l'atteinte de tous les maux ; ils mouraient comme vaincus par le sommeil. Ils étaient en possession de tous les biens : la terre féconde produisait d'elle-même des fruits en quantité, et eux, tranquilles et sans contrainte, en jouissaient dans l'abondance et la félicitéf. »
L'âge d'argent lui succède : la décadence commence à se faire sentir : les chagrins, la douleur, l'impiété même se font jour peu à peu.
La description de l'âge suivant, qui fut l'âge d'airain, a été probablement empruntée à un autre mythe ; car, si dans la contexture du poème elle paraît intimement liée aux descriptions qui la précèdent, elle renferme toutefois une idée nouvelle, celle de la naissance de la civilisation : les hommes vivaient d'abord à l'état sauvage, insociables ; c'était la race des géants, et Zeus régnait sur eux ; au contraire dans les vers qui dépeignent l'âge d'or, cet âge est placé sous la domination de Saturne (Cronos). A l'âge d'airain a succédé l'âge des héros, dont la gloire s'est répandue sur toute la terre et qui ont accompli les premières merveilles du génie de l'homme. Ces deux époques semblent donc être des âges intermédiaires appartenant à l'histoire de l'origine des sociétés et dont la description a été intercalée soit par Hésiode, soit par un commentateur quelconque dans le récit primitifg.
Avec le cinquième et dernier âge nous revenons, en effet, à l'idée de la décadence. « Jamais, ni le jour ni la nuit les hommes ne cesseront d'être minés par la fatigue et par le chagrin ; les dieux leur prodigueront les inquiétudes pénibles… Ni le père ne s'accordera avec les enfants, ni les enfants avec le père, ni l'hôte avec l'hôte, ni le compagnon avec le compagnon, ni les frères ne s'aimeront d'une affection durable. Ils se hâteront d'outrager leurs parents vieillissants : ils leur adresseront des paroles dures et insultantes ; impies, sans souci de la vengeance des dieux, incapables de rendre à la vieillesse de leurs parents les soins qu'a reçus leur propre enfance, ils ne connaîtront que le droit de la force ; par un échange de violences ils saccageront leurs villes. Ni le serment, ni la justice, ni le bien n'obtiendront plus d'honneur ; tous les hommages seront pour la méchanceté et pour la violence ; la brutalité remplacera le droit, la pudeur n'existera plus ; le mauvais opprimera le bon par son langage faux et par ses injures ; ces hommes misérables auront tous pour compagnon assidu l'Envie à la voix discordante, au visage repoussant, qui ne connaît que la joie du mal. Alors promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la Pudeur et Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers les célestes tribus et laisseront les humains ; il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants et leurs maux seront irrémédiablesh. »
Ce mythe se retrouve chez un grand nombre de poètes, avec quelques modifications de peu d'importance. Le nombre des âges est généralement réduit à quatre, et ces quatre âges reçoivent le nom des quatre métaux : l'or, l'argent, l'airain et le fer. La suppression de l'âge héroïque s'explique d'autant mieux, que chez Hésiode sa description appartenait vraisemblablement, comme nous l'avons remarqué, à une autre tradition.
La cosmogonie orphique reprit la fable en y introduisant quelques légères différences. Platon, qui est un véritable poète quand il se laisse aller à raconter les vieilles traditions, ne rejette pas celle-là et rappelle dans le Politique l'antique légende du règne de Cronos, alors que le bonheur était le lot des humains et qu'ils vivaient du fruit de la terre féconde, sans souffrance et sans chagrin.
C'était aussi une entrée en matière facile pour qui entreprenait l'histoire des temps héroïques. Dicéarque, historien grec, qui vivait vers l'an 300 avant Jésus-Christ, et dont Cicéron dit qu'il fait ses délices, commence ses récits par la légende de l'âge d'ori.
Aratus (iiie siècle avant notre ère), dont le poème, les Phénomènes, a été imité en vers latins par Cicéron, raconte un mythe analogue, le mythe de la vierge Astrée, dont le règne sur la terre avait été signalé par une félicité et une vertu exceptionnelles : malheureusement la décadence ne tarda pas à survenir, et la céleste reine quitta la terre coupable en lui jetant cette malédiction : « Race dégénérée, tu auras des descendants qui sans cesse dégénéreront aussij. »
Enfin, l'historien Pausanias, décrivant l'époque de Lycaon, dit que « les hommes de ce temps étaient, à cause de leur justice et de leur piété, les hôtes et les commensaux des dieux : c'est pourquoi les dieux les récompensaient promptement lorsqu'ils étaient vertueux, et les punissaient de même lorsqu'ils commettaient quelque crime. Mais aujourd'hui que la méchanceté est portée à l'excès et a gagné toutes les villes et tous les pays, on ne voit plus d'hommes placés au rang des dieux, si ce n'est par de vaines apothéoses qu'invente la flatterie pour celui qui a l'autorité, et la vengeance divine plus lente et plus tardive n'atteint les méchants que lorsqu'ils ont quitté la vie. »
A Rome, Virgile fait les mêmes peintures : « Avant le règne de Jupiter on ne cultivait point la terre. Il n'était pas même permis de partager les champs ni d'en fixer les limites. Les campagnes et les moissons, tout était commun. La terre, sans être cultivée, fournissait d'elle-même à tous les besoins de ses habitants. Jupiter arma les serpents d'un poison funeste ; il voulut que les loups vécussent de rapines, et que les hommes avides affrontassent les dangers de la navigation. Ce Dieu secoua le miel qui était sur les feuilles des arbres. Il déroba le feu aux regards des mortels ; il fit tarir les ruisseaux de vin qui coulaient dans les vallons. Il voulut que l'expérience et la réflexion enfantassent les arts ; que le seul travail des hommes fit sortir le froment des entrailles de la terre et qu'ils tirassent le feu du sein des caillouxk. »
Ailleurs de même : « Telle fut la vie qu'on mena sous le règne de Saturne, avant que Jupiter l'eût détrôné et que la race impie des mortels se fut accoutumée à se nourrir de la chair des animaux. La trompette guerrière ne s'était point encore fait entendre, et l'enclume qui forge les épées, n'avait point encore retenti sous les coups du marteaul. »
Enfin, Virgile rappelle encore cette légende dans le discours d'Evandre à Enée, où l'on retrouve de nombreux souvenirs de la tradition hésiodique, par exemple, l'idée que les hommes sont nés des arbres. Cette description semble d'ailleurs être empruntée au mythe de la naissance des sociétés plutôt qu'à celui de l'âge d'or proprement dit : le poète représente les hommes comme sauvages, durs « comme les chênes d'où ils sont sortis, » ignorant l'art de cultiver la terre et ne vivant que de leur chasse. Mais alors, chose singulière, Virgile place l'âge d'or après la déchéance de Saturne : « Saturne détrôné par son fils Jupiter, pour se dérober à sa poursuite, s'enfuit de l'Olympe et vint se réfugier en ces lieux. Il rassembla les hommes sauvages, épars sur nos montagnes : il leur donna des lois, et voulut qu'un pays où il s'était caché et qui avait été pour lui un sûr asile, portât le nom de Latium. On dit que son règne fut l'âge d'or, ses paisibles sujets étant gouvernés avec douceur. Mais cet âge dégénéra insensiblement et les hommes s'abandonnèrent à la fureur des combats et à la soif des richessesm » Il s'agit ici évidemment d'un âge d'or particulier, qui ne favorisa que le Latium, et qui ne fut une époque privilégiée que grâce à la présence de Saturne. D'ailleurs sa durée fut courte, et le Latium se mit promptement à l'unisson du reste du monde.
Ovide, l'Hésiode italien, ne devait pas passer sous silence ce mythe : il en fait une très longue et très complète descriptionn, et élève à quatre le nombre des âges que Virgile semble réduire à deux.
Horace n'admet que trois âges : après avoir fait le tableau des Îles Fortunées où il engage les Romains à se rendre, il ajoute : « Jupiter réserva ces rivages à un peuple innocent quand l'airain souilla les jours de l'âge d'or : le fer plus dur encore vient peser sur notre âge : mais une fuite heureuse est offerte aux mortels pieux ; qu'ils partent sur la foi de mes chantso ! » Tibulle (Élégies), Catulle (Les noces de Thétis et de Pélée), Claudien (De l'enlèvement de Proserpine), Cornelius Severus (Ætna), Sénèque le Tragique (Hippolyte, Octavie, Médée) retracent avec complaisance le bonheur des mortels sous le règne de Saturne et se lamentent sur leur misère actuelle.
Cicéron remarque la prédilection des poètes à traiter ce sujet : « Dans l'âge d'or, comme disent les poètes, on n'a jamais porté une main violente sur ces animaux (les bœufs), qui fendaient la terre avec le soc de la charrue », et il cite alors trois vers du poème d'Aratus : « Mais bientôt naquit la race de fer, qui eut la première l'audace de forger une funeste épée, et de se nourrir du taureau qu'elle égorgea de sa main ». (Phénomènes, v. 130 et suiv.)p.
Quelque grand crédit qu'eût ce mythe, il ne l'avait cependant qu'auprès des poètes et du vulgaire. La philosophie voulut quelque chose de plus complet, une sorte de synthèse générale qui pût donner une explication satisfaisante du monde dans le passé, le présent et l'avenir. La fiction des quatre âges laisse en définitive l'esprit en face d'une question fort malaisée à résoudre : une fois qu'on aura atteint le fond de l'abîme où le monde se précipite, que se passera-t-il ?
C'est pour répondre à cette question que la philosophie imagina la théorie de la grande année : Au bout d'un certain nombre de siècles, disait-elle, à un moment précis marqué par le destin, l'univers entier sera détruit, puis reconstruit, et toutes choses reviendront au point où elles étaient au début de la période actuelle.
La croyance générale était que le cycle se terminait lorsque les astres se retrouvaient dans le signe même qu'ils occupaient lorsque le cycle avait commencé. Certains philosophes fixaient un chiffre approximatif, plus ou moins différent : par exemple, Julius Firmicus Maternus (écrivain latin du ive siècle de notre ère), estimait à 300 000 ans la durée de cette période après laquelle devait arriver une apocatastase, ou renaissance universelle.
Orphée, ou plutôt l'auteur anonyme qui a emprunté le nom du chantre de Thrace, assigne à cette révolution un délai plus court.
Lycophron la porte au contraire à 360 000 ans.
Cicéron dit que la valeur de cette grande année, cherchée par les mathématiciens et les astronomes, était une question longuement controverséeq.
Servius déclare que Cicéron et les savants ont varié sur cette durée ; malheureusement il fait allusion à un texte de La Nature des dieux, qui n'a pu être retrouvé.
Dans le dialogue Des causes de la corruption de l'éloquence, attribué par les uns à Cicéron, par les autres à Tacite ou à Quintilien, la grande année était estimée à 12 854 ans.
Pline l'Ancien dit que « selon Manilius la révolution de la grande année se rapporte à la vie du phénix, et lorsqu'elle s'achève, les saisons et signes se retrouvent au même point. Il fixe l'époque de ce renouvellement au jour où le soleil entre dans le signe du bélier, à midir ». Le phénix vivant, d'après Manilius, 560 ans, telle est la durée de la grande année. Macrobe donne à cette période 15 000 ans. On peut d'ailleurs voir le détail de ces approximations dans Censorinuss.
L'idée elle-même apparaît tout d'abord chez Héraclite ; le terme du développement cosmique auquel tout aspire est la conversion de toutes choses en feu, ce qui n'est d'ailleurs qu'un retour au principe de leur existence, de leur force et de leur vie. Mais cet embrasement universel ne doit pas être considéré comme le terme dernier de tout ce qui est (parce qu'il y aurait, par le fait, un terme au flux éternel des choses), mais seulement comme un point de transition à la formation d'un nouveau mondet.
Indiquons, en passant, comme appartenant au même courant d'idées, la théorie d'Anaximandre sur la décomposition et la recomposition de l'univers, et celle d'Anaxagore sur les différentes périodes de la formation du mondeu.
Si nous en croyons Ovide, les pythagoriciens auraient professé des doctrines analogues à celle de la grande année. Le témoignage de Plutarque confirme cette opinion, et M. Zeller pense que quelques pythagoriciens ont adopté cette cosmogonie, mais il hésite à l'attribuer à l'école entière.
[Le pythagoricien Ocellus Lucanus affirme que « tout ce qui appartient à ce monde est mobile et changeant : les sociétés naissent, croissent et meurent comme les hommes, pour être remplacées par d'autres sociétés, comme nous le serons par d'autres hommes ». (Cité par de Ferron : Théorie du Progrès. Tome II, p. 52.)]
C'est surtout Platon qui a donné à cette théorie tout son développement. Dans le Timée,