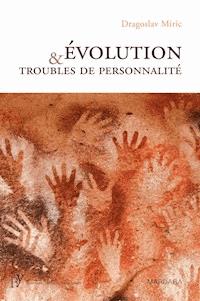
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les théories évolutionnistes peuvent-elles expliquer certaines pathologies de la personnalité ?
L’homme a besoin d’explications. Y compris sur ses propres comportements. Dans les pays occidentaux, les troubles de la personnalité touchent environ une personne sur dix. Pourquoi ces troubles, qui sont pour moitié sous influence génétique, ont-ils persisté dans le temps et n’ont pas été éliminés au cours de l’évolution humaine ? Y aurait-il eu, dans un lointain passé, un bénéfice pour les individus ou plus largement pour les groupes à maintenir ces troubles ? Et si oui, lesquels ?
Dans ce livre, l’auteur apporte des éléments de réponses à ces questions en se basant sur la psychiatrie évolutionniste, discipline nouvelle qui tente d’intégrer la dimension évolutionniste dans la compréhension de la maladie mentale. Mais il va au-delà de cette discipline en cherchant une explication au niveau du groupe et pas seulement de l’individu. Inenvisageable il y a encore une quinzaine d’années, la sélection naturelle au niveau du groupe est désormais reconnue comme un des moteurs possibles de l’évolution. Ainsi, selon l’auteur, les individus atteints par ce qu’on considère aujourd’hui comme un trouble de personnalité auraient joué un rôle déterminant dans la structuration des groupes d’Homo sapiens. Par exemple, la personnalité dépendante – ce besoin d’être pris en charge par les autres – aurait permis le maintien d’une forme d’altruisme non « institutionnalisé » par la société et indispensable à la survie des groupes. Ou encore la personnalité schizotypique, avec ses visions et hallucinations, aurait facilité la compréhension de l’« autre monde », permettant d’éviter à chaque membre du groupe d’affronter ces angoissants mystères, et se serait ainsi posé comme précurseur de l’homme religieux.
Cet ouvrage de référence souligne les articulations entre psychologie du comportement et sélection naturelle.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "La psychiatrie évolutionniste est une discipline récente qui tente d’intégrer la dimension évolutionniste dans la compréhension de la maladie mentale. La sélection naturelle au niveau du groupe est désormais reconnue comme un des moteurs possibles de l’évolution. Ainsi, selon l’auteur, la personnalité obsessionnelle compulsive aurait permis la persistance d’une certaine vigilance vis-à-vis des dangers extérieurs."
(Anne Fornoville-Dubois, Psychologos, 3/2014)
- "L’ouvrage de Dragoslav Miric [...] est dans la "littérature" médicale francophone un des rares représentants du courant de la psychiatrie darwinienne ou évolutionniste.
Évolution et troubles de personnalité permet ainsi au lecteur français de prendre la mesure de ce courant qui replace la psychopathologie dans une perspective darwinienne (sur fond de sélection naturelle des groupes donc)."
(Arthur Mary, Lectures.revues.org)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes fils Thomas, Milan et Nathanaël À mon petit fils Roman
Introduction
Les troubles de la personnalité se rencontrent fréquemment. Tous troubles confondus, ils touchent à peu près un dixième de la population dans les pays occidentaux, cette prévalence étant un peu moindre à l’échelle mondiale. Pourquoi?
Pourquoi certains d’entre nous sont-ils obsessionnels ? Antisociaux ? Paranoïaques ? Pourquoi d’autres ont-ils des pensées étranges ? Pourquoi d’autres encore veulent-ils être, en toutes circonstances, le centre de l’attention ou au contraire limitent-ils leurs interactions avec autrui au minimum?
Les tentatives d’explications, souvent issues des théories du développement de la personnalité, ne manquent pas : culturelles, psychanalytiques, biologiques, génétiques, cognitives, sociales, behavioristes… Elles sont la plupart du temps mutuellement exclusives et leurs promoteurs, publiant des études méthodologiquement irréprochables dans des revues de plus en plus spécialisées, communiquent très peu entre eux.
Le débat sans fin entre la part de l’acquis et celle de l’inné dans l’édification et le développement d’une personnalité, normale comme pathologique, semble heureusement s’apaiser peu à peu. La participation à peu près égale des facteurs génétiques et environnementaux (pris au sens large), ainsi qu’une interaction permanente entre ces facteurs est maintenant reconnue par la plupart des auteurs.
Cet essai, qui ne prétend pas proposer un nouveau modèle explicatif global mais plutôt apporter un éclairage différent sur l’origine de ces troubles, s’intéressera avant tout à leur composante génétique. En effet, comment, et surtout pourquoi, de tels troubles ont-ils pu se transmettre d’une génération à l’autre au cours de l’évolution humaine alors que, par définition, ils entraînent un handicap social important?
Une discipline nouvelle, la psychiatrie évolutionniste, appelée aussi darwinienne, tente de résoudre ce problème en expliquant que les individus présentant certains de ces comportements, à l’instar de ce qui existe pour d’autres pathologies mentales, auraient pu être tout à fait adaptés à l’environnement ancestral, mais ne le seraient plus à l’environnement moderne.
En se servant de ce modèle, le point de vue exposé dans ce livre est à la fois opposé et complémentaire : c’est la société, le groupe, et non l’individu, qui bénéficie – ou plutôt a bénéficié-– de ces troubles de la personnalité. D’emblée cette proposition peut apparaître choquante, ou au minimum contre-intuitive. Quel bien un paranoïaque peut-il faire à un groupe ? Comment la société peut-elle profiter de ses antisociaux ? Quel bénéfice une communauté peut-elle tirer d’un comportement hystérique ou obsessionnel?
On verra combien il est important de resituer notre place dans l’évolution pour que cette proposition prenne son sens. En effet nos sociétés actuelles, en particulier occidentales, ne ressemblent en rien à ce qu’étaient les groupements humains avant la domestication des plantes et des animaux et la création consécutive des cités-État. Citadines, énormes en nombre de personnes, souvent très individualistes, elles sont en tout point opposées aux groupes de quelques dizaines de chasseurs-cueilleurs nomades, solidaires par nécessité, qui existaient jusqu’alors. La formation de ces groupes, l’ajustement nécessaire, comme dans toute espèce sociale, entre les différents membres qui les composaient, se sont effectués sur plusieurs centaines de milliers d’années, alors que nos sociétés modernes ne datent que de quelques siècles, au plus quelques millénaires. C’est-à-dire que 99 % de notre évolution s’est déroulée dans un environnement complètement différent de celui que nous connaissons actuellement.
Or la sélection naturelle, qui sera l’un des principaux cadres de référence de ce livre, aboutissant, très schématiquement, aux individus les mieux adaptés à leur milieu, s’exerce sur le long terme. La probabilité est donc grande que les caractéristiques, en particulier comportementales, retrouvées chez Homo sapiens, aient été forgées par ces centaines de milliers d’années d’évolution (Homo erectus qui représente le début du processus d’hominisation était présent il y a presque deux millions d’années – vingt mille siècles1 !) plutôt que par les cinq mille ans de la période historique, et donc aient été plus adaptées au milieu des chasseurs-collecteurs vivant en petits groupes qu’aux concentrations urbaines d’aujourd’hui.
Les critères utilisés pour définir les troubles de la personnalité seront ceux de la Classification Internationale des Maladies (dixième édition) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), connue sous le sigle CIM 10, et surtout ceux du DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quatrième édition), manuel spécifiquement orienté vers les pathologies mentales, et largement utilisé dans le monde entier. De nombreuses critiques peuvent être portées à leur encontre, mais l’avantage de ces outils est qu’ils sont descriptifs, issus de données statistiques, et ne proposent pas d’explication quant à l’origine (l’étiologie) des pathologies mentales. Ainsi les définitions des troubles de la personnalité de ces ouvrages, lorsqu’elles sont acceptées, permettent à ceux qui s’intéressent à l’origine des troubles mentaux, de parler de la même chose à partir d’un matériau commun. Cela revient à dire qu’il y aura le moins possible de distorsion diagnostique, d’approximation, de construction ad hoc pour faire entrer le trouble de personnalité dans le cadre fixé, pourtant très rigide.
Cet essai est divisé en trois parties. La première partie est consacrée à préciser le contexte évolutionniste dans lequel se situe cet ouvrage : une présentation générale de la psychologie et de la psychiatrie évolutionnistes sera d’abord effectuée, car cette approche particulière n’est quasi jamais abordée dans les traités francophones ni même anglophones de psychiatrie; ensuite une tentative de reconstruction des rapports sociaux dans l’environnement ancestral sera proposée à partir des informations, issues de différentes disciplines, dont on dispose actuellement. Enfin sera examinée la question centrale de la particularité des groupes humains. La deuxième partie débutera par une présentation schématique de la conception des troubles de la personnalité aujourd’hui. Ensuite, chaque chapitre traitera d’un type de personnalité pathologique selon un même plan, et sera principalement axé sur le bénéfice qu’a pu en tirer le groupe, raison d’être de cet essai. La troisième partie sera consacrée aux principales critiques et questions induites par ce travail : comment un trouble de la personnalité peut-il être « hérité » de nos lointains ancêtres ? Le groupe peut-il être la cible de la sélection naturelle ? L’homme étant un être de culture, quelle part celle-ci jouet-elle ou a-t-elle joué ? N’est-ce pas l’éducation parentale, ou bien alors l’environnement actuel, ou les deux, qui sont à l’origine des troubles de la personnalité ? N’existe-t-il pas, d’un point de vue évolutionniste, d’autres alternatives ? Enfin, en conclusion, comment tester cette hypothèse et quelles perspectives ouvre-t-elle?
En tentant d’apporter un éclairage différent sur la rigidité parfois extrême de certains comportements, cet essai emprunte, inévitablement de manière superficielle, à un grand nombre de disciplines, comme l’anthropologie, la génétique, la primatologie ou les sciences sociales, sans oublier bien sûr la psychiatrie et la psychologie. Que les lecteurs spécialisés pardonnent les insuffisances, les approximations et les carences qu’ils ne manqueront pas de relever ici et là… Et que les moins initiés y trouvent – souhaitons-le – des informations et des pistes de réflexion stimulantes !
1. Certains toutefois proposent de réserver le terme d’Homo erectus à ceux qui ont essaimé à partir de l’Afrique et d’utiliser le terme d’Homo ergaster pour ceux restés sur le continent africain. Notre propos n’est certes pas ici d’entrer dans ces débats de spécialistes, mais, pour que l’information du lecteur soit complète, voici ce qu’en dit Jean-Jacques Hublin, de l’Institut d’anthropologie évolutive Max Planck à Leipzig : « Quel est le premier homme qui quitta l’Afrique ? Trois variantes du scénario apparaissent ici. Selon une première hypothèse, une espèce humaine encore inconnue mais proche d’Homo habilis aurait quitté le continent africain et serait à l’origine d’Homo ergaster en Afrique et d’Homo erectus en Asie. Un deuxième scénario fait sortir du continent Homo ergaster, qui aurait évolué vers Homo erectus stricto sensu seulement en Asie. Une troisième version, de plus en plus largement reprise, juge que le nom d’Homo ergaster est quelque peu abusif et que les fossiles désignés ainsi en Afrique ne sont que les plus anciens Homo erectus. Après être apparus en Afrique, ceux-ci auraient conquis l’Eurasie pour connaître ensuite un sort différent selon les régions. » Voir Hublin, J.-J. & Seytre, B. (2008; 2e éd. 2011). Quand d’autres hommes peuplaient la terre : nouveaux regards sur nos origines. Flammarion. Paris.
PREMIÈRE PARTIE Quel cadre évolutionniste?
Chapitre 1
Psychologie et psychiatrie évolutionnistes
Chaque être vivant obéit à deux nécessités : survivre et se reproduire. De la plus simple des plantes ou des bactéries jusqu’à nous, le même impératif est à l’œuvre. Ce qui nous distingue de ces formes simples du vivant, c’est la complexité de notre organisation, qui n’est pas, elle, une obligation. Pourquoi cette complexification, cette « évolution » ? Une des hypothèses avancées est celle d’une « course aux armements » entre les organismes, qui seraient obligés d’augmenter leurs potentiels défensif et offensif pour survivre et se reproduire (par exemple dans Brüne, 2008). La notion d’évolution des êtres vivants date de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, avec Buffon et Lamarck en particulier. Il revient à Darwin d’avoir proposé en 1859 un mécanisme pour expliquer cette évolution : la sélection naturelle. C’est dans ce premier cadre extrêmement général que se situent la psychologie et la psychiatrie évolutionnistes.
Ces deux disciplines appliquent le principe darwinien de la sélection naturelle à l’esprit humain. L’esprit est considéré comme l’activité du traitement de l’information par le cerveau (Pinker, 1997). Nos capacités cognitives, nos émotions et nos comportements, ce qui fait notre esprit, est en dernière analyse réductible à l’activité de notre cerveau. Et celui-ci est, comme n’importe quel organe du corps, l’aboutissement d’une adaptation, la meilleure (ou la moins mauvaise) possible, à son environnement, par le biais de la sélection naturelle.
Le cerveau humain, qui contient environ 100 milliards de neurones et 100 000 kilomètres de câblage, est probablement l’organe le plus complexe ayant jamais évolué. Il représente 2 % du poids du corps mais consomme 20 % de l’énergie totale, ce qui demande une explication particulière, car les processus physiologiques sont plutôt parcimonieux en général. Les avantages évolutifs procurés à l’organisme tout entier par ce gros consommateur d’énergie doivent donc être largement supérieurs aux coûts qu’il engendre (voir en particulier Brüne, 2008).
Les premiers neurones, qui sont à la base de tout système nerveux, sont apparus chez certains poissons il y a 500 millions d’années. Ils ont ensuite évolué en organes structurés de manière hiérarchique, les cerveaux. On peut « lire » dans le cerveau humain, comme dans celui de tous les mammifères, notre histoire évolutive. Il revient à Mac Lean (1990), dans les années 1960, d’avoir proposé la division du cerveau en trois couches qui correspondent à leur émergence au cours de l’évolution : cerveau reptilien, paléo-mammalien et néo-mammalien.
La couche la plus profonde correspond au cerveau reptilien. C’est évidemment la couche la plus ancienne. Les structures qui la composent sont responsables des fonctions fondamentales de régulation de la respiration, de la température et du cycle veille-sommeil par exemple. Mais elles sont aussi le siège de comportements sociaux ritualisés comme la sexualité ou la chasse. Globalement elles sont responsables de comportements assez rigides.
La couche intermédiaire est le siège du cerveau paléo-mammalien, qui régule les émotions fondamentales comme le comportement maternel (« l’instinct maternel »), la peur et la colère. C’est le cerveau de la « connaissance affective ».
Enfin la couche superficielle est représentée par le cerveau néomammalien ou néocortex. C’est celui qui a profité des changements les plus importants au cours de l’évolution humaine. C’est principalement au bénéfice de sa partie frontale (le cortex préfrontal en particulier) qu’il s’est développé. Or c’est notre cerveau social. C’est celui qui permet l’anticipation et la programmation de l’action à venir, qui nous rend aptes à comprendre et analyser des situations complexes, qui nous incite à contrôler nos pulsions et à réfléchir avant de passer à l’action. Un patient atteint d’un syndrome frontal, terme faisant référence aux symptômes secondaires aux dysfonctionnements du cortex préfrontal, quelle qu’en soit l’origine (traumatisme crânien, accident vasculaire, tumeur, maladie neurodégénérative), est, à des degrés divers, soit très apathique, incapable de planifier même une action proche et très simple comme de porter une cuillère à sa bouche, ou bien très agressif, verbalement comme physiquement, vis-à-vis de ses proches comme de ses soignants. La désinhibition sexuelle (pelotage ou propositions salaces), la désinhibition vis-à-vis de la nourriture (goinfrerie, utilisation des mains pour manger dans une société où ce n’est pas la règle), la désinhibition verbale (insultes, grossièreté, chez une personne jusque-là polie) sont fréquentes. Il est intéressant de noter que cette « perte de contrôle » des structures plus anciennes phylogénétiquement s’accompagne souvent de la réapparition de réflexes archaïques comme le grasping ou réflexe d’agrippement (voir infra). Le cas emblématique de cette corrélation entre la partie préfrontale du cerveau et notre comportement social est celui du désormais célèbre Phineas Gage, décrit initialement par Harlow (1848), puis par Damasio dans L’erreur de Descartes (1994). Cet ouvrier, travaillant à la construction d’une ligne de chemin de fer en Amérique dans les années 1850, était considéré par ses pairs et ses employeurs comme un modèle, tempérant, poli avec son entourage, etc. À la suite d’une explosion de chantier, une barre à mine a pénétré dans son crâne par son orbite gauche et en est ressortie par le sommet de son crâne de manière presque verticale. Aucune partie vitale ou fonctionnelle motrice du cerveau n’ayant été atteinte, malgré l’importance du traumatisme, le patient survécut, qui plus est sans dommage majeur apparent. Un miracle ! Pourtant cet ouvrier modèle, est rapidement devenu grossier, alcoolique, sale, l’opprobre de sa petite communauté. La barre à mine avait justement détruit son cerveau social, celui qui lui avait permis des années durant de vivre en harmonie avec les autres.
L’une des thèses centrales de la psychologie et de la psychiatrie évolutionnistes est que le cerveau (et donc l’esprit) a évolué pour résoudre les problèmes rencontrés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs durant ce que John Bowlby (1969), psychiatre anglais, a appelé, dans les années 1960, l’EEA, terme fréquemment rencontré dans les écrits évolutionnistes. L’EEA est l’acronyme de Evolutionary Environment of Adaptedness. L’expression est difficile à adapter en français. Le traducteur de Bowlby propose « Environnement d’adaptétude évolutionniste ». Françoise Parot, la traductrice de « Psychologie évolutionniste » de Workman et Reader (2007) suggère quant à elle « Environnement de l’Évolution Adaptative », qui est probablement la moins mauvaise approximation, mais ces deux expressions ne signifient pas grand-chose en français. Aussi se contentera-t-on du terme moins précis d’« environnement ancestral », tout en utilisant parfois l’expression d’EEA. Cette désignation met en évidence que nos comportements, comme nos émotions et nos capacités cognitives, sont le fruit d’une évolution et d’une adaptation au milieu dans lequel Homo sapiens, et plus généralement le genre Homo, a existé, c’est-à-dire pendant une période couvrant plus de deux millions d’années (Ma) (voir le chapitre 2) et correspondant à la période géologique appelée Pléistocène. Pour beaucoup pourtant, y compris les psychologues évolutionnistes, cet environnement n’est situé ni en un lieu (Afrique) ni en un temps précis. Il repose sur une fiction (Tooby & Cosmides, 1990a). En effet pourquoi faire commencer l’EEA au moment de l’apparition du genre Homo, alors que – on l’a vu avec la stratification du cerveau – les problèmes adaptatifs rencontrés par nos ancêtres sont bien antérieurs à cette époque. Par ailleurs, géographiquement, il pourrait y avoir eu beaucoup d’EEA en raison de la migration précoce d’Homo erectus en dehors de l’Afrique. On peut, avec Tooby et Cosmides (1990a), considérer que l’EEA est mieux conceptualisée comme un « composite statistique d’aspects variés qui ont duré assez longtemps pour créer des pressions de sélection sur les humains en évolution ».
LA PSYCHOLOGIE ÉVOLUTIONNISTE
Les prémices de la psychologie évolutionniste se trouvent déjà chez Darwin dans L’origine des espèces qui date de 1859:
J’entrevois dans un avenir éloigné des routes ouvertes à des recherches encore plus importantes. La psychologie sera solidement établie sur une nouvelle base, c’est-à-dire sur l’acquisition nécessairement graduelle de toutes les facultés et de toutes les aptitudes mentales, ce qui jettera une vive lumière sur l’origine de l’homme et son histoire. (p. 547)
On peut faire remonter l’origine de la psychologie évolutionniste moderne à la sociobiologie, discipline développée à partir de l’éthologie (par exemple, Lorenz 1965), et qui a suscité tant de controverses. En 1975 est publiée une monographie de E.O Wilson intitulée Sociobiologie : la nouvelle synthèse. Ce livre posait les fondements d’une approche évolutionniste dans l’étude du comportement. La sociobiologie était définie par Wilson lui-même comme « l’étude systématique des bases biologiques de tout comportement social », et concernait essentiellement les sociétés d’insectes, dont il est un spécialiste reconnu. L’ouvrage ne contenait qu’un seul chapitre destiné au problème du comportement humain, intitulé « L’homme : de la sociobiologie à la sociologie », notion ensuite développée dans L’humaine nature (1978). Mais c’est ce chapitre qui a déclenché un tollé, en particulier en dehors de la communauté scientifique. En effet Wilson fut insulté, traité de raciste, de « prophète du patriarcat conservateur », tant était grande la crainte d’un retour au « darwinisme social », à l’eugénisme, ou à la justification d’idées racistes ou sexistes, qui expliquaient les différences socioculturelles entre les individus en termes de différences biologiques (voir Workman & Reader, 2007). Le sujet est d’ailleurs toujours sensible.
Aussi la notion de psychologie évolutionniste, plus « politiquement correcte », a-t-elle succédé à celle de sociobiologie. Par exemple une revue comme Ethology and Sociobiology a pris, à partir de 1996, le nom plus acceptable de Evolution and Human Behavior. Ses principaux promoteurs furent John Tooby et Lea Cosmides au début des années 1990. Dans The Adapted Mind, (L’esprit adapté; Barkow et al. 1992), la proposition centrale est la suivante : l’esprit – et son support physique, le cerveau – n’est pas, à la naissance, une cire vierge, une page blanche, sur laquelle va s’inscrire l’expérience de l’individu, modelée par l’apprentissage parental et sociétal. Ce n’est pas la « tabula rasa », l’ardoise vierge de Locke. Le nouveau-né présente des réflexes archaïques, testés à la naissance, connus depuis longtemps, disparaissant par la suite et qui témoignent de notre phylogénie de primates. C’est le cas par exemple du grasping, ou réflexe d’agrippement, qui permettait au nouveau-né de s’agripper à la toison de sa mère. Quiconque a soulevé un nouveau-né en glissant ses index à l’intérieur de ses minuscules paumes peut témoigner de la force de préhension incroyable qu’il développe. Et il en va de même du réflexe qui lui fait orienter son visage vers le stimulus buccal permettant ainsi la tétée. Bowlby (1969) avait déjà montré dans les années 1950 que les liens entre la mère et l’enfant étaient de nature instinctuelle et non secondaires à une forme d’apprentissage, ce qui était considéré comme la règle jusque-là. Pour la psychologie évolutionniste, comme pour les disciplines qui y sont associées, l’éthologie et l’écologie comportementale, le cerveau humain est préadapté aux situations rencontrées dans l’environnement ancestral permettant par exemple, comme chez les autres animaux, d’identifier la nourriture comestible, chercher un partenaire, élever ses enfants, reconnaître les cris d’alarme ou les tendances agressives chez autrui (Tooby & Cosmides, 1990 b).
Toutes ces préadaptations sont encore, à quelques nuances près, présentes dans le monde contemporain. De même, on le verra dans le chapitre suivant, presque toutes se rencontrent chez les grands singes anthropoïdes vivant en société, ce qui témoigne d’une grande constance phylogénétique. Il est fort peu probable que de notre ancêtre commun jusqu’à nous, chaque individu de chaque génération ait développé l’ensemble de ses connaissances sur son environnement uniquement à partir de mécanismes d’apprentissage !
Pour un grand nombre de psychologues évolutionnistes (mais pas tous), l’esprit fonctionnerait de manière modulaire. Chaque préadaptation correspondrait à un « module » issu d’un « algorithme darwinien préstructurant l’expérience selon des dimensions adaptatives variées » (Gayon, 2007). Ainsi, pour les psychologues évolutionnistes et modularistes, il existerait entre quelques centaines et deux ou trois mille modules mentaux innés. Cette idée de structure modulaire de l’esprit, selon laquelle à chaque module correspondrait un trait adaptatif complexe, n’est pas nouvelle. Ce concept a évolué depuis la « phrénologie » de Franz Gall. Ce médecin allemand ayant vécu à cheval sur les XVIIIe et XIXe siècles avait développé une théorie selon laquelle les irrégularités du crâne (bosses) étaient l’expression des « organes » spécialisés sous-jacents, comme celui du besoin d’être approuvé ou celui du goût pour les bonnes boissons (Gayon, 2007). Dans la première moitié du XXe siècle, cette conception se poursuit et s’amplifie chez Jung (1954) avec l’hypothèse des archétypes, fonctionnant comme « des unités neuropsychiques ayant évolué par le mécanisme de la sélection naturelle et responsables des caractéristiques comportementales ainsi que des expériences affectives et cognitives typiques des êtres humains » (dans Stevens & Price, 1996, p. 6). Les idées de Jung sont ainsi très proches des propositions de la psychologie évolutionniste actuelle, et pourtant cet auteur est bien peu cité en ce domaine. Au début des années 1980, un philosophe, Jerry Fodor, a publié un livre qui a eu un grand retentissement, intitulé La modularité de l’esprit. Il considérait que chaque module dont serait constitué l’esprit humain pourrait être responsable d’un aspect particulier du comportement. Proche de cette notion est celle d’« organes cérébraux » de Noam Chomsky (1980). Par la suite les psychologues évolutionnistes ont considéré que chacun de ces modules avait pu répondre à un problème particulier dans l’EEA et donc avoir été la cible de la sélection naturelle. Le fait que le cerveau fonctionne de façon modulaire et non de façon globale est d’après eux lié au fait qu’il n’y a pas de solution générale… car il n’y a pas de problème général (Symons, 1992). La métaphore du couteau suisse est souvent utilisée pour illustrer ce fait ! Ce n’est pas un outil à tout faire mais un ensemble d’outils séparés servant à couper, à scier, à limer, à visser, chacun remplissant efficacement la fonction pour laquelle il a été conçu.
Ces modules mentaux fonctionneraient seulement avec certains types d’information, seraient largement indépendants les uns des autres et organisés de manière hiérarchique. Le module de la détection d’une menace, par exemple, serait déclenché dans des conditions de vigilance accrue comme le fait d’être seul dans le noir, et activé par un algorithme centré sur la détection des mouvements. Si ce qui bouge semble se déplacer par ses propres moyens, un module d’un ordre plus élevé serait activé par un algorithme qui se concentrerait sur l’orientation du mouvement. S’il s’effectue en direction de l’individu, un autre module pourrait être activé pour déterminer ce qui est à l’origine du mouvement etc. (Dans Brüne, 2008).
Que le cerveau fonctionne de manière « archétypale », « modulaire », « algorithmique » ou pas, la psychologie évolutionniste en général pose moins la question des mécanismes conduisant à un comportement (« le comment ») que celle de la raison de l’existence de celui-ci (« le pourquoi »). Ernst Mayr (1961), un des trois principaux acteurs de la théorie synthétique de l’évolution, celle qui intègre les données génétiques au mécanisme de la sélection naturelle, distinguait dans l’origine du comportement de tout être vivant des causes – ou explications – prochaines (proximate) et des causes – ou explications – ultimes (ultimate), les deux types de causes devant être expliqués et interprétés pour comprendre pleinement un phénomène biologique. Les termes de « causes premières » et « causes dernières » qui auraient pu être utilisés en français (en raison de leur symétrie phonétique en particulier), semblent ne pas avoir été retenus. Schématiquement les explications prochaines s’intéressent aux processus (biologiques, physiologiques, mentaux…) qui sous-tendent un comportement, tandis que les explications ultimes intègrent la notion d’évolution à moyen et long terme, et s’appliquent à la survie et à la reproduction. La psychologie évolutionniste s’intéresse donc à ce deuxième type d’explications.
Quelques exemples permettront de mettre cela en évidence. Pourquoi a-t-on toujours peur, voire très peur avec parfois des manifestations physiques incontrôlables, y compris à leur seule évocation, des serpents et des araignées, mais pas des automobiles, alors que la probabilité d’être blessé ou tué par les uns ou par les autres, au moins dans les pays occidentaux, est sans commune mesure. Pourquoi les petits enfants ont-ils si peur de l’obscurité et des étrangers ? Pourquoi cette phobie du vide, ce « vertige » si bien décrit par Montaigne?
Qu’on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés, qui soit suspendue au haut des tours de Notre-Dame de Paris : il verra par raison évidente qu’il est impossible qu’il en tombe; et si ne se saurait garder (s’il n’a accoutumé le métier des recouvreurs) que la vue de cette hauteur extrême ne l’épouvante et ne le transisse… Qu’on jette une poutre entre ces deux tours, d’une grosseur telle qu’il nous la faut à nous promener dessus, il n’y a sagesse philosophique de si grande fermeté qui puisse nous donner le courage d’y marcher comme nous le ferions, si elle était à terre. (Essais II, XII, p. 422 et 423)
De même, il décrit son horreur et ses « tremblements de jarrets et de cuisses » à la vue d’un précipice, qui s’atténue lorsque l’œil peut se raccrocher à une aspérité « arbre ou bosse de rocher ». Si on n’analyse pas ces phobies à la lumière de ce qui était dans un lointain passé synonyme de survie, on ne peut pas les comprendre.
La psychologie évolutionniste permet aussi de répondre à un certain nombre de questions, même si ces réponses sont davantage spéculatives. La divergence entre les hommes et les femmes dans le choix des partenaires, les uns privilégiant la jeunesse (fertilité/reproduction), les autres le statut social (ressources pour les enfants), – divergence que l’on retrouve dans toutes les cultures (Buss, 1989) –, relèverait aussi d’explications ultimes, en lien avec la reproduction (voir le chapitre suivant). L’engagement dans des activités à haut risque, avec un taux élevé d’homicides dans certaines circonstances, chez les jeunes hommes entre 16 et 24 ans, serait en rapport avec l’entrée des hommes dans l’arène où ils sont en compétition pour gagner les faveurs de futures partenaires (Wilson & Daly, 1985). La jalousie des mâles (incertitude sur la paternité) est présente dans toutes les cultures et la raison majeure de l’homicide des épouses (Daly & Wilson, 1988). De même les causes de dissolution du mariage dans les 186 cultures étudiées par Laura Betzig sont liées à l’infidélité ou à la stérilité de l’épouse (Betzig, 1989). Wilson et Daly (1987) expliquent que la maltraitance envers des enfants d’âge préscolaire est quarante fois plus souvent le fait de la belle famille que de la famille biologique, et est plutôt liée à la question de l’allocation des ressources. Enfin, on peut terminer cette série par l’exemple moins tragique de l’attrait à peu près universel des hommes pour la pornographie. Difficile d’y voir autre chose qu’une explication prochaine (l’excitation sexuelle par des images) détournée de son objet initial (le désir de pratiquer l’acte sexuel) pour une raison ultime (se reproduire) (Buss, 1995).
Mais surtout, on le verra tout au long de ce livre, l’extrême importance de la vie sociale chez les humains suggère clairement que les principaux mécanismes psychologiques pour atteindre ces buts ultimes, survie et reproduction, ont été sociaux par nature.
La principale différence entre la sociobiologie et la psychologie évolutionniste réside dans ce que David Buss (1991) appelle l’« erreur sociobiologique » (« sociobiological fallacy »). En effet la sociobiologie combine une théorie sur les origines, le processus causal de certains mécanismes psychologiques et une théorie sur la nature de ces mécanismes. C’est-à-dire qu’elle explique un comportement par son utilité directe pour l’individu en termes de survie et/ou de reproduction. Buss écrit que, par exemple, si les hommes avaient pour but d’optimiser leur valeur reproductive, il devrait y avoir la queue dans les banques de sperme. Elles semblent plutôt actuellement en pénurie de donneurs. Pour la plupart des psychologues évolutionnistes (mais tous n’ont pas cette prudence) les contraintes adaptatives ne rendent pas compte de tous les processus psychologiques, et les conduites humaines ne se résument pas à celles d’individus cherchant à optimiser leur valeur adaptative.
Dans le cadre du propos de cet ouvrage on soulignera que le principal courant de la psychologie évolutionniste, représenté par ses fondateurs, ne reconnaît pas la personnalité des individus, et a fortiori les troubles de la personnalité, comme ayant une valeur adaptative. Pour ces auteurs, autant il existe une nature humaine et des « modules » de préadaptation communs à tous, autant les différences individuelles ne sont pas en elles-mêmes des adaptations. Pour eux, soit elles représentent des conséquences secondaires de mécanismes adaptatifs principaux, soit elles sont le résultat d’un « bruit de fond » génétique qui les perturbe (Tooby & Cosmides, 1990b). Mais, tous les auteurs ne partagent pas ce point de vue, et cet essai n’aurait pas de sens s’il en était ainsi des différences interindividuelles. Cette question de génétique comportementale sera traitée dans un chapitre de la troisième partie.
De la même manière, et pour terminer ce point, la position adoptée tout au long de ce livre sera assez éloignée de celle de la psychologie évolutionniste devenue – déjà – classique depuis les années 1990. En effet, outre la question fondamentale des personnalités, la très grande plasticité cérébrale caractérisant l’être humain rend difficile d’admettre que la plupart de nos comportements soient issus de structures modulaires hiérarchisées. Jerry Fodor lui-même (2003) est revenu sur les excès théoriques du « nativisme computationnel » qu’il avait lui-même introduits.
Outre ces réserves, l’ensemble de cet essai s’inscrit pleinement dans la perspective évolutionniste d’une adaptation de nos comportements aux conditions, en particulier de la vie sociale, rencontrées par nos ancêtres durant le Pléistocène.
LA PSYCHIATRIE ÉVOLUTIONNISTE
Cette discipline adopte les mêmes fondements que sa consœur, mais au lieu de s’intéresser aux traits et aux comportements normaux, elle tente d’expliquer la maladie mentale, ou plutôt d’intégrer dans la compréhension de celle-ci, la dimension évolutionniste.
La question de fond est la suivante : pourquoi la maladie mentale a-t-elle persisté au cours de l’évolution alors qu’elle entraîne un désavantage, en particulier en matière de reproduction, pour l’individu qui en est porteur ? En effet pour le psychiatre comme pour le psychologue évolutionniste, le but du fonctionnement mental normal n’est pas d’être heureux ou d’avoir des rapports harmonieux avec les autres, mais que les traits comportementaux soient sélectionnés pour optimiser les taux de reproduction aux générations suivantes (Mc Guire & Troisi, 1998). Néanmoins, en tant que psychiatres, ils envisagent plus les rapports d’un individu à la pathologie mentale en termes de risque ou de vulnérabilité. Très (très) schématiquement, la psychiatrie évolutionniste propose que les symptômes psychiatriques relèvent d’anciennes stratégies adaptatives, qui ne sont plus nécessaires aujourd’hui.
La psychiatrie envisagée de ce point de vue a été traitée principalement à l’origine par Stevens et Price en 1996 dans leur ouvrage Evolutionary Psychiatry : A new Beginning et par Mc Guire et Troisi en 1998 sous le titre Darwinian Psychiatry. Plus récemment Martin Brüne (2008) a écrit un manuel, Textbook of Evolutionary Psychiatry : the Origins of Psychopathology, qui a largement inspiré la rédaction de ce chapitre. Aucun de ces trois traités, pourtant fondamentaux, n’a été traduit en français, raison pour laquelle ils sont mentionnés ici par leur titre original. Un livre publié en 2009, en français, sous la direction de Van der Henst et Mercier, Darwin en tête !, intègre cependant un chapitre intitulé « Psychiatrie darwinienne », et il faut reconnaître à un collègue belge, Albert Demaret (Éthologie et psychiatrie, 1979) son rôle de pionnier – solitaire – dans la littérature francophone.
Ces différents auteurs envisagent presque toutes les pathologies mentales, et en particulier les troubles de personnalité, les seuls qui nous intéressent ici. Il n’est pas question d’essayer de faire une synthèse de leurs livres, qui sont eux-mêmes une synthèse des travaux dans le domaine, mais de situer leur démarche au moyen de quelques exemples, comme cela a été fait pour la psychologie évolutionniste.
L’exemple peut-être le plus convaincant est celui de la dépression; il est question ici de la forme de dépression la plus habituelle et non de la psychose maniaco-dépressive, dépression « endogène » beaucoup plus difficile à expliquer d’un point de vue évolutionniste. La dépression a été très étudiée dans une perspective liée à l’évolution du fait de sa grande fréquence, mais peut se résumer au modèle proposé depuis les années 1970 par Price (Stevens & Price, 1996) : celle-ci serait une pathologie du « rang », liée à la compétition sociale entre les individus. À l’origine de la dépression, il y a une perte – réelle ou symbolique – de son rang dans la hiérarchie. La fonction de la dépression serait pour l’individu de faciliter cette perte, et d’accepter son nouveau rôle. L’état d’inhibition qui caractérise la dépression permet au sujet d’éviter des blessures supplémentaires, en particulier de l’estime de soi, en se mettant « hors compétition ». Il envoie des signaux non verbaux, en particulier en évitant le regard des autres, en réduisant sa fluence verbale, en adoptant un timbre de voix monocorde. Ici encore, on peut distinguer des causes prochaines et des explications ultimes. L’explication ultime est celle que nous venons de décrire, la protection de l’individu contre des blessures supplémentaires mettant en jeu sa survie. Price ajoute une raison ultime supplémentaire : préserver la stabilité et l’efficacité compétitive du groupe en maintenant son homéostasie. Ce sujet, très controversé, de l’utilité pour le groupe des pathologies mentales, sera analysé dans la troisième partie de cet essai. Quant aux explications prochaines elles tiennent à deux facteurs principaux. Le premier est de nature biologique : l’état d’inhibition caractéristique de la dépression peut être souvent levé par des traitements impliquant des neuromédiateurs, ce qui est une preuve a contrario de l’implication de ces substances endogènes dans cette pathologie. Le second est d’ordre sociologique et explique probablement la flambée actuelle des syndromes dépressifs, au moins dans les sociétés occidentales (en plus de la « stratégie marketing » des laboratoires qui vendent les antidépresseurs). Beaucoup d’évolutionnistes, en particulier Nesse et Williams (1995) pensent que cette épidémie est liée à deux phénomènes récemment apparus : la désintégration des communautés et la communication de masse. En effet la télévision, devant laquelle nous passons plusieurs heures par jour, fait de nous tous un seul groupe de compétition. Comme elle nous présente des personnes au physique agréable, souriantes, sachant s’exprimer, et pleines de talent, notre propre statut social s’en trouve particulièrement dévalorisé au quotidien. L’explication prochaine rejoint l’explication ultime…
L’autre grand groupe de pathologies mentales rencontré fréquemment en psychiatrie concerne la schizophrénie dans toutes ses composantes. Présente chez environ 1 % de la population et également répartie dans tous les pays du monde, elle n’a pas, bien sûr, manqué d’attirer l’attention des évolutionnistes. Cette question sera évoquée au chapitre de la personnalité schizotypique qui lui est proche.
Comme nous l’avons dit dans la section précédente, les troubles anxieux et phobiques seraient les reliquats d’anciennes stratégies adaptatives : celui ou celle qui n’a pas eu peur du vide ou de se retrouver seul(e) dans un endroit à découvert n’a pas été notre ancêtre. Les phobies extrêmes représenteraient la fin d’une distribution gaussienne de cette indispensable anxiété (voir aussi le chapitre sur la personnalité évitante).
Concernant les addictions, l’action des drogues psycho-actives sur la région mésolimbique du cerveau (paléo-mammalien), a été fréquemment étudiée dans l’optique d’une explication prochaine. Mais ce système est fondamentalement en rapport avec des comportements liés à la survie et à la reproduction chez les mammifères. L’expérimentation chez les rongeurs montre à quel point ceux-ci sont sensibles aux drogues addictives. Ces substances agissent en stimulant artificiellement les neuromédiateurs utiles à la survie en créant une illusion. On pourrait dire qu’elles font « main basse » sur le système dopaminergique cortico-mésolimbique souvent appelé « circuit de la récompense » (par exemple, Hill & Newlin, 2002; Panksepp et al., 2002; Nesse, 2002).
Olivier Morin (2009) analyse en détail la spéculation d’une psychiatre américaine (Guisinger, 2003), qui, à la suite d’autres, fait de l’anorexie mentale une stratégie d’adaptation (dans notre lointain passé bien entendu) à la famine lorsque le poids descend en deçà d’un certain seuil.
Bien d’autres maladies mentales sont analysées d’un point de vue évolutionniste et parmi elles les troubles de la personnalité.
Quel peut alors être l’apport, l’originalité de ce livre ? D’abord, tous les troubles de la personnalité n’ont pas été traités dans les ouvrages de psychiatrie évolutionniste cités. Ensuite, les hypothèses proposées sont moins convaincantes, s’agissant des troubles de la personnalité, que pour des pathologies mentales comme la dépression, les troubles anxieux ou les addictions Bien qu’infiniment redevables à ces auteurs qui ont permis de donner un cadre à cette approche spécifique des pathologies mentales, les hypothèses présentées ici diffèrent de ces travaux sur un point fondamental.
En effet, pour ces auteurs, comme pour presque la totalité des interprétations en rapport avec la sélection naturelle, la mesure est celle de l’individu. Selon ce point de vue dominant, les tenants de la psychiatrie évolutionniste envisagent les troubles mentaux comme n’ayant « bénéficié » qu’à l’individu qui en était porteur. Sans nier cette dimension individuelle, l’hypothèse originale développée ici est celle d’un bénéfice pour le groupe, dans l’environnement ancestral. Néanmoins, comme un niveau de sélection (ici celui du groupe) ne peut être envisagé que si le niveau inférieur (ici celui de l’individu) a d’abord été sélectionné, ou au moins non éliminé (Gouyon et al., 1997), l’explication évolutionniste au niveau de l’individu, sera systématiquement prise en considération pour l’étude de chaque trouble de personnalité, en utilisant les travaux cités par ces auteurs. De plus, ainsi que le reconnaissent McGuire et Troisi, il n’est absolument pas évident que les troubles de la personnalité aient entraîné (et entraînent encore maintenant) une interférence telle avec la vie sociale que les capacités de reproduction en aient été (ou en soient) diminuées. C’est ce point de vue – de bon sens – qui sera adopté dans cet essai.
On conçoit l’extrême difficulté, pour beaucoup, d’envisager ce type d’explication évolutionniste. Notre filiation animale ne nous pose pas trop de problèmes concernant notre corps et nos fonctions physiologiques, voire certains de nos comportements de base, en particulier ceux faisant appel aux émotions (la joie, la peur, la tristesse par exemple). Mais la plupart d’entre nous considèrent que ce qui fait notre humanité, ce qui nous distingue en grande partie des animaux, c’est notre capacité à dominer nos « pulsions », « nos instincts ». Aussi, l’idée que les traits de nos personnalités, révélés par nos comportements, puissent, eux aussi, comme n’importe quelle composante physiologique, être l’aboutissement d’une évolution par sélection naturelle peut nous mettre mal à l’aise. A fortiori penser qu’une personnalité pathologique, qui, par définition, entraîne un handicap pour celui qui en est porteur, puisse avoir été sélectionnée positivement au cours de l’évolution peut sembler absurde. C’est pourtant bel et bien l’objet de cet essai.
C’est grâce aux concepts développés par la psychologie et la psychiatrie évolutionnistes, que ce travail a pu être réalisé. Cette perspective (qui n’est en aucun cas une théorie exclusive) est loin d’être acceptée par tous, et particulièrement par les psychiatres qui sont réticents à l’intégrer, ne serait-ce qu’à titre d’information, dans le cursus des étudiants (par exemple Abed, 2000, 2008; Nesse, 2009). Nous parlons ici des réticences anglophones, les francophones ignorant eux tout simplement le sujet. Cette ignorance et ces résistances sont probablement liées aux raisons invoquées plus haut, et, au moins en France, dans l’enseignement de la psychologie, à l’omniprésence des théories psychodynamiques, toutes dérivées de la théorie freudienne classique, malgré son discrédit actuel en tant que système explicatif des troubles mentaux (y compris ceux de la personnalité). Pour s’en convaincre, Il n’y qu’à voir les rayonnages des grandes librairies remplis d’ouvrages psychanalytiques, et les difficultés que l’on rencontre pour se procurer, en français, un livre traitant de psychologie évolutionniste.
Chapitre 2
Une reconstruction possible de notre histoire sociale
L’hypothèse au centre de cet essai, proposant que certains types de personnalités, considérés actuellement comme assez pathologiques pour handicaper la vie sociale, ont été positivement sélectionnés dans l’intérêt du groupe, nécessite de pouvoir évaluer la nature des relations sociales ayant existé dans l’environnement ancestral. Il s’agit d’essayer d’établir un schéma global à partir des données scientifiques actuelles, en essayant de les croiser. Ce n’est qu’une tentative de reconstitution plausible, par triangulation et extrapolation, puisque, à de rares exceptions près, et qui ne concernent pas l’homme, on ne peut jamais observer directement un processus d’évolution par sélection naturelle.
SOUS QUELS ANGLES REGARDER NOTRE PASSÉ?
Trois types de points de vue, plus ou moins complémentaires, semblent possibles:
– les données paléoanthropologiques et génétiques,
– les comparaisons avec les animaux sociaux vivant actuellement et dont nous sommes les plus proches, c’est-à-dire les grands singes, principalement les chimpanzés et les bonobos,
– et les études anthropologiques des rapports sociaux existant dans les sociétés « simples » ou traditionnelles, par exemple chez les chasseurs-cueilleurs existant encore ou pour lesquels nous avons des témoignages historiques.
LES DONNÉES PALÉOANTHROPOLOGIQUES ET PALÉOGÉNÉTIQUES
Vouloir reconstruire un mode de fonctionnement mental et social des sociétés humaines anciennes à partir des restes d’hominidés (dents et ossements principalement), puis des outils disséminés depuis plus de deux millions d’années est une gageure. Pourtant, jusqu’à la « révolution symbolique », représentée par l’apparition des premières sépultures et des grottes ornées, témoignant de l’apparition de l’homme cognitivement moderne, ce « registre archéologique » (voir Coupé, 2009), est le seul qui puisse nous éviter de faire des contresens chronologiques.
Il ne se passe pas une année sans que de nouvelles données ne viennent bouleverser les scénarios de l’évolution des hominidés. Michel Brunet, le découvreur de Toumaï, écrit dans sa leçon inaugurale du Collège de France (2008) que depuis 1994, les plus anciens hominidés connus sont passés de 3.6 à 7 millions d’années (Ma), et que le nombre de genres d’hominidés est passé de trois à sept. À l’autre bout de la chaîne existent d’autres surprenantes découvertes. Par exemple celle de l’homme de Flores en 2003, avec sa toute petite capacité crânienne, due peut-être à son isolement insulaire, descendant d’un hominidé ancien et qui aurait vécu jusqu’à il y a 18 000 ans (Brown, 2003). Et puis voilà que certains Homo sapiens ont des gènes de Néandertal en eux, témoignant d’une interfécondité (Green et al., 2010; Gibbons, 2010), qui paraissait impossible jusqu’à présent. On peut gager que des surprises sont encore à venir.
La découverte au Tchad par Brunet et ses collègues (2002) du crâne de Toumaï (Sahelanthropus tchadensis), avec l’orientation typique du trou occipital qui fait de lui un bipède, fait donc remonter à très loin notre origine (7 Ma) et reculer d’autant la séparation d’avec la lignée des grands singes, estimée maintenant entre 7 et 10 Ma.





























