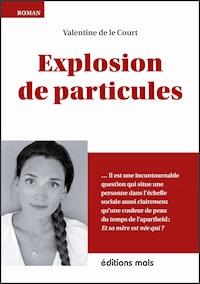
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Et si la vérité sur notre entourage apparaissait dans toute sa clarté seulement au moment de notre mort ?Et si l'on pouvait assister à son propre enterrement ? Si tous les gens que l'on a aimés ou détestés au fil de sa vie se trouvaient réunis en un même endroit, sachant pourquoi vous avez disparu, alors que vous-même n'en avez plus le moindre souvenir ?Et si toute l'assemblée présente, aristocrates belges en apparence classiques et bien-pensants, étaient en fait bien plus délirants, cyniques et imparfaits les uns que les autres ?Comment Juliette, violoniste promise à un bel avenir, a-t-elle pu mourir si tôt ?Un premier roman réussi, dressant avec humour une satire de la noblesse et de l'aristocratie en Belgique !EXTRAITLe chemin est semé d’ornières et des herbes folles se poussent entre les cailloux. Guidée par la foule qui, autour d’elle, se fait de plus en plus nombreuse, Juliette grimpe la colline qui mène à la petite église de Suzeril. Une collègue violoniste la dépasse, l’air affairé, son instrument à la main. Les autres cheminent doucement vers la chapelle éclairée par le pâle soleil de cette fin de matinée.Au-dessus du porche, trois lettres à demi effacées par le temps; D.O.M. Dominus Omnia Mundi. Les ventaux du portail sont maintenus par des étais usés. La jeune femme rejoint deux de ses tantes qui se tiennent par le bras, cheveux blancs impeccablement bouclés. Juliette entre avec elles par la grande porte de chêne. Le monde s’agglutine dans l’entrée comme des doubles croches sur une partition.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Un premier roman écrit avec beaucoup de tendresse et de finesse, assorti d’une description sans concession aucune des principaux protagonistes. - Éric Guisgand, L'avenirPour un coup d’essai, c’est un coup de maître : l’intrigue se montre habilement construite, le regard de l’auteure s’avère perçant, l’humour décalé est omniprésent et la langue française parfaitement respectée… - Bernard Delcord, Lire est un plaisirÀ PROPOS DE L'AUTEUR Valentine de le Court est belge et juriste. D’aucuns prétendent qu’elle a usé dix-sept paires de chaussures sur des parquets de danse, c’est dire si elle peut parler avec expérience de choses futiles!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire.
CHAPITRE I
Suzeril, 15mars, 10h 50
Le chemin est semé d’ornières et des herbes folles se poussent entre les cailloux. Guidée par la foule qui, autour d’elle, se fait de plus en plus nombreuse, Juliette grimpe la colline qui mène à la petite église de Suzeril. Une collègue violoniste la dépasse, l’air affairé, son instrument à la main. Les autres cheminent doucement vers la chapelle éclairée par le pâle soleil de cette fin de matinée.
Au-dessus du porche, trois lettres à demi effacées par le temps; D.O.M. Dominus Omnia Mundi. Les ventaux du portail sont maintenus par des étais usés. La jeune femme rejoint deux de ses tantes qui se tiennent par le bras, cheveux blancs impeccablement bouclés. Juliette entre avec elles par la grande porte de chêne. Le monde s’agglutine dans l’entrée comme des doubles croches sur une partition.
Il fait froid sous les arcades de pierres. Des deux côtés de l’allée centrale, les femmes choisissent leur siège et bavardent entre elles à voix basse. Les hommes se tiennent droit, mal à l’aise, traînés par leur épouse tels des enfants indociles. Certains relèvent le col de leur manteau gris.
Une vierge en bois allaite son fils depuis quatre siècles. À ses pieds, un gros bouquet de fleurs orange et des bougies qui tremblent.
Juliette s’avance entre les bancs. Sa grand-mère grelotte au deuxième rang malgré son étole de laine noire. Elle se serre contre son mari. Lui, tourne la tête et lève son cou de vieille tortue pour repérer les personnes de connaissance. Le crâne du grand-père luit comme un parquet de salle de bal.
Une large photo est posée près du lutrin. Juliette s’approche. En couleur, les lunettes de soleil dans les cheveux, c’est elle qui sourit à l’assemblée.
CHAPITRE II
Suzeril, Église Saint-Charles, 15mars, 10h 55
Au milieu de la cinquième travée de la chapelle, Juliette regarde un groupe d’hommes jeunes chuchotant avec animation. La cravate noire et les cheveux plaqués, Louis de M., le brun à l’extrême gauche, s’est brossé les dents avant la messe, il a des traces blanches dans les commissures. Sa fiancée Léopoldine le nettoie d’un baiser au coin des lèvres et lui fait signe de se taire. Louis ne déchiffre pas son geste et continue sa conversation.
Juliette a longtemps rêvé qu’un jour elle se laverait les dents aux côtés d’un mari qui comprendrait ce qu’elle lui dit, même la bouche pleine de dentifrice. Un homme qui saurait, sans qu’elle doive le lui rappeler, combien il est déplacé d’apporter des fleurs lorsqu’on est invité à dîner et que les gens qui se souhaitent «bon appétit» avant de mordre dans un sandwich lui donnent la nausée.
Sans doute n’aurait-elle pas été jusqu’à élire un de ces légitimistes ou orléanistes français dont elle s’était tant moquée, pour le retour d’un roi, sans pouvoir désigner le candidat valable pour ce trône qui attend, poussiéreux, qu’un séant royal vienne à nouveau se poser sur ses coussins moirés.
Elle concevait plutôt l’homme idéal incollable sur l’art étrusque et ignorant l’existence des bougies d’allumage ou le nombre de joueurs nécessaire à une équipe sportive. Il se régalerait de Lully, Haendel et Chopin et ne manquerait pas d’applaudir son épouse Juliette, au premier rang de l’Opéra, tandis qu’elle saluerait la foule envoûtée, son violon à la main.
Ce mari éventuel pourrait se révolter de la disparition de l’oseille sur les étals des épiciers, rêver de l’Europe de Charlemagne et discourir à l’infini sur l’imperméabilité inégalable des vestes de chasse. Ces sujets avaient l’avantage, selon Juliette, de garantir des années d’énergiques débats qui pimenteraient sans danger une longue vie conjugale.
Parfois, il l’emmènerait, la nuit, escalader des murs en ruine pour découvrir des bancs moussus au milieu de jardins oubliés. En admirant la lune, il lui raconterait que le ciel étoilé est tout autre au-dessus de l’Australie, qu’ils partiraient un jour, à l’autre bout de la terre, voir l’eau tourner à l’envers dans les lavabos et qu’ils mangeraient du kangourou en se battant pour les droits des aborigènes. Un soir, en le regardant prier, elle saurait, devant ce visage apaisé, illuminé d’amour, que sa quête s’était achevée.
Juliette se voyait, entourée de koalas, racontant à ses arrière-petits-enfants son histoire d’amour extraordinaire, de la rencontre derrière une colonne de théâtre à leur mariage féerique. Et la descente des marches le matin des noces, dans la robe qu’elle imaginait depuis l’âge de huit ans.
Bien sûr, avant tout engagement, elle lui présenterait sa grand-mère, Geneviève. Ils iraient prendre le thé chez elle. La vieille dame leur raconterait encore et encore, sans jamais se lasser, qu’adolescente elle avait sillonné la Wallonie à bicyclette, le porte-bagages rempli de postes de radio destinés aux résistants, à la barbe des Allemands qui lui criaient qu’elle était belle quand elle roulait devant eux, cheveux dans le vent, jupe retroussée et socquettes blanches sur ses jambes brunes.
Geneviève
La Grand-mère est une femme solide. Elle a élevé cinqenfants sans froisser sa mise-en-plis. Elle n’a peur ni des guêpesdans les prunes trop mûres, ni des trams qui renversent lespiétons distraits, ni des agressions dans les ruelles malfamées.Elle ne craint que les socialistes qui, elle en jurerait, complotentsans relâche pour transformer le pays en une république.Chaque matin, elle traque les journaux pour étayer les preuvesde cette cabale qui signerait le glas de toute civilisation. Ensuite,rassurée, elle résout les mots croisés du jour sur fond de Brahms.
La Grand-mère n’a pas connu sa mère. Celle-ci, grandedame austère à la chevelure de jais, mourut la veille de sestrente-cinq ans, laissant un veuf éperdu et neuf orphelins.
Bonne-maman raconte volontiers son père. Il se dessine, auxyeux de ses petits-enfants, paré des milles vertus d’un hérosmythologique, aussi courageux qu’Ulysse et le Chevalier Bayardréunis. Cet homme extraordinaire, jamais consolé de la perte desa femme, avait aimé ses enfants avec passion. Il dirigeait sacommune, le cigare à la main, suivi en chaque déplacement desa nombreuse progéniture, collection de petits wagons cahotantderrière une locomotive fumante. La guerre venue, il avait cachédes Juifs dans ses caves et organisé le plasticage des ponts duCondroz tandis que l’État-major allemand réquisitionnait sesmeilleures chambres. Ce père, qu’à quatre-vingts ans elle aimeencore d’un amour d’enfant.
La Grand-mère a vécu une jeunesse merveilleuse, en dehorsdu temps, entourée de gouvernantes, de poupées de porcelaineet d’après-midi champêtres qui traînent jusqu’à la nuit. Elle s’estéveillée, le matin de ses vingt-quatre ans et a décidé que lesbals, les thés dansants et les tournois de bridge ne suffisaientplus à son bonheur. Privée de mère, elle rêvait de découvrir lamaternité.
À Spontin, au château familial, une série de prétendants sebousculaient à l’heure des cocktails. Il y avait cinq sœurs àmarier. Le trajet parcouru se trouvait compensé par l’assortimentféminin disponible. Le Grand-père était beau, elle l’aima donc.Elle exigea deux choses avant de s’engager: qu’il se coupe lamoustache et renonce à la vouvoyer. Cinquante ans plus tard,elle est fière de son choix matrimonial. Il a perdu ses cheveux,mais dans ses yeux il est resté aussi vert qu’autrefois quand,durant leurs fiançailles, il l’emmenait en balade le long de laMeuse, dans sa Chevrolet Fleetmaster.
La Grand-mère connaît les secrets des mariages réussis.Penchée sur la bassine en cuivre qui exhale le parfum desgroseilles, elle distribue avec largesse sa science à ses filles etbelles-filles. «Laisser son mari en paix est la meilleure recetted’une union harmonieuse, répète-t-elle à l’envi. Les hommesont leurs petites manies, leurs rites inaccessibles. Il est essentield’apprendre à aimer leurs instants de solitude. Mais, ajoute-t-elle,si votre époux s’engage dans une allée de traverse, vous vousdevez de le remettre sans faiblesse sur le chemin de la perfection.»Elle nomme cela «le pouvoir salutaire du froncement desourcil». Son bon sens mérita la fidélité admirative de sonépoux.
La vieille dame vit à Suzeril depuis son mariage. Elle y esten exil. Lorsque le long de l’autoroute, elle aperçoit le panneaude sa commune natale, elle s’écrie, ravie, «ah, on est chez moi!» Et elle exige un arrêt pour respirer «le bon air du pays»!
Le château est vendu. Depuis longtemps. Tant d’enfants, un seul domaine. La contrepartie cruelle des familles nombreuses. Pourtant, la Grand-mère continue de commencer ses phrases par «Chez nous, à Spontin…»
La Grand-mère raconte, des enfants sur les genoux, les albums jaunis, nomme des silhouettes disparues, tisse des généalogies, salue des visages aux prénoms démodés. Cousin Roch, Oncle Constant. Ils sont habillés de noir et sourient, un peu figés, assis sur l’herbe ou fièrement dressés derrière un tableaude chasse. Tandis qu’elle désigne les images, elle tourne autourde son poignet son lourd bracelet d’argent. Ce bijou égyptien nela quitte qu’à l’heure du coucher, après sa prière. Ses bellesmains nues se croisent alors sur un chapelet de perlescéruléennes. Elle invoque le Bon Dieu avec confiance. Elleentretient avec Lui cette connivence tendre née d’une longuerelation paisible.
La Grand-mère sent l’enfance. L’obscurité fraîche des cavesen été. La salade-de-fruits. La crème qui colore ses joues. Lespastilles de menthe que l’on reçoit après la messe quand on aété sage, «ne dites rien aux autres je n’en ai pas pour tout lemonde». Et la cire d’abeille. Parce qu’elle ne peut s’empêcherde caresser les meubles qui brillent.
Bonne-maman enseigne à ses petits-fils des jeux de cartesoubliés: l’écarté, le pharaon ou la crapette. Mais c’est à sespetites-filles qu’elle confie ses «trucs» pour gagner contre lesgarçons. Elle nomme le Valet de pique Varlemucheet prétendque c’est de l’allemand. Elle court derrière les plus petits pourleur apprendre la bicyclette et à la rencontre des plus grands quilui apportent des marrons glacés, sa friandise préférée. Elle netrahit jamais les petits chagrins et les grands secrets. Tandisqu’elle raconte les histoires de Pinkeltje, héros hollandais aussiminuscule qu’une souris, ses petits-enfants caressent ce fanonde peau douce et transparente qui pend à son bras.
La Grand-mère est fragile, elle est malade. Elle part acheterdes fraises et rentre avec du pain. Un jour de décembre elle nerevient pas. Elle a pris le train pour Spontin. Elle n’oublie pas sonvillage, son père et ses huit frères et sœurs. Mais elle a effacé leréveillon prévu chez elle, ce soir, avec ses enfants. Elle sesouvient des dîners de Noël de sa jeunesse, du grand sapin vertdans la cage de l’escalier et de la messe de minuit dont onrevient sous la neige, le nez rougi. Elle pleure quand elle estramenée à la maison, à Suzeril.
Bonne-maman ignore à présent où se situe sa cuisine et nefait plus de pâtisserie. Elle se félicite de la réussite de sonParis-Brest sans voir l’étiquette du pâtissier. Elle maigrit, sedécharne toujours plus. Sa peau diaphane, et si merveilleusement élastique pour les jeux d’enfants, semble trop grande pourson corps courbé par le poids des souvenirs qui la quittent. Sesjoues se creusent. Le squelette apparaît.
Chaque jour, ses pensées s’effilochent un peu plus. LaGrand-mère déroule de longs phylactères de mémoire qui flottentun instant derrière elle, avant d’être perdus. La maladie,insatiable, grignote la mémoire. Pour conjurer l’avancée vers lenéant, on lui fait réciter sans fin les prénoms de ses petitsenfants. Elle oublie les derniers nés, et puis les autres. Fermerat-elle un jour la porte à son mari, angoissant inconnu dans lesténèbres de son mal?
Elle interroge, inquiète, ses petites-filles enceintes, «tu esmariée, n’est-ce pas ma chérie?» «Oui, Bonne-maman, ne vousen faites pas.» L’union libre n’a pas cours dans la famille,dernier bastion contre le relâchement des mœurs. Le bateau ne prendra pas l’eau tant qu’elle vivra. Même si peu.
CHAPITRE III
Suzeril, Église Saint-Charles, 15mars, 11h 05
La chapelle est noire de monde à présent. Les retardataires, sans place assise, s’adossent contre les colonnes grises. Sous le porche, deux adolescents terminent une cigarette et l’écrasent sur le gravier avant de se glisser derrière le baptistère pour continuer à bavarder sans être dérangés. À gauche du chœur, répartis sur deux rangées de chaises en paille, une partie des musiciens de l’orchestre symphonique de la Monnaie accordent leur instrument, placent des partitions sur les lutrins dépliés, se murmurent des indications.
Quand elle remarque que Francesco, placé à l’avant, saisit sa clarinette et dépose les lèvres sur le bec en ébonite blanche, Juliette devine le morceau que ses collègues ont choisi en musique d’entrée. Quelques instants plus tard, ce sont les premières notes du Concerto pour clarinette de Mozart qui retentissent dans l’église où le bruissement des conversations s’est tu. C’est le deuxième mouvement, celui qu’elle préfère, qui va accompagner le début de la célébration. La mélodie caresse les arcades et éclaire les statues ternes des martyrs antiques.
Le ton mélancolique de l’adagio rythme les pas lents des hommes en jaquette qui s’avancent depuis le fond de l’édifice. Ils sont huit à soutenir un cercueil. Son frère Guillaume, grand, fort, les yeux au loin. Sur son visage, une grimace immobile d’acteur antique. Ses beaux-frères fixent leurs pieds de peur de trébucher. Les cousins, pénétrés de la solennité du moment, scrutent leur charge comme s’ils craignaient qu’elle leur soit enlevée. Baudouin porte sans doute un costume d’emprunt. La veste trop large lui donne une carrure de boxeur miniature. Le pauvre fait mine de poser les mains sur le côté droit mais ses épaules n’arrivent pas à hauteur utile pour soutenir la charge avec les autres. Les manches de Jean-Baptiste sont humides, il a déjà pleuré.
Juliette les contemple cheminer le long de l’allée entre les rangées de gens qui se tordent le cou pour mieux les dévisager. Elle peine à réaliser que c’est son propre corps qui repose dans cette longue boîte couleur cognac. Celle-ci paraît si lourde à conduire alors que d’une seule main, quelques semaines auparavant, son cousin l’avait hissée en riant sur son dos pour la déloger de son fauteuil préféré.
Derrière l’octave virile tenant la bière, son filleul supporte l’obiit. Les armoiries familiales, d’argent au chef échiqueté d’argent et de sable, ressortent sur le fond noir. L’enfant trottine allègrement, les bras écartelés par le grand losange de bois. Son air ravi tranche parmi la sinistrose ambiante.
Ensuite viennent ses parents. Vieux. Perdus. Ils ne se tiennent pas le bras et semblent ignorer leurs amis qui sourient tristement dans les travées.
Pour clore la procession, ses deux sœurs, presque des étrangères avec leurs cheveux serrés en arrière sous une mantille de dentelle noire. Éléonore porte, enroulé autour du poignet, le sautoir de perles que Juliette avait reçu pour ses dix-huit ans et qu’elle a toujours préféré au sien.
Le cercueil est déposé au pied de l’autel. Il fait un bruit mat quand il touche le sol. Les dames se placent à gauche, près de Tante Marie-Madeleine qui disparaît sous le crêpe. Les messieurs s’installent de l’autre côté. Les sœurs embrassent leur grand-mère qui fait tomber son chapelet en les serrant dans ses bras maigres. Elles s’asseyent au premier rang, à côté de leur mère.
Le regard de Juliette se porte sur les bouquets disposés devant le grand crucifix d’ébène. Pourquoi les fleurs sont-elles orange et ocre alors qu’elle abhorre ces couleurs? Elle aurait plutôt vu quelques arums au milieu de feuilles luisantes de vigne vierge.
Elle se rappelle avoir entendu que Charles Quint avait orchestré son propre enterrement, grande répétition générale en sa présence, afin d’être certain qu’au jour dernier la mort seule sonnerait le glas de sa magnificence. Elle caresse un instant l’idée. Trop tard. Elle s’étonne qu’une personne prétendument décédée puisse générer des pensées si superficielles. Même mort, se déçoit-on encore?
CHAPITRE IV
Suzeril, la grande maison, un an plus tôt
Toc toc toc. Sur la fenêtre de la voiture. Rapide. Énervé.
— Juju? Que fais-tu? Viens. Nous sommes à table! Pourquoi rêvasses-tuencore derrière le volant?
Les dimanches chez Bonne-maman. Ils se déroulaient chaque semaine de la même façon. Le visage de sa mère, inquiet, se collait à la vitre de la petite voiture. Juliette quittait sa ceinture et coupait le moteur. Elle s’extirpait du véhicule, enveloppée des pensées qui l’avaient conduite, en pilote automatique, tout au long de la route.
Ce trajet vers la grande bâtisse biscornue et couverte de vigne vierge évoquait, depuis l’enfance, le chemin magique qui menait aux vacances ou aux fêtes de Noël. Petite, comme c’était long d’être serrée dans la voiture encombrée de bagages avec, pour seule distraction, l’ombre des vélos sur le toit qui s’étalait sur l’asphalte. Impossible d’être sage quand les cousins commençaient peut-être leurs jeux sans elle.
En grandissant, cela lui parut de plus en plus rapide d’arriver à la maison bruyante, aux odeurs de cire et de pommes et de vieux bois qui craque. Adulte, elle aimait à imaginer que, tel un cheval bien dressé, sa voiture connaissait le chemin de l’écurie, et décidait seule quand quitter l’autoroute pour s’enfoncer dans les sentiers perdus dévorés de fougères.
Juliette grimpait les larges marches de pierre qui menaient à la porte-fenêtre de la salle à manger. Sa mère continuait sa litanie habituelle de questions sur son retard, sur sa soirée de la veille, sa santé, le pourquoi elle ne restait pas loger le samedi soir et ne les accompagnait pas à la messe le matin, ce serait si pratique, ils pourraient la ramener chez elle le dimanche soir, c’est mieux, tu ne penses pas?
Juliette se taisait. Elle entrait dans la pièce où un joyeux brouhaha de cantine l’accueillait. La grande salle à manger paraissait petite, saturée de rires et de sièges d’enfants. Certains neveux avaient droit, suprême honneur, à une chaise de «grand» et ils étaient perchés sur deux bottins de téléphone pour avoir la bouche à hauteur d’assiette. Leurs petites têtes rondes éclataient de fierté derrière leur serviette nouée au cou.
Elle embrassait toute l’assemblée qui la réclamait en criant. C’était long. La table avait reçu toutes ses rallonges et deux nappes avaient été posées pour la recouvrir entièrement. Juliette s’asseyait à l’endroit où elles se chevauchaient, un peu effilochées à force d’avoir été lavées. Oncle Georges, son parrain, assis à sa droite, la servait de veau Orloff. La sauce inondait le motifà la mouchede l’assiette. Le cristal de son verre était teinté par le vin déjà versé pour elle.
La famille avait toujours été très unie. Sa mère leur répétait sans cesse que les liens familiaux ont une sorte de permanence intransposable dans d’autres types de relations. Les conversations dominicales fusaient au milieu des tintements des couverts sur les plats. Habitué des grandes tablées familiales, chacun parlait plus fort que l’autre pour être entendu et les réponses importaient bien moins que la victoire d’avoir pu placer sa question. Prolixe d’habitude, Juliette profitait ce jourlà du spectacle offert à son oreille exercée.
— Tu ne devineras jamais qui j’ai croisé et qui n’a pas arrêté de me parler de toi?
— Rappelle-moi tout à l’heure de te donner le cadeau de naissance que j’ai laissé dans le hall. Je l’ai cousu moi-même.
— Tu vas au mariage d’Hélène samedi?
— Et tu te rends compte que dans son sermon il n’a commenté que la première lecture car il trouvait l’Évangile trop difficile à développer!
— Vous allez à Rutigliano cet été chez les Pierreponti?
— Il faudra en profiter pour aller rendre visite à la cousine Jeanne, elle est si seule là-bas depuis le décès de son mari.
— Tu n’as pas encore été voir la rétrospectiveBrancusi? Le concept est novateur, il n’y a pas une pièce authentique dans toute l’exposition.
— Antoine lui a répondu que si le garde-chasse le voyait il lui plomberait les fesses!
— Tu me prêterais la capeline verte que tu portais aux fiançailles d’Aloïse?
Chaque semaine, une impression de bien-être se répandait dans les veines de Juliette. Sans sa présence, là et à cet instant précis, il manquerait un instrument au grand orchestre du dimanche chez sa grand-mère. Elle lui plaisait tant, cette sensation de pérennité. Tout changeait ailleurs. Sous le vieux toit d’ardoise, les choses semblaient délicieusement immuables.
C’est vrai, le velours violet surles chaises pâlissait un peu plus chaque été, mais c’est avec ce tissu lilas que la mère de son grand-père les avait reçues. Personne n’aurait admis qu’elles soient retendues, malgré les éraillures infligées par des chaussures impatientes et les clous qui s’étaient perdus.
Telle une enfant, Juliette se laissait servir, raclait son assiette puis réclamait une seconde part de la tarte aux prunes de Tante Françoise. La vieille demoiselle rougissait avec la même constance, semaine après semaine, lorsqu’à la fin du déjeuner les compliments pleuvaient sur ses talents culinaires dont elle n’avait jamais fait profiter un homme autre que ses frères et son père.
L’éternelle jeune fille avait empli sa vie de fascination pour Jean sans Terre et d’excitantes commandes par correspondance. Chaque jour, elle recevait des catalogues illustrés qu’elle feuilletait avec ravissement dans son lit aux draps fleuris, les épaules couvertes d’un plaid en patchwork, cadeau promotionnel du mois précédent.
Repue, un peu euphorique après trois verres de vieux vin, Juliette se laissait conduire par ses cousins qui, en procession, quittaient la salle à manger et s’installaient au petit salon pour prendre le café.
Le feu dansait dans la cheminée et, par moments, paraissait prêt à bondir hors du foyer, grimper le long du guéridon nd’acajou qui grinçait sous une pile de gros livres jaunes, s’enrouler autour des rideaux de velours, s’élancer à l’abordage des cadres en bois dorés qui logeaient de vieux personnages à l’air prétentieux ou ennuyé. Oncle Georges fourrageait alors dans les bûches et plaçait la grille devant l’âtre. Les flammes, soumises, ronronnaient.
Juliette était parfaitement heureuse, le dernier-né de sa cousine sur les genoux. Il bavotait doucement. Un cordon ombilical de salive reliait la bouche du bébé à l’avant-bras de la jeune fille.
Profitant qu’elle se soit servie d’un chocolat qui passait, sa mère lançait alors perfidement l’attaque, à la manière d’un prédateur exercé qui devine le moment où sa victime a baissé la garde.
— J’ai lu dans le journal que ton amie Léopoldine était fiancée.
— Léopoldine? Léopoldine van W.? Intervenait sa sœur aînée sans aucune solidarité, ce n’était pas cette fille un peu puérile et assez laide qui était venue passer des vacances ici il y a des années? C’est incroyable qu’elle se soit fiancée! Tu le savais toi?
— Oui, répondait Juliette, la bouche encore pleine, sachant ce qui allait suivre et résignée à subir le calvaire en place publique.
— Et elle épouse Louis de M., ce délicieux garçon. Sa mère détachait chaque syllabe de l’adjectif. Dé-li-ci-eux. Elle faisait rouler ce mot dans sa bouche comme une pâte de fruit délectable. Il ne te courait pas un peu derrière dans le temps?
Juliette ne désirait pas s’étendre sur le fait que Louis l’avait quittée, quelques années plus tôt, après six semaines d’une relation sans passion, de peur que vingt-quatre bouches ne s’étonnent de concert qu’elle n’ait pas su garder un jeune homme charmant, dont on connaît les parents depuis toujours, si bien élevé, avec de bonnes valeurs chrétiennes, qui avait été en pension avec plusieurs de ses cousins, aimait les chiens et épousait malheureusement Léopoldine plutôt qu’elle.
— Je ne m’en souviens plus, disait-elle hypocritement en faisant au bébé rieur la grimace qu’elle destinait à sa mère. Et puis, Léopoldine est devenue très jolie vous savez.
Elle allait rejoindre sa grand-mère qui, de l’autre côté de la pièce, farfouillait dans une armoire à la recherche de «petits biscuits» que lui réclamaient les plus jeunes.
— Tu sais, lançait un de ses neveux avec la naïveté criminelle des enfants, à ton âge, Maman m’avait déjà.
Juliette lui aurait volontiers répondu que sa belle-sœur Anne-Laure avait eu tôt fait de remplir sa vie de marmots et de bonnes œuvres pour combler tous les samedis où son mari préférait être à la chasse plutôt que d’écouter ses potins de paroisse. Elle se retenait pour ne pas peiner Bonne-maman qui, d’une pichenette bien sentie, avait renvoyé l’importun à ses jeux.
— Je suis certaine que Juju nous ramènera bientôt un type parfait! tentait parfois Éléonore, son autre sœur, afin de la sauver.
Mais l’intervention était maladroite et l’hallali lancé. Chacun y allait, en cacophonie, de ses exigences et projections; il faudrait un garçon qui s’y connaisse en forêts, qui adore les jeux de société, surtout les échecs, un catholique convaincu, complétait son père de sa voix sérieuse, et surtout jeune et beau, ajoutait timidement Tante Françoise, les yeux dans le vague.
— Vicomte, c’est le plus joli des titres, soupirait sa jeune cousine Margot, à la réputation non usurpée d’écervelée.
— Titre ou non, peu importe, du moment qu’il soit de notre milieu c’est tout ce que nous te demandons! concluait sa mère, infatigable.
Un bref instant de silence. Chacun imaginait cette nouvelle recrue au sein du groupe.
— Tiens, que pensez-vous du dernier rapport européen sur la dégradation du niveau scolaire en milieu urbain? Interrompait son frère Guillaume, après avoir écouté toute la conversation, la petite cuillère d’argent tournant de plus en plus vite dans la tasse.
Le sujet Juliette était balayé à l’instant et cette dernière savourait son anonymat retrouvé.
Le reste de l’après-midi se passait gaiement. En septembre, le jardin sentait la fin de l’été et les fruits tombés dans l’herbe pour des festins de fourmis. La Grand-tante, Marie-Madeleine, assise sur une chaise de jardin, esquissait en riant des croquis de ses deux cockers occupés à détruire les précieux parterres du Grand-père.
Oncle Georges organisait la chasse qui aurait lieu quelques semaines plus tard. Il allait repérer les angles de tir. Les autres suivaient en joyeuse bande bottée de caoutchouc vert. Un communisme familial les unissait dans une entente parfaite, quatre générations, une même tribu.
Juliette aimait ces promenades en forêt, les gouttes de rosée comme des colliers sur les champignons, les terriers mystérieux, le chant des oiseaux qu’on ne voit jamais, les mûres qui tachent les robes blanches, les nuages entre les arbres, les rayons du soleil qui jouent dans l’herbe, les plantes qui sentent le linge propre, les araignées fragiles…
Les conversations étaient douces, d’âme à âme, entre gens qui s’étaient toujours connus et qui se verraient encore, invariablement, chaque semaine, au travers des saisons. Un peu plus souvent à l’époque des communions et des mariages, vers la fin du printemps. Un peu moins en janvier car les chemins étaient mauvais et le temps froid.
Ils parlaient le même langage, mélange de nostalgie, de souvenirs de grenouilles ramenées en douce dans les poches, de pissenlits que l’on souffle, de fous rires sous la nappe, de livres interdits que l’on lit avant tous les autres. Et la jeune fille anglaise qui était partie après deux semaines car la cuisine était trop mauvaise. Le tracteur qu’Aymeric avait volé au fermier pour aller en boîte de nuit parce qu’il n’avait pas encore de permis de conduire et qui avait fini dans le fossé. La fuite du Grand-père durant l’occupation. Les pleurs avant de partir en pension. Les robes brûlées, les doigts pincés, les mollets mordus, mais aussi les mythes fondateurs. Le cousin qui perdit tout pour une Brésilienne et l’ancêtre qui mourut par fidélité à un roitelet spolié de son royaume aujourd’hui disparu. Et surtout, l’histoire d’amour tragique de l’Oncle Constant qui, mille fois racontée, se pare à chaque récit d’un nouvel éclat et enflamme l’imagination des plus jeunes qui ne l’entendent que pour la cinquième fois.
Le soir tombait, tous prenaient leur voiture pour rentrer. Grand-père allumait les lumières tandis que Tante Françoise dressait déjà la table du petit déjeuner. L’heure était bleue. Bonne-maman, sur le seuil, accomplissait inlassablement son rituel. Elle courait sur le sentier derrière ceux qui partaient, comme si elle allait suivre à pied les voitures, en agitant les bras, envoyant des baisers et des recommandations, soyez prudents, ne roulez pas trop vite, à vendredi prochain, j’ai mis des pommes et des prunes dans le coffre, le sachet en papier c’est pour les pommes à compote, vous êtes sûrs que vous ne voulez pas de noix…
Juliette était seule dans sa voiture. Le siège passager était encombré de fruits, de courriers officiels qu’elle n’ouvrait jamais, de cartons bigarrés de fêtes passées. Elle regardait les arbres qui glissent des deux côtés de la route quand on conduit vite et laissait à nouveau ses pensées gambader comme autant de ballons en grappe.
La solitude s’abattait sur elle tandis qu’elle déroulait le film de la journée. C’était étrange, ce sentiment qui l’emportait parfois, remettant en cause le sens de sa vie, de ses engagements. Comme si son travail lui pesait plus qu’une simple perte de temps. Un fardeau indicible qui la poussait à ne pas rentrer chez elle, à rester le plus longtemps possible, à abandonner surtout cet instrument, amant exigeant qui l’inféodait plusieurs heures chaque jour. Cette vie tiraillée entre l’appartement et les exercices musicaux solitaires, le monde bruissant de l’opéra et des fins de semaine dans le cocon familial lui apparaissait ces soirs-là si éloignée de ses aspirations profondes.
Chaque fin de week-end, la même tentation revenait, lancinante. Se blottir contre sa grand-mère, respirer son parfum, toucher sa peau si fragile, presque transparente, la regarder bouger, se dire qu’elle pourrait casser, entendre la musique de la voix rauque d’ancien fumeur de pipe de son grand-père, rester près d’eux au lieu de rouler vers la capitale et ses odeurs métalliques.
L’absence de sa famille était une douleur qu’elle ressentait même quelques heures avant d’être partie vraiment. Le goûter terminé, quand le soleil se colorait un peu, la tristesse commençait, et déjà elle pensait au départ. Elle était là, mais ses pensées s’envolaient ailleurs. Dès que le dimanche basculait dans l’après-midi, il semblait contaminé par des avant-goûts de lundi, d’horaires, de contraintes. Pour Juliette, le vendredi soir ressemblait au mois d’avril, plein de promesses, le prélude d’une cantate de Monteverdi. La soirée du dimanche était un novembre venteux et triste.
Il faisait noir sur la ville et sa chambre lui paraissait froide et vide. Un jour, elle le sentait, elle le savait, elle aurait une kyrielle d’enfants. Sa maison bruisserait de portes qui claquent à cause des fenêtres ouvertes et chaque éclat dans les murs, chaque griffe dans les pieds de la table aurait une histoire qu’ils se raconteraient parfois le soir, en famille, pelotonnés tous ensemble dans un grand lit.
Elle aurait une étagère pleine d’albums de photos où de petits blonds souriraient, la peau brunie par le soleil de la mer du Nord. Pelles à la main, devant un magasin de fleurs en papier crépon, le menton décoré des empreintes de la glace du goûter, ils lui paraissaient aussi réels que s’ils existaient déjà.
Le silence de ces soirs-là, après tant de bruit, lui semblait insupportable. Alors, elle glissait son violon hors de son étui, l’encastrait au creux de son cou, et la musique l‘enveloppait comme une couverture chaude. Dehors il pleuvait, mais les notes tissaient une aura de joie dans la chambre et Juliette imaginait qu’un jour elle reviendrait accompagnée des dimanches à la campagne.
Elle ne pouvait concevoir alors que, bientôt, sa rencontre avec Marc allait tout changer.
Georges
Oncle Georges est malheureux. Malheureux de vivre encette fin de vingtième siècle, lui qui aurait été tellement plus à saplace au dix-huitième. Cette époque honnie de nivellement parle bas, d’anti-élitisme et de culture télévisuelle le désole. Ilregrette le temps, qu’il n’a pas connu, où des métayers auraientôté leur bonnet sur son passage, dans un geste plein dedéférente soumission.
Pour acquérir un semblant de droit de vie et de mort sur desterres que sa famille n’a jamais possédées, il a choisi une carrièredans la magistrature. Il rend la justice, tranche et décide. Ilescompte ainsi retrouver un brin du pouvoir auquel sa naissancen’a plus attaché de privilège.
Il prône un anti-modernisme féroce et pose un regardempreint de commisération sur le bas peuple qui, pense-t-il,ignore La Bruyère ou la beauté d’un Requiem. Arriéré, préhistorique, rétro, archaïque, vieillot sont des qualificatifs dont ils’affuble lui-même, certain d’être dans le juste chemin, aucontraire des autres, vulgum pecus, égarés à la recherche deplaisirs immédiats et de satisfactions matérielles.
Il secourt, dans des dictionnaires antédiluviens, des motstombés en désuétude et s’acharne à leur donner une secondejeunesse dans ses conversations quotidiennes. Potron-minet,barguigner, quinteux, vespériser lui sont aussi familiers que sonjargon juridique professionnel.
Mais sa véritable quête, inavouable secret de polichinelle,est de se voir conférer un titre de noblesse supérieur au sien,récompense prestigieuse proposée à certains hauts magistratsméritants à la fin de leur carrière. De chevalier à baron. Il se voitdéjà ajoutant à sa couronne nobiliaire deux perles, passant decinq à sept, sous le regard embué de son vieux père.
Oncle Georges fréquente des amis qui partagent sesidées. La plupart d’entre eux ont des noms de rues, de placesou d’arrêts de métro. Il connaît l’histoire de leur famille, celle deleur mère et n’ignore rien des faiblesses de leurs ancêtres. Il selamente avec eux quand leurs enfants se mésallient avec desindividus dont l’arbre généalogique est criblé de blancs demauvais aloi et le patronyme d’origine brumeuse.
Intellectuel distingué, il ne s’abaisse pas aux tâchesmanuelles et se flatte de ne pas connaître son organismebancaire ni la manière dont on change une ampoule. Il préfèrediscourir de longues soirées sur des sujets d’actualité brûlants,tels la qualification exacte de Vatican II: concile frappé del’infaillibilité pontificale ou conciliabule non pastoral? Entre lesdeux, son cœur balance.
Classique avec recherche et démodé par principe, il s’estmis à arborer un couvre-chef lorsqu’il a constaté que personnen’en portait plus. Il arpente ainsi les rues, en loden vert,chapeau sur la tête et parapluie noir sous le bras. Il croise desjeunes filles en pantalon. Il est navré de leur manque deféminité.
Oncle Georges défend son droit à l’obsolétude avecl’énergie du dernier survivant d’une tribu qui se meurt. Sesnombreux enfants, en culottes courtes ou jupes plissées, lesuivent avec enthousiasme dans sa croisade. Quand ils défilentdans les manifestations contre le mariage homosexuel, leurmédaille de baptême fait un éclat jaune dans le cou.
L’oncle idolâtre son passé glorieux et son titre à cinqperles. Une guerre n’est digne de son intérêt que si un trisaïeuly est tombé au champ d’honneur. Sa première pensée le matinest de remercier Dieu de l‘avoir fait naître avec ce nom-là. Ilregarde avec tendresse sa chevalière qui luit dans la lumièresuintant des rideaux cendreux.
Son fils aîné se montre digne de cet héritage qu’on luiconte le soir, tandis que ses copains de classe fixent la télévision. Il maîtrise mieux l’histoire du mayorat d’Ypres auquinzième siècle que les tribulations de Superman. Il arbore un visage suranné d’enfant d’enluminures.
Oncle Georges est un bon mari, un bon père, un bon fils pour ses vieux parents. Il craint Dieu, respecte son pays. Il s’endort le soir le cœur léger, il est un homme bien et il le sait.
CHAPITRE V
Suzeril, Église Saint-Charles, 15mars, 11h 10
Derrière Oncle Georges qui entre dans l’église, l’allure raide, les mains pleines d’une brassée de carnets de messe, se glisse, discret, Gabriel. Son teint est d’une pâleur de cierge. Ses joues rondes sont creusées.
Juliette n’a jamais oublié cette fin de matinée, deux ans plus tôt, où, sous une pluie battante, elle l’avait vu pour la première fois. Elle espérait un bus, le dos collé à la vitrine d’une boutique pour éviter d’être trempée. Un jeune homme, assez petit, cheveux mi-longs, dégaine de teddy-bear, l’avait rejointe sous son abri précaire. Son regard avait croisé celui de Juliette et ils avaient d’abord partagé un instant qui résonnait de notes de pluie.
Il l’avait abordée en lui demandant si elle attendait l’autobus. Le prétexte pour nouer une conversation semblait si évident qu’elle avait ri en lui répondant que, pas du tout, elle débutait une étude sur les mœurs des escargots bruxellois par temps pluvieux. Il s’était approché d’elle, amusé, et s’était présenté, la main tendue, Gabriel, Français expatrié pour quelques mois. Elle lui avait offert un mouchoir car son visage ruisselait d’eau. Elle avait été frappée par son sourire enfantin et l’énergie pataude qui émanait de chacun de ses gestes.





























