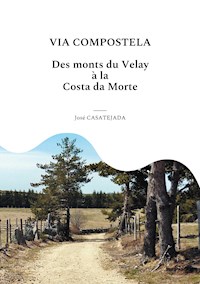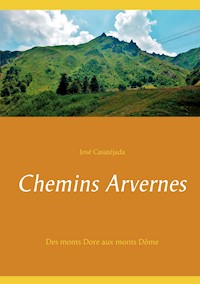Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vacancier dans le Sud-Ouest, Joël Carpentier marche seul dans la forêt girondine. Sexagénaire dynamique épris de nature, il avance serein parmi les pins lorsqu'une oppression s'insinue dans sa poitrine. La sensation insidieuse l'angoisse peu à peu. Joé a peur. De quoi ? Il veut l'ignorer. Il poursuit, termine le parcours. Sans qu'il le sache encore, son destin vient de basculer. De l'Aquitaine au Forez, entre mer et montagne, Joé découvre l'univers clos de l'hôpital. Il subit des examens, des implantations d'endoprothèses, participe à un stage de réadaptation. Devenir celui à qui l'on rend visite, représente pour lui une désespérance enrichissante. Cette autofiction se construit autour des inquiétudes, des doutes, des rencontres, des espoirs, de la lutte d'un homme victime d'accident cardiovasculaire. Elle relate ce que chacun serait en mesure d'éprouver, d'escompter à la suite d'une circonstance aussi brutale et s'attache à démystifier les impacts du choc traumatique perçu. Joël Carpentier trouvera-t-il l'énergie de rapprendre à vivre, de marcher de nouveau vers ses rêves ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
- VIA COMPOSTELA, Des monts du Velay à la Costa da Morte – Books on Demand, mars 2015.
A mes parents,
María et Mariano,
par qui bat mon cœur.
A mon épouse, Sylvie,
pour qui bat mon cœur.
Table
NOTE DE L’AUTEUR
VACANCES GIRONDINES
La forêt de la presqu’île du Cap Ferret
La piste cyclable du Porge
Le sentier du littoral d’Arès
L’HÔPITAL, ACTES PREMIERS
Les urgences
Bordeaux, premier séjour hospitalier
Patrice
Bordeaux, deuxième séjour hospitalier
L’ancien militaire
Bordeaux, troisième séjour hospitalier
ENTRE FOREZ ET AQUITAINE
Rentrer chez nous
Le rendez-vous
Le stage
L’activité physique
Retour à la nature
L’HÔPITAL, ACTES SECONDS
Bis repetita
Saint-Etienne, quatrième séjour hospitalier
Le diagnostic
Saint-Etienne, cinquième séjour hospitalier
LE PRINTEMPS
La confiance
Les bords de Loire
La vie continue
REMERCIEMENTS
NOTE DE L’AUTEUR
Il est des rencontres, éphémères ou durables, qui marquent nos esprits au fer rouge, y laissant des traces indélébiles. D’autres, agréables ou affligeantes, qui ouvrent les tiroirs verrouillés de nos mémoires sélectives, laissant surgir anges ou démons. D’autres encore, importunes, discrètes ou vitales, qui fissurent la gangue compacte de nos certitudes, laissant sourdre l’humilité du plus profond de nous-même.
Pour leurs rencontres inopinées et opportunes, au détour d’un chemin, sur un lit de douleur, dans une salle de cardio training, je témoigne ma gratitude à Christian, Patrick, Bruno, Fatiha, Françoise, Michelle, Franck, Jean-Marc, Lucien, Pasquale. Merci pour le partage de leurs chaleureuses paroles, l’écoute attentive des miennes, leurs silences forts comme des phrases, leur altruisme, leur solidarité, leur humanité. Cet ouvrage leur est dédié.
Pour leur professionnalisme et leur dévouement, dédié aussi de tout cœur à nos médecins généralistes, aux urgentistes, aux spécialistes et personnels soignants des Services d’Urgences et des Unités de Soins Intensifs Cardiologiques des hôpitaux et cliniques, aux personnels des Centres de Réadaptation Cardiaque, aux personnels des Services Ambulanciers, des Services Départementaux d’Incendie et de Secours des Sapeurs-Pompiers, des Services d’Aide Médicale d’Urgence.
Saint-Just – Saint-Rambert le 14 mars 2017
José Casatéjada
On a deux vies,
la seconde commence
le jour où l’on se rend compte
qu’on en a qu’une.
Confucius
VACANCES GIRONDINES
En ce matin du 14 janvier 2015, les rigueurs de l’hiver persistaient. Dans l’immense salle du gymnase, le groupe de séniors, auquel Joël Carpentier, alias Joé, était intégré, acheva les exercices d’étirements par les quadriceps et les muscles jumeaux de la jambe droite. Le coach s’écria : « Ce sera tout pour aujourd’hui, à la semaine prochaine ! » Disciplinés, hommes et femmes se dirigèrent vers leurs vestiaires respectifs.
Emmitouflé jusqu’aux oreilles, Joël poussa la porte et sortit, exposé à la bise glaciale. Le sexagénaire, cadre retraité de l’industrie automobile, se retourna et porta son regard sur le bâtiment omnisports. Il s’arrêta un instant, esquissa un sourire de satisfaction et, alerte, rejoignit son véhicule. Joël s’engouffra dans l’habitacle. Des bourrasques de vent agitèrent la voiture d’un perceptible balancement qui le berça. Assis sur le siège confortable, il allongea ses bras, posa ses mains côte à côte sur le bas du volant et le serra avec force. Son regard, figé sur les cimes défeuillées des arbres, s’abaissa sur le tableau de bord. Ses doigts relâchèrent leur étreinte. Sombrant dans la rêverie, Joël se remémora les mouvements du corps, des bras, des abdominaux, des jambes, des fessiers. Il venait de participer à la première séance de gymnastique douce d’une longue série. Cette gymnastique volontaire s’inscrivait dans la continuité d’un programme commencé il y a huit semaines, qui lui-même succédait à de vives recommandations. Ses pensées l’absorbèrent et l’entrainèrent dans un tourbillon inverse. Un vortex qui le propulsa en 2014, aux derniers mois de ses vacances d’été en Gironde.
La forêt de la presqu’île du Cap Ferret
Des étoiles scintillent encore. A l’est du Bassin d’Arcachon, l’aube teinte le ciel d’une clarté rosée. Le thermomètre affiche neuf degrés, température fraîche pour le lieu et la saison. Cela confirme les prévisions météorologiques de la veille et la promesse d’une journée magnifique. Insertion d’une fine tranche de satisfaction dans cet été pourri.
Sylvaine, mon épouse, me conduit au Cap Ferret d’où je reviendrai à pied. Le trajet s’étire à proximité des dunes océanes. Vingt-cinq kilomètres de terrain plat à parcourir sur pistes cyclables, chemins de grave et routes forestières. Un plaisir savouré sans modération, à maintes reprises. Sylvaine sort l’auto du jardin et la gare devant la maison. Je m’empresse de terminer les préparatifs, de déposer sac à dos, chaussures et bâtons de marche dans le coffre. Le moteur ronronne. Nous partons.
A Claouey, je tourne la tête en direction d’Andernos :
–– Le soleil se lève sur le Bassin, quelle merveille ces couleurs ! Arrête-toi, je vais les photographier.
–– Pas facile avec cette circulation.
Au port ostréicole de Piraillan, Sylvaine stationne le véhicule sur le bas-côté de la route. La vue est magnifique, mais, maintenant, les couleurs ternies estompent les contrastes. Par conséquent, pas de clichés. Nous repartons par la route côtière, traversons les charmants villages endormis du Canon et de La Vigne avant d’aboutir à un croisement. Sylvaine bifurque à droite, longe les rails de la voie du « Petit train du Cap Ferret » et s’arrête au parking, à l’orée de la forêt.
Empressé, j’ouvre le hayon, saisis les chaussures, m’assieds sur le rebord du coffre et les chausse, endosse le coupe-vent, attrape le sac à dos et le charge sur moi. Par des contorsions coordonnées et audacieuses, les bretelles se positionnent sur les épaules. Le sac prend place sur mon dos. J’ajuste la sangle pectorale et la ventrale, les boucle avec des « clac » et des « clic » sonores du plus bel effet. Sur un ton ironique, Sylvaine s’exclame :
–– Quelle maîtrise !
–– Tu as vu ? Trois ou quatre mouvements et hop, tout se met en place !
–– Quand comptes-tu rentrer ?
–– Vers quinze heures. Ne m’attendez pas pour déjeuner.
L’imminence du départ me réjouit. Les bâtons dans une main, la casquette sur la tête, j’embrasse Sylvaine et me dirige vers l’entrée de la piste. Elle monte dans la berline, lance le démarreur. En roulant dessus, les pneus crissent sur le sable du parking. Un dernier regard vers Sylvaine, un dernier sourire, un dernier signe de la main et je m’enfonce dans la pignada.
Une brise légère caresse mon visage, fraîche, parfumée de la senteur balsamique des pins à laquelle se mêle des effluves de chênes. Les chants d’oiseaux, rythmés par le grondement du ressac de l’Atlantique tout proche, animent d’une agréable symphonie la futaie qui m’entoure. Les rayons du soleil traversent les branches des conifères et se projettent en taches claires sur l’étroite bande de bitume sombre. Quel plaisir de marcher dans cette forêt par une journée idyllique ! Mon ardeur est telle que je dois ralentir la cadence de mes pas.
Selon mon habitude, je me reposerai au carrefour de Piraillan et me restaurerai à celui de Mailloulas. En cours de chemin, je devrais croiser Jean-Michel, mon beau-frère, qui roule à vélo. Depuis dix minutes, gaillard, j’avance sur le bord terreux lorsqu’une oppression ponctuelle surgit dans la poitrine. Aussitôt, j’envisage une déchirure intercostale, survenue en chargeant le sac sur mon dos. Je soulève les bretelles afin de diminuer la pression sur mes épaules. L’embarras disparait. Il reparait dès que cesse le soulagement. J’aspire l’air à grandes goulées. Le point subsiste. L’opération d’allègement renouvelée, je respire mieux. De façon concrète, la sensation se manifeste par une difficulté à inspirer. Quelle malchance de m’être blessé. J’aurais dû me contorsionner avec moins de vigueur. Trop de précipitation, trop de hâte. Cela va s’arrêter, cela doit s’arrêter.
Des joggeurs, des vététistes, des cyclistes me croisent ou me dépassent lançant des « Bonjour ! » enthousiastes auxquels répondent les miens, sans enthousiasme. Absorbé par mes réflexions, je marche à une cadence irrégulière. Je tente de les repousser en suivant du regard les traces fraîches des sangliers, en bordure. La nuit, les cochons retournent les aiguilles de pin, les feuilles et, avec leur groin, fouissent le sol à la recherche de nourriture, de vers, de glands. De profonds sillons marquent leurs passages.
La gêne se propage sous le haut du sternum. Je respire mieux et éprouve moins le besoin de soulager la pression sur les épaules. C’est certain, il s’agit d’une petite lésion intercostale. Au fur et à mesure que je progresse, une impression de malaise m’envahit. Une faiblesse diffuse court le long de mes avant-bras, se concentre au creux des coudes. Je baisse les bras et laisse trainer les bâtons sur le sol. Cette action génère une réaction immédiate de mieux-être. Je plie les bras afin d’utiliser les bâtons. De brefs picotements surgissent aux poignets. Tandis que je baisse de nouveau les bras, le mieux-être revient. Je plie de nouveau les bras, les picotements reparaissent.
Devant ces manifestations subites d’inconfort, une question germe dans mon esprit : se pourrait-il qu’il s’agisse d’un infarctus ? De toute évidence, non. A ma connaissance, une crise cardiaque attaque entre six heures et midi, dans le lit et préférentiellement le lundi ou bien à la suite d’un effort violent ou d’un accès de colère. Les individus se tordent de douleur, cloués sur place et dans l’impossibilité de réagir. Rien de comparable pour moi, la souffrance est tolérable.
Aucun risque, un cardiologue me suit depuis le décès de mon père. En février dernier, je l’ai consulté, tout était parfait. Mes réflexions n’empêchent pas l’inquiétude de croître. Sans conviction, je toussote pour conjurer le mal-être, me force à regarder autour de moi afin de chasser toute idée noire. Pas d’amélioration tangible. Comment réagir ? Téléphoner à Sylvaine ? Impossible de capter le réseau, ici, en pleine forêt. Revenir sur mes pas ? Je décide de poursuivre, sans argumentation fondée.
Jusque-là, le terrain plat favorisait la progression. A présent, une modeste pente aboutit à la route départementale. S’il s’agit de ce que je n’ose imaginer, la gravir générera un surcroît d’effort, un essoufflement anormal, voire une douleur. J’atteins le bas de la pente, non sans crainte. Avant de grimper, je m’autorise un « arrêt technique », en vue de me raisonner plus que par besoin naturel. Si je m’essouffle, j’aviserai en conséquence. Au croisement, j’obtiendrai de l’aide auprès des camping-cars qui stationnent à proximité. Afin de ne pas aggraver une éventuelle contusion aux côtes, je déboucle et dépose le sac avec précaution. Sans charge sur le dos, pas de gêne thoracique, respiration régulière. Le sac replacé sur le dos, je boucle les sangles. A mon grand étonnement, aucune perception singulière dans la poitrine.
Bravache, j’entreprends la grimpette. Le bruit sourd des bâtons sur le sol cadence mes pas. J’atteins le sommet sans essoufflement anormal, sans embarras, mais avec ce point diffus sous le sternum. L’absence de tout autre type de manifestation me tranquillise. Par contre, s’il existe une normalité en termes d’essoufflement, saurais-je différencier un essoufflement normal d’un essoufflement anormal ? Rien n’est moins sûr.
Convaincu de m’être blessé en plaçant le sac sur mon dos, je poursuis l’excursion. Sous l’ombre des pins, l’air frais, saturé d’odeurs de résine et d’humus, avive mon visage. L’entrée dans la forêt s’éloigne de moi. De moins en moins de personnes me croisent ou me dépassent. Soudain, un étourdissement furtif parcourt mes tempes. Tout semble s’apaiser lorsqu’une fatigue inhabituelle s’insinue en moi. L’inquiétude m’oppresse davantage.
Sur la piste en direction du Canon, les courses des joggeurs, des vététistes et des cyclistes, retrouvées avec satisfaction, me rassurent. La chaleur commence à piquer. Au sortir de la pineraie, la fatigue s’efface. Suit une parcelle où les forestiers ont procédé à une « coupe à blanc », à l’abattage de la totalité des arbres. Une autre pente accède à un monticule. J’ôte de nouveau le sac à dos avec précaution et prends place sur le banc rivé en bordure. Je respire l’air revigorant à plein poumons, pour me tester davantage que par nécessité. La côte gravie sans gêne ni embarras étrange, l’exploit se doit d’être relativisé. La dénivelée n’atteint que cinq à six mètres ! Pour autant, je ne suis pas au mieux de ma forme. Après dix à quinze minutes de repos, je m’équipe et repars vers le prochain carrefour.
A un détour, un chevreuil détale et s’enfonce dans la forêt. Surprenant, d’en apercevoir à cette heure avancée de la matinée. Alentour, le bourdonnement des insectes croît au fur et à mesure que la température s’élève. Bientôt, je devrais croiser Jean-Michel en provenance de Claouey. Dois-je lui révéler ce qui m’arrive ? Il ne s’agit que d’une compression diffuse, là, dans la poitrine. La route toute proche draine un flot incessant de véhicules vers les plages océanes. La proximité de la civilisation me réconforte. Un groupe à vélo se profile au loin. Lorsqu’il défile devant moi, je ne distingue pas Jean-Michel. Un cycliste arrive seul. Ce n’est pas lui. Par contre, le suivant, coiffé d’une casquette verte… C’est lui. Au fur et à mesure qu’il se rapproche, sa venue me procure un réel soulagement. Il s’arrête. Nous discutons de choses et d’autres, sans aborder le sujet qui me préoccupe. Que lui dirais-je ? « J’ai ressenti une légère douleur à la poitrine. » Et puis, il ne s’agit que d’une petite blessure intercostale, indolore.
Jean-Michel reprend sa course, moi la mienne sur une ancienne voie aménagée en route forestière. Construite par les troupes allemandes durant la seconde guerre mondiale, elle reliait entre eux les blockhaus érigés sur la côte aquitaine. Derrière moi, quelqu’un approche en courant. Une jeune femme me dépasse et me distance, ponctuant inspirations et expirations sur le rythme de ses foulées. Afin de tromper l’appréhension qui me gagne une nouvelle fois, je la suis du regard. Fugace, une insignifiante douleur vient d’apparaître encore sous le sternum. Un pas trop appuyé l’aura déclenchée, puisqu’elle disparait aussitôt. La joggeuse revient dans ma direction. Je lui souris, mais pas de réciproque. Sur ce tronçon dégagé, des ronciers couverts de baies mûrissantes débordent çà et là sur le bitume dégradé. Au bout d’une longue ligne droite le carrefour de Mailloulas apparaît.
Mon sac déposé avec délicatesse sur l’un des bancs, j’y étale barres chocolatées, banane, biscuits aux céréales et bouteille d’eau. Songeur, j’avale une à une les denrées de ce repas frugal et bois en abondance. J’appelle Sylvaine et confirme l’heure de mon arrivée, mais ne l’informe pas de la blessure. Elle jubile, car nous pourrons aller ensemble à la plage.
Je poursuis par le chemin forestier de grave blanche qui longe la voie cyclable. Le sol meuble rend la marche plus agréable que sur le macadam. D’ici au premier réservoir d’eau, j’observe les bordures. Parfois, des lapins de garenne en surgissent et traversent. Ce subterfuge consiste à duper mon imagination, plutôt que de voir détaler un spécimen de léporidé. Je me surprends à épier mon corps, à écouter mon cœur. Alors qu’aucun signe ne se manifeste, l’angoisse m’atteint de nouveau. De manière instinctive, j’allonge mes pas, comme si j’avais hâte de rentrer. De toute évidence, la peur me gagne. La peur de quoi ? Je l’ignore ou plutôt, je veux l’ignorer.
A intervalles réguliers, des panonceaux indiquent le numéro de chaque garde-feu. D’autres, signalent l’identification de la piste sur laquelle j’avance ainsi que la distance parcourue depuis l’entrée dans la forêt. Mon cerveau formule des coordonnées précises avec ces informations. Par téléphone, je les communiquerais aux secours afin d’être localisé, si cela devenait vital. Le « 112 » n’a jamais fait retentir mon portable ; je redoute que cela soit nécessaire.
A l’approche du prochain croisement, le moelleux de la grave laisse place à la rudesse de l’asphalte. Encore deux à trois cents mètres et je me pose sur l’unique banc du lieu. Repos mérité, à la suite de ces kilomètres parcourus à un rythme soutenu. En me désaltérant, je réponds aux saluts approximatifs de cyclistes qui déboulent en trombe et se dirigent vers les dunes du Grand Crohot. Ni frais, ni vraiment dispos malgré les minutes de répit, je reprends la marche pour sept kilomètres.
Aux environs du pare-feu principal, je longe une parcelle dont les pins montrent les chairs d’un récent gemmage. Des fragments de pots à résine gisent au pied des troncs écorchés par les cares. En périphérie de la Dune du Magorn Blanc, je parviens au second réservoir. Identique à celle du précédent, l’énorme cuve cylindrique contient l’eau qui permettrait de lutter un temps contre un incendie. Je m’y arrête pour souffler, bien que je ne sois pas fatigué.
De là au dernier carrefour, le trajet vallonné traverse une zone sylvestre où s’élèvent pins, chênes adultes et petits chênes. Le sol jonché d’aiguilles et de feuilles mortes exhale des odeurs de moisissure. Je marche en balayant du regard les sous-bois alentour, à la recherche d’éventuelles girolles. Les ouï-dire colportent qu’elles seraient sorties avec les pluies de la semaine précédente. Nul petit chapeau orangé en vue. D’immenses « coupes à blanc » éclairent le parcours, avant d’atteindre le croisement.
Un couple et leur bambin s’y reposent, assis sur l’un des bancs. Je les salue et prends place sur l’autre. La jeune femme désaltère le gamin d’un biberon rempli d’eau, dont il aspire goulument la tétine. Je souris à l’enfant. Etonné, il tourne vers moi sa frimousse poupine, sans lâcher pour autant le tétin de caoutchouc. De longues gorgées de liquide tiède m’abreuvent sans étancher ma soif. Je me sens bien, malgré l’insignifiante gêne thoracique qu’occasionne cette malencontreuse contusion. A l’avenir, je porterai une attention particulière à la mise en place du sac sur mon dos.
Je repars sur la voie rectiligne bordée de jeunes pins… qui m’observent ! Ni le soleil, ni la fatigue, ni quoi que ce soit n’embrument mon cerveau. Les arbres ont des yeux, les arbres me regardent ! Les premières branches, tombées ou coupées, marquent les troncs de lésions circulaires. Chapeautées d’anfractuosités courbes, au centre desquelles subsiste un petit trou sombre, semblables à des yeux globuleux surmontés d’épais sourcils, elles confèrent aux troncs un regard curieux.
Je quitte la forêt et continue jusqu’à la maison. Il est plus tôt que prévu lorsque Sylvaine, qui m’a aperçu par la fenêtre de la cuisine, vient à ma rencontre. Elle m’embrasse, puis demande :
–– Veux-tu manger tout de suite ?
–– Non, je me douche d’abord.
Le retour du soleil essaime les estivants sur les routes, les parkings, les pineraies, les plages. Sylvaine et moi arrivons à basse mer. Il y a foule sur ce qui subsiste de cette splendide côte aquitaine qui a souffert des violentes tempêtes de l’hiver. Nous avançons en quête d’un espace suffisant, à défaut d’être confortable. A proximité de la ganivelle qui délimite la dune, nous établissons notre camp de base et point de vue panoramique. Les serviettes étalées, Sylvaine interroge :
–– Tu viens te baigner ?
–– Plus tard, je me repose.
–– Alors, j’y vais seule !
Sa démarche nonchalante l’éloigne vers le rivage. Dans le sable chaud, ses pas chaloupés accentuent son déhanché naturel, la rendent que plus sensuelle. Sous le parasol, je la suis du regard, la contemple. Elle pénètre dans les vagues et se fond avec l’écume des crêtes. Je m’allonge, rêvasse, pense à cette insolite randonnée et m’assoupis bercé par le ressac.
La piste cyclable du Porge
Repos dominical respecté, « Sea, sex and sun »1 – enfin presque ! –, formules idéales pour débuter une semaine qui s’annonce prometteuse. Ce lundi matin, reprise du sport, avec au programme une sortie à V.T.T. Depuis la maison, je projette d’atteindre Le Porge. Un aller et retour de vingt-six kilomètres à effectuer sous un soleil splendide et par une agréable température de saison. La distance peut paraître courte, mais avec de larges pneus à crampons l’adhérence sur le bitume n’épargne ni les cuisses, ni les mollets, même sur un terrain plat. Séance musclée en perspective !
Equipé de pied en cap, j’enfourche ma machine, rejoins Lège, puis la piste cyclable. J’accélère. Le buste courbé sur le guidon, mon regard se porte sur les abords. De nombreux mouchoirs en papier les décorent de façon disgracieuse. Bien que leur biodégradation s’effectue en quelques mois, ces fleurs froissées enlaidissent la nature. Facile de les conserver sur soi et les jeter ensuite dans une poubelle. Je redresse le torse et, sans y prêter attention, tâte ma poitrine, là où les réactions bizarres sont apparues. Aucun trouble, ni douleur. Le repos de fin de semaine a été bénéfique, à tel point que je respire à pleins poumons, sans aucune gêne. Sur la longue ligne droite, je file tel un bolide qu’entrainent de vigoureux coups de pédales !
L’heure matinale, s’avère propice aux rencontres avec la faune sauvage : lapins, chevreuils, canards, faisans, sangliers. En traversant les chemins d’un domaine agricole, je scrute les étendues cultivées : pas le moindre poil, pas la moindre plume ! La promiscuité et l’affluence grandissante de cyclistes, de patineurs à rollers et de vététistes les éloignent du passage. Toutefois, les traces de leurs sabots, sur le sable en bordure, trahissent la présence de chevreuils dans les parages. Au pont de la craste de Goupilleyre, un fossé de drainage des eaux, j’effectue une halte, me désaltère et repars vers Le Porge. Parvenu à l’intersection avec la route départementale, je cesse la course et appelle Sylvaine. Lors de mes escapades sportives en solitaire, elle apprécie que je la rassure. Puis, je reviens en sens inverse, tout aussi serein qu’à l’aller.
En milieu d’après-midi, Sylvaine et moi revenons de la plage. Elle a nagé à plusieurs reprises ; l’eau était bonne, selon ses dires. Moi, je n’avais pas le cœur à me baigner.
Je me douche, lorsqu’une nièce téléphone. Sylvaine répond. Isabelle, en vacances chez son père Jean-Michel, demande de les rejoindre ce soir, au port de Claouey. Huîtres et moules-frites au menu… Sans hésitation, nous sommes d’accord !
Enfants, jeunes, moins jeunes et aïeule se retrouvent près de la cale de mise à l’eau qui s’enfonce dans les eaux bleues du Bassin. Des canots multicolores, ancrés à même le sable, se languissent des pêcheurs et plaisanciers. Au loin, le courant de la marée montante oriente les plates des ostréiculteurs dans le sens du flot. Plus au large, dans l’estey de Madone, les centaines de sphères blanches des corps morts retiennent les bateaux alignés les uns derrière les autres. Les cris sauvages des mouettes se mêlent aux clapotis des vaguelettes étincelantes qui s’échouent et meurent sur la grève au soleil déclinant.
En surplomb du rivage, toute la famille s’installe sous un abri de bois sur les montants duquel grimpent des bougainvilliers aux fleurs rouges. Le personnel de service s’affaire à placer les convives qui affluent. Peu à peu, plateaux de fruits de mer, douzaines d’huîtres, casseroles de moules, bouteilles de vin recouvrent les tables. Autour de nous, résonnent le cliquetis des couverts, l’entrechoquement des verres, le brouhaha des paroles et des rires. Nous terminons le diner devant un spectacle féérique : les couleurs chaudes du crépuscule embrasent le Bassin de mille feux chatoyants.
Sur la placette proche du parking, Sylvaine propose aux enfants :
–– Voulez-vous manger une glace, je vous l’offre ?
–– Ouiiii, s’écrient-ils d’une seule voix, leurs frimousses réjouies !
Elle interroge Isabelle du regard qui, en souriant, acquiesce d’un signe de tête. Jean-Michel et Mamie discutent près des voitures. Sylvaine, Isabelle, les enfants et moi nous asseyons à une table éclairée par des lampes tempête. Tandis que Sylvaine occupe les petits, qui se délectent de boules de glace à la vanille, au chocolat et autres crêpes-dentelle, je me rapproche d’Isabelle. Elle achève des études d’infirmière par une formation dans un service de cardiologie. Nous parlons des cours, des travaux pratiques, de l’examen auquel elle se présentera sous peu. La curiosité l’emporte. Je pose des questions relatives au cœur, aux infarctus, aux A.V.C.2 auxquelles elle répond avec moult précisions. Elle devine mon tracas :
–– Pourquoi toutes ces questions ?
–– Je profite de ta présence afin de m’informer.
–– Pourtant, elles sont bien ciblées !
–– C’est parce que l’autre jour il m’est arrivé une drôle d’affaire, mais il s’agit d’une petite blessure intercostale. D’ailleurs, je n’ai plus mal, même au toucher. Tu vois, dis-je en appuyant sur mes côtes ?
–– Raconte-moi.
Je lui relate tout. Proche de nous, Sylvaine, stupéfaite, écoute le récit d’une oreille attentive :
–– Tu ne m’en as pas parlé, intervient-elle.
–– Je ne voulais pas t’inquiéter.
–– Ne reste pas ainsi. Tu devrais consulter un médecin, suggère Isabelle.
La discussion se termine sur cette fin qui me parait abrupte.
1 « Sea, sex and sun » - Chanson de Serge Gainsbourg – Philips-Phonogram, 1978.
2 Accident Vasculaire Cérébral.
Le sentier du littoral d’Arès
Soirée magnifique, retour silencieux. Les réponses d’Isabelle reviennent une à une. De nouvelles questions germent. A-t-elle raison ? Je ne ressens plus rien, nous verrons. Voir quoi ? Je ne souffre pas. Et ainsi de suite en un débat interminable entre moi et moi-même, jusqu’à ce que la fatigue m’ensommeille.
Ce matin, je décide de marcher. Sylvaine s’est levée et déjeune avec moi :
–– Où vas-tu en randonnée ?
–– Jusqu’à Arès, au port ostréicole, le sentier du littoral, les prés salés, l’étang, le canal et je rentre. Treize kilomètres de nature !
–– Comment te sens-tu ?
–– Bien, bien ! Ne t’inquiète pas, c’était un coup insignifiant aux côtes. Je serai de retour vers midi.
Départ, sac sur le dos – après moult précautions pour l’endosser –, et bâtons aux poignets ! Temps estival, zénith d’un bleu absolu et température clémente. L’absence d’oppression thoracique me rassure après les premiers pas effectués avec appréhension. La sente longe le Canal des Etangs jusqu’à la route départementale. De là, le parcours mène à Lège, aboutit à la partie cyclable et poursuit en direction d’Andernos.
Sur la ligne droite bordée de pins, qui mène à la voie rapide, des bornes kilométriques permettent de contrôler ma vitesse. Je déclenche le chronomètre de ma montre. Quinze minutes, allure parfaite ! Par sécurité, je marche dans l’herbe et le sable des bas-côtés. Sur les pistes girondines, fort prisées en été, circule une multitude de sportifs : joggeurs, randonneurs, patineurs, adeptes de « la petite reine », vététistes, cyclotouristes aux énormes sacoches, véhistes couchés sur leur vélo, estivants rouleurs tractant des remorques chargées qui de bagages, qui d’enfants, qui d’un chien… La prudence s’impose !
Soudain, un chevreuil jaillit de la forêt, s’immobilise, hume l’air et s’enfuit d’un bond puissant. L’action, fugace, se déroule à une rapidité telle que photographier l’animal s’avère impossible. Parvenu au débouché du passage sous la voie rapide, un peloton de six ou sept cyclistes me croise en trombe !