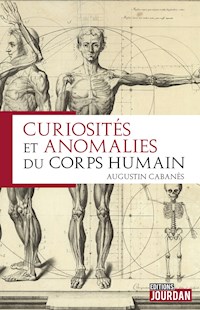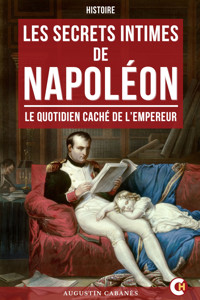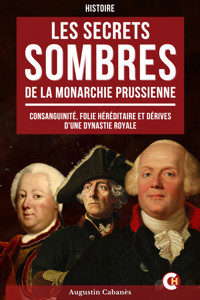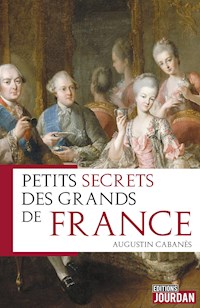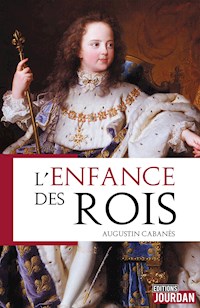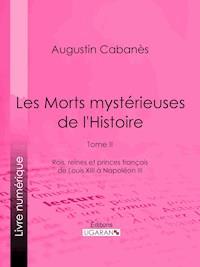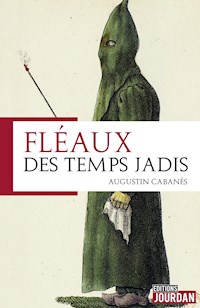
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Replonger dans l'histoire de l'Europe, c'est également se pencher sur l'histoire des maladies, des traitements et des épidémies qui ont sévi sur le vieux continent... La lèpre, le choléra, la grippe... tous ces fléaux ont fait parfois plus de morts que les guerres qui ravageaient l'Europe à la même époque. Mais comment étaient-ils traités? Quelles précautions prenait-on pour éviter la contagion? Que risquaient les malades et quel sort leur était réservé? Augustin Cabanès, spécialiste de la médecine et de l'Histoire, dépeint dans cet ouvrage détonnant les grands fléaux qui ont frappé l'Europe, du Moyen ge au début du XXe siècle, et les différentes croyances qui en ont découlé au fil des époques. De la tenue des médecins qui devaient guérir les malades de la peste aux lois absurdes en vigueur pour éviter la propagation du choléra dans les villes, découvrez un pan sombre de l'Histoire de la médecine! Parcourez l'histoire de l'Europe et du monde en découvrant les nombreuses maladies qui décimèrent la population à plusieurs reprises, les personnages historiques atteints mais aussi les remèdes administrés, bien souvent surprenants. EXTRAIT Encore un trait qui mérite de ne pas être passé sous silence : une paysanne, durant sa maladie, refusa d'être soignée par son mari, de crainte de lui communiquer la contagion. Comme elle jugea qu'après sa mort, il serait obligé de la porter en terre, et qu'en lui rendant ce dernier devoir il pourrait gagner son mal, elle lui demanda une longue corde, qu'elle s'attacha aux pieds lorsqu'elle vit approcher son dernier moment, afin qu'il pût la traîner dans la fosse sans aucun danger pour lui. Quand la mort est partout, on s'habitue à l'envisager de sang-froid. Un homme et sa femme, seuls dans une maison, furent attaqués en même temps de la peste et se regardèrent comme perdus, dans l'impossibilité o ils se trouvaient de recevoir du secours. Hanté par cette idée, le mari se mit à creuser deux fosses. Puis, quand il comprit que c'était la fin de ses maux, il fit ses adieux à sa femme, moins accablée que lui par le mal et se laissa choir dans la fosse qu'il avait creusée, s'offrant de lui-même, pour ainsi dire, à la mort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Éditions Jourdan
Paris
http://www.editionsjourdan.com
Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-375-6 – EAN : 9782390093756
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
DOCTEUR CABANÈS
FLÉAUX DES TEMPS JADIS
LA PESTE
LA PESTE DANS L’IMAGINATION POPULAIRE
Les époques d’abattement moral sont celles de grande mortalité. Michelet, Histoire de France.
De toutes les épidémies qui ont désolé l’humanité, la peste est celle qui, de tout temps, a causé le plus vif effroi ; effroi légitime, si l’on considère, que nous en sommes encore à chercher un remède assuré contre une affection qui, en dépit des perfectionnements de la science curative, est restée presque aussi meurtrière qu’aux époques d’ignorance et de barbarie.
Certes, nous sommes loin de la crédulité de nos pères, qui cherchaient une cause surnaturelle à des fléaux dont nous donnons une explication plus raisonnée, pour ne pas dire moins déraisonnable. Encore ne répondrions-nous point qu’on ne trouverait pas, à l’heure actuelle, et pas toujours aux plus bas échelons de la hiérarchie intellectuelle et sociale, ces étranges aberrations conservées par une sorte d’atavisme et qui semblent n’attendre pour se manifester qu’un milieu favorable de culture.
À maintes reprises, on a signalé ce vertige qui saisit les foules et les pousse à commettre les crimes les plus atroces, alors que chaque individu, pris à part, serait incapable d’une méchante action. Cet état d’esprit si spécial se retrouve dans l’histoire des épidémies de peste. La plupart des phénomènes observés dans ces circonstances se relient les uns aux autres par une psychologie commune.
Les superstitions que semble avoir engendrées une foi naïve dérivent du même état d’esprit qui pousse des infortunés tombés momentanément en démence, à tuer leurs semblables, ou à courir d’eux-mêmes au-devant d’un dénouement que leur résignation avait à l’avance accepté. On ne peut comprendre les ravages que causait autrefois la peste, ravages bien autrement terribles que ceux que nous constatons aujourd’hui, qu’en tenant compte de cette folie particulière qui saisit les cerveaux de personnes jusque-là équilibrées, quand tombe autour d’elles, comme frappé d’une arme invisible, l’objet de leur affection, leur raison principale de vivre.
Au Moyen Âge, comme à la Renaissance, la peste a été secondée, dans son œuvre dévastatrice, par une foule de facteurs néfastes: la misère, la famine, l’oubli des préceptes les plus rudimentaires de l’hygiène ; mais ce qui, par-dessus tout, a contribué à alimenter ce feu dévorant, c’est la terreur folle d’un mal réputé implacable, tour à tour considéré comme une punition du Ciel, ou une émanation de l’enfer. Cette peur, cette phobie de la peste pousse les uns au désespoir et au crime, tandis que d’autres cherchent leur salut dans l’intervention de la Divinité ou des Saints. C’est un sentiment plus noble, bien que la peur n’y soit pas étrangère, qui a dicté les mesures de prophylaxie auxquelles notre siècle de progrès n’a guère ajouté.
Il faudrait remonter haut dans l’histoire pour retrouver l’origine de la terreur qu’inspire la peste. C’est une conception bien ancienne, puisque déjà Galien assimilait la peste à une bête sauvage.
Le même mot reparaît sous la plume d’Ambroise Paré. Le chirurgien de Charles IX caractérisait la peste en termes dont un commentaire affaiblirait l’âpre saveur : peste est une maladie venant de l’ire de Dieu, hâtive, monstrueuse et épouvantable, contagieuse, terrible peste sauvage, farouche et fort cruelle, ennemie mortelle de la vie des hommes et de plusieurs bêtes, plantes et arbres.
Au temps d’Ambroise Paré, les peuples croyaient voir dans le ciel des figures sinistres et des mains armées de glaives, sur les villes à la porte desquelles frappait le fléau. Le bon Ambroise, qui ne manque jamais de partager la crédulité de ses contemporains, s’est empressé de reproduire ces images fantastiques dans son chapitre des Monstres célestes.
La peste est au-dessus des ressources de la médecine, l’art et la science sont inutiles, il faut s’en remettre à la volonté divine, telle est la doctrine à peu près généralement admise autrefois. Mieux encore, elle est professée par la Faculté elle-même.
Au XIVe siècle, la Faculté de médecine de Paris, invitée à faire connaître les causes de l’épidémie, à en indiquer le traitement et à établir un régime pendant la durée de la maladie, disait entre autres choses : nous nous proposons de produire clairement au jour les causes de cette pestilence suivant les règles et principes de l’astrologie et des sciences naturelles... Nous pensons que les astres, aidés des secours de la nature, s’efforcent, par leur céleste puissance, de protéger la race humaine et de la guérir de ses maux et, de concert avec le soleil, de percer, par la force du feu, l’épaisseur des nuages... Si les habitants n’observent pas les prescriptions suivantes, ou d’autres analogues, nous leur annonçons une mort inévitable, si la grâce du Christ ne leur envoie la vie de quelque autre manière.
L’astrologie étant alors une science officielle, on ne discutait pas ses arrêts. La cause principale de la peste, pour les médecins les plus qualifiés, comme Guy de Chauliac, archiatre du pape Clément VI, était une conjonction des trois planètes, Saturne, Jupiter et Mars, qui avait eu lieu le 23 mars 1345, au 14e degré du Verseau ; époque à laquelle la maladie se déclara dans l’Orient.
C’est vers le même temps que d’autres médecins, tels que Jérôme Cardan et Marsile Ficin consultant aussi les astres, faisaient redouter Saturne aux vieillards, vantaient les douces influences de Vénus aux jeunes gens, et les conjonctions de la planète Mars aux belles dames. Cette croyance était si bien acceptée de tous, qu’en 1596, les autorités annoncèrent, rien que d’après l’inspection du ciel, que l’épidémie allait subir une recrudescence. À l’aurore du XVIIe siècle, on vit le Bureau de santé de Sisteron interdire brusquement l’entrée de la ville, parce qu’on était sous l’influence d’un mauvais quartier de lune.
Lors des épidémies de peste, on n’a pas manqué de noter, après coup, les faits extraordinaires qui les avaient précédées. Grégoire de Tours a signalé les grands prodiges qui ont causé l’épouvante en Auvergne, quelque temps avant qu’éclata l’épidémie du VIe siècle: on avait observé des halos, ou couronnes, autour du soleil, des diminutions de l’éclat de cet astre, des comètes ayant un rayon en forme de glaive. Des globes de feu, des météorites, sans oublier les secousses sismiques, les inondations, les éclipses. Le médecin astronome Textor ne reconnaissait la gravité de l’épidémie dans la conjonction pestifère et ruineuse d’aucun astre ou aspect malin des étoiles... Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, autre médecin, prévoyait une épidémie, lorsque la queue d’une comète était tournée vers l’Orient.
L’auteur de Robinson Crusoé, qui a tenu un Journal de l’année de la peste, rapporte que, quelques mois avant qu’elle éclatât, on vit dans lès cieux une étoile brillante, mais il ne voulut y attacher nulle importance, sachant que les astronomes assignent des causes naturelles à de tels phénomènes et même calculent ou prétendent calculer leurs mouvements et révolutions.
En réalité, ces troubles météorologiques, de même que les inondations, sécheresses, effondrements de montagnes, raz de marée, tremblements de terre, ont, pu coïncider avec telle ou telle perturbation de la santé publique, sans qu’on soit autorisé à conclure à une relation de cause à effet. On conçoit l’affolement qui devait saisir des esprits déformés par l’éducation monastique, angoissés par la crainte de l’inconnu, quand se manifestaient ces symptômes d’une puissance d’autant plus redoutable qu’elle était occulte.
C’est dans les moments de lassitude morale autant que physique que ces infortunés se prenaient à invoquer Dieu et tous les Saints du Paradis.
La liste des bienheureux invoqués contre la peste serait longue, si nous voulions l’établir complète. Nous ne citerons que les principaux, nous attachant surtout à mettre en relief des traits de mœurs, plutôt qu’à donner une énumération dont la sécheresse exclurait l’intérêt.
D’après une tradition antique, la peste qui affligeait Rome ayant augmenté pendant le temps pascal, le pape Grégoire ordonna une procession où parurent pour la première fois tous les abbés des monastères de Rome avec leurs moines, et toutes les abbesses avec leurs religieuses. On porta avec respect le portrait de la Vierge, peint par saint Luc. Le cortège se dirigea vers la basilique de Saint-Pierre. La foule se pressait sur le passage de la Sainte Image, suivie du Pontife en prière. Au moment où l’on traversait le pont qui unit la ville au quartier du Vatican, un concert d’anges se fit entendre. Alors on vit apparaître sur le Môle d’Adrien l’ange exterminateur, qui remettait son épée dans le fourreau, et la contagion cessa à l’instant: c’est depuis ce temps que le Môle d’Adrien, surmonté d’une statue colossale de cet ange, a pris le nom de fort Saint-Ange, et telle serait l’origine de l’invocation adressée à saint Grégoire pour la cessation de la peste.
D’après un recueil de législation municipale de Montpellier, au Moyen Âge, en 1384 et 1897, la peste sévissait dans les trois sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire, comme elle avait sévi auparavant à Montpellier. Les consuls votèrent un cierge de cire assez grand pour entourer la ville et les remparts. Il devait être façonné à l’aide des aumônes des braves gens et brûler jour et nuit sur l’autel de Notre-Dame-de-Toulon. Plusieurs autres cités atteintes par la peste firent des vœux semblables. En 1495, la ville de Beaune imagina un moyen d’invocation à saint Sébastien, un des saints les plus fréquemment invoqués dans les épidémies de peste, bien autrement original. Comme les prières, les processions et la ceinture de cire ne faisaient pas cesser le fléau, les échevins décidèrent que, pour obtenir plus sûrement l’intervention du saint, il fallait représenter un mystère, retraçant sa vie et son martyre. Un théâtre fut dressé, la pièce, en vers, fut examinée et corrigée, et trente bourgeois firent serment sur les Évangiles d’accepter les rôles qui leur seraient confiés et de s’habiller à leurs frais. On joua Monsieur Saint-Sébastien à la satisfaction générale.
On sait combien Louis XI était imbu d’idées superstitieuses: la peste s’étant déclarée à Auxerre, aux premiers jours du printemps de ١٤٧٩, on crut devoir en informer ce prince, qui ordonna aux officiers d’engager, par leurs sollicitations, le chapitre de la cathédrale à aller en procession à l’abbaye de Poligny, au tombeau de saint Edme, afin d’y offrir, conjointement avec les jurés et bourgeois, deux cierges, chacun du poids de trente livres. Le roi, par ses lettres datées de Château-Landon, au mois de mai, fit un don de douze livres au même saint.
Louis XI professait une dévotion toute spéciale pour saint Edme, de Poligny. N’ayant pu s’y rendre, selon son habitude, à cause de la peste, il fit don à cette abbaye de vignes sises à Talant, près Dijon, afin que les religieux priassent Dieu, Notre-Dame et saint Edme pour lui, pour le dauphin son fils pour la reine, et même pour la bonne disposition de notre estomac. Que vin ni viande ne nous y puissent nuire, et que nous l’ayons toujours bien disposé. Ce bon Louis XI pratiquait le précepte évangélique: Charité bien ordonnée...
Un des saints qui ont joui de tout temps du plus grand crédit contre la peste est le vénéré saint Roch. À Montluçon, près la porte Saint-Pierre, on lisait jadis cette inscription:
Vous qui craignez la Peste et ses mortels effets, Allez prier saint Roch, vous ne l’aurez jamais.
Longtemps ont existé à Versailles les Chapelains de Saint-Roch. L’origine de cette appellation est assez peu connue pour que nous la rapportions.
Le Grand-Commun, comme toutes les dépendances du château de Versailles, faisait partie de la paroisse de Notre-Dame. Ce qui n’empêchait pas les offices, célébrés tous les jours dans la chapelle de ce bâtiment, d’être très suivis par les principaux personnages de la Cour. Cette chapelle était desservie par les aumôniers de la Maison du Roi, ou les chapelains de Saint-Roch, établis à la Cour par François Ier, voici ce qui donna lieu à leur établissement et à ce nom de chapelains de Saint-Roch.
François Ier était occupé, en 1545, à chasser les Anglais de la ville de Boulogne. Il était campé entre Abbeville et Montreuil, où régnait depuis quelque temps une maladie contagieuse. Le duc d’Orléans, son second fils, à un âge où l’on traite souvent la prudence de poltronnerie, voulant se moquer de ceux qui redoutaient la maladie, alla avec d’autres jeunes gens dans une maison où il était mort depuis peu huit personnes. Ils renversèrent les lits, se couvrirent de la plume qu’ils en tirèrent et parcoururent dans cet équipage plusieurs tentes du camp. Le prince, fort échauffé, but en rentrant un verre d’eau froide et se coucha. Deux heures après, une fièvre chaude s’emparait de lui et alors, saisi d’effroi, il s’écriait : c’est la peste ! J’en mourrai !
Les médecins voulaient empêcher le roi d’entrer dans sa chambre. François Ier, malgré le danger, se refusait à leurs instances. À peine eut-il franchi le seuil de la porte, que le duc d’Orléans, se soulevant sur sa couche, lui dit: ah ! Monseigneur, je me meurs, mais puisque je vous vois, je meurs content ! Un moment après, il expirait. Le roi jeta un cri et s’évanouit. Les officiers de sa maison, épouvantés et redoutant la contagion, prièrent le souverain de nommer des ecclésiastiques, pour leur dire la messe tous les jours, ce qui leur fut accordé : les chapelains de Saint-Roch, au nombre de six, étaient tenus de suivre les officiers de la Maison du roi partout où celui-ci se rendait.
La dévotion à saint Roch avait commencé à s’introduire à la Cour en 1533. Paris était alors ravagé par une maladie épidémique dont plusieurs personnages avaient été victimes. Un chirurgien de François Ier, Guillaume Levasseur, obtint du pape Clément VII la permission de prendre une relique de saint Roch à Arles. Il s’y transporta en vertu d’un ordre du Roi, qui lui défendit en même temps de laisser sortir la relique hors du royaume, et il l’apporta à Paris, où on l’invoquait dans les calamités publiques.
Saint Roch n’avait pas le monopole de la guérison de la peste. Ce privilège lui était vivement disputé, notamment par saint Prudent et Saint-Charles-Borromée.
En 1597, les magistrats châtillonnais édictèrent qu’on se rendrait en pèlerinage à l’abbaye de Bèze, où reposaient les reliques de Saint Prudent. Le voyage dura trois jours pendant lesquels les cloches de l’église Saint-Nicolas ne cessèrent de sonner, même pendant la nuit. Pour répandre la peste, on ne s’y serait pas pris autrement. Ces zélés adorateurs de saint Prudent manquaient terriblement de prudence.
Dans le midi, on préférait avoir recours à Saint-Charles-Borromée, qui s’était distingué pendant la peste de Milan.
La peste exerçait ses ravages à Béziers, en 1630. Les consuls de la ville, ne parvenant pas à endiguer le fléau, eurent tout d’abord la pensée d’implorer Notre-Dame-du-Grau, à Agde. Puis ils décidèrent de former une confrérie en l’honneur de Saint-Charles-Borromée et d’emprunter une somme de quatre cents livres, pour acheter une lampe et deux chandeliers d’argent, destinés à être placés dans la chapelle dédiée au Saint, dans l’église des Frères prêcheurs réformés. Ils firent faire, pour cette chapelle, un tableau commémoratif de leur vœu, aujourd’hui conservé dans l’église Sainte-Madeleine, et pour lequel ils donnèrent cent livres au peintre.
C’est également pour arrêter les progrès de la peste que les magistrats de Compiègne firent vœu de construire une chapelle en l’honneur de saint Roch et de saint Sébastien. Cet édifice fut élevé en 1637, vis-à-vis de Royallieu, entre les chemins de Béthisy et de Champlieu, près de la forêt.
En 1653, il était tombé en ruine et sa démolition fut ordonnée, pour ce qu’en icelle chapelle, qui étoit éloignée près d’un quart de lieue d’icelle ville, il se retirait le plus souvent des personnes inconnues et mal vivantes, qui y commettaient des impiétés. Les gouverneurs, par une délibération du 10 juin 1653, décidèrent de transférer leur vœu dans la chapelle élevée près du couvent des Capucins, en 1637, sous l’invocation de Notre-Dame de Bonsecours, et qui fut alors reconstruite sur les matériaux de la chapelle Saint-Roch et Saint-Sébastien, grâce aux aumônes de la reine Anne d’Autriche et de son fils, à l’aide d’un don de cent livres fait par les gouverneurs. Cette chapelle est encore l’objet d’un pèlerinage suivi, pendant une neuvaine qui a lieu au mois de mars, et qui est l’occasion d’une foire, désignée sous le nom de foire des Capucins.
À Moulins, dans le Bourbonnais, on honorait, pour se préserver de la peste, sainte Rosalie. Le 14 novembre 1630, le corps municipal de la ville ayant appris que, par l’intercession de la sainte, plusieurs provinces de l’Italie, ravagées par la peste, en avaient été délivrées, et que la ville de Thiers, en Auvergne, avait vu le fléau disparaître après les prières publiques à elle adressées, décréta que, puisqu’on possédait à Moulins des parcelles de ses reliques, on ferait en son honneur, pour être préservé du mal, une neuvaine de prières et de processions. On s’engageait aussi à assister, le 14 juillet de chaque année, à une procession autour de la ville.
La foi qui guérit, selon l’expression du professeur Charcot, est aussi la foi qui aveugle. Le penchant au surnaturel est si développé chez les peuples primitifs, ou chez ceux qui le sont restés à travers les âges, qu’on s’explique que, sous le couvert de la religion, l’instinct de conservation ait parfois entraîné les esprits simples tantôt à des superstitions comme le culte des reliques, tantôt à des actes qu’une morale, dégagée de tout esprit confessionnel, ne saurait que réprouver.
Cet instinct de conservation se manifeste, dans les épidémies comme dans les grandes catastrophes, par une recherche effrénée des jouissances, ou revêt la forme du plus monstrueux égoïsme. Il annihile tous les autres sentiments, brise tous les liens, aussi bien ceux de la société que ceux de la famille. Il pousse à l’abandon des êtres qui nous sont chers, et aussi à celui des devoirs sociaux qui incombent à tout individu appartenant à une nation policée: ainsi a-t-on vu, en temps de peste, les citoyens devenir étrangers les uns aux autres, les magistrats communaux donner, les premiers, l’exemple de la désertion. On avait beau frapper d’amendes les déserteurs ou les blâmer publiquement, rarement on parvenait à les ramener sous la menace du châtiment ou de la honte. La panique était si générale, qu’on vit des morts causées par la peur seule de la maladie qu’on appréhendait.
On sait depuis longtemps que les sensations violentes, la peur, comme une joie vive et trop soudaine, peuvent provoquer un ictus mortel. Des spectacles funèbres sont également capables de produire les mêmes effets.
Lors d’une peste qui éclata dans la ville de Lyon, un témoin oculaire rapporte qu’il vit des femmes devenues tout à coup taciturnes, l’air abattu et un chapelet à la main, faire retentir l’air de hurlements affreux. Il y en eut qui, au bruit de la sonnette attachée aux tombereaux, pour avertir les passants de s’éloigner, tombèrent sans vie. On en vit d’une fortune et d’une condition au-dessus du commun, qui, ayant entendu sonner la prière pour demander à Dieu la cessation du fléau, furent saisies d’une telle frayeur, qu’elles tombèrent malades en rentrant chez elle et moururent. Il est dit, dans une autre relation, que des hommes forts comme des taureaux... jouissant de la meilleure santé, sont tombés morts en mettant le pied dans la rue.
La peur a produit d’autres effets, dont la collectivité s’est surtout ressentie. À Marseille, en 1720, par crainte de la contagion, on laissa mourir de faim, dans les îles voisines de la cité, des familles entières, auxquelles on avait coutume d’apporter régulièrement les aliments nécessaires à leur subsistance. Un grand nombre d’habitants de la ville, poussés par la peur, se réfugièrent sur des bateaux démarrés au hasard et voguèrent au large, sans provisions. Bientôt, pris de délire, la plupart se jetèrent à la mer et se noyèrent.
Parfois il a suffi d’une décision énergique, d’un ordre venu de haut, pour voir se dissiper ces appréhensions. Nous rappellerons à cet égard un épisode resté légendaire.
Pendant la guerre de Sept Ans, la peste ravageait et anéantissait l’armée prussienne et l’armée moscovite. Le grand Frédéric n’avait trouvé d’autre moyen, pour remonter le courage de ses soldats, que de faire fusiller ceux qui l’abandonnaient. Le général russe eut recours à un expédient plus décisif: au nom de l’Empereur, proclama-t-il, la peur étant la mère de la peste, il est défendu à ses enfants de l’avoir, sous peine d’être enterrés vifs !
Qu’en résulta-t-il ? La foi des Slaves en la parole du Tsar leur donna le mépris du fléau, qui disparut de leurs rangs.
Soit la peur, soit l’effet de la maladie, on a vu éclater des cas de folie individuelle. Ce qui se rattache davantage à la pathologie de l’histoire, ce sont ces névroses des foules et des armées, ces paniques, subites et inexplicables, que font éclore les calamités publiques, telles que les guerres, les famines, les naufrages, les épidémies.
Dans ces dernières, comme dans toutes les catastrophes, on retrouve les désordres vésaniques qui aboutissent au crime, les penchants au suicide ou à l’homicide, le délire qui s’empare de ceux qu’un obscurcissement passager de la raison transforme en maniaques impulsifs. Il semble que ces troubles mentaux soient plus caractérisés au moment des épidémies.
On raconte, écrit Ambroise Paré, qu’il y a environ quatre-vingts ans, que la peste avait couru de telles rages par la foule lyonnaise, que les femmes principalement, sans apparence d’aucun mal en leur corps, se jetaient dedans leurs puits, surmontées de la fureur de telles maladies... Il y en a d’autres, dit-il ailleurs, qui, par l’ardeur de ceste contagion, se sont jetées dans le feu, les autres dedans les puits, aucunes ès rivières. On en a vu se précipiter par les fenêtres de leurs chambres sur le pavé, se heurter la teste contre les murailles, jusques à en faire sortir la cervelle. Ce que j’ay vu... C’est le même Antoine Paré qui rapporte que, soigné à l’Hôtel-Dieu pour la peste, un prêtre de la paroisse Saint-Eustache, à Paris, fut pris tout à coup de manie homicide: il se leva du lit en furie, avec sa dague frappa plusieurs malades couchés dans leurs lits et en tua trois: et n’eût été qu’il fût découvert par le chirurgien dudit Hôtel, il eût occis autant qu’il en eût trouvé...
D’autres fois, le malade, mû par un fatalisme inexplicable, vole vers la mort comme vers la délivrance.
Une jeune femme, après avoir perdu son mari et deux de ses enfants, se sentant atteinte à son tour, s’ensevelit et se cousit elle-même dans son linceul. Il y eut des moribonds qui, par pudeur, s’enveloppèrent dans un drap, quand ils sentirent leur dernière heure approcher, afin de ne pas être enterrés nus.
Ailleurs, on vit un homme plus que nonagénaire qui, étant à la campagne, et ayant perdu tous les siens, creusa sa fosse, mit sur le bord un peu de paille et se coucha, de manière qu’en expirant, il pût tomber dedans sans exposer personne à prendre son mal, quand on viendrait pour l’enlever de sa maison. Ces sentiments d’altruisme offrent un contraste saisissant avec ceux qui ont été généralement observés. Aussi ont-ils été notés avec soin par les observateurs.
Un historiographe d’une petite localité de l’Oise a rapporté qu’en 1626, une peste, la plus affreuse qu’on ait connue dans le pays, vint enlever la plupart des habitants de Breteuil et des régions voisines. Dès qu’une personne se sentait atteinte du mal contagieux, elle allait, une croix de bois blanc entre les mains, se coucher elle-même dans une des nombreuses fosses creusées à l’avance dans le cimetière du village: les lèvres collées à la croix, les malheureux pestiférés attendaient avec résignation la mort qui ne tardait pas à venir. Ils agissaient de la sorte pour s’assurer une sépulture chrétienne, ne voulant pas exposer leurs parents ou leurs amis à la contagion, en les enterrant. Il y eut des circonstances dans lesquelles les mères durent procéder elles-mêmes à l’inhumation de leurs fils. Où les parents furent enterrés par leurs propres enfants, faute de trouver des mercenaires pour s’en charger.
Encore un trait qui mérite de ne pas être passé sous silence: une paysanne, durant sa maladie, refusa d’être soignée par son mari, de crainte de lui communiquer la contagion. Comme elle jugea qu’après sa mort, il serait obligé de la porter en terre, et qu’en lui rendant ce dernier devoir il pourrait gagner son mal, elle lui demanda une longue corde, qu’elle s’attacha aux pieds lorsqu’elle vit approcher son dernier moment, afin qu’il pût la traîner dans la fosse sans aucun danger pour lui.
Quand la mort est partout, on s’habitue à l’envisager de sang-froid. Un homme et sa femme, seuls dans une maison, furent attaqués en même temps de la peste et se regardèrent comme perdus, dans l’impossibilité où ils se trouvaient de recevoir du secours. Hanté par cette idée, le mari se mit à creuser deux fosses. Puis, quand il comprit que c’était la fin de ses maux, il fit ses adieux à sa femme, moins accablée que lui par le mal et se laissa choir dans la fosse qu’il avait creusée, s’offrant de lui-même, pour ainsi dire, à la mort.
Dans la relation de la peste de Digne, en 1629, ont été relevés des phénomènes plus étranges encore, qui ne peuvent se justifier que par un détraquement cérébral. Ainsi vit-on un malade sortir de son lit et grimper le long des murs de sa maison, et, sur le toit, faire voler les tuiles dans la rue. Un autre, monté au faîte de son logis, par le moyen d’une échelle, y dansa quelque temps, descendit ensuite, courut partout, jusqu’à ce que, s’étant présenté au corps de garde, il y fut tué d’un coup de fusil. Un troisième s’échappa de l’hôpital, vola chez sa femme, qui eut la faiblesse de se prêter à ses désirs, et ils moururent, l’un et l’autre, dans leurs embrassements. Ici, une femme enceinte, à peine délivrée de son fruit, court en chemise dans des endroits escarpés et tombe dans un précipice où elle perd la vie. Ailleurs, c’est un homme qui, s’imaginant dans son délire qu’il pourra voler, prend son essor d’un endroit élevé et succombe dans sa chute.
Un autre, croyant être dans un vaisseau battu de la tempête, jetait ses meubles dans la rue, comme si c’étaient des marchandises dont il fallait se délivrer pour éviter un naufrage. Comment ne pas être pris de pitié pour cet infortuné qui jeta par la fenêtre son fils encore au berceau ?
Le fait qui suit paraîtrait incroyable, s’il n’était attesté par l’écrivain probe et consciencieux auquel nous l’empruntons.
Gassendi assure qu’un homme attaqué de la peste et étant resté sans mouvement, sa femme lui creusa une fosse. N’étant pas assez forte pour l’y porter ou l’y traîner, elle le laissa quatre jours dans son lit, au bout desquels il se réveilla, courut les champs, fit le prophète, et annonça le jugement dernier, en exhortant les mécréants à faire pénitence. Il maudissait ceux qui refusaient de fléchir le genou devant lui, et fit beaucoup d’au très extravagances pendant tout le temps que dura son délire, qui finit avec la maladie, dont il revint.
Ce qui surprendra moins, c’est que beaucoup de malheureux, ne donnant qu’un signe apparent de vie, furent mis en terre. Quelques-uns reprirent leurs sens dans la bière, ou dans le char sur lequel on les portait.
La commotion tira de la léthargie où elle était plongée une jeune fille de vingt ans, lorsqu’on la projeta sur un monceau de morts. Une autre, qui avait glissé dans une fosse ouverte, y resta trois jours sans mouvement. Le quatrième jour, elle fut réveillée par la douleur que lui causa l’éruption d’un bubon, qui fut, en l’espèce, un mal providentiel.
Durant cette même épidémie de Digne, l’on vit des paysans confisquer les provisions que des personnes charitables envoyaient à leurs parents ou à leurs amis de la ville, et les revendre ensuite à des prix exorbitants. Était-ce l’appât du gain qui les poussait, on a du mal à le croire, quand on voit ces brutes à face d’homme délibérer s’ils ne mettent pas le feu à la ville, pour enrayer les progrès du fléau, et parce qu’ils ne voyaient aucun autre moyen d’enterrer les quinze cents morts qui restaient encore dans les rues ou dans les maisons. Ça n’eut pas été trop mal imaginé, s’ils avaient eu la précaution de faire sortir au préalable les malades et les gens valides. Malgré sa barbarie, ce projet allait être mis à exécution, quand on apprit que la peste venait d’éclater dans quatre autres villes. Digne dut à cette seule circonstance d’être préservée. On se contenta de mettre le feu à une maison de campagne, où périt toute la famille du propriétaire, qui s’y était retirée pour éviter la contagion.
En Lorraine, les paysans vivaient en bêtes dans les bois, et souvent ne trouvaient plus que des glands et des racines. La soldatesque leur faisait subir de cruels supplices. « Les pauvres paysans, dit dans ses Mémoires l’abbé Drouin, étaient jetés dans les cachots et, par une insigne malice, pour les forcer à se rançonner, on les fouettait nus, pendant qu’au son du violon on les forçait à sauter et à danser. Tantôt les Hongrois et les Croates leur entouraient la tête avec une corde qu’ils serraient tant qu’ils pouvaient la tordre ; tantôt ils leur serraient les doigts entre le chien d’un pistolet ou d’une arquebuse, et le plus souvent leur liaient les mains derrière le dos, la tête contre les genoux et les cuisses, et les ayant réduits comme en un peloton, à coups de bâton, les faisaient rouler.
On vit, dans ce misérable pays, des femmes manger leurs propres enfants, et se dire l’une à l’autre: tu mangeras aujourd’hui ta part du mien, et demain je mangerai ma part du tien. C’est d’après M. de Bouveau, témoin oculaire de ces faits, que Dom Calmet raconte ces horreurs, parmi lesquelles le fait de ce coadjuteur de l’abbaye de Longueville, qui, étant un jour à Forsvillers, près de son monastère, y trouva la femme de son cocher, qui mangeait la chair de son mari mort de faim !
La folie affecte, on le sait, toutes les formes: après les cas d’anthropophagie que nous venons de relater, voici des cas d’automutilation. Les aliénistes en ont souvent signalé d’analogues.
Il s’en est trouvésaisis de telle appréhension de la mort, étant frappés de cette maladie, que pour se secourir eux-mêmes, ils se sont appliqué des fers ardents sur la bosse, se brûlants tout vifs. Antres l’ont arrachée avec des tenailles, pensant se garantir. Il régnait un affolement tel, que les femmes grosses, seulement soupçonnées de peste, étaient délaissées et abandonnées à leur enfantement. Les enfants dont la nourrice avait succombé à l’épidémie étaient condamnés à une mort certaine, faute de soins.
La peur du fléau engendra chez quelques-uns du délire de la persécution, et comme les persécutés se transforment aisément en persécuteurs, on en vit poursuivre de leur haine démente ceux-là même qui exposaient leur vie pour les sauver.
Lors d’une épidémie de peste qui sévit en Russie au début de ce siècle, de véritables atrocités furent commises contre les médecins.
Déjà au seizième siècle, on lapidait ceux qui se dévouaient à secourir leurs semblables. À Lyon, lorsqu’on apercevait seulement ès rues les médecins, chirurgiens et barbiers élus pour panser les malades, chacun courait après eux à coups de pierres pour les tuer, comme chiens enragez, criant qu’ils ne devaient aller que de nuit.
On n’a pas perdu le souvenir des émeutes qui marquèrent, en 1841, l’épidémie de peste dans la Basse-Égypte. On vit alors des foules furieuses se jeter sur les médecins européens, accourus au secours des malheureuses populations égyptiennes. Ils ne pouvaient se montrer en public qu’accompagnés d’une forte escorte. Des pestiférés, que la maladie n’empêchait pas de sortir de leurs demeures, enlevaient leurs chemises et s’efforçaient d’en envelopper les médecins, en s’écriant : fasse le Ciel que la peste dont je suis atteint se communique à toi et que ces hardes te la donnent, puisque toi, infidèle, tu t’opposes à ce qui est écrit et que tu oses combattre un mal que Dieu nous, envoie !
Le même fanatisme animait, à la fin du siècle dernier, les Nadis, qui, après avoir été très éprouvés par la peste, venaient jeter sur la place de la Calle, par-dessus les remparts, des débris de vêtements qu’avaient portés des pestiférés. Ces forcenés espéraient transmettre par ce moyen la terrible maladie aux chrétiens de cette ville, qui avaient réussi à s’en préserver par de sages mesures d’hygiène. Enfin, il y a quelques années, n’a-t-on pas vu la population d’Oporto insulter, lapider le médecin Ricardo Jorge, qui avait eu le courage de dénoncer l’existence du mal ? Était-ce l’un des médecins de la mission française qui était obligé de demander la protection des autorités contre des misérables fanatisés qui le poursuivaient à coups de pierres ?
Jadis on allait jusqu’à autoriser le lynchage, faute de pouvoir l’empêcher. Était-on soupçonné d’avoir semé la peste, que la foule pendait celui qu’elle jugeait coupable, sans autre forme de procès. Ces exécutions furent relativement fréquentes et l’on dut instituer des tribunaux de santé, qui substituèrent leur autorité à la justice par trop sommaire du peuple.
Dans son ignorance, celui-ci était persuadé qu’on semait la peste, soit en graissant les ferrures des portes avec des substances empoisonnées. Soit en plaçant, dans des lieux fréquentés, des mouchoirs ou autres objets, infectés par le contact du pus des ulcères pesteux.
En 1530 et 1545, on arrêta et on condamna, à Genève, avec la rigueur du temps, des bandes d’engraisseurs. Il résulta des aveux des personnes suspectées, aveux faits en partie avant, en partie après la torture, que lesdits personnages s’étaient liés, par serment, pour répandre la peste par la ville, et partager entre eux le profit qu’ils feraient en soignant et volant leurs victimes.
Après avoir prononcé leur serment, chacun des conjurés s’était partagé les rôles. L’un d’eux s’était chargé de préparer le poison, avec l’aide de sa femme. À cet effet, il prit des emplâtres ayant servi à panser des ulcères pesteux, les fit sécher au feu et les broya dans un mortier de plomb avec un pilon de fer, après y avoir ajouté de la racine d’euphorbe blanche. La poudre obtenue fut enfermée dans des boîtes larges et rondes. Une partie de cette poudre servit à saupoudrer des mouchoirs et des fleurs en soie, que deux autres affiliés s’engageaient à répandre par la ville. Le préparateur du poison, chirurgien à l’hôpital des pestiférés, pour faire l’essai de la substance vénéneuse, en mit dans la bouche de plusieurs des malades auxquels il donnait ses soins, lesquels moururent tous, à l’exception d’une femme.
Quinze ans plus tard, ces horreurs devaient être dépassées. On arrêtait, à Thonon, un nommé Bernard Dallonge et un certain Jehan Lentille, accusés de s’être servis, pour répandre la peste, d’une graisse extraite des corps des pestiférés, mêlée à celle des cadavres tombés du gibet. Ils furent condamnés à être traînés par la ville, puis brûlés. Nombre de leurs complices, après une ou plusieurs séances de torture, firent des aveux semblables à ceux des précédents condamnés. Les accusés affirmèrent que ces pratiques avaient été suivies de cas de peste, dans presque toutes les maisons qui avaient été engraissées.
Lentille et les autres avaient soin de se servir de morceaux de papier enduits de la graisse toxique, pour oindre les portes des maisons et les sièges des boutiques. S’ils touchaient la graisse par accident, ils s’essuyaient aussitôt les mains et se les lavaient avec leur urine. Ils étaient donc convaincus de l’efficacité du poison. Une de leurs complices en fournit, d’ailleurs, la preuve: ayant appris l’arrestation des premiers conjurés et craignant la torture, elle absorba de la graisse empoisonnée, réduite en poudre, et contracta la peste. Dix-neuf femmes et sept hommes subirent le dernier supplice. Une des femmes, qui avait dit être enceinte pour y échapper, n’en fut pas moins mise à mort.
On comprend la rigueur de la répression, quand on constate que c’étaient ceux-là mêmes auxquels on se fiait pour soigner les malades et pour nettoyer les maisons infectées, c’est-à-dire les chirurgiens et les cureurs, qui se rendaient coupables de pareils méfaits. On s’explique la sévérité de la justice contre les misérables qui n’avaient pas craint de faire un pacte criminel pour faire durer le mal et le semer autour d’eux. Conséquence ou coïncidence: en 1545 comme en 1530, la peste cessa brusquement, quelques semaines après qu’on eut mis à mort les empoisonneurs.
On vit les semeurs de peste reparaître dans le Jura, canton d’Orgelet, arrondissement de Lons-le-Saunier, en l’an 1564. Un homme d’Orgelet sema la peste dans vingt-cinq maisons, en frottant subitement d’une graisse qu’il portait dans une boîte, dans laquelle était aussi l’antidote dont il usait tous les matins pour se préserver et garantir du mal qu’il donnait aux autres. Il fut exécuté à Annecy, où il confessa, entre autres choses, ce que l’on vient de lire.
En présence de l’énormité du crime, on s’est demandé si ceux qui en ont été accusés ne l’ont pas été à tort ; si, par suite, on ne se trouvait pas en présence d’une épouvantable erreur judiciaire ? Un fait est indéniable: on a trouvé des boîtes de graisse sur plusieurs accusés. En outre, les précautions prises pour manier les substances auxquelles ils prêtaient des vertus toxiques témoignent qu’ils croyaient à leur efficacité. Il est au surplus démontré que la peste peut se transmettre de cette façon: n’a-t-on pas vu, il y a quelques années, un étudiant de Gratz, arrêté pour avoir menacé une riche veuve de semer des microbes dans sa chambre et sur ses vêtements, si elle ne lui donnait pas une somme d’argent ? Lorsqu’on s’empara de lui, il était porteur de cultures de bacilles de choléra, de la fièvre typhoïde et du tétanos, qu’il avait dérobées au laboratoire de bactériologie. N’a-t-on pas jugé, il n’y a pas longtemps, en Russie, un médecin inculpé d’avoir empoisonné un certain nombre de personnes avec le sérum diphtérique ? Donc la science d’aujourd’hui admet ce mode de contagion.
Quant à nos ancêtres du XVIe siècle, il est évident qu’ils étaient convaincus de la réalité du crime: les juges, comme du reste tous les gens éclairés, partageaient à cet égard la conviction du public. Un des premiers médecins de Genève, à cette époque, parle de la transmission du fléau par ce moyen comme d’un fait incontestable. Il invoque à l’appui les aveux, spontanés ou extorqués, d’un grand nombre de femmes condamnées comme engraisseuses, notamment en 1761, année où parut son Commentaire de la Peste.
Calvin lui-même ne met pas en doute un seul instant qu’un pareil crime ait pu être commis. Enfin, un historien de nos jours déclare qu’il ne lui paraît pas possible de méconnaître l’existence de ces pratiques criminelles, en présence de l’unanimité et de la concordance des témoignages et des réponses des accusés.
En dépit de ces nombreuses autorités, nous nous expliquons difficilement que ceux qui maniaient les prétendus poisons aient pu les manipuler sans courir le risque d’être atteints eux-mêmes. D’autre part, il y a peu d’apparences qu’il ait suffi d’oindre les murs d’une maison, pour que ses habitants fussent aussitôt en danger d’être contaminés. À ce propos, qu’il nous est permis de rappeler une histoire, qui a été déjà racontée dans un de nos magazines littéraires, et dont il nous suffira de donner un substantiel résumé.
En l’an 1630, une peste terrible dévastait Milan. Devant la persistance du fléau, le peuple chercha la source du mal dans la méchanceté des hommes et l’attribua à des onctions contagieuses. Toute souillure qui se remarquait sur les murailles était considérée avec effroi. Tout homme qui, par inadvertance, étendait la main pour toucher un mur, était traîné en prison aux cris d’une populace furieuse, quelquefois même était massacré sur place.