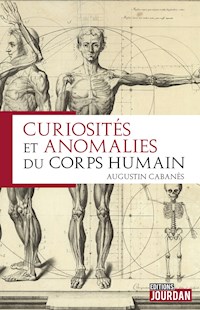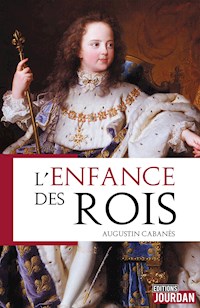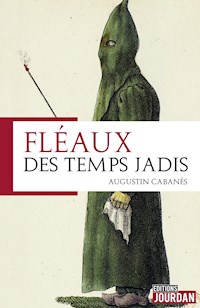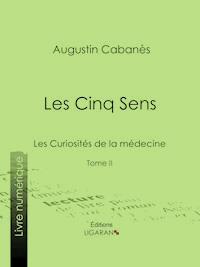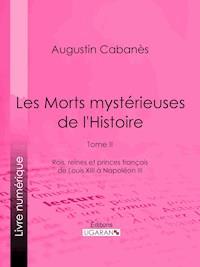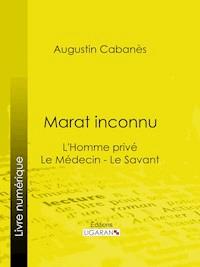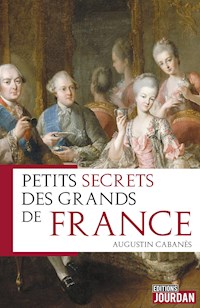
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
En un seul ouvrage sont rassemblés les mystères et les énigmes qui façonnèrent les trônes et les grands noms de France.
Le docteur Cabanès, spécialiste de l'étude de l'Histoire au regard de la médecine, fait le point.
Irrésolus ou non, de nombreux mystères ont tourné autour des grands noms de l'Histoire de France. Secrets longtemps enfouis, énigmes dont seuls les morts ont les clés...
Le Docteur Cabanès, spécialiste de l'Histoire et de la médecine, grand amateur de curiosités, fait le point dans cet ouvrage sur les tabous et les mystères de l'Histoire de France.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Éditions Jourdan
Paris
http://www.editionsjourdan.fr
Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-362-6 – EAN : 9782390093626
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
DOCTEUR CABANÈS
Petits secrets des grands de France
L’ÉNIGME DU MASQUE DE FER
Il n’est pas de mystère plus irritant, d’énigme qui ait davantage piqué la curiosité, sans jamais la lasser. De nombreux érudits se sont occupés de la déchiffrer. L’Histoire n’a pas le droit de se prononcer sur ce qui ne sortira jamais du domaine des conjectures, écrit Henri Martin. Michelet va plus loin, qui déclare sans ambages : L’Homme au masque de fer sera toujours un problème insoluble.
On conte que M. de Laborde, valet et favori du roi Louis XV, ayant demandé au souverain de lui révéler le vrai nom du prisonnier mystérieux, ne reçoit jamais que cette réponse : Je le plains, mais sa détention n’a fait de tort qu’à lui et a prévenu de grands malheurs. Tu ne peux pas le savoir. Quand on le presse par trop, Louis XVconvient qu’il a témoigné, dès son enfance, du même désir dontest possédé son interlocuteur et qu’on lui a toujours dit qu’il nesaura quelque chose qu’à sa majorité.
Le jour de ses 14 ans, les courtisans qui assiègent la porte de sa chambre se pressent autour de lui en l’interrogeant et il leur rétorque, comme il répondra plus tard à son valet : Vous ne pouvez pas le savoir ! Un secret aussi bien gardé, que Napoléon regrette de n’avoir pu pénétrer, dont Louis-Philippe avoue n’avoir jamais été instruit, mais que d’autres monarques donnent à entendre qu’ils n’ignorent point, restera-t-il à jamais irrésolu ? Plus d’un siècle de discussions et de controverses ne doit-il aboutir qu’à un aveu d’impuissance ?
De chaque côté de Cannes, la côte de Provence décrit une légère courbe formant deux golfes : celui de Napoule et celui de Jouan, séparés par la pointe de la Croisette. Devant cette pointe et à 1500 mètres de la plage, s’élèvent, comme des sentinelles avancées, deux terres placées l’une devant l’autre, de grandeur inégale, mais toutes deux d’une forme allongée et entourées de rochers et de récifs, qui en rendent l’approche dangereuse. La vue de ces îlots, désignés sous le nom commun d’îles de Lérins, mais plus généralement connus sous celui d’îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, évoque le souvenir du détenu masqué, qui, d’après une légende indestructible, y aura été enfermé, par ordre de Louis XIV, le 30 avril 1687, selon les uns. Sept années seulement plus tard, pour d’autre qui veulent paraître mieux informés.
La première dépêche officielle relative au prisonnier dont nous recherchons l’identité est de 1678. Depuis deux ans, le gouvernement de Louis XIV a conçu le projet d’acquérir un établissement dans le Montferrat, annexe éloignée de Mantoue et il a jeté les yeux sur Casale, capitale de Montferrat, située sur le Pô, à 15 lieues de Turin, afin de posséder de la sorte une des entrées de l’Italie.
L’occasion était des plus propices pour traiter avec le duc de Mantoue, gueux, grand joueur et dépensier et qu’on pouvait aisément gagner, en lui donnant une bonne somme et une pension considérable, pour entretenir la garnison de la ville et du château. Avec un prince aussi léger d’esprit que d’argent, il deviendra facile de s’entendre. Des arrangements sont, en conséquence, entamés et il est arrêté entre les négociateurs, tant au nom de Louis XIV qu’en celui du duc de Mantoue, que la remise de Casale sera faite aux troupes françaises, le plus secrètement possible, afin de ne pas éveiller les susceptibilités de l’Espagne et surtout de la Cour de Turin.
Malgré cette convention, les jours et les mois s’écoulent sans que les engagements pris par l’envoyé mantouan soient tenus. Se voyant joué, Louvois enjoint à un officier, connu pour son esprit résolu autant que pour sa bravoure, de se rendre secrètement à Pignerol, petite ville située dans le Piémont et acquise par la France de la maison de Savoie. Le commandant, chargé de la garde de ceux enfermés dans le donjon de la citadelle de Pignerol, est seul prévenu de l’arrivée prochaine de l’officier, qui se présentera sous le nom de Richemond et doit passer, aux yeux de tous, pour un prisonnier d’État. Comme détenus de marque, il n’a à ce moment en surveillance que Lauzun et Fouquet. Après qu’il ait acquis la conviction que les promesses de Mantoue ne seront pas tenues et que l’agent du prince a joué double, Louvois donne des instructions pour attirer ce dernier dans un piège et il charge le prétendu Richemond, qui n’est autre que Catinat, du soin de le faire condamner.
Par une lettre du 27 avril 1679, Saint-Mars, le gouverneur de la citadelle, est avisé de l’arrestation prochaine d’un homme de la conduite duquel sa Majesté n’a pas sujet d’être satisfaite. Trois choses lui sont recommandées : le prisonnier ne doit avoir de commerce avec personne. Saint-Mars a ordre de le traiter de façon qu’il ait lieu de se repentir de sa mauvaise conduite. Tout le monde doit ignorer que Pignerol compte un nouvel hôte.
On persuade au traître que Catinat a les mains pleines d’argent et a mission de les ouvrir toutes grandes pour lui. On réussit, par ce subterfuge, à l’attirer dans une église, à un demi-mile de Turin. L’ambassadeur et l’Italien montent dans un carrosse, qui les conduit rapidement vers une petite hôtellerie, où les attend Catinat, hôtellerie située en territoire français. Là, on procède, sans lui laisser le temps de s’expliquer, à l’arrestation du fourbe, qui s’est joué, avec tant de désinvolture, du Roi-Soleil et de ses ministres.
Il y a eu violation manifeste du droit international, atteinte à l’autorité du duc de Mantoue, dont le personnage mis sous les verrous est le sujet : qu’importe à Louis XIV ? Il a vengé son injure, sans se soucier des conséquences que peut entraîner un coup de force, dont les circonstances lui ont fait une impérieuse nécessité. Il est convenu que le nouveau prisonnier sera désigné sous l’appellation de Lestang, personne à Pignerol ne sachant le nom du fripon, pas même les officiers qui ont aidé à l’arrêter.
Il était demandé au gouverneur de le traiter fort honnêtement, pour ce qui regarde la propreté et la nourriture, mais bien soigneusement pour ce qui pouvait lui ôter tout commerce. Ces ordres ne sont que la marque d’une sollicitude qu’en haut lieu on trouva trop empressée. Les recommandations du ministre sont autrement sévères : Il faut, mande Louvois à M. de Saint-Mars, tenir le nommé Lestang dans la dure prison que je vous ai marquée dans mes précédentes, sans souffrir qu’il voie de médecin, que lorsque vous connaîtrez qu’il en aura absolument besoin.
Tout différent est le régime auquel sont soumis les autres, à l’exception des détenus du commun, qui ne sont pas moins rigoureusement traités. Le surintendant Fouquet, qui est à Pignerol depuis quatorze ans et Lauzun depuis huit années ont un valet à leur service. Ils occupaient, au-dessus l’un de l’autre, chacun un étage du donjon. Dans les premiers temps, on les a mis au secret le plus absolu, les privant d’encre, de plumes et de papier. Plus tard, on se relâche de cette rigueur et il leur est accordé de se voir, de manger ensemble, de se promener dans toute la citadelle et de jouer et de converser avec les officiers du gouverneur.
Les autres prisonniers — ils sont quatre, — sont loin de jouir de ces faveurs. Enfermés dans des cachots où ne pénètre ni air ni lumière, en butte aux menaces et aux injures de leurs gardiens, ils sont soumis à une surveillance des plus rigoureuses. Le nouveau venu a à subir le même régime. Moins d’un an après son arrestation, il se plaint qu’on ne le traite pas en homme de sa qualité et ministre d’un grand prince. Il offre, paraît-il, tous les signes d’une aliénation qui n’est pas sans préoccuper ceux qui sont préposés à sa garde. Il parle tous les jours à Dieu et aux anges, s’emporte contre son geôlier, le menace. Aux doléances de M. de Saint-Mars, Louvois répond de traiter ce fripon comme il le mérite, quand il manque de respect et de le mettre à la raison par tous lesmoyens, fût-ce avec un gourdin !
Que devient ultérieurement ce personnage que nous n’avons pas encore désigné et dont le moment est venu de révéler le nom ? Devrons-nous identifier en Mattioli cet Homme ? Ou faut-il pousser ailleurs nos investigations ? La suite aidera peut-être à guider notre lecteur dans ce dédale. Un fait digne de remarque, c’est que, jusqu’à présent, nous ne constatons pas qu’on ait pris à l’égard de ce Mattioli, dont on a voulu faire l’Homme au masque de velours, nous ne voyons pas, disons-nous, qu’on ait cherché à dissimuler l’existence de ce captif.
Un moment, on a eu le projet de le changer de prison, mais tout concorde à prouver que Mattioli a été maintenu à Pignerol. Quand, le 20 janvier 1687, le gouverneur de Pignerol sera nommé aux îles Honorat et Sainte-Marguerite, il n’y a plus à Exilles qu’un seul prisonnier d’État, qui l’accompagnera dans la résidence qui vient de lui être assignée. Ce dernier détenu — qui n’est pas Mattioli, nous le répétons, est arrivé très malade à destination, après un voyage de douze jours, pendant lequel il avait souffert surtout du défaut d’air, ayant été, très incommodément, enfermé dans une chaise de toile cirée.
Quel était ce personnage si bien dérobé à tous les regards et sur qui l’attention publique est dès lors éveillée ? Tant de précautions avaient-elles pour but de couvrir un important secret d’État ? Dès les premiers jours que l’Homme est dans l’île, le gouverneur (M. de Saint-Mars) met lui-même les plats sur la table et ensuite se retire après l’avoir enfermé. Un jour, le prisonnier écrit avec un couteau sur une soucoupe d’argent et la jette par la fenêtre, vers un navire qui est au rivage, presque au pied de la tour. Un marin, à qui le bateau appartient, ramasse l’assiette et la rapporte au gouverneur. Celui-ci, étonné, demande au pêcheur : Avez-vous vu ce qui est écrit sur cette assiette et quelqu’un l’a-t-il aperçue entre vos mains ?
Je ne sais pas lire, répond-il, je viens de la trouver, personne ne l’a découverte. Ce paysan est retenu, jusqu’à ce que le gouverneur soit bien informé qu’il n’a jamais décrypté et que l’assiette n’a été vue de personne. Allez, lui dit-il, vous êtes bien heureux de ne savoir pas lire. Voltaire, qui reproduit ce récit, ajoute que, parmi les personnes qui ont eu connaissance immédiate de ce fait, il y en a une très digne de foi : cette personne, on l’a su depuis, est Riouffe, très probablement celui qui est anobli plus tard, pour sa belle conduite lors de l’entrée en Provence du prince Eugène.
À la suite de la tentative d’évasion, le gouverneur a fait placer une triple grille à la fenêtre du prisonnier, pour empêcher que celui-ci ne renouvelle son entreprise. On prétend, ou, pour mieux dire, Voltaire rapporte que le marquis de Louvois va un jour visiter le détenu et qu’il lui parle debout, avec une considération qui tient du respect. Quoi qu’il en soit, on ne lui refuse rien de ce qu’il demande.
Son goût est pour le linge d’une finesse extraordinaire et pour les dentelles. Il joue de la guitare. On lui fait la plus grande chère et le gouverneur s’assied rarement devant lui. Il est très certain, confirme un mémorialiste, que Mme Le Bret, mère de M. Le Bret, premier président et intendant de Provence, choisit à Paris, à la prière de Mme de Saint-Mars, son intime amie, le linge le plus fin et les plus belles dentelles et les envoie à l’île Sainte-Marguerite, pour le prisonnier. On verra par la suite quelles conséquences on en veut tirer.
Comment a été renseigné Voltaire ? Nous allons le dire, sans plus tarder : par le successeur de M. de Saint-Mars dans le gouvernement de la Bastille et aussi par un vieux médecin de cette forteresse, qui a soigné le prisonnier et n’a jamais vu son visage, quoiqu’il ait souvent examiné sa langue et le reste de son corps.L’auteur du Siècle de Louis XIV n’a-t-il pas suppléé, par l’imagination,aux lacunes de son information ? Il y a forte apparence. Un homme est mieux en situation que lui de lever le voile qui cache le mystère et c’està lui que nous allons demander de nous aider à le pénétrer.
Le Père Griffet, jésuite d’une haute intelligence et doué d’un rare esprit critique pour son époque, procède, l’un des premiers, sinon le premier, avec méthode à l’examen de l’anecdote de l’inconnu au masque.Ce jésuite remplit, pendant neuf ans, l’emploi délicat de confesseur des prisonniers renfermés à la Bastille.Entre autres pièces à conviction que le Père Griffet verse au débat,il en est une qui offre toutes les garanties d’une authenticité non douteuse. Il s’agit d’un texte, rédigé par un M. Dujonca ou Du Junca, qui est lieutenant du roi à la Bastille, lorsqu’y arrive le prisonnier qu’amène avec lui M. de Saint-Mars.
De tout ce qui est dit, ou écrit, sur ce prisonnier au masque, fait très judicieusement observer le Père Griffet, rien ne peut être comparé, pour la certitude, à l’autorité de ce témoignage. C’est une pièce authentique, c’est un homme en place, un spectateur qui rapporte ce qu’il voit, dans un journal tout entier écrit de sa main, où il marque chaque jour ce qui se passe sous ses yeux.
Le médecin, chargé de lui donner des soins, confie plus tard, à quelqu’un qui l’interroge sur le personnage, qu’il est autorisé à approcher : qu’il est admirablement bien fait. Sa peau est brune. Il intéresse par le seul ton de sa voix, ne se plaignant jamais de son état et ne laissant point entrevoir ce qu’il pouvait être. Cet inconnu succombe le lundi 19 novembre 1703. S’étant trouvé un peu mal, ce jour-là, en sortant de la messe, il meurt à dix heures du soir, sans avoir eu une grande maladie. Il est enterré le lendemain à quatre heures de l’après-midi, dans le cimetière Saint-Paul. Sur le registre, on inscrit le nom de Marchioly, âgé de 45 ans ou environ. Le corps a été inhumé en présence de M. Rosarges, major de la Bastille, et de M. Reilhe, chirurgien-major de la même prison.
Ce qui suit est du pur roman ou de l’anecdote plus ou moins légendaire. Le lendemain, une personne ayant engagé le fossoyeur à déterrer le cadavre et à le lui laisser voir, il est trouvé un gros caillou à la place du crâne ! Il n’y a eu que le tronc d’inhumé. La tête a été séparée et partagée en divers morceaux, qu’on a enterrés dans un endroit ignoré. Ordre a été donné de brûler tout ce qui avait été à l’usage de l’inconnu : linge, habits, matelas, couvertures, etc. On regratte et reblanchit les murailles de la chambre où il a logé. On pousse même les précautions jusqu’à en défaire les carreaux. Dans la crainte qu’il n’ait caché quelque billet ou fait quelque marque qui ait pu aider à trouver qui il est. Lors du sac de la prison, en 1789, on ne relève pas la moindre trace de pièces se rapportant à l’Homme masqué. Le feuillet correspondant à l’année 1688, année de son entrée à la Bastille, manque au registre d’écrou et l’on constate que ce feuillet a été coupé !
Nous venons d’exposer le sujet dans ses lignes essentielles. Est-il possible désormais de se faire une opinion sur l’identité du personnage ? D’abord, pourquoi ce velours, qui est le trait caractéristique, distinctif, du prisonnier mystérieux, trait encore plus saisissant que tous les autres… Sans doute, on trouve maintes attestations du libre usage d’un camouflagedans le cours ordinaire de l’existence : le médecin Héroard ne rapporte-t-il pas que Marie de Médicis, allant voir le jeune Louis XIII, l’embrasse par-dessous le masque ?
Les demoiselles d’honneur de la duchesse de Montpensier ne sont-elles pas autorisées, par celle-ci, à se vêtir la tête de velours noir ? La maréchale de Clérambault ne va-t-elle pas dans les chemins et dans les galeries, la figure recouverte du masque ? Enfin, n’avons-nous pas nous-même relaté que Mme de Maintenon se cache le visage lorsque, à sept reprises, elle part chercher à Versailles les enfants qui viennent de naître du commerce de Mme de Montespan avec Louis XIV, pour les ramener à Paris, en grand mystère, dans un fiacre ?
Mais, du moins à notre connaissance, il n’y a pas un autre exemple d’un masque imposé à un prisonnier. Est-ce que le détenu, aussi exceptionnellement traité, est de qualité supérieure, de haute extraction et qu’il y a un intérêt capital à ignorer sa personnalité ? Aura-t-on voulu, par ce moyen, éviter de laisser se trahir, à des yeux indiscrets, une ressemblance révélatrice de son origine ? On parle d’un fils naturel du Grand Roi, comme étant l’homme masqué : on nomme Vermandois, qui aura été puni, par une détention perpétuelle, d’une injure grave faite à un prince du sang : un soufflet donné au dauphin. Supposition toute gratuite, car le comte de Vermandois est mort publiquement, de la petite vérole, dès 1683, à l’armée, et il est enterré dans le chœur de l’église d’Arras.
On ne saura davantage mettre en cause et pour une raison analogue, ni de Beaufort, tué par les Turcs, à la défense de Candie, en 1669. Ni le duc de Monmouth, exécuté en public à Londres, en 1685. Le Masque de fer sera-t-il, comme on le prétend, un fils d’Anne d’Autriche, un frère aîné de Louis XIV ? On sait que la reine a un attrait particulier pour le linge fin, que le prisonnier manifeste, lui aussi : cette similitude de goûts peut-elle être invoquée au même titre qu’une tare héréditaire ?
L’hypothèse est hasardeuse et rien, absolument rien, ne la justifie. Quand on démontrera qu’un fils est né d’Anne, à l’insu de son royal époux, encore faudra-t-il administrer la preuve que ce fils est l’homme au masque de fer. Les égards particuliers dont on l’entoure ? Racontars sans fondement, assertions dépourvues de base. On parle d’une visite de Louvois, à Sainte-Marguerite : or, Louvois, à cette date, s’est cassé la jambe droite et, pour hâter sa guérison, les médecins l’ont envoyé aux eaux de Barèges, d’où il ne bouge pas.
On a vu, d’autre part, ce qu’est le pauvre mobilier réservé au prisonnier, mobilier des plus modestes, sans le moindre luxe, si on le compare surtout à celui d’autres détenus de distinction, tels que Fouquet ou Lauzun. Où enferme-t-on, du reste, l’homme masqué, à son entrée à la Bastille ? Est-ce dans un appartement ? Non, dans la troisième chambre sud de la tour de la Bertaudière, consigne le lieutenant Du Junca sur son registre.
Quant à sa nourriture, elle est des plus ordinaires. Ce n’est pas qu’on est mal alimenté à la Bastille. Notre prisonnier n’est ni moins bien ni mieux traité que ses codétenus. Alors, pourquoi le velours ? La question revient, obsédante. Ce n’est qu’en Italie que se retrouve cet usage de couvrir d’un masque le visage des prisonniers : les personnes arrêtées à Venise, par ordre des inquisiteurs d’État, sont conduites camouflées dans leurs cachots.
Or, Mattioli — voici qu’il reparaît — est Italien. Le velours, le ministre du duc de Mantoue et son compagnon de débauches le portent toujours avec lui : pourquoi lui aura-t-on interdit d’en faire usage ? Si c’est, au contraire, un autre que Mattioli que l’on veuille nous faire accepter comme l’homme au masque, on justifie le port de ce loup de velours d’une différente manière ! N’est-ce pas là, nous dira-t-on, un moyen de tenir le prisonnier anonyme, tout en lui permettant de se promener au grand air, de concilier la sévérité des règlements avec les sentiments d’humanité ?
Explication bien laborieuse pour être acceptée sans réserve. Faudra-t-il donc, en fin d’analyse, accueillir l’hypothèse de l’identification avec Mattioli, sous le prétexte que nous venons de dire et pour la raison aussi que le nom se rapproche, par sa désinence, de Marchioly, qui est celui que portait l’individu inhumé dans le cimetière de Saint-Paul ? Il n’y a là, croyons-nous, qu’une vague, très vague similitude onomastique.
Pour conclure et à ne s’en tenir qu’aux faits certains, aux seules pièces officielles, le mystère reste entier. Dussions-nous être accusé d’avoir irrité la curiosité sans la satisfaire, nous aurons le courage de reconnaître que, pas plus que nos prédécesseurs, nous n’avons découvert le mot décisif de cette obscure et troublante énigme.
En 2019, l’hypothèse de Mattioli est définitivement écartée pour plusieurs raisons. La correspondance entre Louvois et Saint-Mars conservée aux archives du ministère de la Guerre — où Mattioli est d’abord désigné sous le nom de Lestang — montre qu’il n’est pas considéré avec les égards attribués au Masque de fer : L’intention du roi n’est pas que le sieur de Lestang soit bien traité (25 mai 1679). Si Mattioli est servi à Pignerol par son valet, c’est parce que ce dernier, qui a été chargé de récupérer ses papiers, a dû être emprisonné avec lui pour qu’il ne puisse pas révéler le secret de son incarcération.
Après la cession de Casale à la France en 1682, le duc de Mantoue est informé de l’arrestation de Mattioli. Le mystère n’a donc plus de raison d’être maintenu et le prisonnier est d’ailleurs désigné sous son vrai nom dans la correspondance de Louvois et Saint-Mars.
Mattioli n’accompagne pas Saint-Mars à Exilles en 1681, mais il reste à Pignerol jusqu’en avril 1694, date à laquelle il est transféré à Sainte-Marguerite à la suite de la cession de Pignerol à la Savoie. Ceci est attesté par une missive de Saint-Mars à l’abbé d’Estrades du 25 juin 1681 et par plusieurs lettres de Louvois aux successeurs de Saint-Mars à Pignerol.
Mattioli est mort peu après son transfert à Sainte-Marguerite, sans doute le 29 avril 1694. On sait en effet qu’à cette date décède un prisonnier qui est servi par son valet. Or Mattioli est le seul détenu qui, à Sainte-Marguerite, pouvait alors jouir de ce privilège.
POURQUOI VATEL S’EST-IL SUICIDÉ ?
Le 23 avril 1671, Louis XIV, accompagné de son épouse, de Monsieur et de toute la Cour, est reçu chez le prince de Condé. Le roi a entendu donner, par cette visite à l’illustre guerrier, un témoignage manifeste de sa faveur et, pour l’accentuer, il a annoncé son intention de passer trois jours à Chantilly, où l’attend une réception fastueuse. Toutes les dépendances du château et les maisons des villages voisins sont remplies, a écrit Gustave Macon, de dames, de courtisans, d’officiers, de valets revêtus de cent titres divers, tous nourris, hébergés aux frais de M. le Prince, en dehors des soixante tables servies trois fois par jour pour les hôtes du château.
La fête est de tous points réussie. La Gazette de France en laisse une relation où défilent promenades, chasses, concerts, festins, repas, illuminations, feu d’artifice sur l’eau. Leurs Majestés visitent un palais que le duc d’Enghien a fait bâtir dans le petit parc, sous le nom de la Maison de Sylvie. La collation est présentée en ce beau lieu, dans une salle percée des deux côtés en symétrie, de l’un desquels on découvre un parterre rempli de tant de fleurs et de couleurs si différentes qu’il sera difficile de voir une nuance plus agréable. De l’autre, un buffet dressé entre les arbres, qui semblent courber leurs rameaux pour en former une couronne à l’or, l’argent, aux cristaux et aux porcelaines qui le composent. Ce régal est accompagné d’un charmant concert de violons et de hautbois.
La salle à manger où doivent avoir lieu les grands repas a été dressée dans la galerie dite des Batailles. On a organisé vingt-cinq tables, qui sont servies chacune à cinq reprises. Comme elles ne suffisent pas, on en installe dans les communs, dans des pièces qui jusque-là ne sont utiles qu’à mettre des arrosoirs.L’homme qui est chargé de diriger l’équipe des cuisiniers et deveiller au bon ordre du service n’est pas un personnage de mince importance. Mme de Sévigné, dans une de ses Lettres, parle avec une considération marquée du grand Vatel… d’une intelligence distinguée de tous les autres, dont la bonne tête est capable de contenir tous les soins d’un État.
Vatel, qui s’appelle en réalité Wattel, ainsi que l’attestent plusieurs pièces revêtues de sa signature, a une ascendance des plus modestes : son père est maître couvreur, après avoir débuté comme simple manœuvre. Sa famille est, présume-t-on, originaire des Flandres, car le nom de Wattel est flamand ou allemand. François Vatel commence-t-il lui-même par servir les maçons et ne devient-il que plus tard maître cuisinier, puis chef d’office et contrôleur de la bouche, chez Nicolas Fouquet, puis le prince de Condé, ses biographes nous le laissent ignorer et cela importe peu à l’histoire que nous voulons conter. Retenons seulement de leurs recherches que Vatel a gagné la faveur du fameux surintendant, au point d’être très avant dans les secrètes affaires de son seigneur et se mêlait d’autre chose que de la cuisine et de l’office: il s’occupe de tout ce qui regarde la maison de Fouquet, il contrôle tout et communique à Courtois les ordres de leur patron commun. François Vatel est, en un mot, plutôt le factotum de Fouquet, que son maître d’hôtel ou que son chef. Il ne commande pas seulement aux cuisiniers, mais à tout le domestique. Quand Fouquet est arrêté, puis condamné à la prison perpétuelle, Vatel s’est offert à l’accompagner à Pignerol et à partager sa détention, mais sa requête n’est pas agréée. On a trouvé, dans les papiers saisis, des documents compromettants pour le serviteur de Fouquet et qui l’obligent à quitter furtivement Paris pour se retirer en Angleterre, où il réside quelques années.
On ignore à quelle époque Condé se l’attache. On sait seulement qu’il est entré à Chantilly avec le titre de contrôleur de la bouche, entre les années 1667 et 1669. Il est donc depuis deux ans au service du grand Condé, quand survient l’événement qui doit l’immortaliser. Grâce à Mme de Sévigné, qui est, en cette circonstance, une admirable reporteresse, si l’on peut user de ce barbarisme, on connaît les moindres détails de l’incident tragique qui fait l’objet de notre étude. La charmante épistolière, qui est venue à la suite de Louis XIV, ne peut être que bien renseignée et son récit est un des plus complets que l’on connaisse et sans doute aussi un des plus véridiques.
Elle conte d’abord qu’on soupe… Il y a plusieurs tables où le rôti manque, à cause de plusieurs dîneurs à qui on ne s’est pas attendu. Vatel s’en montre fort préoccupé et son inquiétude se manifeste: Je suis perdu d’honneur, dit-il à un des familiers du prince. Voici un affront que je ne supporterai pas. Et comme son interlocuteur essayait de le remonter : La tête me tourne, lui répliqua-t-il. Il y a douze nuits que je n’ai dormi, aidez-moi à donner des ordres. Celui à qui il s’adresse le réconforte de son mieux et Condé lui-même s’en vient trouver Vatel dans sa chambre : Mais non, Vatel, lui dit le prince avec bienveillance, rien n’est si beau que le souper du Roi. — Monseigneur, repartit Vatel, votre bonté m’achève. Je sais que le rôti a manqué à deux tables. — Point du tout. Ne vous fâchez pas, tout va bien.
La nuit se passe, au matin, les pourvoyeurs apportent des quantités de viandes. Par contre, la marée est en retard ! À peine en est-il arrivé deux charges, alors qu’on en attend vingt-cinq. Vatel se désole et on l’entend murmurer : Les coquins ne viendront donc pas ! Ah ! Monsieur, dit-il à Gourville, qui s’efforce à lui donner espoir, ah ! Cette fois, je ne survivrai pas à cet affront-là ! Laissons Mme de Sévigné narrer la suite, vous ne vous plaindrez pas, j’imagine, de la substitution.
Voici ce que j’apprends en entrant ici (à Chantilly, vendredi soir 24 avril 1671), dont je nepuisme remettre et qui fait que je ne sais plus ce que je vous mande. Voyant que ce matin, à huit heures, la marée n’est pas encore arrivée, Vatel ne peut soutenir l’affront dont il a croit qu’il va être accablé et, en un mot, il se poignarde. Vous pouvez imaginer l’horrible désordre qu’un si tragique accident cause dans cette fête. Songez que la marée est peut-être arrivée comme il expire. Je n’en sais point davantage présentement. Je pense que vous trouverez que c’est assez. Je ne doute que la confusion ait été grande : c’est une chose fâcheuse à une fête de cinquante mille écus.
Mme de Sévigné ne s’en tient pas là. Elle ne se borne pas à mentionner un fait-divers impressionnant, elle veut fournir à sa fille tous les détails que sa curiosité attend : elle s’informe à toutes les sources où elle peut puiser, afin de renseigner Mme de Grignan. Information prise, Vatel ne s’est pas servi d’un poignard. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur (sic), mais ce n’est qu’au troisième coup, car il s’en donne deux qui ne sont point mortels. Il tombe raide. La marée, cependant, arrive de tous les côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte, on le trouve noyé dans son sang. On court prévenir M. le Prince, qui est au désespoir et qui pleure. C’est sur Vatel que tourne tout son voyage en Bourgogne. Il explique à Louis XIV fort tristement : On dit que c’était à force d’avoir de l’honneur à sa manière. On loue et on blâme son courage. Le roi raconte qu’il y a cinq ans qu’il retarde de venir à Chantilly parce qu’il comprend l’excès de cet embarras. Il argumente qu’il ne doit avoir que deux tables et ne point se charger de tout. Il jure qu’il ne souffrira plus que M. le Prince en use ainsi. C’est trop tard pour Vatel.
Le pauvre Vatel est bien vite oublié ! Le contrôleur en second Gourville s’essuie les yeux et ne perd pas la tête pour si peu. Il attrape, si l’on peut parler de la sorte, la queue de la poêle et commande désormais en maître. Les tables sont abondamment servies et la fête reprend son cours, qui n’a d’ailleurs été qu’un instant interrompu. On dîne très bien, écrit Mme de Sévigné. On se promène, on joue, on est à la chasse. Tout est parfumé de jonquilles, tout est enchanté. On a parlé de Vatel à toutes les tables, même à celle du Roi, mais sans trop insister, car Louis XIV ne se plaît point à de pareils propos, et l’on mange comme si un grand deuil n’est pas inopinément tombé sur la cuisine.
Gourville, qui a été un des premiers prévenus, dans la Canardière, où il dort sur la paille, de ce qui vient d’arriver, n’est pas long à prendre une détermination. Comprenant qu’il n’est pas convenable qu’un cadavre reste dans le château, où tout doit être joie et fête, il donne des ordres pour qu’on le mette sur une charrette et qu’on le mène dans un village, à une demi-lieue de là, pour le faire enterrer. La paroisse sur le territoire de laquelle est le château de Chantilly est Saint-Léonard. De ce qu’on trouve sur les registres de cette paroisse aucune trace de ce décès, on en conclut un peu hâtivement que Vattel est déposé probablement dans une fosse non bénite, au pied de quelque arbre, le long de la grand-route. Depuis on a découvert l’acte mortuaire de Vatel dans les archives de la mairie de Vineuil-Saint-Firmin et c’est là que devrait se trouver la sépulture du fameux maître d’hôtel. Quand la paroisse de Saint-Firmin est annexée au village de Vineuil, avec lequel elle ne forme plus qu’une commune, le vieux cimetière qui entoure l’église est supprimé et les restes des personnes inhumées, réunies dans un même tombeau au milieu du nouveau.
C’est donc là, s’il faut en croire notre confrère Jean-Bernard, à qui nous devons ces particularités, que repose aujourd’hui Vatel, à 150 mètres de la Croix-de-Courteuil, où, quatre-vingt-douze années plus tard, on doit trouver, par une nuit neigeuse de novembre, le corps de l’abbé Prévost, l’auteur de Manon Lescaut, aumônier du château de Chantilly, dont Vatel a été le grand-officier de bouche.
Nous avons fait connaître la version la plus généralement adoptée du suicide de Vatel. Il en est au moins deux autres qui jouissent d’une certaine créance et que nous devons, en tout cas, énoncer. À entendre des chroniqueurs se prétendant renseignés, Vatel est éperdument amoureux d’une dame de la Cour. Il lui a déclaré sa flamme le jour même de la fête et la douleur de se voir repoussé aura armé son bras. On fait ressortir l’invraisemblance d’une pareille hypothèse : D’abord, Vatel n’était plus un jeune premier en 1671. Ensuite, comment l’homme qui a la responsabilité de la plus importante moitié de la fête donnée, — car, qu’étaient le feu d’artifice, les surprises et le spectacle, comparés au repas de Sa Majesté et de six mille invités ? — comment cet homme aura-t-il choisi justement Ie jour de la venue de la Cour à Chantilly pour déclarer sa passion à une dame, certainement trop occupée de toilettes et de présentations pour avoir le temps de donner audience à un soupirant ? Enfin, comment admettre que Mme de Sévigné, qui ne manque pas de s’informer de toutes les circonstances antérieures à la fin tragique de l’homme qu’elle connaît, si en effet une aventure d’amour, une prétention ridicule, une intempestive entreprise de galanterie a armé le bras de Vatel, n’en aura-t-elle pas dit quelque chose, ou directement ou par allusions ?
Considérations fort judicieuses et auxquelles nous ne pouvons que souscrire. On parle, d’autre part, d’une scène qui aura éclaté entre le prince de Condé et son maître d’hôtel à la suite de laquelle celui-ci aura pris la fatale détermination que l’on sait. Voici le billet, extrait de la correspondance de Bussy-Rabutin, qui présente sous cet angle nouveau les mobiles qui auraient entraîné le suicide de Vatel :
Paris, 26 avril 1671.
Je n’ai rien à vous mander que le départ de Son Altesse. Le 23 de ce mois, Sa Majesté va coucher à Chantilly, où M. le Prince l’attend avec les plus importants préparatifs du monde. Cependant la marée n’est point arrivée dans le temps que l’on demande à manger, on se met en grande colère contre Vatel, son maître d’hôtel, qui de regret s’en va poignarder, et, pour ce sujet, le Roi y reste un jour de moins qu’il n’aurait fait.
Mlle de Montpensier ne fait pas un récit sensiblement différent. Nous séjournons, écrit-elle, à Chantilly, où il arrive un tragique accident. Un maître d’hôtel, qui a paru et qui est en réputation d’être très sage, se tue parce que M. le Prince s’est fâché d’un service qui n’est pas arrivé à temps pour le souper du Roi.
On sait que le grand Condé est sujet à de terribles emportements et, si on ne possède, par ailleurs, les récits plus circonstanciés de Mme de Sévigné et surtout de Gourville, on pourra ajouter foi à celui de Bussy-Rabutin, fortifié par celui de Mme de Montpensier. Pour une fois, la légende nous paraît se rapprocher de la réalité. Si elle n’est pas la vérité même. Continuons donc à voir, en Vatel, une victime du devoir professionnel, un martyr du point d’honneur.
LE COUP DE CANIF DE DAMIENS
Imagine-t-on la sensation de stupeur que doit produire, à Versailles et à Paris, la rumeur qui se propage de bouche en bouche par une nuit de janvier de l’année 1757 ? Deux provinciaux sortent de la Comédie-Française, où on a représenté l’Impromptu de Campagne. Entendant plus de bruit que de coutume dans la rue, à cette heure généralement silencieuse, ils voient bientôt